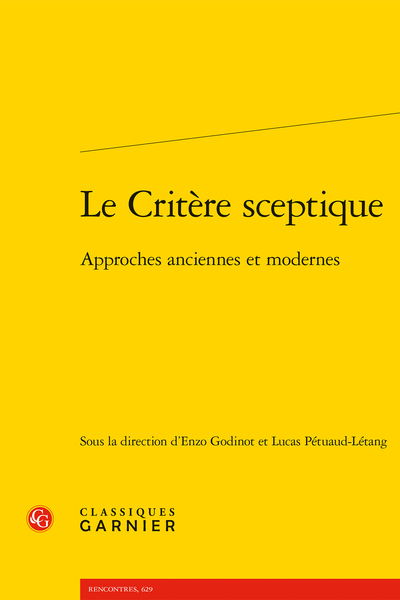
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Le Critère sceptique. Approches anciennes et modernes
- Pages : 191 à 193
- Collection : Rencontres, n° 629
- Série : Études de philosophie, n° 16
- Thème CLIL : 3916 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Histoire de la philosophie
- EAN : 9782406170426
- ISBN : 978-2-406-17042-6
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-17042-6.p.0191
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/06/2024
- Langue : Français
Résumés
Lucas Pétuaud-Létang et Enzo Godinot, « Introduction »
Une analyse lexicale et historique de la notion de critère permet d’exposer ses enjeux dans les usages sceptiques au cours de l’Antiquité et dans la modernité, que les études réunies dans le volume s’attachent à analyser plus précisément.
Dimitri Cunty, « Timon et le critère d’action »
Quel fut le critère d’action au sein du pyrrhonisme primitif, en particulier chez Timon ? Les premiers pyrrhoniens se sont très vite retrouvés confrontés à l’objection de l’apraxie et que la défense de la possibilité de réaliser une action prudente s’est imposée lors de la première constitution d’une philosophie pyrrhonienne chez Timon. Une série de fragments étaye l’idée que l’apparence est le critère d’action et que le pyrrhonien peut vivre avec prudence sans renoncer à son pessimisme gnoséologique.
Enzo Godinot, « Le critère pratique chez Carnéade. Un témoignage de Sextus Empiricus »
Quelle description du critère pratique de Carnéade est proposée par Sextus Empiricus dans le premier livre du Contre les logiciens ? L’analyse de la distinction des différentes représentations « persuasives » et les circonstances de leur emploi, permet de comprendre que le « persuasif » carnéadien est non seulement un critère qui rend possible une action adaptée à la gravité des circonstances, mais aussi et surtout un critère qui n’admet aucune dimension épistémique.
192Stéphane Marchand, « Sextus Empiricus et l’apparence. De quoi les phénomènes sont-ils critère ? »
Cet article interroge la nature, le sens et la fonction du « critère sceptique » en partant du constat que l’apparence (to phainomenon) ne constitue pas une règle de choix a posteriori permettant une quelconque délibération. Le critère sceptique exprime seulement l’impossibilité de définir une règle universelle d’action. Cet usage du critère aboutit à l’expression d’un scepticisme sur la légitimité de la philosophie à éclairer les décisions éthiques ; il doit être distingué du critère plausible des académiciens.
Sylvia Giocanti, « Le critère à l’essai. De la pierre de touche à l’instrument de plomb et de cire »
Quelle différence entre les sceptiques anciens et modernes dans leur critique du critère du jugement ? Montaigne, prenant acte de l’impossibilité qu’une représentation, constitue à partir de cette position néo-académicienne une pierre de touche et met en œuvre un usage spécifique de la raison conçue comme un instrument de plomb et de cire. Le critère sceptique du jugement repose alors sur la capacité d’ajuster incessamment notre rapport au réel, investi d’une manière artificialiste.
Jean-Michel Gros, « Bayle et le bon usage du scepticisme »
Le renouveau du scepticisme aux xvie et xviie siècles, inscrit dans les conflits religieux contemporains, prône une exigence « fidéiste » de soumission de la raison vis-à-vis de la foi. Certaines déclarations de Bayle, en particulier de son Dictionnaire, semblent aller dans ce sens mais elles entrent en contradiction, dans d’autres de ses œuvres, avec une revendication de rationalisme radical. Un « choix de lecture » préalable s’impose pour décider du rapport de Bayle avec le scepticisme.
Michel Malherbe, « Le critère de l’expérience dans la méthode expérimentale »
Le xviiie siècle voit le triomphe de la méthode expérimentale, méthode critique prenant l’expérience comme critère de vérité des propositions. Il faut pour cela user de la méthode analytique et soumettre les mots mêmes au principe de l’expérience. Ce que fait Locke, butant sur la question du simple. La 193théorie humienne de l’impression, vrai critère de la vérité, résout ce problème, au prix de la question de la relation dont la méthode expérimentale ne peut rendre raison. Le sceptique triomphe.
Lucas Pétuaud-Létang, « Schulze critique de Kant. Le critère de l’impensable »
Schulze a grandement participé aux débats qui ont suivi la publication de la Critique de la raison pure, notamment en reprochant à Kant d’employer indûment un critère dogmatique à des moments-clés de son œuvre, pour prouver la réalité des jugements synthétiques nécessaires. Cet article examine dans un premier temps l’attaque de Schulze, puis montre qu’elle met en jeu des critères sceptiques dont le statut demeure problématique.
Dietmar H. Heidemann, « Le problème du critère sceptique dans la Phénoménologie de l’esprit de Hegel »
Fin connaisseur de l’histoire du scepticisme, Hegel considère que le pyrrhonisme ancien représente le scepticisme le plus radical et le plus systématique. En quoi l’idée fondamentale de la conception hégélienne du « scepticisme en train de s’accomplir » est-elle une forme de confrontation au problème du critère sceptique ? Comment Hegel combine-t-il le « scepticisme en train de s’accomplir » avec la théorie de l’histoire de la conscience de soi, afin de résoudre le problème du critère sceptique ?