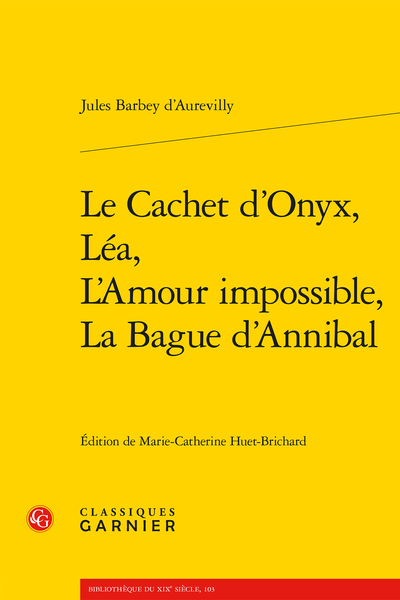
Notice
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Cachet d’Onyx, Léa, L’Amour impossible, La Bague d’Annibal
- Pages : 263 à 269
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 103
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782406137740
- ISBN : 978-2-406-13774-0
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13774-0.p.0263
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/04/2023
- Langue : Français
NOTICE
Éditions parues du vivant de Barbey :
Le Globe, 12, 13, 14, 15 octobre 1842.
La Bague d ’ Annibal, Paris, Duprey, Caen (imprimerie de F. Poisson), 1843, 127 p. Édition due à Trebutien, 150 exemplaires (15 sur papier couleur).
Le Gaulois 27 et 28 février 1881 (le 27 dans le Supplément littéraire).
L ’ Amour impossible, La Bague d’Annibal, Paris, A. Lemerre, Petite bibliothèque littéraire, 1884, 330 p.
Le texte de La Bague d’Annibal est reproduit d’après l’édition Lemerre de 1884, dernière édition à avoir été revue par Barbey et qui reprend l’édition de 1843.
Articles contemporains de la première édition :
Satan, 2 novembre 1843 (article anonyme et sans titre).
« La Bague d’Annibal », L’Écho français, 18 novembre 1843 (signé F. L.)
« La Bague d’Annibal », La France, 25 novembre 1843 (signé X. de B.)
« La bague d’Annibal par J.-A Barbey d’Aurevilly », Le Moniteur universel, 7 avril 1844 (signé A. Grün).
« La Bague d’Annibal, par M. J.-A. Barbey d’Aurevilly », Revue de Rouen et de Normandie, mai 1844 (signé A. S)
Barbey écrit La Bague d’Annibal en une nuit – dit-il – de décembre 1834. Il demande alors à Trebutien de lui trouver un « libraire » : « Je vous la remettrai sans aucun changement que le nom de l’héroïne et allongée de quelques strophes1. » Mais les deux amis rompent toute relation en avril 1837, rupture dont on ne connaît pas la cause et qui dure jusqu’en 1841.
En 1842, Barbey entre au Globe. Il livre dans ce journal des articles politiques non signés et y publie en feuilleton La Bague d’Annibal les 12, 26413, 14 et 15 octobre de cette même année. Une note de l’auteur accompagne le titre du texte : « Il y a quelques années, les premières strophes de cette nouvelle parurent, mais la publication ne fut pas continuée par la raison qui fait tourner un portrait par trop ressemblant contre le mur. Aujourd’hui que le temps a influé ou sur le portrait ou sur le modèle et peut-être sur tous les deux, les raisons qui firent interrompre la publication de ce conte ne subsistent plus, et nous le publions avec de nombreux changemens et comme il doit rester, s’il reste. » Il n’existe nulle trace de la publication interrompue à laquelle Barbey fait ici allusion.
Le 23 mars 1843, Barbey réagit à la proposition que lui fait Trebutien d’éditer son texte : « C’est une des choses qui me flattent le plus et qui devaient le plus me flatter que votre proposition, et je veux vous en témoigner ma reconnaissance en vous dédiant ladite Bague2. » Il envoie à son ami la dédicace en avril et l’épigraphe le 2 juin. Il promet et se promet d’ajouter quelques strophes, mais il ne veut le faire que sur épreuves.
Le texte paru dans LeGlobe et qui contient de nombreuses fautes d’impression est alors revu par Trebutien et relu ou contrôlé par Antoine Charma (1801-1869), ami de Trebutien et professeur de Philosophie à l’université de Caen.
Le 15 août 1843, Barbey corrige une partie des épreuves.
Le 16, il ajoute une strophe (LVI) et écrit vouloir réserver un exemplaire à George Sand à la beauté de laquelle, dit-il, il n’est pas insensible. Il se déclare satisfait du format et du caractère.
Le 12 septembre, il relit les épreuves corrigées par Trebutien : « Revoyez encore la ponctuation, je vous prie. Ceci est un scrupule de conscience, un scrupule de dévot3. »
Le 21, il corrige la dernière épreuve, fait « une addition de style » à la strophe cxxxviii, une « petite modification4 » à la strophe cxlii, et ajoute trois strophes (celles numérotées cxliii, cxliv, cxlv).
Le 28 octobre, il commence la cérémonie des offres d’exemplaires. Suivant la personnalité du destinataire, il varie la couleur de la couverture : verte, jaune, ou encore bleuâtre pour Mme de Maistre ou rose pour la comtesse de Pfaffius5.
265Le 10 décembre, il mentionne le succès du livre. Il parlera même de « succès matériel6 » dans une lettre à Trebutien en janvier 1844.
Quelque dix ans plus tard, le 12 février 1855, il annonce à Trebutien l’envoi de plusieurs manuscrits, dont un cahier vert : « Par exemple, vous retrouverez là le premier trait de La Bague d’Annibal (écrite en une seule nuit) tel qu’il est sorti primitivement de ma tête. L’écriture même a le diable au corps comme je l’avais à l’esprit, au cœur, à la main quand j’écrivis cette chose, vomie plutôt qu’écrite et que vous verrez dans son premier bouillonnement, sous cette écriture d’il y a tant d’années, comme un morceau de lave dans son cratère refroidi. Il y a bien longtemps que je n’ai regardé dans le Vomitorium de ce cahier. » Il demande le secret : « pareils déshabillés ne sont que pour les amis7 ».
Le 4 juillet 1857, il écrit à Trebutien qu’il a l’espoir d’éditer chez Cadot L’Amour impossible et La Bague. Sans doute a-t-il le sentiment d’être sacrilège : comment comparer un « éditeur artiste » à quelqu’un qui « tire à cinq mille » et offre de « la librairie à 1 franc8 » ? Mais, s’excuse-t-il, n’est-ce pas le prix à payer pour être lu et reconnu ? Ce n’est pourtant pas ce dernier point qui choque le plus son correspondant, et il le sait fort bien ; Trebutien note en marge de la lettre : « Voilà comment il m’annonce la publication de la Bague, après qu’il avait été convenu ici, entre nous de la manière la plus formelle que ce livre ne serait jamais réimprimé9 !… »
Le 10 juillet suivant, Barbey dit renoncer, à regret, à son projet, mais il continue néanmoins d’argumenter : « Est-ce la femme dont il fut question dans la Bague ? Mais l’éclat a été fait et parfait. Le Mari n’est plus. La femme est vieille10. » Il ne rend grâce que le 18 : « Mon ami, la cause est entendue. Puisque vous ne voulez par que la BAGUE paraisse, sous aucune condition et dans aucun cas, elle ne paraîtra point. Elle est à vous. Elle vous fut donnée et dédiée11. »
La brouille définitive entre Barbey et Trebutien survient l’année suivante.
266Trebutien, dans une lettre au poète Marie Jenna du 27 janvier 1870, parle de La Bague d’Annibal comme « une des œuvres les plus remarquables de l’auteur », mais aussi comme « une mauvaise action » : « c’est une vengeance et une vengeance contre une femme qui n’avait d’autre tort que de s’être un peu jouée de sa fatuité à lui ou d’avoir ressenti un peu cet effroi dont parle Eugénie12 et enfin d’avoir pris pour mari un homme qui lui donnait ce qu’elle paraît avoir principalement convoité – une position dans le monde qu’Aloys de Synarose ne pouvait lui donner alors ni depuis13. »
Le décès de Trebutien le 23 mai 1870 délivre-t-il Barbey de sa promesse ? La Bague d’Annibal paraît en feuilleton dans Le Gaulois les 27 et 28 février 1881. C’est Paul Bourget qui a servi d’intermédiaire entre Barbey et Arthur Meyer, le directeur du journal.
« Mon cher monsieur Meyer
Vous avez eu la gracieuseté de me demander pour votre supplément littéraire au Gaulois quelque chose de ma littérature et je vous envoie ce petit roman publié – il y a bien des années déjà – à cent cinquante exemplaires sur papier de Hollande et tous donnés de la main à la main. Noyé dans cette goutte d’eau de cent cinquante exemplaires, je l’en retire pour vous l’offrir. C’est presque de l’inédit car il est bien possible qu’il est cent cinquante fois oublié14. »
Le texte est publié en volume avec L’Amour impossible en 1884, chez Lemerre.
Le poème que l’on trouve en dédicace dans cette dernière édition a été envoyé à Roger de Beauvoir en 1851 avec un exemplaire de La Bague. Il est intégré sous le titre « À Roger de Beauvoir » dans l’édition confidentielle (trente-six exemplaires) du recueil Poésies réalisée par Trebutien en 1854 et imprimée à Caen chez Hardel. Il prendra finalement place dans le recueil Poussières (Lemerre, 1897, édition posthume15).
On peut suivre, grâce à la correspondance avec Trebutien, le bonheur éprouvé par Barbey à la parution de La Bague d’Annibal en 1843. Il se 267réjouit, sans aucune fausse honte, du scandale que son livre suscite : « La Bague ici a du succès. On trouve que c’est une horreur, mais l’horreur d’abord est toujours une jolie chose en soi et puis on convient d’un diable de talent… et cela me suffit16. » Et il continue en se moquant de l’hypocrisie de certaines réactions : « À Paris, pourtant ville immorale, il se trouve encore des « gens qui se griment en moralistes pour condamner, sans rire, un petit livre, gros comme rien et trop léger de ton pour faire beaucoup de mal (car le mal se fait toujours gravement et Byron avait raison quand il disait que Don Juan était moins dangereux que Corinne) […]17. ».
Début 1844, ayant appris que son livre « était lu avec l’intérêt le plus incroyable (ou le plus croyable) » et que « tous les personnages en étaient reconnus », il demande à Trebutien de l’informer « en détail » de tous les « commérages18 ».
Il mentionne, avec plaisir, les réactions critiques, à quelques exceptions près. Il s’emporte contre Paul Delasalle au « puritanisme guindé et faux » et dont la lecture de L’Amour impossible l’avait déjà agacé : « Quelle méthode de critique est celle-là ? Vous me gâtez, vous me salissez, vous me racontez mal, vous me citez de travers, vous me coupez en morceaux et puis vous prononcez dogmatiquement que tout cela est mauvais, que tout cela est bien moi parce que de fait, ce sont bien là mes morceaux ! Le hachis de mon livre n’est plus mon livre19. » Il s’agace aussi de l’article de La France : « Ils l’ont fait avec les débris du mien, » écrit-il dans cette même lettre à Trebutien, « car comme je vous l’avais dit, je leur avais envoyé un article où je m’étais moi-même semoncé et admonesté20. »
Il fait remercier Alphonse Le Flaguais d’un article paru dans La Revue de Rouen (article non retrouvé). Il savoure les articles du Satan et de L’Écho français qui parlent de « portraits frappants de ressemblance et d’acteurs connus21 ».
On trouve, en effet, dans Le Satan du 2 novembre 1843, cet entrefilet non signé :
268« Le monde financier de quelques salons de Paris, est depuis huit jours, assez agité, par suite d’un fort malicieux livre qui contient les révélations les plus curieuses sur une fraction de la société parisienne. La bague d’Annibal, par M. d’Aurevilly, a été lacéré en notre présence par de fort jolies mains. Les portraits sont vivants, la psychologie est profonde ; espérons qu’il n’y aura point de duel entre M. Baudouin d’Artinel et l’auteur, comme le bruit en courait hier. »
Dans L’Écho français du 18 novembre 1843, prend place une brève recension signée FL. Y est soulignée la « fatale influence de l’école de lord Byron, qui a jeté, lors de son apparition, un si grand trouble dans toutes les intelligences, et nous pensions en avoir fini avec elle ; mais l’ouvrage dont nous parlons aujourd’hui, nous oblige de recommencer nos attaques contre cet excès d’analyse qui dessèche le cœur sans féconder l’esprit.
Le livre de M. d’Aurevilly nous en fournit un triste exemple. On ne refusera pas à ce jeune écrivain, le sentiment artistique porté à un haut degré ; mais on lui reprochera d’avoir fait preuve d’une intelligence sans principes. De là, une tendance funeste, un système déplorable, qui semble avoir pour but de battre en brèche toutes les institutions sociales ; système et tendance dont M. d’Aurevilly veut être le dangereux représentant. Son livre, dont la forme séduit par son exiguïté, peut faire un mal immense.
L’intrigue qui lui sert de base, a été prise dans l’histoire de nos mœurs contemporaines, on en nomme les personnages. – Quel que soit le mérite réel, incontestable, supérieur de l’écrivain, nous ne cesserons de protester contre un pareil moraliste, avec toute l’énergie d’un homme aussi convaincu qu’indigné. La Bague d’Annibal, par le charme d’un style franc et d’un drame simple, sera malheureusement trop lu, beaucoup trop lu sans doute. Comment résister à la tentation de ce que nous appellerons la mise en scène de la vie privée, lorsqu’on en connaît les couleurs et que tout le monde est appelé à visiter les coulisses ? »
L’entrefilet de La France est de la même eau : « Avec une allumette on brûle une ville, avec une goutte d’acide prussique on tue un taureau, avec quatre lignes de votre écriture un procureur de la complicité morale vous ferait prendre. Avec un livre grand comme une édition de poche un écrivain de talent peut causer un mal profond. » Les reproches faits à Barbey sont semblables : « l’ironie chronique », les « prétentions à un scepticisme absolu », « l’incrédulité [qui] déborde à chaque page ». Le 269jugement est sans appel : « en un mot, ce livre est une mauvaise œuvre, travaillée avec un talent supérieur ».
Alphonse Grün, directeur du Moniteur universel, qui « a haché le livre avec un grand respect pour l’auteur22 » écrit Barbey à Trebutien, publie un article assez sévère le 7 avril 1844. Il souligne la volonté affichée d’originalité : dans le titre, « prétentieusement étranger au sujet », dans le format inhabituel du volume, dans le tirage limité qui fait du livre un « de ces bijoux typographiques » réservés à quelques-uns, mais aussi dans l’histoire (le romancier ne croit pas à ses personnages) et dans le style qui manque de naturel. Bref, il s’agit d’« un travail entaché de bizarrerie volontaire et de recherche maniérée ». Les points positifs sont évoqués en finale : « de la fermeté dans l’expression, de la personnalité piquante dans la pensée ». Un conseil est donné : « Il faut que M. Barbey d’Aurevilly laisse au plus vite la littérature de boudoir ». La conclusion tombe : « Nous attendons M. Barbey d’Aurevilly à son premier ouvrage sérieux. »
L’article de la Revue de Rouen est, lui, dithyrambique. On y loue « une œuvre étincelante de beautés neuves, d’idées originales », « une œuvre de fantaisie » qui se démarque de la triste production en vogue et qui marie « observation, philosophie, passion, sentiment, fashion, ironie ». Imagination, verve, hardiesse du style, tout contribue à la singularité de ce petit livre, « vrai bijou bibliographique » de plus, et dont le père spirituel est évidemment lord Byron.
1 LT, p. 52.
2 LT, p. 83.
3 LT, p. 109.
4 LT, p. 112.
5 La comtesse Pfaffius était une amie de Mme de Maistre dont Barbey fréquentait le salon lorsque cette dernière séjournait à Paris.
6 LT, p. 132.
7 LT, p. 810.
8 LIT, p. 133.
9 LIT, p. 134.
10 LIT, p. 135.
11 LIT, p. 138.
12 Eugénie de Guérin.
13 « Quelques lettres de G.-S. Trebutien », présentées par A. Martineau, Mercure de France, vol. LXIII, 1er octobre 1906, p. 365 (lettre citée en partie par Jean-Luc Pire, op. cit.).
14 Lettre du 23 février 1881, Corr. 8, p. 278.
15 Jacques Petit l’insère dans son édition de ce dernier recueil. Pascale Auraix-Jonchière s’y refuse jugeant ce texte d’un intérêt plus « anecdotique » que poétique (« Un palais dans un labyrinthe », Poèmes, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 26).
16 Lettre du 20 novembre 1843, LT, p. 120.
17 Ibid.
18 Lettre du 2 janvier 1844, LT, p. 130.
19 Lettre du 10 décembre 1843, LT, p. 125.
20 Ibid.
21 Lettre du 20 novembre 1843, LT, p. 122.
22 Lettre du 12 avril 1844, LT, p. 144.