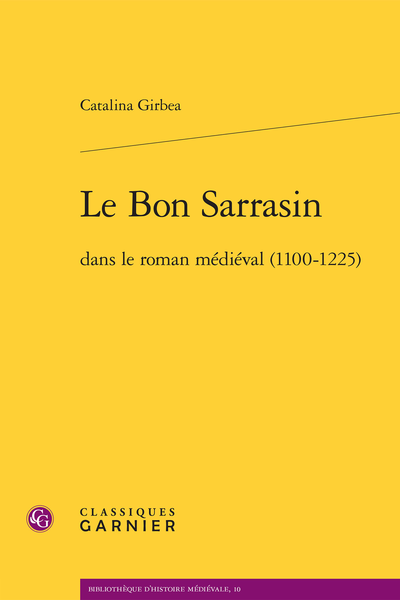
Préface
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Bon Sarrasin dans le roman médiéval (1100-1225)
- Auteur : Galderisi (Claudio)
- Pages : 7 à 15
- Collection : Bibliothèque d'histoire médiévale, n° 10
- Thème CLIL : 3386 -- HISTOIRE -- Moyen Age
- EAN : 9782812428623
- ISBN : 978-2-8124-2862-3
- ISSN : 2264-4261
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2862-3.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/07/2014
- Langue : Français
Préface
Les livres de Catalina Girbea, qu’ils soient consacrés aux récits du Graal et aux thèmes de la grâce et de la conversion dans cette matière, comme les deux premiers – La Couronne ou l’auréole : royauté terrestre et chevalerie célestielle à travers la légende arthurienne (xiie-xiiie siècles ; Communiquer pour convertir dans les romans du Graal (xiie-xiiie) – ou qu’ils brossent le portrait inattendu et heureux du bon sarrasin dans la littérature romanesque, comme ce dernier, tous offrent à ses lecteurs un éclairage original et une approche novatrice, qui appelle les médiévistes à poser autrement des questions critiques essentielles.
Au fil des ans, Catalina Girbea est en train de s’imposer comme l’une des meilleures spécialistes du roman français des xiie et xiiie siècles. Son Bon Sarrasin fera date. Audacieux et mesuré à la fois, l’ouvrage trouve une voie originale dans l’approche de la perception médiévale de l’Autre, qui ne relève pas toujours, contrairement à l’idée reçue, du rejet. Il prolonge ainsi sa réflexion sur la conversion, fil conducteur d’un livre précédent qui reprenait ainsi l’une des voies de recherches ouvertes par Michel Zink. Ce troisième ouvrage traduit une maturité certaine. Sa lecture ne peut qu’enrichir le lecteur, et pas seulement au plan scientifique.
Dans cette préface à deux voix, Claudio Galderisi et Martin Aurell lisent selon deux regards disciplinaires complémentaires l’aventure critique du Bon Sarrasin.
Les travaux de Catalina Girbea ne laissent jamais indifférents ses lecteurs. On peut être plus ou moins d’accord avec les thèses et la vision globalisante que la médiéviste présente dans ses recherches ; on ne peut pas ne pas être intéressé par des lectures et des rapprochements critiques qui témoignent à la fois d’une connaissance remarquable des œuvres et d’une acuité herméneutique singulière.
Dans cette étude de la figure du bon sarrasin, Catalina Girbea parvient à concilier l’acribie des sectateurs de Clio et la sensibilité esthétique des historiens de la littérature dans le cadre d’une méthode syncrétique qui met en perspective les faits historiques, sans jamais oublier la nature partiellement autotélique des textes littéraires qu’elle examine. En lisant ces pages, on est forcé d’admettre que son parti pris programmatique, parfaitement résumé par le titre du présent ouvrage, est réussi. L’attention nécessaire à la lettre et à ses métamorphoses, à des contradictions qui sont parfois propres à la mimésis littéraire, la conscience qu’une vision globale de l’objet étudié ne peut se fonder que sur les différentes facettes et articulations du texte médiéval sont présentes dans toutes les pages de cet ouvrage.
Mais ce bon Sarrasin va bien au-delà de ce que son titre donne à deviner au lecteur. La figure romanesque du païen qui prend forme ici représente une autre image du Moyen Âge, de sa civilisation, de son imaginaire. On voit alors surgir à travers le clair-obscur des citations ce que Catalina Girbea appelle « un Moyen Âge de lumière et de tolérance ». Cette image ne surgit pas d’emblée devant le lecteur avec la netteté qui permet à l’historien de la littérature de reconnaître les figures hautes en couleur des grands héros médiévaux, mais elle assume progressivement les semblances, puis les formes d’une de ces realia auxquelles l’auteur consacre ici quelques-unes parmi les pages les plus précieuses.
« Pourquoi le Sarrasin / païen est[-il] valorisé, embrassé, choyé, ou érigé en modèle, au cœur d’une société chrétienne, d’un christianisme guerrier, et d’une littérature qui s’adresse à des guerriers chrétiens ? » (p. 19), se demande Catalina Girbea au début de ce livre, en lieu et place d’un lecteur qu’elle soupçonne encore incrédule ou peu convaincu de l’existence du bon sarrasin. La réponse qu’elle apporte au bout d’un cheminement qui nous conduit à lire des récits souvent peu connus et d’un accès difficile, que les traductions de l’auteur rendent facile aussi à l’illettré moderne, apparaît comme évidente : « Le roman où apparaît le bon Sarrasin génère une esthétique anthropocentriste. […] En décalage par rapport aux arts poétiques du xiie siècle, qui placent Dieu à la source de toute création et font de Nature un maillon de cette chaîne, les romans qui mettent en scène de bons Sarrasins sont centrés sur les capacités de l’homme à produire de l’art, en alliance avec la nigromance des dieux païens » (p. 585).
L’invention herméneutique du personnage du bon Sarrasin, que le corpus ici réuni confirme dans sa pertinence, permet de lever le voile sur une autre figure originale et peut-être tout aussi marginale : le « bon clerc » en train de mettre en roman des valeurs nouvelles, et in primis la tolérance, seuil ultime de l’amour du prochain. Dans le corpus analysé par Catalina Girbea, ce sont surtout deux récits allemands, Parzival et Le Comte Rudolf, qui justifient une telle lecture. Mais c’est l’ensemble des textes étudiés qui permet d’affirmer que le roman « génère une esthétique anthropocentriste », et cela au moment même où la visée eschatologique du récit et les différents phénomènes que l’on peut relier soit à la sacralisation de la merveille, soit à la translatio de certains motifs mythiques, se dégage clairement. Une telle interprétation donne aussi toute sa cohérence à l’hypothèse originale avancée par l’auteur d’une connexion forte entre une matière de Grèce, que les médiévistes semblent avoir ignorée jusqu’ici, et la naissance du roman : entre Byzance et la clergie française.
La nouvelle taxinomie que Catalina Gîrbea introduit (non plus trois mais cinq matières, dont deux profondément imbriquées) apporte alors un éclairage complémentaire sur les origines du genre. Elle nous aide à comprendre « pourquoi » et en partie « comment » les clercs ont créé ces récits. Elle ne peut en revanche révéler qu’en partie les raisons qui peuvent expliquer le succès de ces narrations auprès des illettrés.
Car en face et parfois à côté des clercs qui composent ces récits, de leur idéologie et de leurs valeurs, il y a le lecteur médiéval avec sa paresse, ses habitudes (un plaisir du texte qui lui est propre), son désir de « lire » en pleine suspension d’incrédulité des histoires qui le font rêver. Sans le véritable engouement idéologique et populaire qu’ont suscité ces narrations, et en particulier les romans en prose, dans le domaine géolinguistique de l’oïl, nous ne serions sans doute pas en train de nous poser la question des valeurs cléricales et du bon sarrasin. Non pas parce que ces valeurs ne se seraient pas reflétées dans ces textes, mais parce que le faible nombre de leurs témoins manuscrits ne nous aurait pas permis de connaître la plupart de ces récits.
Le roman, avec ses représentations et ses fausses mimésis, invente souvent le réel, ou projette sur le papier ou le parchemin des fragments d’un autre réel. Mais le roman n’est pas seulement un signifié, possédant une substance et une forme du contenu, il est aussi un signifiant, qui
se façonne dans la substance et la forme de l’expression. Si l’on a souvent privilégié le signifié par rapport au signifiant c’est en raison d’un tropisme linguistique, d’une confusion entre objet critique et langue de l’herméneute, mais également parce que la dimension comparatiste a été fondamentalement absente des études médiévales.
Hans Robert Jauss avait déjà suggéré qu’une histoire des genres n’est possible que si elle se fait « in re », c’est-à-dire à travers une histoire en mouvement, une définition en perpétuelle évolution et révolution, qui intègre d’autres espaces et d’autres moments historiques.
Lorsqu’on s’affranchit de la dimension totalisante des lettres d’oïl, on s’aperçoit que le panorama littéraire vernaculaire nous offre une réalité bien plus complexe, aussi bien sur un plan diachronique que chronologique. On constate alors que le triomphe du roman ne se produit pas partout : le domaine d’Oc, mais aussi l’Italie et en partie la Catalogne sont pour ainsi dire résistants à ce genre.
La vraie spécificité de cette narration longue réside moins en ses contenus ou en sa forme qu’en la substance et en la forme de son expression. Cette substance et cette forme sont l’oïl et de manière subsidiaire la prose, comme le suggérait déjà Dante : « Allegat ergo pro se lingua oïl quod propter sui faciliorem ac delectabiliorem vulgaritatem quicquid redactum est sive inventum ad vulgare prosaycum, suum est » (De vulgari eloquentia, I, x, 2).
Dès lors que l’on a identifié cette spécificité nationale comme la substance de l’expression, on peut essayer de se poser la question du pourquoi. Essayer, car il est difficile et prétentieux de vouloir sonder le génie des peuples. Ce qui frappe le plus alors, c’est en effet que malgré une certaine similarité des structures intellectuelles (le chevalier lettré était présent également en Italie, par exemple), le diasystème littéraire français fabrique dès le début de son histoire ou presque (l’exemple de l’Alexandre d’Albéric de Pisançon est dans ce sens éclairant) une série impressionnante de récits longs qui nous sont parvenus à travers deux milliers et plus de manuscrits, là où en même temps le diasystème transalpin n’en produit que deux ou trois et en importe une petite dizaine, conservés dans une cinquantaine au plus de manuscrits.
L’auteur nous livre ici l’une des raisons qui peut expliquer cette spécificité de l’oïl. Il s’agit du conflit idéologique entre des matières
qui représentent deux visions du monde et de la société, deux modèles, pour faire vite, très différents (n’oublions pas que le topos de la translatio studii est aussi une invention française). Cette guerre des contenus n’a pas lieu d’être – pas selon le même registre, en tout cas – dans l’Italie romaine, ni même dans l’Espagne à la fois catholique et musulmane. Elle trouve en revanche toute sa place dans une France plurigénétique (Francs, Latins, Normands, Bretons, avec des formes de paganismes plus accentuées que dans les autres régions de la Romania). Cette dialectique idéologique alimente la guerre des fictions et dans une certaine mesure celle des modalités de l’expression (forme du signifiant) à travers la bataille du vers et de la prose. Elle est aussi renforcée par la structure féodale, où chaque acteur à des intérêts plus ou moins convergents, selon les époques, avec l’une ou l’autre des deux idéologiques.
Or la dimension comparatiste qu’implique une telle analyse non seulement est présente dans les multiples lectures qui jalonnent la construction du bon sarrasin, mais elle en constitue l’horizon naturel et la coordonnée esthétique majeure. Si au bout de ces lectures passionnantes on voit se former d’abord entre les lignes, puis campée comme une espèce de chargeure romanesque, enfin dominant les récits allemands la figura de l’autre comme soi-même, du sarrasin qui ne doit plus son intérêt et son existence fictionnelle à une altérité en trompe-l’œil et toujours réductible aux valeurs religieuses du monde occidental, c’est parce que la fiction romanesque, la puissance de son imaginaire offre à ce sarrasin une conversion sans baptême, un salut sans reniement. Comme le chrétien, comme tout autre personnage, le sarrasin peut être alors méchant ou enfin bon.
Dans ce sens, on remarque, d’une part, une différenciation formelle et peut-être idéologique entre le corpus allemand et le corpus français, et, d’autre part, entre la vertu de la tolérance chrétienne et l’originalité narrative de certains romans, qui mettent en scène un idéal nouveau de la conversion par les larmes, par l’émotion, par la communion romanesque. Il y a à côté de la dimension idéologique une intention esthétique, qu’il ne faut pas négliger si l’on veut restituer à ces écritures de l’altérité une dimension littéraire historicisée. Nombre de ces récits mettent clairement en scène la tentation du delectare. Et c’est aussi dans le cadre d’une esthétique de l’écart, de l’originalité, que l’on peut expliquer certaines
issues surprenantes, certaines solutions apparemment subversives, voire hérétiques.
Les exemples et les citations proposés par Catalina Girbea dans ce livre stimulant apparaissent alors comme un miroir et un symptôme d’une mutation profonde de la pensée médiévale. Ils sont l’indice d’une dialectique nouvelle qui affecte l’horizon chrétien et qui nous révèle l’opposition entre deux conceptions du religieux qui aboutiront quelques siècles plus tard à la Réforme, d’une part, et à la Contre-réforme, d’autre part.
L’interdisciplinarité est le premier point fort du livre, largement préparé au Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (Poitiers) dont l’un des principes fondateurs est le dialogue entre toutes les branches de la médiévistique. C’est pourquoi, après la critique littéraire ou la philologie, domaine où s’exerce l’enseignement de l’auteur, l’histoire conditionne une fine lecture des textes qu’elle parvient toujours à replacer dans leur contexte. En outre, sa formation philosophique et anthropologique lui permet de leur poser de multiples questions et de les soumettre à des comparaisons variées. Il en résulte une diversité d’angles d’attaque dont les apports sont innombrables. Même de nature historiographique, le débat sur l’évolution de la chevalerie est présenté ici plus clairement que ne saurait le faire aucun historien. Il est impossible de comprendre les mentalités et idéologies de l’aristocratie guerrière sans se pencher sérieusement sur la fiction où les protagonistes eux-mêmes laissent libre cours à leurs rêves et idéaux. Le pari de ressusciter l’imaginaire chevaleresque a été tenu grâce à une curiosité intellectuelle, qui, toujours en éveil, franchit allégrement les barrières disciplinaires par lesquelles les Facultés universitaires bornent de longue date le savoir. Cette transgression, si elle en est, aboutit à de saines remises en cause. Ses résultats se concrétisent dans ce bel ouvrage.
L’interdisciplinarité n’est que la conséquence d’une indéniable ouverture d’esprit. Elle s’inscrit dans le droit fil du Moyen Âge de la « tolérance », mot peut-être anachronique. Quoi qu’il en soit des nuances que les modernes ont apporté au terme, son concept apparaît bien sous la plume des romanciers et chroniqueurs allemands des années 1200, que Catalina Girbea connaît très bien. Elle aborde ainsi sans préjugé à la page ou sans idée reçue, et même avec une compréhension sincère, les
médiévaux, dont la mentalité est si étrange à la modernité, car « leur cogito est leur credo », écrit-elle avec justesse. Dégagée des contraintes que nous imposent si souvent les modes de pensée, cette liberté face au texte lui ouvre, sans préjugé aucun, une voie originale dans une discipline, la critique littéraire, à laquelle elle entend rester fidèle.
Dans son introduction, l’auteur associe sa « boulimie interdisciplinaire » à sa « boulimie interculturelle » (p. 21). Son besoin constant d’élargir son champ culturel l’honore. Le Bon Sarrasin n’aurait jamais vu le jour sans une maîtrise hors du commun des langues, et surtout de l’allemand. Catalina Girbea a ainsi travaillé sur le Graf Rudolf, texte en vers du xiie siècle, dont il n’existe aucune traduction ni adaptation en allemand moderne. Rédigé dans les années 1170-1185, ce roman est significatif du projet de l’auteur. Il met en scène un noble flamand qui arrive, à la demande du pape, à Jérusalem. Il croyait alléger les souffrances des chrétiens d’Orient en contribuant au siège de la ville sainte, mais il est étonné de découvrir qu’elle est déjà sous domination croisée. Mesquin et discourtois, son nouveau roi mène alors une guerre injuste contre la cité musulmane d’Ascalon. Rudolf déserte son armée et, épris de la fille du roi ennemi, décide de passer à son service. Il combat, toutefois, d’une épée épointée ses coreligionnaires, qu’il ne veut pas blesser. Dans sa nouvelle troupe, il devient le compagnon « de noble Girabobe, jeune homme très sage », intelligent et beau parleur, d’Agarrain et d’Agar, dont le doublon onomastique réitère leur identité arabe. Pour être musulmans, ils n’en sont pas moins, tous les trois, des chevaliers hors pair. Leur courage et leur courtoisie sont, en effet, exemplaires. La trahison de Rudolf, si elle en est pour l’auteur anonyme du roman, facilite les négociations entre les deux camps, dont le but louable est de mettre un terme aux malheurs que la guerre apporte aux uns et aux autres. La méchanceté du roi chrétien de Jérusalem empêche cependant toute paix : « Il pille et il brûle la terre de païens, s’appliquant à les nuire plutôt qu’à agir avec justice. Il leur inflige de tout détruire et d’égorger les femmes et les enfants comme du bétail. » En filigrane, l’on croirait lire les récriminations d’Albert, chanoine d’Aix-la-Chapelle, qui dénonce, dans sa chronique du début du xiie siècle, les pogroms et les massacres auxquels se livrent les participants de la première croisade. Il existe une indéniable spécificité germanique dans la critique de la « guerre sainte », oxymoron s’il en est.
Les travaux de Catalina Girbea témoignent de l’étendue de ses lectures et pas seulement dans son domaine de recherches, mais aussi des auteurs classiques ou des penseurs les plus contemporains. Sans doute une telle culture lui a-t-elle permis de montrer, après presque un siècle d’oubli dans la critique littéraire, l’influence du roman néo-hellénique sur le roman occidental. La matière de Rome devient ainsi la matière des Rum, terme par lequel les Arabes désignaient les Byzantins.
Catalina Girbea sait toujours poser de bonnes questions. Deux exemples seulement. Le premier : le Sarrasin n’est pas l’Autre au sens strict, mais le « soi-même comme un autre » de Paul Ricœur, et même le Doppelgänger, son sosie fantastique : « C’est l’ennemi à convertir. C’est l’adversaire à respecter. C’est la femme musulmane à aimer. » (p. 456). Au sujet du mariage mixte, elle aborde même l’« exogamie joyeuse » des chrétiens et musulmanes. Pour l’amitié entre les prétendus adversaires religieux, le livre se penche sur le passage de la philia, qui relève d’un amour généreux et désintéressé, à l’agapè chrétienne. Il en résulte une sorte de « complicité souterraine permanente » entre les chevaliers chrétiens et musulmans. Second exemple : le lien entre le tournoi et le jeu qui dépasse la sévérité d’un Jan Huizinga pour adhérer à l’interprétation, à la fois ludique et sacrée, d’un Roger Cailliois. La joute chevaleresque devient ainsi un carnaval où le masque est de mise. Sa dimension « agonale » existe certes toujours, mais elle se situe sur le plan du mythe ou de l’archétype, de la structure religieuse ancienne, enfouie dans l’inconscient des combattants.
Dans toutes les études de Catalina Girbea, l’écriture est au service de la communication, l’un des thèmes clefs de sa recherche, fondée sur les méthodes les plus à la pointe de l’analyse du discours et de la performance de la langue. Un seul échantillon : « La glossolalie areligieuse que les adoubements habituels à la Pentecôte problématisent régulièrement. » (p. 209). Ici, on perçoit, entre les lignes, les langues de feu descendues sur les Apôtres, qui prêchent aussitôt aux peuples les plus divers pour être compris à la perfection. Babel est ainsi aboli au profit d’une communication sans entrave. Le lecteur songe à l’une des thèses principales du livre, l’universalité – quelle que soit la religion – de la chevalerie, païenne par essence : « la chevalerie qui devient un espace de rencontre au-delà des religions. »
L’ouvrage contient des pistes de recherche ou des découvertes remarquables. Sa priorité accordée à la matière sur le genre emporte l’adhésion,
pour la simple raison que les écrivains des xiie et xiiie siècles ont une forte conscience de la première qu’ils parviennent à définir avec précision ; il n’en va pas de même pour le genre, que la critique littéraire a appréhendé plus tardivement. Aussi passionnante est l’opposition entre la matière de Bretagne et la matière de Grèce, qui recoupe la querelle des auteurs, comme celle qui oppose Chrétien de Troyes à Alexandre de Paris. Chrétien a fini par l’emporter et le païen (sans mauvais jeu de mots) en a fait les frais en « victime collatérale » du combat des matières. Le franciscanisme subjacent à l’Estoire del Saint Graal, autre découverte de l’auteur, amène en discussion les thèses de Jean Frappier et apporte des arguments à une datation des années 1220-1225. Le lecteur peut adhérer ou pas à la définition – trop sacrée ou païenne et pas assez chrétienne au goût du préfacier – de la chevalerie que propose Catalina Girbea, mais c’est la vexata quæstio par excellence où chacun est en droit d’exprimer son opinion, les arguments ne manquant pas pour soutenir l’une ou l’autre hypothèse. Les pages sur les armes, sont aussi stimulantes : équipement militaire animé des païens et de leurs automates, brillance de leurs armures, hybridation jusqu’à la monstruosité… L’auteur saisit une inflexion entre le xiie et le xiiie siècle dans la manière de décrire l’équipement militaire : la lumière quitte les chevaliers après les années 1200, pour se concentrer sur les reliques. Des conclusions sur la perception de la chevalerie s’en dégagent avec clarté. La liste des apports du Bon Sarrasin pourrait être élargie. Laissons cependant au lecteur la joie de les découvrir par lui-même.
Claudio Galderisi et Martin Aurell
Université de Poitiers – CESCM