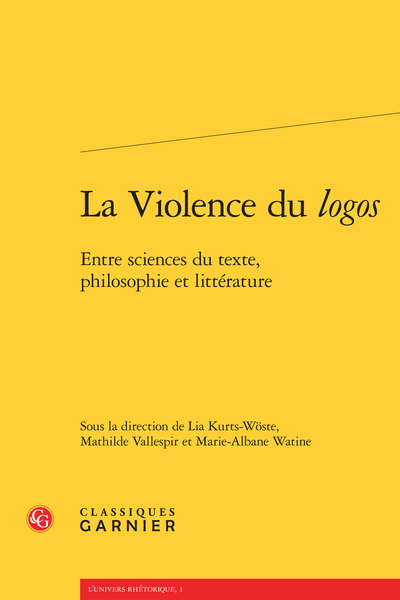
Préfaces
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Violence du logos. Entre sciences du texte, philosophie et littérature
- Pages : 9 à 21
- Collection : L'Univers rhétorique, n° 1
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782812409981
- ISBN : 978-2-8124-0998-1
- ISSN : 2271-703X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-0998-1.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/08/2013
- Langue : Français
Préfaces
Le logos : quelle violence ?
A priori, la question qui accouple violence et logos peut paraître paradoxale, surtout pour qui théorise que le logos, dans l’archéologie transcendantale de sa génération et de sa structuration grecques, constitue la forme la plus aiguë de l’activité sémiotique principielle, c’est-à-dire du langage naturel en général, à savoir l’opération de traitement de l’articulation de la subjectivité et de l’altérité, de chaque subjectivité et de son altérité relative, à savoir tout simplement la sémiose, sous l’aspect maximalisant la composante noétique : le langage verbal.
Il s’agit alors, sous cet horizon, rigoureusement d’une anti-violence, de l’anti-violence par excellence, celle qui s’oppose aux deux meurtres archétypiques : le meurtre de soi et le meurtre de l’autre, le suicide et l’assassinat. C’est ainsi que justement, on le sait, j’analyse la manifestation sociale la plus large et la plus systématique de ce logos fondateur : la position et le mouvement des dispositifs rhétoriques, à la fois signe et moyen de toute interaction sociale.
Et pourtant, si l’on s’interroge sur le rapport du logos et de la violence, ce n’est sans doute pas dans l’idée que le logos combat et maîtrise la violence, ce qu’a d’une certaine façon traité le marxisme-léninisme, mais en fonction d’une sorte d’implicite de la question : le logos générerait de la violence. C’est bien l’esprit du temps, selon quoi on s’est aussi récemment, sans hasard de rencontre, interrogé, autour d’Emmanuelle Danblon, sur rhétorique et violence1.
Je me contenterai, suivant donc cette tendance, de proposer quelques voies.
Il y a d’abord la violence originelle du logos comme logos.
Il ne faut pas oublier en effet que le logos, du moins dans ma théorisation, c’est le langage verbal. Et le langage verbal est à l’origine d’une double violence.
La première, dans l’ordre structural, tient justement à la maximalisation de la composante noétique. C’est elle, en tout cas son jeu dominant dans le traitement sémiotique de la mondanisation (voilà d’ailleurs à mes yeux la seule caractéristique véritablement sémiotique du langage verbal), qui est responsable du travail spécifique de cette sémiose-là : la catégorisation. Le rôle majeur du ratio-conceptuel est exactement de ratio-conceptualiser, de former un processus de ratio-conceptualisation. On peut dire aussi, autrement, qu’il s’agit de l’étiquetage : ratio-conceptualisation par étiquetage. De quoi ? – du monde devenu du mondain. On comprend que l’entreprise ne soit jamais finie, dans la mesure où elle est hors mesure, rigoureusement infinissable, le monde se dilatant à la mesure de la mondanisation et l’excédant toujours d’autant. Mais le mondanisé est bien d’abord de l’étiqueté, du conquis, du dominé, du colonisé. D’où l’affinité herméneutique entre l’Occident et le colonialisme, entre la raison (occidentale) et le colonialisme2. Et d’où aussi, plus calmement, l’affinité, intra-sémiotique, entre le logos et le lexique. Et d’où finalement l’affinité traditionnelle entre l’idée de science et l’idée de nomenclature. C’est atavique.
En quoi est-ce violence ? Au moins selon deux dimensions.
L’une vise la signification, la pensée de la signification. Le primat du logos dans cette atmosphère discrédite toute conception hors linguistique, entraînant le mépris des arts (dont la poésie), de l’émotion, et, bien sûr, de tous les langages non-verbaux, considérés au mieux comme des sous-langages naturels ou des ersatz de langages à code fini, au pire (et plus généralement) comme des comportements non sémantiques. C’est là une violence principielle et absolue, que l’on pourrait qualifier de théorétique.
Et elle s’associe, inévitablement, suivant la pente d’un platonisme totalement irrédentiste, ou d’un irrédentisme pleinement platonicien, à une autre violence, une violence éthique. C’est la violence de la domination,
de la fierté, de la morgue de l’esprit occidental, sûr de sa supériorité technique, de sa supériorité intellectuelle, de sa supériorité morale ; sûr en tout cas des liens qui unissent et justifient ce triple sentiment de supériorité, fondant à la fois le mercantilisme et la conquête européens au détriment du monde entier et de toutes les différences civilisationnelles. C’est bien la violence de cette sensation-là, exacerbée, qui est à l’origine des réactions identitaristes et fondamentalistes qui marquent l’aujourd’hui mondial d’après les écroulements historiques.
On pourrait gratter davantage : c’est l’humain qui est en question, et la possibilité même d’appréhender la sortie ou l’extase vers l’art.
À maximaliser la maximalisation du noétique inhérente à la sémiose du logos, on oublie les fortes et sidérantes thèses méta-épistémologiques du début du Péri hermènéias d’Aristote, fondant l’idée linguistique même sur les affects et sur leur rapport à la mondanisation3 ; on vire vers une posture linguistique tendant à l’abstraction et à la squelettisation de la langue, au risque de déréaliser l’incarnation et de simulacrer tout discours, de le fantomiser, de le néantiser – c’est la tendance de tout classicisme, dont la langue française a presque emblématisé la geste4 ; on risque enfin d’inexister toute tentative d’artistisation.
Voilà la violence radicale, consubstantielle à l’arrogance définitoire du logos. Ce que j’évoque, c’est la révolte de l’émotion, des affects, du pathético-thymique, de la chair, du somatique – au nom de l’éthique, c’est-à-dire de la dignité du corps humain comme corps : souffrant, suant, jouissant, désirant, mortel.
Une telle révolte, théoriquement nécessaire et pratiquement inévitable, peut se manifester de diverses façons.
On a évidemment les révoltes que l’on pourrait appeler positives, actives, voire activistes : celles d’après Rimbaud et Lautréamont, d’après Artaud et Michaux, de la poésie matérique, de la postpoésie de Jean-Marie Gleize (pour ne citer que quelques exemples5). C’est apparemment de la
violence faite au logos, à titre de représailles, ou d’expérience des limites, de manière à en casser la raideur et le port altier pour dégager les traces et les lueurs d’autres rivages de la signification, de la sur-signification et du bouleversement à l’intimité impartageable et pourtant offerte à partage. On est alors en présence de propositions ostentatoires, visant à afficher un « pouvoir/devoir signifier autrement », selon une démarche analogue à celle de Sade ou de Bataille radicalisant dans la violence la radicalité de la désirabilité. C’est la réponse, violente, à la violence ordinaire par quoi le logos prétend gérer la manifestation du pulsionnel et de l’essentiel intime.
Et puis on a la révolte que l’on pourrait, maladroitement, qualifier de passive, ou d’inversée, dans les pratiques du genre de celles que l’on a appelées quelquefois la novlangue. Elles ont été illustrées, si l’on peut dire, par Otto Klemperer, à propos de l’usage de la langue par les nazis – est-ce la langue nazie ? On doit généraliser à tous les usages totalitaires, à condition de bien garder en tête l’idée que tout usage du logos porte en soi le germe de cette criminalité. Thucydide l’avait clairement exprimée au début de son chapitre sur les désordres de Corcyre, dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse : « on avait changé le sens des mots. » Une telle inversion sémiotique équivaut à une violence faite au logos, qui revient également à une violence faite par le logos, sur les êtres de chair qui en sont victimes, déshumanisés, Untermenschen néantisés par la mécanique abstractisante du langage verbal désincarné6.
La violence inhérente au logos tient forcément à son déracinement du sensible. Or, le sensible, c’est pour nous la mesure du réel en tant qu’humain, ou qu’humanisant, ou qu’humanisable. Cette limite, à quoi se heurte l’ubris du logos prétentieux et fascisant7, c’est proprement l’obscène, qui toujours le nargue.
Georges Molinié
Université Paris-Sorbonne
Comment faire échec à la violence du logos ?
Reprenons le titre de la journée d’étude8 : « La violence du logos » (l’énoncé, nous dit-on justement, peut paraître a priori paradoxal) et donnons-lui une forme interrogative : qu’en est-il de « la violence du logos » ? Et reprenons aussi les termes de l’argumentaire9 qui nous a été proposé. Comment la « raison » (le logos ?) qui est dotée par définition d’« une puissance régulatrice » de la violence, de l’ubris, peut-elle être dite elle-même « violente » ?
Je vais d’abord prendre le parti inverse, celui d’un logos non violent, un logos soit organisateur, soit protecteur. La tradition, d’Héraclite à la logique médiévale, dote le logos de deux acceptions qui se recouvrent ou qui s’ordonnent. Elles se recouvrent quand, avec Hugues de Saint-Victor, au xiie siècle, s’établit l’équivalence : « Sermo sive ratio. » On ne peut pas opposer dans le logos le discours (sermo) à la raison (ratio). Elles s’ordonnent quand la raison (ratio) se développe en discours (sermo). C’est ce que fait Dieu, selon Tertullien, qui ordonne son discours au moyen de la raison. En somme le logos, comme le pensait Héraclite, dit l’unité des choses. C’est un principe d’ordre, d’organisation, dont il serait par trop réducteur de faire un simple principe de raison. L’interprétation du logos comme marque du rationalisme, pour reprendre Bachelard, nous conduirait en effet, si nous suivions les « albinos du concept10 », à assimiler le principe d’organisation à l’intellect, ou, si l’on veut, le principe d’organisation aux valeurs cognitives. Telle est l’option de Platon qui, dans le Phédon, voit dans les « notions intelligibles » (logoi, les représentations, les raisonnements) un refuge face à l’agression des choses (pragmata), à l’hostilité du monde :
J’ai craint, dit Socrate, que mon âme (psuchè) ne fût totalement aveuglée si je regardais les choses avec mes yeux et si j’essayais, par chacun de mes sens,
d’entrer en contact avec elles. Il me sembla dès lors que je devais me réfugier du côté des notions intelligibles et chercher à voir la vérité des choses11.
Néanmoins, qu’il s’agisse d’un principe d’ordre (Héraclite) ou d’un principe de raison (Platon), le logos n’a pas de caractère de violence, mais plutôt, à l’évidence chez Platon, valeur de protection. Le débat se déplace alors : les choses (pragmata), telles qu’elles apparaissent (phainomena) sont-elles par nature hostiles ? Ou bien, le monde tel qu’il se constitue, ou même, dès le premier contact, tel qu’il nous apparaît, dans les formes qu’il revêt, n’est-il pas le donné sensible, bénéfique dont nous avons besoin pour vivre, dont nous nous nourrissons, sans lequel nous ne saurions penser ?
Dans l’acception ratio, « raison », « pensée », « esprit », etc., le logos a tendance à occuper, voire à annexer tout le domaine du savoir. La connaissance relève alors tout naturellement, si l’on peut dire, du logos. C’est une occupation violente, aveugle, dans certains cas. La violence du logos, pour moi, elle est là.
On peut voir la trace de cette mainmise totalitaire dans la manière de traiter le langage, plus généralement, des sciences du langage. Pour J. A. Fodor, par exemple, un psycholinguiste célèbre du M.I.T. de Cambridge, que je prends comme témoin du raz-de-marée venu d’Outre-Atlantique dans les années soixante-quatre-vingt, la linguistique n’a plus d’objet qui lui soit propre, ou, si l’on veut, n’a désormais d’autre objet que cognitif. C’est lui qui voulait promouvoir le « mentalais », une lingua mentis, à la suite des médiévaux12. Trois des domaines habituels de la linguistique, la phonétique, la morphosyntaxe, la sémantique, sont du ressort, dans l’ordre, de l’acoustique, science physique, de la logique computationnelle, science mathématique, de la psycho- et de la sociolinguistique, sciences sociales. Fodor et son collègue Katz, visant à construire une théorie générale du langage, s’appliquaient à dégager le « contenu conceptuel », la forme nécessairement abstraite du plan sémantique, permettant, croyaient-ils, à chaque suite de morphèmes bien formés, d’être « un moyen de communication véritable ». Concept et vérité, les deux sont liés13.
Il est dès lors tentant de subsumer cet ensemble d’apparence hétéroclite sous un chapeau aux très larges bords : les sciences cognitives (ou sciences de la pensée), tributaires d’une philosophie de l’esprit. De fait, pour faire simple, la linguistique sera dite « science cognitive », un mécanisme computationnel parmi d’autres systèmes cognitifs. Par extension extrême, on retrouve le terme de « cognitif » dans le discours politique comme support de la notion d’« immatériel », cela même que les Stoïciens appelaient l’« incorporel ». Ainsi dans un entretien avec Antonio Negri au sujet d’un rassemblement altermondialiste à Rostock : « Il n’y a plus de classe ouvrière », dit-il, mais « un nouveau prolétariat cognitif ». Et Negri continue :
Prendre acte d’une forme de travail de plus en plus “cognitivé”, c’est-à-dire immatérielle et communicationnelle […], c’est accepter le fait que le prolétariat industriel tend à céder sa place à un autre sujet collectif, plus hybride, plus adapté aux formes globales de l’exploitation […]. Cette nouvelle figure politique [est nommée] “multitude”14.
Tenons compte de la notion d’« immatériel » avancée avec ou sans humour par Negri. S’il est fidèle à cette ligne, qui est aussi celle de Katz et Fodor (ce que nous recherchons, disaient-ils, c’est « la forme abstraite d’une théorie sémantique »), un chercheur, en l’occurrence, un linguiste, exclura de son analyse tout ce qui n’est pas de l’ordre de l’« immatériel » ou de son synonyme, l’« incorporel », le terme propre à la doctrine stoïcienne. Je prendrai en exemple la démarche d’un linguiste contemporain dont je me sens par certains côtés très proche, A. Culioli. Il aime à citer une lettre de Sénèque à son ami Lucilius (Lettre 117) qui me paraît illustrer convenablement ce que nous pouvons appeler la violence du logos15.
Voici en résumé le texte sur lequel il s’appuie. Sénèque s’attache d’abord au mouvement ; il l’analyse ensuite. En somme, deux temps, dirait-on en phénoménologie du langage : prise et reprise.
Je vois Caton se promener. Les sens me le montrent, ma pensée y croit. C’est un corps que je vois, qui occupe mes yeux, ma pensée. Ensuite, je dis : “Caton se promène”16 .
Bel exemple du primat de la perception, dira-t-on. Mais comment un linguiste, tenant d’une théorie de l’esprit, intégrera-t-il la perception du mouvement corporel dans son analyse ? Bien qu’il note avec raison : « le corps, c’est toute la scène en fait17 », il efface l’énoncé, faute d’avoir reconnu la présence de prédicats somatiques (ou encore, prédicats de réalité, domaine de la phusis) qui prennent le corps soit comme centre de référence, soit comme cible18. Or, l’analyse de la langue suppose le repérage de tels prédicats, ceux qui notent la perception, ici, la perception du corps de l’autre, la durée d’un phénomène, son apparition ou sa disparition, ou le contact, en particulier la position dans l’espace, le mouvement, la proximité ou l’éloignement ou encore le degré d’un affect, etc. C’est ce travail d’analyse du prédicat somatique qui est délaissé au profit exclusif de l’« activité mentale », des opérations de l’esprit. A. Culioli l’affirme : « M’occupant du langage, je suis bien obligé de m’occuper de l’activité mentale tout de même19 ! ». « Activité mentale », opération de construction, certes, mais, en phénoménologie du langage, activité de reprise, activité seconde, relation de l’événement qui doit être corrélée à l’activité de prise, activité du corps percevant, activité première. En quittant (en fait, en excluant), le domaine du prédicat somatique, celui de la phusis, nous sommes entrés dans celui de la représentation, de l’« incorporel », du seul prédicat cognitif, du logos. Et pourtant, je vois d’abord un corps en mouvement ; ensuite, je rends compte de l’événement. Le premier « je » (« Je vois Caton se promener, ce que je vois est un corps ») est le « je » du prédicat somatique, un « je » percevant ; il n’a pas le même statut que le second « je » du prédicat cognitif (« Ensuite je dis : Caton se promène »), un « je » déclaratif. Le « je » percevant enregistre l’événement, le « je » déclaratif le rapporte. En passant de l’un à l’autre, on a changé d’instance énonçante. Percevoir et, finalement, dire le corps (corpus dicere), ce n’est pas le même acte de discours que de parler au sujet du corps (de corpore dicere) et même la différence est très grande. Sénèque le souligne :
Plurimum interest utrum corpus dicas an de corpore.
« [Ensuite je dis : “Caton se promène”.] Cette fois, ce que je dis là, n’est pas un corps [je glose en : n’est pas de l’ordre de la perception, de la prise], mais c’est un quelque chose que j’énonce au sujet d’un corps [temps de la reprise]20. »
L’effacement de la phusis, opération qui va de pair avec l’affirmation implicite de la précellence du logos, implique que l’on considère, dans la lignée de la sémiotique de Peirce à laquelle A. Culioli se réfère souvent, et, plus généralement, de la philosophie du langage, que « le langage est une activité symbolique, c’est-à-dire de relation à la réalité, de construction de représentations qui peuvent se substituer à, qui peuvent opérer en dehors même d’une réalité qui serait là21 ».
À l’inverse, redonner ses droits à la phusis, c’est reconnaître au langage la capacité de noter l’expérience corporelle, c’est faire échec à la violence du logos. Loin de n’être que le lieu des « représentations », comme le voudrait la philosophie du langage, conformément aux principes d’une théorie de l’esprit, le langage, du moins dans l’optique d’une phénoménologie du langage, « re-produit la réalité22 ». La réalité première est enregistrée par le corps, fût-ce sous la forme d’une réalité onirique ; le langage la « re-produit », la produit une seconde fois. Pour introduire à ce phénomène singulier, la signifiance de la phusis, qui nous paraît étrange parce que nous sommes habitués à tenir le langage (on dit généralement en ce cas la « langue ») pour un outil, un instrument de communication, Husserl et, à sa suite, Merleau-Ponty, font état d’une « incarnation linguistique » (sprachliche Verleiblichung) et Benveniste, de l’« inhérence » de l’expérience humaine dans le langage23. Le corps (Leib) enregistre ce qui se passe autour de lui (Umwelt), il l’intériorise, puis il l’exprime. Prise et reprise. La fonction première du corps dans le langage (« Mon corps, ce lieu de la nature24 », de la phusis) est précisément de permettre d’effectuer le retour « aux choses mêmes », à la réalité, à l’expérience du monde25, et lui seul peut l’exercer. Une analyse, ou tout simplement
une lecture qui ne voudrait pas être piégée par « l’intellect, ce maître du travestissement26 », autrement dit par un logos tout puissant, négateur de la phusis, oublieux d’« une moitié de la vérité27 », subordonnera l’un à l’autre, le logos à la phusis, ce qui vient après (la reprise, la relation) à ce qui vient avant (la prise, la notation de l’expérience), sans rapport de causalité entre les deux.
En exemple de ce rôle central du corps, je retiens cette formulation programmatique, tenue à l’évidence pour un bavardage inepte par tout linguiste qui se serait inscrit dans le monde exclusif du logos. Je la dois à H. Cixous : « La vie fait texte à partir de mon corps. Je suis déjà du texte28 ». La vie, le corps, « la région unique », « la région ontologique du Körperleib29 », dit le neurophénoménologue F. Varela, c’est là que tout commence. Ainsi la passion : « Ça commence par une brûlure dans la poitrine et après ça s’appelle amour », ou : « D’abord le feu, et ensuite la traduction de l’incendie », ou encore : « Tout est expérience, d’abord. Ensuite30… »
Le domaine de la phusis d’abord, celui du logos ensuite. Il y a là deux temporalités et une exigence de priorité, une hiérarchie à préserver. C’est bien « à partir de » l’instance corporelle qu’opère la « conscience », l’instance judicative, et que se construit le texte :
Le corps ne se trompe jamais : avant la conscience il enregistre, il amplifie, il rassemble et relève au-dehors avec une implacable brutalité des multitudes d’impressions infimes, insaisissables, éparses31…
La méconnaissance de cette règle de lecture (le « corps » avant la « conscience », c’est-à-dire, en phénoménologie du langage, l’obligation pour l’instance de réception de repérer les prédicats somatiques dont dépendent les prédicats cognitifs), plus généralement de cette règle de production (il faut se garder de la contamination des prédicats somatiques par les prédicats cognitifs), met en péril l’œuvre elle-même. En témoigne, par exemple, un peintre, Cézanne :
L’artiste n’est qu’un réceptacle de sensations, un cerveau, un appareil enregistreur, mais si je pense en peignant, si j’interviens, patatras ! Tout fout le camp32.
Remarquons encore qu’en passant de la phusis au logos nous changeons de régime instanciel. L’instance énonçante du monde naturel, l’instance corporelle de la phusis, le non-sujet, n’a pas le même statut que l’instance énonçante appartenant au domaine cognitif, l’instance judicative du logos, le sujet, même si l’indicateur linguistique est identique. Merleau-Ponty distingue ainsi le « je » de : « je vois le bleu du ciel » (on pourrait opérer de même avec le « je » de : « Je vois Caton se promener ») du « je » de « je comprends le contenu de ce livre » (comparable au « je » de « Je dis : Caton se promène »). Le « je » de « je vois le bleu du ciel » ou de « je vois Caton se promener » n’est que l’indicateur linguistique d’un opérateur de prédicat somatique (le « voir » de la perception, de l’instance percevante) auquel le nom métalinguistique « on », retenu par Merleau-Ponty, convient assez bien. Voici deux citations :
Si je voulais traduire exactement l’expérience perceptive, je devrais dire qu’on perçoit en moi et non pas que je perçois33.
Chaque perception renouvelle en nous l’expérience d’un On primordial, puisque la communication ne fait pas problème à ce niveau, et ne devient douteuse que si j’oublie le champ de perception pour me réduire à ce que la réflexion fera de moi34.
La leçon est claire pour un phénoménologue du langage. Si j’oublie le champ de perception où opère le non-sujet, je risque de « me réduire » à l’état de sujet. C’est dire que le non-sujet a le pas sur le sujet. La figure spatiale de ces deux étages successifs, l’un, « primordial », celui de la phusis, du non-sujet, opérateur d’un prédicat somatique, l’autre, qui lui est subordonné, celui du logos, du sujet, opérateur d’un prédicat cognitif, a son exact correspondant dans les deux phases temporelles de l’avant et de l’après. C’est cette relation entre phusis et logos, entre instance corporelle et instance judicative, que l’épisode célèbre du réveil du narrateur, raconté dans les toutes premières pages de À la Recherche du temps perdu, met parfaitement en lumière. Au moment où l’instance
judicative (le sujet) s’avère inopérante pour reconnaître les formes et les lieux (« mon esprit » s’agite pour chercher, « sans y réussir », à reconnaître la pièce où il se réveille), l’instance corporelle (« mon corps ») prend le relais et accomplit, à sa place, dans le champ de perception qui lui est propre, les opérations de reconnaissance spatiale, et, finalement, assure les conditions du retour du sujet :
Quand je me réveillais, mon esprit [logos] s’agitant pour chercher, sans y réussir, à savoir où j’étais, tout tournait autour de moi dans l’obscurité […]. Mon corps [phusis] trop engourdi pour remuer, cherchait, d’après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu’autour de lui les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée [logos], qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui – mon corps [phusis] – se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l’existence d’un couloir, avec la pensée que j’avais en m’y endormant et que je retrouvais au réveil35.
Le corps propre (« mon corps ») est doté d’une « fonction exploratrice » de son environnement, plus généralement, d’une « fonction de connaissance », comme le souligne Merleau-Ponty renvoyant à la Cinquième Méditation cartésienne de Husserl36. Il serait donc inexact de dire que le corps se substitue à un esprit défaillant ; il a sa démarche spécifique. Il ne mène pas à bien des opérations cognitives, abstraites ; il s’appuie sur une expérience corporelle, concrète, sur « la forme de sa fatigue », pour mettre en place les prédicats somatiques de la connaissance.
Sans doute, le lexique est celui de l’univers du logos, mais entrés dans l’univers de la phusis, dans le champ de perception, les termes changent de statut : de ce fait, « repérer », « induire », « reconstruire », « nommer », « se rappeler » sont des opérations à redéfinir. La perception n’a pas d’appui stable, ni du côté du corps percevant ni du côté des objets pris comme cibles. Elle est contrainte par la « forme de [la] fatigue » du corps
percevant, nous dit-on. Des points de vue « successifs » s’offrent alors à lui selon la mémoire que ses membres en ont gardée : la mémoire, oui, mais plus précisément, trois sortes de mémoire : « la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules ». Il en va de même pour les objets. Nous manquons de repères pour les localiser : les murs sont « invisibles ». Comment sont-ils perçus ? On n’en sait rien. Néanmoins, « ils changent de place », mieux, « ils tourbillonnent dans les ténèbres ». Ce sont des êtres sans frontières, non identifiables ; plutôt que des objets, des quasi-objets.
Ainsi s’achève – provisoirement – mon plaidoyer pour la reconnaissance de l’univers de la phusis. On aurait intérêt, me semble-t-il, à le considérer comme un bon antidote à la violence du logos.
Jean-Claude Coquet
Université Paris VIII
1 Voir par exemple E. Danblon, L. Nicolas (éd.), Les Rhétoriques de la conspiration, Paris, CNRS éditions, 2010 [note de l’éditeur].
2 C’est le même problème que pointe Hélène Cixous lorsqu’elle note, selon une approche et une thématisation apparemment différentes : « Presque toute l’histoire de l’écriture se confond avec l’histoire de la raison dont elle est à la fois l’effet, le soutien, et un des alibis privilégiés. » (H. Cixous, Le Rire de la Méduse, La Jeune Née – L’Arc, Paris, Galilée, 2010 [1975]).
3 Voir mes commentaires dans Hermès mutilé – Vers une herméneutique matérielle, Paris, Champion, 2005, et dans « Les choses sont pathétiques », Émotions et Discours, M. Rinn (éd.), Rennes, PUR, 2008, p. 59-64.
4 Comme l’a si précisément dénoncé A.-W. Schlegel dans La Doctrine de l’art – Conférences sur les belles lettres et l’art, trad. M. Géraud et M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 2009, de la Kunstlehre de Berlin en 1801.
5 Voir Sorties, Paris, Questions théoriques, 2009. On pourrait aussi prendre sous ce point de vue le surprenant livre de Lionel Ray, L’Invention des bibliothèques, Paris, Gallimard, 2007.
6 À un moindre degré, mais selon la même logique, c’est l’ensemble des pratiques, bien actuelles, de la désinformation.
7 Pour évoquer la formule, si mal comprise, de Roland Barthes.
8 Organisée à l’université Paris-Sorbonne en mai 2009 (voir introduction du présent volume) [note de l’éditeur].
9 Les données de cet argumentaire sont reprises dans l’introduction du présent livre [note de l’éditeur].
10 F. Nietzsche, Vérité et Mensonge au sens extra-moral, Arles, Actes Sud, « Babel », 1997 [1873], p. 70.
11 Platon, Phédon, 99e, trad. P. Vicaire (à l’exception de psuchè que Vicaire a traduit par « esprit »), Paris, Les Belles Lettres, 1983, p. 78.
12 H. Putnam, Représentation et Réalité, Paris, Gallimard, 1990, p. 80-81.
13 J. J. Katz et J. A. Fodor, « The Structure of a Semantic Theory », Language, XXXIX, April-June 1963, repris dans « Structure d’une théorie sémantique », Cahiers de Lexicologie, 1966-2, p. 39 et 1967-1, p. 65.
14 « Entretien avec Antonio Negri », Le Monde, 13 juillet 2007.
15 A. Culioli, Variations sur la linguistique, Paris, Klincksieck, 2002 ; A. Culioli et C. Normand, Onze Rencontres sur le langage et les langues, Paris, Ophrys, 2005.
16 Sénèque, Lettres à Lucilius, Livres XIX et XX, Paris, Les Belles Lettres, 2003.
17 A. Culioli et C. Normand, op. cit., p. 252.
18 J.-C. Coquet, Phusis et Logos. Une phénoménologie du langage, « Avant-propos », Presses Universitaires de Vincennes, 2007, p. 8.
19 A. Culioli et C. Normand, loc. cit.
20 Sénèque, loc. cit.
21 A. Culioli, op. cit., p. 52.
22 L’expression est de Benveniste : « Coup d’œil sur le développement de la linguistique », Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 25.
23 M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 106 ; É. Benveniste, « Le langage et l’expérience humaine », Problèmes de linguistique générale, t. 2, Paris, Gallimard, 1974, p. 68.
24 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 277.
25 Ibid., « Avant-propos », p. ii.
26 F. Nietzsche, op. cit., p. 30.
27 M. Merleau-Ponty, Signes, op. cit., p. 204.
28 H. Cixous, Entre l’écriture, Paris, Des Femmes, 1986, p. 63.
29 F. Varela, « Quatre phares pour l’avenir des sciences cognitives », Théorie, Littérature, Enseignement, no 17, 1999, p. 19.
30 H. Cixous, On ne part pas, on ne revient pas, Paris, Des Femmes, 1991, p. 52. Photos de racines, Paris, Des Femmes, 1994, p. 28 et 66.
31 N. Sarraute, Le Planétarium, Paris, Gallimard, 1959, p. 63.
32 J. Gasquet, Cézanne, La Versanne, Encre Marine, 2002 [1921], p. 237.
33 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 249.
34 M. Merleau-Ponty, Signes, op. cit., p. 221.
35 M. Proust, À la Recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, p. 6.
36 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 109.