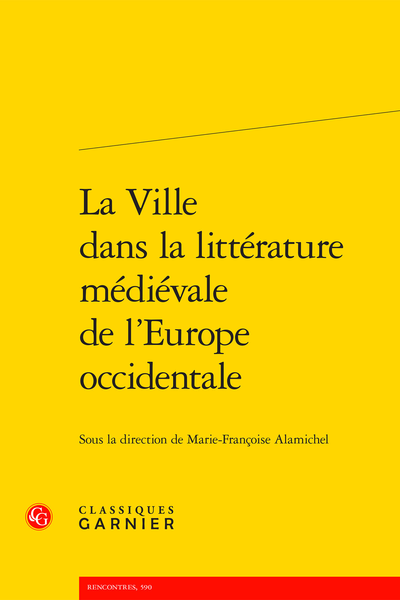
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Ville dans la littérature médiévale de l’Europe occidentale
- Pages : 623 à 625
- Collection : Rencontres, n° 590
- Série : Civilisation médiévale, n° 55
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406150008
- ISBN : 978-2-406-15000-8
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15000-8.p.0623
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/08/2023
- Langue : Français
Résumés
Marie-Françoise Alamichel, « Introduction »
L’introduction fait un bref bilan des études urbaines menées par les historiens médiévistes et précise que le but de l’ouvrage est de distinguer le discours propre à la ville littéraire médiévale. Elle résume et souligne les points saillants des neuf chapitres et de la conclusion.
Pierre Levron, « Définir la ville. La mise en mots »
Ce chapitre interroge le vocabulaire utilisé pour désigner une ville. Il part d’un premier constat : « ville » est un mot ambigu en ancien français, parce qu’il peut désigner un village. Il s’intéresse alors aux emplois urbains du mot, mais aussi aux mots chastel, et cité, ainsi qu’aux caractéristiques lexicales de l’urbanité, ainsi qu’au vocabulaire de l’anglais, de l’espagnol, de l’italien et de l’allemand médiévaux.
Frédéric Alchalabi, « La description des villes »
La descriptio civitatis était un exercice défini depuis l’Antiquité, fait de passages obligés et consacrés aux fondateurs de villes, à l’environnement et à l’architecture de ces dernières. La vocation du chapitre est de présenter aux lecteurs quelques descriptions de villes extraites de près de quarante œuvres écrites tout au long du Moyen Âge, de les étudier et de les comparer entre elles.
Pierre Levron, « La ville médiévale. Ordre social et institutions »
La ville est une agglomération complexe : notoriété, population et surtout l’existence d’institutions municipales et économiques en sont les caractéristiques. Les textes parlent aussi de l’existence d’aristocraties urbaines. De plus, les villes sont le siège de pouvoirs cléricaux : spirituels, administratifs et judiciaires, 624et apparaissent parfois comme des espaces à christianiser. A contrario, Peire Cardenal fait de la ville un lieu désorganisé par la folie.
Marie-Françoise Alamichel, « Le dynamisme des rues. Métiers, argent, activités »
Peut-on parler de littérature urbaine ? La ville est étudiée comme lieu de vie économique. Les textes littéraires présentent le paysage urbain visuel et sonore de la rue. Certains auteurs se font moralisateurs et condamnent les marchands, figures d’Avaritia. D’autres se focalisent sur les fêtes, processions ou jeux théâtraux – forme littéraire urbaine par excellence, le théâtre s’étant développé et épanoui dans les cités.
Danielle Buschinger, « Chroniques urbaines. L’exemple de l’espace germanophone à la fin du Moyen Âge »
À la fin du Moyen Âge naissent dans l’Empire de nombreuses chroniques urbaines qui secondent la conscience et la compréhension que la ville et ses habitants ont d’eux-mêmes et sauvegardent leur pouvoir de plus en plus contesté. Elles ont une fonction essentiellement didactique : elles ont pour mission d’instruire les communautés. Elles ont aussi une fonction politique : elles contribuent à la stabilisation de l’ordre établi et, dans ce contexte, on les utilise comme arme de propagande.
Marie-Françoise Alamichel, « Troie, la ville des origines »
Troie est le lieu fantasmé des toutes les richesses et merveilles orientales. Les diverses réécritures européennes du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure sont passées en revue et permettent une réflexion sur la question de la description. Les Troyens ont été revendiqués comme ancêtres prestigieux notamment en Angleterre où Londres est longtemps nommée la « Nouvelle Troie » et célébrée en tant que telle.
Marie-Françoise Alamichel et Pierre Levron, « Rome, ville antique et cité papale »
La décadence de Rome au Moyen Âge est analysée. L’ancienne « Reine du monde » n’est pas décrite autrement que les autres villes des romans médiévaux. 625Seuls le nombre d’églises et les indulgences associées la distinguent. Les guides pour pèlerins sont alors présentés. Le chapitre s’interroge sur le vocabulaire qui est utilisé pour désigner le pape et traite ensuite des pouvoirs de ce dernier : célébrer, parfois enseigner et défendre les dogmes, et être un souverain spirituel et temporel.
Pierre Levron, « “Que je ne t’oublie pas, Jérusalem !” ou Jérusalem entre les discours. Enquête dans les textes littéraires vernaculaires médiévaux »
Les littératures médiévales connaissent deux villes de Jérusalem : la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. La première, ville de pèlerinage, est décrite sous l’angle des lieux saints, et les textes parlent parfois de pèlerins illustres, comme Charlemagne. La seconde procède de l’Apocalypse selon saint Jean : elle apparaît dans la littérature religieuse vernaculaire, mais aussi dans des textes plus polémiques comme la Comédie de Dante.
Frédéric Alchalabi, « D’une Constantinople, l’autre »
La description de Constantinople dans les témoignages laissés par les auteurs du Moyen Âge n’est jamais uniforme : elle dépend du contexte politique, religieux, économique et historique entourant la rédaction des œuvres que les écrivains lui ont consacrées. Ainsi, plusieurs auteurs de l’époque ont célébré, blâme ou idéalisé Constantinople : les passages qu’ils ont écrits à propos de cette dernière sont étudiés dans le chapitre.
Raffaella Zanni, « En guise de conclusion. Bannissement, éloignement : pleurer sa ville »
La conclusion présente des chansons d’éloignement italiennes contenues dans le Chansonnier du Vatican. La ville, Florence ou Pise, y est désignée comme la dame lointaine de la poésie amoureuse : dame et ville, « dame-ville » sont au cœur des pensées du poète même si ce dernier est physiquement en dehors de la ville.