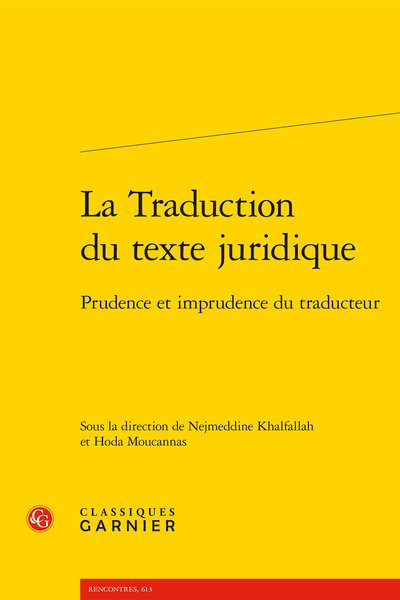
Conclusion
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Traduction du texte juridique. Prudence et imprudence du traducteur
- Résumé : Le résultat des travaux présentés montre que la prudence dans le domaine traductique n’est pas une simple disposition de l’esprit, mais un processus global de vérification qui se déclenche à la quête non seulement des équivalences mais aussi des éléments contextuels de la réception.
- Pages : 327 à 329
- Collection : Rencontres, n° 613
- Thème CLIL : 3146 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage
- EAN : 9782406161301
- ISBN : 978-2-406-16130-1
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16130-1.p.0327
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/03/2024
- Langue : Français
- Mots-clés : Traduction juridique, prudence, traduction politique, terminologie juridique, juritraductologie
Conclusion
Loin d’être une disposition de l’esprit ou une vérification anodine, la prudence est, dans le domaine de la traduction formelle, un processus qui reprend en amont le texte-cible. Mais elle n’est pas seulement un réexamen où l’on arrête de reformuler le texte, pendant un moment, avant de lui donner sa forme définitive. Elle est surtout un moment, ouvert à diverses possibilités (approbation ou rejet des choix traductiques, leur maintien ou disparition), où se déclenche ce processus de vérification dans lequel les influences socioculturelles et les convictions idéologiques interfèrent avec les composantes linguistiques.
On ne vérifie pas seulement la correction formelle du texte produit, mais aussi sa conformité aux normes, explicites ou implicites, qui régissent la communauté de lecteurs à laquelle s’adresse le traducteur. Leur « horizon d’attente », selon l’expression de Hans Robert Jauss (1921-1997), doit être non seulement respecté, mais aussi assouvi ; des normes tracées par le pouvoir politique en place, parfois mélangées à des règles éthiques, sont également à prendre en compte lors de ce moment cognitif de prudence. Celle-ci ne prémunit donc pas contre l’erreur ; mais elle protège le texte-cible de la trahison de sa source et de la déformation de son identité profonde auprès de son public. Cela faisant, elle le protège contre toute maladresse d’interprétation ou faute de décryptage. Ainsi, l’ultime fonction de la prudence est de ne pas brouiller les voies de la réception, dans l’acception la plus large du terme.
En effet, les quinze chapitres, dont se compose ce volume, ont voulu montrer, grâce aux concepts théoriques mobilisés et aux nombreux cas pratiques analysés, que la prudence est un mouvement global de l’esprit, activant toutes sortes de compétences intellectuelles afin d’éviter les distensions entre les textes-sources et les textes-cibles. Or, au-delà de cette dimension purement formelle, suggérant des corrections de style par simple précaution d’usage, la prudence s’attache à la conformité du « rendu » définitif aux contraintes et règles normatives qui régissent la 328société. Car, on ne traduit pas un texte juridique ou politique comme l’on traduit un passage littéraire, journalistique ou informel. Les enjeux ne sont nullement les mêmes ; la solennité impose des normes et des règles profondément différentes qui font du discours juridique une entité nettement plus sensible que les autres discours.
Sous forme de dispositifs mentaux, la prudence est axée sur la conformité des équivalences afin d’éviter tout risque d’erreur, d’imprécision ou de discordance. Il s’agit de tout faire pour trouver l’équivalence, non seulement la plus fidèle et la plus proche sur le plan linguistique, mais aussi la plus à même de faire en sorte que le texte-cible respecte leshorizons d’attente du public concerné et remplisse les mêmes effets escomptés. Ce sont les valeurs du public, ses angoisses et désirs qui agissent en arrière-plan, comme des contraintes assimilées par les traducteurs. Plutôt commettre des imperfections stylistiques que heurter l’horizon idéel et l’univers normatif des destinataires de la traduction.
Ce sont ces valeurs mêmes qui influencent, le plus souvent implicitement, la quête d’équivalence entre les modalités de découpage de l’expérience humaine ; comme il n’est nullement aisé de superposer les catégories d’une expérience à une autre, on veille, par cette prudence, à assurer la parfaite conformité entre les deux manières de percevoir et d’interpréter les faits de ce monde. C’est grâce à cette inlassable quête d’équilibre et de conformité que l’on réexamine les outils morphologiques, syntaxiques et métaphoriques afin d’éviter toute sorte de distension.
La prudence est donc un processus souterrain et quasi inconscient qui puise ses éléments dans les ressources linguistiques et notionnelles afin d’offrir l’équivalent le moins périlleux, celui qui porte le moindre risque quant à la réception dans son contexte socioculturel. La prudence devient ainsi l’art de gérer les risques liés au transfert des diverses manières de découper la réalité (droit, politique, diplomatie…) d’un espace sémantique à l’autre.
Or, dans la pratique quotidienne de la traduction, la prudence n’a pas vocation àplonger dans les profondeurs des visions du monde ni à retrouver les structures anthropologiques propres à chaque culture et à chaque système juridique ou politique. Elle n’a pas non plus vocation à surmonter le nihilisme relatif à l’impossibilité de la traduction. Plus modestement, la prudence ne vise qu’à produireun message formel réussi avec un moindre risque d’incorrection linguistique, d’incohérence 329logico-sémantique et d’incapacité à produire les effets juridiques et politiques escomptés.
Se trouvant sur une ligne de crête, la prudence vise un équilibre toujours délicat, entre les signes des deux systèmes linguistiques et culturels. On cherchera la concordance la plus parfaite où « pertes » et « ajouts » sont minimalisés. L’espoir est de conserver les mêmes valeurs connotatives, stylistiques, conceptuelles et pragmatiques de chaque texte.
Les dizaines d’exemples analysés tout au long de cet ouvrage ont été puisés dans différentes branches du droit et sphères politiques, pris de plusieurs aires culturelles (arabe, espagnole, italienne, anglaise etc.) de l’époque moderne. Ces exemples ont tous montré que la prudence ne provient pas seulement de la nécessité de restituer fidèlement le contenu, mais de la nature profonde des discours formels traduits. Car, plus que les autres domaines de l’activité humaine, les énoncés solennels nécessitent ces précautions sous peine de ne point remplir leurs fonctions. En effet, la moindre imprudence pourrait causer non pas la perte du sens, mais celle de l’effet juridique même. Et dans des cas extrêmes, la perte de biens et de vies humaines.
Cet ouvrage a donc cherché à formaliser le principe de prudence, non pas en tant que donnée psychologique ou modalité discursive. Au travers de ses chapitres successifs, il a montré que la prudence, en traductologie, est une position intellectuelle, qui décortique aussi bien le contexte de départ que celui d’arrivée, pour une reconstruction du sens, aboutissant à une meilleure concordance entre les deux textes ; le plus haut degré d’isomorphisme est visé.
Il s’agit donc d’une performance générale qui s’arrête avant d’agir, vérifie avant de prendre la décision, sonde le contexte en profondeur pour éviter le moindre péril : perdre ou ajouter une trame cognitive, si minime soit-elle, manquer les effets de la parole solennelle ou l’une de ses dimensions intellectuelles…
En formalisant ce principe et en l’illustrant par maints exemples, nous avons tenté de sortir la prudence de la sphère psychologique pour la décrire comme une stratégie globale qui déconstruit le contexte traductique et le reconstruit par la suite ; mouvement interminable, toujours peu satisfaisant, le respect du texte-source n’étant qu’une des composantesdece tout. Néanmoins, nous espérons que cette humble contribution sera à même d’ouvrir de nouvelles voies dans les études concernant le domaine de la juritraductologie.