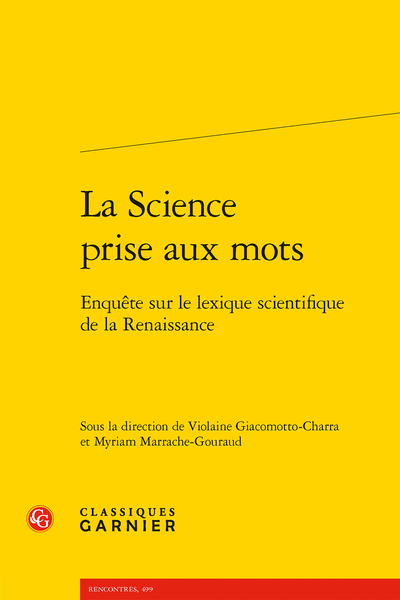
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Science prise aux mots. Enquête sur le lexique scientifique de la Renaissance
- Pages : 451 à 456
- Collection : Rencontres, n° 499
- Série : Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n° 115
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406109976
- ISBN : 978-2-406-10997-6
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10997-6.p.0451
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/05/2021
- Langue : Français
Résumés
Violaine Giacomotto-Charra et Myriam Marrache-Gouraud, « Des noms du savoir et de leurs avatars »
De quels noms variés se pare le savoir, et quelle pluralité de mots et de nuances insoupçonnées se nichent dans les termes les plus génériques et apparemment les plus anodins ? Cette introduction à la première partie s’attache à réfléchir aux mots qui servent à nommer la science et le désir de connaître, et à comprendre comment la science de la Renaissance se nomme elle-même.
Guylaine Pineau, « Ambroise Paré et le “desir curieux, d’apprendre tout ce qui se peut sçavoir” »
Pour caractériser l’attitude d’Ambroise Paré face à l’homme, la notion de curiosité s’impose à l’esprit du lecteur moderne. Mais si l’idée est omniprésente dans les Œuvres du chirurgien, le terme, en réalité, n’apparaît guère. Cet article s’attache à expliquer cet apparent paradoxe grâce à une enquête lexicale minutieuse sur la notion de curiosité, pour comprendre ensuite l’usage qu’en fait Paré et la manière dont s’exprime finalement chez lui l’appétence au savoir.
Nicolas Corréard, « Curiosité/pérégrinité, métaphore viatique et points de vue critiques sur le désir savant »
Les mots désignant le désir de savoir dans les langues européennes, dont ceux de la famille de cura et la notion de curiositas, sont, à la Renaissance, fortement connotés, et font l’objet d’une fluctuation importante. Cet article s’attache à montrer comment l’absence d’une notion neutre pour désigner cette libido sciendi laisse place à d’autres familles de mots, comme celle qui dérive des verbes latins peragrare (« parcourir », « visiter ») et peregrinari (« voyager à l’étranger », « être en exil »).
452Noémie Castagné, « Les mots de la “scienza delle mecaniche”. Dans le laboratoire de la traduction du Mechanicorum liber »
Le Mechanicorum liber est un traité de théorisation mécanique consacré à cinq mécanismes élémentaires, pouvant servir à élaborer des engins plus complexes. Sa traduction fut entreprise par Filippo Pigafetta, mais, face à la complexité de la tâche, il sollicita l’aide de l’auteur du traité. La correspondance exceptionnelle conservée entre les deux hommes permet d’étudier les questions soulevées par la constitution progressive d’un lexique technique en langue italienne à la Renaissance.
Violaine Giacomotto-Charra et Myriam Marrache-Gouraud, « Expérimenter l’expérience, “maistresse des choses douteuses” »
Le mot experience et son corollaire pratique, ainsi que l’ensemble de ce qu’ils recouvrent, sont l’objet de cette deuxième partie. Parce que la notion d’experience concerne toutes les disciplines et se trouve au cœur des pratiques et usages de la science de la Renaissance, cet article introductif s’attache à en définir et à en préciser le sens, ainsi qu’à faire le point sur la place et la valeur de l’expérience dans la science de la Renaissance.
Juliette Ferdinand, « Pratique vs Théorie dans l’œuvre de Bernard Palissy. De l’art à l’épistémologie »
Dans ses écrits, le céramiste et naturaliste Bernard Palissy emploie très rarement le terme expérience. En tant que concept en revanche, l’expérience constitue le fondement de sa pensée et de son approche de l’art et de la science. C’est pourquoi une analyse du lexique de Palissy s’avère nécessaire pour qui veut comprendre comment le céramiste invente ce que l’on a pu qualifier de « discours de l’expérience ».
Laurent Paya, « Les savoirs fondés sur l’expérience du Jardinage d’Antoine Mizauld »
Parmi les sources inexplorées en mesure de contribuer à une histoire des savoirs scientifiques figure le Jardinage d’Antoine Mizauld. L’auteur est le promoteur d’une théorie de la médecine astrologique et adopte ici l’attitude d’un médecin du jardin. Or cette méthode à visées curative et préventive est partiellement fondée sur ce qu’il nomme des « experiences », qui dépendent d’une rationalité différente de la nôtre et que cet article s’attache à éclairer.
453Valérie Worth-Stylianou, « L’expérience dans les traductions en français des traités de médecine »
Les traductions du latin – et parfois du grec – vers le français occupent une place très importante dans l’édition médicale de la Renaissance et la notion d’expérience y joue un rôle, parce qu’on traduit d’abord les ouvrages pratiques. L’étude des préfaces de ces textes permet de montrer comment les traducteurs de la Renaissance comprenaient la notion d’expérience dans divers domaines de la médecine.
Hervé Baudry, « Réflexion sur la notion d’expérience. Un censeur méconnu de Montaigne, le médecin Antoine Martin »
Consacrée à l’ouvrage d’Antoine Martin, la présente étude s’attache à suivre de près l’antimontaignisme de ce médecin. Elle considère, dans un premier temps, les aspects majeurs de sa critique des idées médicales de Montaigne puis, dans un second, se focalise sur la notion, centrale dans l’histoire de la philosophie naturelle, d’expérience. Malgré le retentissement réduit de ce traité, l’argumentation que l’auteur développe met en lumière l’étendue et les paradoxes du séisme provoqué par les Essais.
Michel Pretalli, « L’expérience dans la littérature militaire italienne de la fin du xvie siècle. La rhétorique au service de la légitimation de l’expertise »
Les guerres d’Italie ont été l’occasion de nombreuses publications d’ouvrages d’art militaire. Or l’expérience y occupe une place cruciale : cet article propose d’étudier les définitions diverses qu’ils en donnent, afin de mettre en lumière la manière dont ces différences influent sur les conceptions de l’expertise et de l’art militaires que leurs auteurs défendent, notamment dans la perspective des stratégies de promotion personnelle que ces traités mettent en œuvre.
Aurélien Ruellet, « L’expérience et le système des privilèges d’invention au xviie siècle »
Au cours de l’époque moderne, les « inventeurs » parviennent à se faire reconnaître des droits spécifiques et, au moment même où émerge la méthode expérimentale moderne, les États européens délivrent des protections juridiques à de supposées inventions. Quels étaient les interférences entre les deux 454phénomènes ? Fait-on appel à la méthode expérimentale pour ces expertises ? L’article propose de répondre à ces questions à partir de l’étude de la France et de l’Angleterre du premier xviie siècle.
Violaine Giacomotto-Charra et Myriam Marrache-Gouraud, « Voir pour savoir ? »
Au xvie siècle, et tout particulièrement dans sa seconde moitié, on assiste à une autonomisation croissante des mots et des concepts d’observatio par rapport à experientia. Observatio devient un moyen d’affirmer et de désigner un nouveau geste épistémique, mais aussi d’affirmer l’existence d’un personnage nouveau dans le paysage scientifique, l’observateur, qui n’est pas seulement celui qui observe, mais aussi celui qui organise et ordonne le savoir dans un livre issu de ses observations.
Grégoire Holtz, « Du respect des coutumes à l’affirmation de l’autopsie. Le statut des “observations” dans la littérature de voyage de la Renaissance »
Comment partager ses observations ? Peut-on les faire vérifier par d’autres témoins ? Selon quel protocole, mais aussi en fonction de quelles limitations ? Est-ce que la généralisation du terme observation et ses dérivés induit une nouvelle forme d’échange scientifique ? Cette étude tente de répondre à ces questions en les adressant à un corpus d’écrits empiriques où le statut de l’observation est privilégié, à savoir les récits de voyages qui fleurissent dans le siècle des premières circumnavigations.
Juliette Ferdinand, « “En contemplant tu connaîtras”. Voir contre savoir dans les écrits de Bernard Palissy »
La correspondance entre ce que l’œil observe, ce que l’artiste représente et ce que le naturaliste expose est au cœur des écrits de Bernard Palissy : ses œuvres d’art s’inspirent de la nature observée et ses intérêts scientifiques concernent les phénomènes qu’il peut observer à l’œil nu. Son approche engage deux types de relations à la nature : l’observation directe et l’expérimentation manuelle. L’article examine ici le rôle joué par la vue dans l’acquisition des connaissances sur la nature.
455Philippe Glardon, « Images et descriptions écrites. Éléments discursifs dans les traités d’histoire naturelle du xvie siècle »
Il reste encore beaucoup à faire sur l’analyse de l’image scientifique du xvie siècle. Cet article souhaite, dans une perspective holistique, tenter de reconstituer le facteur de cohésion qui existe entre le texte et l’illustration, mis à mal par notre regard moderne. Pour ce faire, il s’attachera à l’étude de ce que notre regard d’aujourd’hui pourrait être tenté d’interpréter comme des « erreurs » picturales dans les traités d’histoire naturelle de la Renaissance.
Claude La Charité, « “Diligemment contempler”. L’histoire entiere des poissons, de Guillaume Rondelet »
Le présent article étudie la manière dont se manifeste l’idéal d’autopsie consistant à « voir pour savoir », dans le rapport entre le texte et l’image, l’original latin et sa traduction française, mais aussi entre la vue et les autres sens sollicités dans l’observation de la vie marine sous toutes ses formes chez Rondelet. Il permet d’éclairer les fondements épistémologiques de l’ichtyologie de Rondelet, entre logique et rhétorique, vue et contemplation, de l’invisible jusqu’à l’indicible.
Emmanuelle Lacore-Martin, « Le regard de l’anatomiste. De l’immatérialité de la vue à la vérité du discours chez André Du Laurens »
Cet article montre comment, au seuil de son traité d’ophtalmologie, André Du Laurens souligne l’importance de la publication la plus large possible des découvertes médicales et place l’ensemble de son discours médical sous le signe de la transparence, transparence de la communication scientifique, mais aussi transparence qui structure en profondeur la théorie de la vue dont il s’apprête à faire l’exposé, liant théorie de la vision et théorie du savoir.
Benoît Jeanjean, « La vision du xviiie siècle sur la science du xvie. Le cas des planches anatomiques d’Eustache publiées par Giovanni-Maria Lancisi »
En 1714 paraissent les Tabulæ Anatomicæ de Bartholomée Eustache, éditées par Lancisi. Il ajoutait à ces planches anatomiques du xvie siècle ses propres commentaires, inspirés par la confrontation entre la qualité des planches et l’état des connaissances médicales au début du xviiie. Le travail de l’anatomiste 456s’y traduit par une série de mots qui rendent compte de l’observation médicale et de sa diffusion auprès de la communauté scientifique.
David Banks, « Le procès de perception dans la presse savante à la fin du xviie siècle »
Cette contribution analyse l’usage des procès de perception en utilisant les catégories de la linguistique systémique fonctionnelle, afin de mesurer à quel point l’usage diffère entre deux publications savantes de référence, l’une française, l’autre anglaise. La discussion de ces différences permet de faire apparaître les variations provoquées par l’interface entre sciences humaines et sciences exactes, et celles engendrées par les approches empiriste et cartésienne.
Benoît Jeanjean, « Les pages liminaires du Theatrum orbis terrarum d’Ortelius. Vision du monde ou image de l’auteur ? »
En marge de l’objet du Theatrum orbis terrarum s’élabore au fil des éditions un ensemble liminaire destiné à introduire le lecteur à la découverte des cartes et à faire l’éloge de celui qui les a rassemblées. Plusieurs éléments de ces pages liminaires sont ici analysés afin d’observer comment elles disposent le lecteur à appréhender cet ouvrage d’un genre nouveau et comment elles superposent les mots de la poésie et le langage de l’image aux mots de la science.