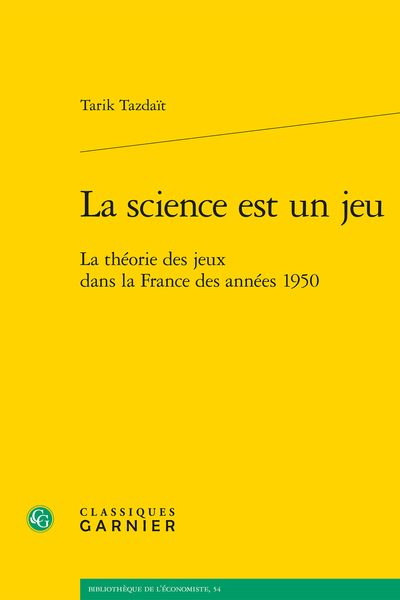
Préface de l'auteur
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La science est un jeu. La théorie des jeux dans la France des années 1950
- Pages : 9 à 10
- Collection : Bibliothèque de l'économiste, n° 54
- Série : 1, n° 32
- Thème CLIL : 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN : 9782406143758
- ISBN : 978-2-406-14375-8
- ISSN : 2261-0979
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14375-8.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/03/2023
- Langue : Français
PRÉFACE DE L’AUTEUR
L’idée que la théorie des jeux a été introduite en France par les économistes vers la fin des années 1970, en raison notamment de ses succès dans l’étude des structures de marché, est largement admise. Comment cette idée s’est-elle imposée ? Je suis incapable d’y répondre. Je sais juste qu’elle était tellement ancrée que je l’avais également fait mienne. à aucun moment je n’avais cherché à en savoir plus ou à faire l’effort de vérifier ce qu’il en était du statut de la théorie des jeux dans la France des années 1950 et 1960.
Aussi me retrouver à envisager ce manuscrit était loin d’être une évidence. Il m’a fallu beaucoup de temps pour y arriver, le temps d’être moi-même convaincu que la théorie des jeux a bien eu une vie en France avant les années 1970.
Tout a commencé en 2005 alors que j’avais été invité par le département d’économie de l’Université de Bejaïa en Algérie pour donner une conférence sur le changement climatique. Y séjournant durant une semaine, j’en ai profité pour voir ce qui se faisait dans le département de mathématiques. J’y ai alors rencontré Mohamed Said Radjef. Nous avons discuté théorie des jeux et il m’a appris qu’un programme de recherche avait été développé à partir de la fin des années 1980 dans l’ex Union Soviétique, pays où il avait été formé, autour d’un concept de solution appelé l’équilibre de Berge. Il m’avait également appris que celui qui avait lancé ce programme de recherche était son directeur de thèse, Vladislav Iosifovich Zhukovskii, et que le concept de solution en question découlait d’un ouvrage du mathématicien français Claude Berge, Théorie générale des jeux à n personnes. Cet ouvrage avait été publié en 1957 dans la fameuse collection « Mémorial des sciences mathématiques » des éditions Gauthier-Villars.
Revenant en France avec, entre les mains, un article de Radjef sur l’équilibre de Berge, j’ai rapidement investi cette notion avec Rabia 10Nessah, Pierre Courtois et Olivier Musy1. Mais, plus que notre travail sur l’équilibre de Berge, tout le temps de mon retour une question n’a cessé de me perturber : pourquoi en France personne ne connaissait l’ouvrage de théorie des jeux de Berge. J’en avais en effet parlé à plusieurs personnes et aucune d’elles ne savait que Berge avait rédigé cet ouvrage.
J’ai donc porté mon attention au parcours de Berge pour m’apercevoir qu’il était en rapport avec d’autres mathématiciens français qui avaient eux aussi rédigé dans les années 1950 des articles sur la théorie des jeux. Parmi eux, on trouve Georges-Théodule Guibaud, Marcel-Paul Schützenberger ou encore Benoît Mandelbrot. Or, ces mêmes mathématiciens étaient eux-mêmes en rapport avec des auteurs de sciences sociales qui ont cherché à utiliser la théorie des jeux à l’image, par exemple, de Claude Lévi-Strauss, Jean Piaget et d’autres. À côté de ces auteurs, il y a tous ceux qui ont fait l’éloge de la théorie des jeux comme cadre formel à même de concourir au renouvellement de leur discipline comme ce fut le cas, par exemple, de l’historien Fernand Braudel. On pourrait ajouter ceux dont on n’imaginait pas que leur discipline pouvait se prêter au recours de cette approche. L’exemple le plus significatif en est le compositeur Iannis Xenakis qui en a fait un usage original pour la création de trois de ses compositions symphoniques.
De fil en aiguille, je me suis aperçu que la théorie des jeux n’avait pas attendu les années 1970 pour faire parler d’elle. Sa réception et sa diffusion avaient commencé bien avant : dès les années 1950 ils étaient déjà un certain nombre à s’y reconnaître, et nous attacher à leur histoire c’est ce qui donne sens à ce manuscrit.
1 L’article de Radjef, publié en 1988 dans les Cahiers mathématiques de l’université d’Oran, est celui sur lequel les premiers travaux anglo-saxons sur l’équilibre de Berge vont s’appuyer. On le voit notamment avec la série d’articles de Kokou Abalo et Michael Kostreva (1996a, 1996b, 2004, 2005).