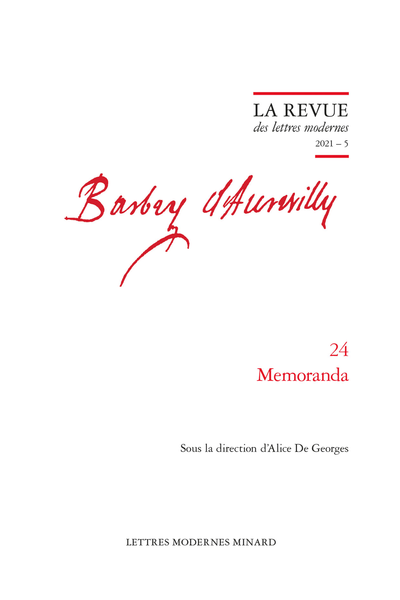
Recensions
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Revue des lettres modernes. Memoranda
- Auteurs : Bertrand (Mathilde), Marro (Frédérique), Ruiz de Chastenet (Jonathan)
- Pages : 257 à 273
- Revue : La Revue des lettres modernes
- Série : Jules Barbey d'Aurevilly, n° 24
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406112273
- ISBN : 978-2-406-11227-3
- ISSN : 0035-2136
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11227-3.p.0257
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 29/09/2021
- Périodicité : Mensuelle
- Langue : Français
Jules Barbey d ’ Aurevilly, Lettres inédites à Trebutien,1835-1858, édition établie par Philippe Berthier, Paris, Bartillat, 2018, 209 p.
Annoté et préfacé par Philippe Berthier, ce précieux volume épistolaire paru chez Bartillat en octobre 2018 rassemble des lettres inédites de Barbey d’Aurevilly à son ami Trebutien. Ces lettres inconnues jusqu’alors jettent un éclairage passionnant sur l’amitié des deux hommes, mais également sur l’évolution de la pensée de Barbey durant l’année 1857, à laquelle elles appartiennent pour la plupart1. En 2013, Philippe Berthier publiait une belle édition des Lettres à Trebutien. Cinq ans plus tard, il lui adjoint une suite inespérée : trente-huit lettres inédites surgissent de l’ombre, vingt-trois autres sont rétablies dans leur intégrité. C’est à un chercheur indépendant que l’on doit ce trésor retrouvé dans la réserve de la Bibliothèque d’Alençon. Alors qu’il travaillait sur les relations entre Baudelaire et l’éditeur des Fleurs du mal, Poulet-Malassis, Benoît Noël a trouvé les lettres d’un autre poète à un autre éditeur2 : dans le fonds Léon de la Sicotière de la Bibliothèque d’Alençon dormaient sept volumes de lettres de Barbey d’Aurevilly adressées à Trebutien de 1832 à 1858 et copiées pour la plus grande part de la main de ce dernier. Alençonnais comme Poulet-Malassis, dont il fut l’ami, La Sicotière avait manifestement la confiance de Trebutien, qui lui confia cette copie en 1861, deux ans après sa brouille avec Barbey. En confrontant cette copie à celle qui a servi de base aux quatre premières éditions de la correspondance de Barbey3, Benoît Noël s’est aperçu qu’elles 258différaient sensiblement : on compte ainsi 389 lettres dans la copie bien connue, conservée aux Archives départementales de Saint-Lô, contre 427 dans celle d’Alençon4.
Nul ne sait si c’est au hasard, à la « ménalquerie » de Trebutien ou à une sorte de censure qu’il aurait d’abord opérée sur certaines lettres que l’on peut imputer la différence entre les deux copies. Il est singulier d’imaginer que c’est à l’occasion d’une recherche sur Poulet-Malassis que ces lettres ont été retrouvées, alors même que c’est précisément son nom qui précipita la rupture entre Barbey et Trebutien, ce dernier ayant allégué, pour rompre avec son ami, la suggestion qu’il lui avait faite de confier la publication du doux Guérin à l’éditeur des Fleurs du mal. Les lettres de 1857 témoignent de la sympathie de Barbey pour Poulet-Malassis et plus encore de son amitié et de son admiration profondes pour Baudelaire. Elles témoignent aussi des résistances farouches que ces affinités adverses font naître chez Trebutien. Date charnière, l’année du procès de Madame Bovary et de celui des Fleurs du mal cristallise tout ce qui éloigne Barbey de Trebutien. Barbey redit avec lui son credo et sa lutte contre les « Matérialistes » qui « posent [la] valeur absolue » de l’art et « n’ont pas d’autre religion que l’amour du Beau dans les formes5 », mais il aime Baudelaire, ce « grand talent qui n’a de pur que la langue6 », il lui fait lire ses Rhythmes oubliés encore inédits et se flatte de lui inspirer la plus grande curiosité :
Ah ! les Rhythmes ont eu du succès parmi les connaisseurs. Baudelaire, qui est une personnalité très profonde, poétiquement parlant, les a goûtés d’autant plus qu’il fait un livre de poésie en prose tout différent et tout semblable. Baudelaire est l’homme le plus curieux de ce que j’écris – je ne parle pas de vous qui êtes moi-même. S’il pouvait mettre en flacon taillé par un Benvenuto du cristal la rognure de mes ongles, il le ferait7.
Pire, en juillet 1857, Barbey consacre un article magnifique aux Fleurs du mal. Dans l’une de ses lettres à Trebutien, il développe un long plaidoyer qui rappelle celui que lui avait inspiré sa Vieille maîtresse, pareillement 259suspectée d’immoralité8. Les arguments qu’il avance pour défendre les Fleurs du mal ont l’air d’être adressés à Trebutien lui-même, qui lui a parlé de Baudelaire avec effroi :
Je viens de vous nommer Baudelaire et vous m’en parliez con spavento dans votre dernière lettre. Je lui ai fait le plus bel article, qui devait paraître hier soir, quand un ordre du ministère a empêché ou du moins retardé l’apparition de cet article tonitruant. Le livre est saisi et on va faire un procès dont on aura peut-être la courte honte, comme on l’a eue pour la Madame Bovary de Flaubert. Braves gens de Caen, pays de Retors, ne vous imaginez pas que ce soit là de la morale que cette saisie des Fleurs du mal9 !
Barbey renchérit :
Tenez-vous le seulement pour dit que mon ami Baudelaire est un grand poète et qu’il a dans le cœur l’envie de vomir son péché, – ce mal de cœur du débauché malade qui précède l’indigestion de vices dont on meurt, et après laquelle, – si on n’en meurt pas, de ces champignons épouvantables, – on devient immanquablement chrétien10.
Rétif à Baudelaire, Trebutien reproche encore à Barbey sa faiblesse coupable pour Banville et pour Flaubert :
Trouvez-vous que ce Banville[…] est aussi un Monstre de l’ordre Moral comme mon pauvre Baudelaire et Flaubert ? […] Je n’aime que la poésie pensée ou sentie, mais la poésie sonore et peinte, je la tiens pour ce qu’elle est, une occupation d’esprit vide et faux. Le bout de glaive que vous réclamez dans ma critique va donc reparaître. Vous ne l’avez pas vu entrer dans le monstre Flaubert, mais que vouliez-vous donc, ô Monsieur de Hache ? J’ai dit de son livre qu’il n’avait pas de charme, pas d’idéalité, pas de poésie, qu’il n’y avait qu’un personnage et une description de cœur pourri, bien faite, que l’auteur était un Matérialiste, que son style crevait les yeux de détails, gros comme des têtes d’épingle, et vous ne trouvez pas le fer assez long comme cela : il fallait un harpon de Baleine11 !
260Barbey expose alors son point de vue sur Madame Bovary, moins sévère que ne le voudrait son ami :
Tout ce qui est doit être écrit, décrit et peint au point de vue de l’art, du renseignement et de la morale que Flaubert, le Matérialiste, n’a pas tirée de sa peinture, mais que d’autres tireront pour lui. Pour moi, ce Flaubert, fils de Médecin, de sang de médecin et qui écrit avec un bistouri, est un grand talent antipathique, mais l’antipathie ne doit pas troubler le calme du jugement porté sur le talent d’un homme, qui est très grand12.
Celui qui posait pourtant au Torquemada de la critique blâme la morale étroite de l’intraitable Trebutien :
Je suis toujours intellectuellement à la même place d’opinion et d’idées. Mais vous, en ces derniers temps, n’auriez-vous pas cinglé vers une sévérité plus haute, vers un point plus exclusif et plus escarpé ? C’est vous alors qui auriez bougé et ce que vous prendriez pour ma derive serait votre mouvement à vous, dans un flot moins large et plus austère13 ?…
Quand Barbey pleure ses amis Lerminier et Custine, qui meurent coup sur coup en août puis en octobre 1857, Trebutien se raidit et rapporte à Barbey la rumeur de leur homosexualité. On dit que ces deux-là étaient bien suspects et qu’ils avaient le « vice Romain14 » qui fait se cabrer les Chrétiens. À propos de son cher Lerminier, comme ici à propos du « Grand Marquis15 », Barbey entame de nouveau un vibrant plaidoyer :
Oui, mon ami, j’ai compris ce que vous avez dit à mots couverts, dans votre lettre. J’ai eu les oreilles rebattues de ce bruit… S’il n’a pas fait les sonnets de Shakespeare, on dit qu’il en avait les goûts. Je n’en sais rien pour moi, et s’il les avait, il s’arrangera sur ce point de conscience intime, avec son Juge Naturel, le Dieu des reins et des cœurs ; mais ce que je sais, c’est que rien n’en transpirait en lui. Il transpirait le beau, le bon, le juste, le généreux, le grand ! […] Les Réputations sont de si fréquents et si mystifiants mensonges ! Il ne faut qu’une femme dont on n’a pas voulu pour vous attacher cet abominable grelot. En voulez-vous la preuve, Trebutien ?
261… On a dit de Moi ce qu’on a dit du Marquis, de moi, mon ami, qui ai perdu ma vie dans le jupon des femmes16 !
Cette curieuse assimilation de Barbey au marquis de Custine fait écho à la très belle lettre de janvier 1857 dans laquelle Barbey évoquait la « passion inouïe » du « Poète des Poètes17 » :
Je viens de lire tous les sonnets, traduits, dit-on, mot-à-mot par François Hugo (un volume) et c’est l’amour Antique avec une intrépidité de passion qui ne soupçonne même pas qu’il puisse y avoir de la honte à l’éprouver. Shakespeare est carrément sodomite, – carrément et passionnément… Le héros de ses chants, l’objet de ses adorations, est un beau Ganymède, resté à peu près inconnu, et jamais Poète n’a parlé de la beauté d’aucune femme adorée, même en la retournant, comme il parle de la beauté de ce Garçon qui fut sa maîtresse et dont il est ivre dans tous ses sonnets18.
La surprise que lui causent ces étranges sonnets ne l’empêche pas d’en goûter la beauté :
Du reste, ils sont presque tous magnifiques, un peu trop constellés de concetti italiens. Vous voyez que tous les goûts de la Renaissance y sont ! Mais comment rendre compte publiquement d’un tel volume ? Comment pénétrer dans les dépravations d’une âme de Génie ? Comment expliquer cette passion inouïe qui élève le forcené jusqu’à l’idéal et donne à un amour qui ressemble au plus affreux de tous les vices les délicates langueurs du sentiment. Ô strange book ! aurait écrit Guérin, l’auteur du Poème resté inédit de l’Hermaphrodite19 !
Trebutien n’a pas la même largeur de vue que Barbey. Il n’absout aucune « dépravation » au nom du Génie littéraire. L’Hermaphrodite ne le plonge pas dans la même rêverie que Guérin naguère et il n’a probablement nulle envie d’être comparé au bon ami du marquis de 262Custine. « Barbey qu’il avait tant aimé, au fond, n’était pas son genre20 », écrivait Philippe Berthier dans la préface du premier volume des Lettres à Trebutien. Cette « amitié providentielle » qui l’avait nourri et galvanisé pendant près de trente ans n’était finalement peut-être qu’un « formidable malentendu21 ». Ses lettres se font plus rares et plus sèches : « la brièveté de vos lettres me navre22 », lui écrit Barbey, « je vois l’aridité, le desséchement, l’ennui monter peu à peu dans vos lettres et je suis effrayé de cela. […] Épistolairement, vous devenez un trappiste… et moi un attrapé23 ! » Barbey impute cette sécheresse aux déboires amoureux de son ami. S’il a lui-même rencontré un « Ange blanc », en la personne de Madame de Bouglon, c’est un « Ange noir » qui plane à l’en croire sur le cœur malade de Trebutien. Barbey n’a pas de mots assez dur pour qualifier Louise Trolley, la femme dont celui-ci est épris, drôlesse, diablesse, bourgeoise et bas-bleu ridicule, auquel il a inconsidérément confié les cahiers de poésie de Guérin. Animé des meilleurs intentions du monde, de celles dont l’enfer est pavé, Barbey traite avec la plus grande sévérité ce que Philippe Berthier appelle, avec Milan Kundera, les « risibles amours24 » de Trebutien, dont il désespère de pouvoir le guérir. Impuissant, il déplore que son amitié ne soit pas de taille à lutter contre cet amour mauvais qui lui ravit Trebutien, mais il semble qu’entre le poète et son éditeur il soit toujours et avant tout question de littérature. Si Trebutien est jaloux, c’est moins de l’influence croissante de Madame de Bouglon sur son ami que des projets éditoriaux que celui-ci échafaude sans lui, autour de ses propres œuvres, celles dont il était jusqu’alors l’unique éditeur25, et autour de l’œuvre de Guérin, casus belli ultime qui met le feu aux poudres.
Ces lettres inédites laissent partout voir les lézardes irréversibles d’une amitié que Barbey croyait infrangible, mais qui prend l’eau de toutes parts. Elles se lisent comme « un roman à un seul correspondant, chose neuve26 ! », où Trebutien n’est présent qu’en creux, à travers la « réponse 263à un acte d’accusation » à laquelle ressemblent de plus en plus les lettres que lui écrit Barbey. Cette année 1857, si importante dans l’histoire de la littérature française, parce que les procès de Flaubert et de Baudelaire y posent la question des rapports de la littérature et de la morale, de l’autonomie de l’art et de l’absolu littéraire, assimilée à la modernité, cette année aura été fatale à l’amitié de Barbey et Trebutien. Les lettres qu’ils échangent alors témoignent de ce point de bascule historique qui les aura définitivement séparés.
Mathilde Bertrand
Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle
*
* *
Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps. Ce que l ’ histoire peut dire de la littérature, Paris, Gallimard, « NRF essais », 2019, 293 p.
Historienne passionnée par l’œuvre aurevillienne27, Judith Lyon-Caen se lance le défi, dans son essai intitulé La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, de saisir la littérature comme « objet du monde28 ». Loin de cantonner la littérature « aux entours29 » de l’histoire, de cloisonner les deux disciplines, elle tente l’expérience de « franchir, en historienne, ce seuil vivement éclairé des fastes de la littérature30 ». 264Ce seuil, c’est d’abord celui franchi par Tressignies dans La Vengeance d’une femme, la dernière nouvelle des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly : le personnage pousse la porte de l’appartement de la duchesse de Sierra-Leone, devenue prostituée dans le seul but de salir le nom de l’époux dont elle veut se venger. Nous entrons avec lui dans les « fastes de la littérature », ceux du drame, de la légende… qui laissent habituellement l’historien à la porte. Mais justement, c’est dans la littérarité du texte que Judith Lyon-Caen se propose d’aller chercher la « signification historique31 » ; c’est dans la singularité d’une œuvre littéraire que l’auteure se met en quête de la vérité historique. Elle cherche alors à percevoir, dans les détails de la fiction, des « griffes du temps32 » sur la matière romanesque, des marques indirectes du passé. Le projet de cet essai – largement développé et illustré dans un chapitre d’introduction – est aussi ambitieux que paradoxal. Loin d’être un monde clos sur lui-même, soustrait à l’histoire, la nouvelle de Barbey peut au contraire faire l’objet d’une lecture herméneutique, une « lecture historienne33 », qui se promet de retrouver ce qui fait trace, dans le matériau littéraire, du monde de la modernité du xixe siècle. Après le chapitre d’introduction, l’essai offre, à cette fin, l’occasion de lire ou de relire l’intégralité de la nouvelle aurevillienne.
Dans le premier chapitre intitulé « Le trottoir insoumis : prostitution, histoire, littérature », Judith Lyon-Caen observe « la montée du thème prostitutionnel dans la littérature du xixe siècle34 », qui s’explique par la hantise du péril vénérien dans les dernières décennies. Dans le récit aurevillien, le thème se charge en plus d’une dimension morale. Est livrée ensuite une lecture « historienne » de La Vengeance d’une femme qui dresse une topographie précise des lieux et des formes de la prostitution parisienne. La littérature s’ajoute donc aux nombreux écrits documentaires (fiches de police, enquêtes, prose abolitionniste, guides galants) qui font de la prostitution un objet d’écriture. Ces multiples formes d’écriture s’influencent, migrent d’un domaine à l’autre (le rapport de 265police peut pénétrer la fiction comme les grandes figures romanesques de prostituée peuvent influencer leur catégorisation dans le monde réel). La littérature devient ainsi une réalité qui concerne l’histoire et le savoir des historiens.
Judith Lyon-Caen insiste, dans un deuxième chapitre intitulé « Couture littéraire », sur l’aspect matériel de la littérarité, qui engage l’écriture même du texte et la manière dont il a été lu. Elle s’intéresse particulièrement à l’image très travaillée de l’auteur : par les portraits photographiques et, s’agissant de Barbey, par les vêtements, l’écrivain continue d’écrire sur un autre support, non plus textuel mais corporel. Ce qui fait la littérature, dans la société du xixe siècle, ne relève plus seulement du champ de l’écriture mais tient à certaines « matérialisations », qui sont « autant de projections hors de l’écrit35 ». La photographie par exemple remodèle l’homme de lettres en le donnant à voir. Le deuxième chapitre étudie ensuite le manuscrit de La Vengeance d’une femme, qui se distingue par ses ornements, sa calligraphie, ses encres de toutes couleurs. De même que Barbey impose au public une image littéraire (figure byronienne, vêtements d’un dandy hors du temps ou empruntés à la Normandie natale), le manuscrit redouble les choix dont Barbey use déjà pour son style. Les encres mettent ainsi en exergue la poétique de la couleur qui caractérise l’écriture aurevillienne. Certaines variantes entre le manuscrit et la première édition font également l’objet d’une herméneutique « historienne » : en supprimant certains détails explicitement sexuels, Barbey aurait anticipé la censure (qui, de fait, s’est ensuite exercée). Il aurait, dans le même temps, marqué la rupture avec la littérature naturaliste de son temps, dont les détails réalistes de même que les couleurs crues et tapageuses sont indissociables de l’image de la prostituée racoleuse.
La lecture « historienne » de La Vengeance d’une femme se poursuit dans le chapitre iii dont le titre reprend la métaphore des « Griffes du temps » : cette lecture se penche sur certaines images soigneusement datées, valant comme autant de marques du temps dans la matière fictionnelle. Cette lecture relève combien la fiction aurevillienne est pétrie par les souvenirs de son auteur, qui sont autant d’indices du passé. Ainsi, la robe jaune et les accessoires orientalistes qui composent le portrait de la duchesse de Sierra-Leone sont interprétés d’après la mode des années 2661830-1840, mais aussi d’après une rhétorique de la mode en vigueur dans les journaux de cette époque et que Barbey a pratiquée. La réalité historique de ces détails provient, de manière concomitante, du regard du flâneur qui arpente les boulevards parisiens et de l’écriture du journaliste de mode. Le portrait de la prostituée est également étudié comme une succession d’images : Tintoret, Véronèse, Vernet, Gavarni sont convoqués par Barbey pour raconter la rencontre à la fois érotique et esthétique entre Tressignies et la duchesse de Sierra-Leone. Ces références – qu’elles viennent de la Renaissance italienne, de la peinture romantique ou des caricatures de journaux satiriques – sont évaluées telles des expériences du regard, des traces de souvenirs déposés dans la littérature, des griffes de la vie parisienne de 1840 dans la matière fictionnelle.
Le chapitre iv, « Madame Husson, l’impudeur d’un bronze », est entièrement consacré à un détail de la nouvelle : une « statuette indescriptible36 » dont Tressignies se souvient à l’apparition de la duchesse de Sierra-Leone en déshabillé et qui provoque un « dangereux rêve obscène37 ». Ce détail est une pure invention, la référence à « Madame Husson » ne pouvant être identifiée sur le plan historique. Pourtant, selon Judith Lyon-Caen, ce bronze de petit format rappelle la production industrielle d’œuvres d’art érotiques au xixe siècle et en cela, il fait signe vers le passé. L’ensemble de ce chapitre cherche alors à répondre par l’affirmative à la problématique suivante : peut-on contextualiser un objet complètement fictif ? L’historienne définit alors les frontières de l’obscène à la fin de la Monarchie de Juillet, en revenant sur la loi d’outrage aux bonnes mœurs et en montrant que se développe une véritable « culture érotique38 » jouant avec ces règles morales. Les œuvres d’art impudiques – par le développement de la lithographie qui imprime des séries libertines et la reproduction industrielle de petits bronzes sensuels – sont légion à l’époque. C’est dans ce contexte historique, érotique et artistique que Judith Lyon-Caen replace l’énigmatique statuette aurevillienne à défaut de résoudre le mystère de cette référence. Un « interlude » synthétise ensuite les trois derniers chapitres pour insister sur l’idée que les détails sont moins des effets de réel que des marques du temps auquel appartient l’intrigue racontée par la nouvelle. 267Leur contextualisation historique restitue leur ancrage dans le temps et fait le pari de restituer également l’expérience des premiers lecteurs des Diaboliques partageant les mêmes souvenirs que Tressignies.
Le chapitre v, « Les yeux d’or de la modernité », s’intéresse justement à la temporalité qui sert de référence à La Vengeance d’une femme. L’intrigue apparaît assez anachronique : ancrée dans les années 1830-1840, l’histoire porte cependant l’empreinte de l’imaginaire baudelairien et de son « peintre de la vie moderne », Constantin Guys. L’édition propose des reproductions de certains de ses dessins, dont Une courtisane turque sur le pas de la porte à Galata qui fait immédiatement penser à la courtisane aurevillienne. Les imaginaires se rejoignent et celui de Barbey semble se nourrir des figures féminines de Guys pour brosser le portrait de son personnage. Pourtant, l’intrigue de la nouvelle fait plutôt référence à une modernité balzacienne et apparaît comme le prolongement de La Fille aux yeux d’or : Judith Lyon-Caen analyse les éléments d’intertextualité non pas dans un but littéraire mais pour en relever tout l’intérêt historique. La « scène de la vie parisienne » qui inaugure la nouvelle diabolique est à la fois un hommage à Balzac, un témoignage de cette première moitié du xixe siècle et la trace d’une lecture de jeunesse. Pour l’essayiste, l’important est de reconnaître « l’historicité » du roman « qui permet de saisir quelque chose du passage du temps39 ». Par cette réécriture, Barbey restitue « la vérité sociale […] qui marqua l’époque40 » des premières publications romanesques balzaciennes et son expérience de lecteur qui, elle aussi, vaut comme une empreinte du passé.
C’est dans la même optique que le chapitre vi, intitulé « La forme d’une ville », s’intéresse à l’espace urbain parcouru par Tressignies, espace bien réel mais « qui n’existe plus41 » au moment de la rédaction de la nouvelle. Les lieux arpentés par le personnage aurevillien, au-delà de leur fonction référentielle, renvoient à une topographie balzacienne, celle que le lecteur avait déjà pu découvrir dans La Fille aux yeux d’or, Une fille d’Ève, Le Cousin Pons ou Les Paysans. Le récit de Barbey garde ainsi en mémoire le Paris balzacien mais aussi un espace urbain en train de s’estomper avec les grands travaux hausmaniens. Plusieurs pages très documentées – plans et photographies des lieux à l’appui – font ensuite 268l’histoire de cet « îlot parisien42 », le quartier de l’Opéra, en pleine mutation. Cet ensemble, entièrement détruit et reconstruit à partir de 1860, correspond à l’époque de l’écriture de La Vengeance d’une femme qui laisse alors apparaître « un tracé et des usages de la ville révolus43 », en convoquant un espace urbain désormais effacé, en capturant la physionomie d’une ville disparue, à la manière de la photographie. Judith Lyon-Caen termine le chapitre vi par la belle métaphore de la « sépulture littéraire d’un espace44 », la nouvelle permettant de conserver la trace d’une double expérience : celle du flâneur (Barbey ou Tressignies, peu importe) de la première moitié du siècle et celle du lecteur balzacien.
L’essai termine sa réflexion sur un autre espace-temps essentiel dans La Vengeance d’une femme, celui d’une Espagne aristocratique et féodale qui semble davantage servir de cadre mythique qu’historique. Mais la gageure du dernier chapitre est précisément de penser une temporalité immémoriale et littéraire comme une expérience humaine et un savoir sur le monde qui, eux, relèvent de l’histoire. Judith Lyon-Caen s’engage ensuite dans une lecture de l’épisode espagnol de la nouvelle aurevillienne telle une « fabrique du passé45 ». Par exemple, elle s’interroge sur les images que Barbey livre de l’Espagne sans y avoir jamais voyagé et tente de les contextualiser en faisant référence à une grandiose exposition de peinture espagnole visible de 1838 à 1848 au Louvre. Ce qui passionne l’historienne, c’est l’effacement de toutes les sources potentielles dans l’écriture de ce « poème étrange46 » espagnol, qui échappe au temps, en contraste avec « l’historicité vivante de la modernité de 184047 ». Une large conclusion rappelle enfin le défi que s’était lancé cet essai : « faire tenir en place un morceau de “littérature” pour faire de l’histoire48 ».
Et le pari est gagné ! La démarche « historienne » pouvait paraître, pour un lecteur de littérature, assez déroutante ; la nouvelle aurevillienne aurait pu servir de beau prétexte à écrire d’intéressantes réflexions historiques sur la prostitution au xixe siècle, la reconstruction d’un espace urbain ou la modernité de la vie parisienne. Avec ambition et modestie, l’historienne 269s’attache aux détails les plus résistants à l’intérêt documentaire, les plus fictifs, les plus littéraires, pour en révéler tout le potentiel mémoriel. Quand l’essai nous offre à lire des pages d’histoire qui contextualisent certains indices du passé, il nous invite surtout à feuilleter La Vengeance d’une femme comme un morceau de littérature qui restitue toute l’expérience du lecteur du xixe siècle, à la fois nourri des romans balzaciens et des images de la modernité baudelairienne. Il nous invite aussi à emboîter le pas de Tressignies et ainsi, à marcher dans ceux des flâneurs-dandys des grands boulevards ou à suivre les traces d’une topographie à jamais effacée. Il nous invite enfin à nous fondre dans la modernité de la vie parisienne, sensuelle et esthétique, ou dans le temps immémorial d’un récit mythique. Seule, la littérature – et plus encore, la nouvelle aurevillienne – peut permettre une telle expérience, qui juxtapose, brouille et anéantit toutes les frontières temporelles. Judith Lyon-Caen signe là le bel hommage que l’histoire rend à la littérature et, en écrivant à son tour une autre « page d’histoire49 », un bel hommage à Barbey d’Aurevilly.
Frédérique Marro
*
* *
Jules Barbey d ’ Aurevilly, Le Traité de la princesse ou la Princesse Maltraitée , texte établi et présenté par Mathilde Bertrand, Paris, Éditions du Sandre, 2012, 181 p.
Après avoir publié les Pensées détachées suivi de Fragments sur les femmes (2005), puis Les Prophètes du Passé (2009), les éditions du Sandre ont 270fait paraître en 2012 un ouvrage de Barbey, en quelque sorte inédit et inachevé. Il est intitulé Le Traité de la Princesse ou la Princesse Maltraitée, et sous-titré « À propos d’une femme entre deux amis », conformément aux instructions éditoriales indiquées par l’écrivain (lettre de Barbey à Trebutien du 4 avril 1857, p. 166). On doit à Mathilde Bertrand, maître de conférences à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, qui a dirigé dans la série Barbey d’Aurevilly le numéro de la Revue des lettres modernes consacré à la comédie (no 22), l’établissement et la présentation de ce texte resté, en dépit de la volonté manifeste de son auteur, à l’état de projet. Il s’agit d’une sélection de lettres déjà publiées, envoyées à Guillaume-Stanislas Trebutien, ami et éditeur de Barbey, et ayant trait à une intrigue amoureuse réelle, ensemble qui aurait dû servir de canevas à un roman épistolaire.
Barbey fait très souvent allusion à un Traité de la Princesse dans son abondante correspondance, le mentionne dans La Bague d’Annibal, et en tire même l’épigraphe de son essai du Dandysme et de George Brummell, comme si ce traité avait déjà vu le jour, alors qu’il ne sera jamais imprimé de son vivant. Jusque dans les dernières années de son existence, le théoricien du dandysme nourrit l’ambition de terminer l’écriture de ce livre et de le publier sans délai. Les confidences en ce sens, écrites ou orales, ne manquent pas. Sans conteste, cet ouvrage lui tient très à cœur. Son contenu l’obsède à tel point que plusieurs morceaux, comme échappés de sa plume effrénée, se sont disséminés dans ses écrits, surtout dans ses lettres. Entre autres projets inaboutis dont Jacques Petit a dressé la liste exhaustive (O. C. II, p. 1636-1639), ce traité à la fois imaginaire et parcellaire, qu’il a « tant roulé dans [sa] tête » (lettre de Barbey à Trebutien du 4 avril 1857, p. 166), est sans doute celui que Barbey a le plus médité, ce dont témoigne sa longue évolution. Comme le rappelle utilement Mathilde Bertrand dans la présentation, Barbey entreprend d’abord le projet, qu’il n’abandonnera jamais sans pour autant le réaliser, de composer un « précis de tactique féminine » (introduction, p. 9), sous la forme d’un « livre d’axiomes, mêlés de portraits » (lettre de Barbey à Trebutien du 22 novembre 1851, p. 53). Il s’en ouvre à l’un des frères Goncourt en des termes explicites : ce livre doit être un « traité de machiavélisme amoureux à l’usage de la femme50 ». Barbey a choisi Machiavel pour modèle et s’inspire de ses principes politiques en les 271appliquant au domaine des relations intimes. Si dans le traité du Prince le Florentin énonce les moyens par lesquels un homme peut prendre et conserver le pouvoir pour commander les autres hommes, dans le traité de la Princesse, Barbey entend inventorier les manœuvres qu’il souhaite mettre à la disposition des séductrices pour asservir et emprisonner leurs proies masculines. Le premier résout le conflit politique opposant celui qui gouverne à ceux qui doivent obéir, au profit du souverain, le second propose de régler les rapports complexes de domination au sein du couple, en faveur de la dame. D’après ses dires, Barbey aurait mis en pratique son savoir en la matière en rédigeant, pour le compte d’une jeune fille à marier, de charmantes missives adressées à un vieux ministre libertin totalement mystifié (lettre de Barbey à Trebutien du 20 mai 1850, p. 27). Barbey est ensuite amené à prendre le contre-pied de sa position, cédant aux instances de son ami Trebutien, timide et maladroit en amour. Le stratège reprend alors le service mais change de camp : il conseille désormais un homme (Trebutien) dans une tentative désespérée de conquérir une femme mariée dont il s’est entiché (Louise Trolley). Surnommée « bottines bleues », cette bourgeoise dans l’air du temps, qui se pose prétentieusement en philosophe, ne plaît guère à Barbey. Par amitié, celui-ci accepte toutefois de secourir à distance l’amoureux transi et inexpérimenté : entre les années 1850 et 1858, il multiplie les recommandations, joue l’intermédiaire, prête sa plume pour écrire dédicaces, billets, lettres ou poèmes. Ces pièces seront parfois mal reçues par la destinataire, provoquant le mécontentement de leur auteur. Barbey n’hésitera pas à tirer à boulets rouges sur cette « harengère » (lettre de Barbey à Trebutien du 4 octobre 1854, p. 125) jugée par lui sans goût et sans éducation, laissant libre cours à l’expression d’une misogynie outrancière mais hilarante. La correspondance entre les deux hommes renferme de précieux échanges où apparaît nettement la matière d’une œuvre littéraire. Barbey en prend conscience lorsqu’il relit leurs lettres : « Quel intérêt ardent que cette correspondance ! Savez-vous que c’est intéressant comme un Roman ? Savez-vous que tout le Traité de la Princesse est là […], sinon démontré, au moins en bloc, dans les conseils que je vous donne, dans ces espèces d’intuitions que j’ai sur elle, dans les manières de la prendre que je vous indique ? » (lettre de Barbey à Trebutien du 4 avril 1857, p. 166). Barbey s’enthousiasme à l’idée de pouvoir donner corps à son traité, même métamorphosé. Le 272livre, modifié dans sa forme comme dans son contenu, serait constitué de tous les extraits de lettres relatifs à cette histoire d’amour : « On pourrait dire que c’était là un épisode du Traité de la Princesse, ouvrage auquel on a renoncé et que ceci c’est la Princesse maltraitée » (ibid., p. 167). Hélas, ce récit ne sera jamais publié.
Jusqu’à présent, personne n’avait songé à extraire ces passages de la correspondance et à les réunir en volume. Mathilde Bertrand a voulu pallier ce vide bibliographique et ne peut qu’en être remerciée. Les amateurs comme les spécialistes de Barbey, même si les lettres à Trebutien leur sont bien connues, apprécieront la cohérence thématique de ces textes rassemblés où « s’illustre brillamment le moraliste immoraliste » (introduction, p. 20). Barbey ne laisse à son interlocuteur qu’une alternative radicale, révélatrice d’une éthique de l’héroïsme dans le bien ou dans le mal. Tour à tour il lui conseille de s’attaquer à la dame et de la posséder, ou de la repousser et de s’en remettre à Dieu. Trebutien se morfond dans la médiocrité d’un entre-deux insatisfaisant. Il est incapable de s’adonner tout entier soit au vice soit à la vertu, accentuant ainsi une différence caractérologique d’envergure avec son correspondant, qui n’est peut-être pas sans rapport avec leur rupture définitive. Barbey connaît les faiblesses de son ami, il l’exhorte certes avec force mais avec dilection aussi. On goûtera la perspicacité psychologique de l’épistolier, comme son style inimitable, fait d’une alliance de flamboyance et de violence, qui ne s’interdit pas la crudité du verbe le cas échéant. Ainsi l’« ancien Arquebusier de la chair » encourage son ami à l’action d’éclat : « Frappez votre grand coup, et le meilleur n’est pas celui qu’on frappe, c’est celui qu’on tire, Trebutien ! » (lettre de Barbey à Trebutien du 6 juillet 1854, p. 117). Barbey forge par ailleurs des tournures marquantes pour dégoûter son ami, alors en pleine phase de cristallisation, de « cette infâme reptile » (lettre de Barbey à Trebutien du 17 mai 1855, p. 132) : « Vous êtes un fameux sculpteur et vous avez fait votre Dieu de ce qui devait rester une cuvette » (lettre de Barbey à Trebutien du 14 mars 1853, p. 70). Le propos donne lieu à un « festival de méchancetés et de goujateries réjouissantes » (introduction, p. 16) que le lecteur pourra savourer à sa guise. Des formules plus sérieuses abondent également dans ces lettres, dont certaines sont reprises dans les Fragments sur les femmes. D’une portée générale, elles invitent à la réflexion et méritent à ce titre d’être relues : « Avoir l’air d’un homme 273qui se sacrifie quand on ne fait que sa volonté est l’art suprême en matière de femmes comme en matière de peuple. Entortillé dans les draperies du sacrifice, l’Amour a sa véritable robe d’enchanteur ; et peut-être le meilleur de son despotisme est-il dans son hypocrisie » (lettre de Barbey à Trebutien du 19 avril 1853, p. 76).
Jonathan de Chastenet
1 Le recueil rassemble des lettres et des fragments de lettres allant de l’année 1835 à l’année 1858, mais les lettres datées de 1857 représentent plus des trois quarts de l’ensemble.
2 À Trebutien qui vient d’éditer son poème en prose Laocoon, Barbey écrit qu’il est le « prince des éditeurs » et qu’il « enfonce » Poulet-Malassis, dans la lettre du 25 juillet 1857, Lettres inédites à Trebutien, 1835-1858, édition établie par Philippe Berthier, Paris, Bartillat, 2018, p. 143-144.
3 Celles d’Auguste Blaizot (1908), de François Bernouard (1927), des Belles-Lettres (1980-1989) et de Bartillat (2013).
4 Cette nouvelle copie comporte en outre quelques « réflexions (souvent amères et sarcastiques) » notées dans les marges par Trebutien rageur, « Marginalia inédits », Lettres inédites à Trebutien, op. cit., p. 195.
5 Lettre du 7 février 1857, ibid., p. 67.
6 Lettre du 24 janvier 1857, ibid., p. 60.
7 Lettre du 14 mai 1857, ibid., p. 106-107.
8 En marge de la lettre du 22 avril 1848, la copie d’Alençon nous fait découvrir, entre autres commentaires acerbes écrits à l’encre rouge de la main de Trebutien, ces quelques lignes particulièrement féroces sur Une vieille maîtresse : « Jamais livre ne m’a inspiré plus de répulsion. C’est pour moi, une putréfaction morale. » (« Marginalia inédits », ibid., p. 196).
9 Lettre du 25 juillet 1857, ibid., p. 142 (« con spavento », avec effroi, en italien).
10 Ibid., p. 143.
11 Lettre du 23 octobre 1857, ibid., p. 170-171.
12 Idem.
13 Lettre du 7 ou 8 novembre 1857, ibid., p. 182.
14 Voir les lettres du 30 août 1857, à propos de Georges Lerminier, et du 31 octobre 1857, à propos du marquis d’Astolphe de Custine, ibid., p. 156 et p. 177.
15 Lettre du 31 octobre 1857, ibid., p. 177.
16 Ibid., p. 177-178. Barbey prolonge l’analogie entre Custine et lui en comparant Trebutien à Sainte-Barbe, l’ami de cœur du marquis : « Je viens d’écrire à ce pauvre Sainte-Barbe qui doit faire pitié. Ils s’aimaient et vivaient ensemble depuis trente-cinq ans. Ils avaient l’idéal de la vie qui serait le mien avec Vous et que nous n’avons pas. » (lettre du 17 octobre 1857, ibid., p. 166) ; « J’ai vu Ste-Barbe, à ce propos. Douleur qui l’honore ! Vous figurez-vous, Vous après m’avoir perdu : c’est lui ! ! ! » (lettre du 23 octobre 1857, ibid., p. 173).
17 Lettre du 26 janvier 1857, ibid., p. 64.
18 Idem.
19 Idem.
20 Philippe Berthier, « Préface », LT, p. 22.
21 Idem.
22 Lettre du 21 novembre 1857, Lettres inédites à Trebutien, op. cit., p. 185.
23 Ibid., p. 186.
24 Philippe Berthier, « Préface », LT, p. 9.
25 La Bague d ’ Annibal et le Brummell (voir les lettres du 4, 10 et 18 juillet et celle du 17 octobre 1857, Lettres inédites à Trebutien, op. cit., p. 133, p. 135, p. 138 et p. 168).
26 Lettre du 4 avril 1857, LT, p. 1189.
27 Elle a notamment réédité les romans aurevilliens : Jules Barbey d’Aurevilly, Romans, Paris, Gallimard, « Quarto », 2013.
28 Roland Barthes, « Histoire et littérature. À propos de Racine », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1960, no 3, p. 524-537, repris dans Sur Racine, Paris, Le Seuil, 1963, p. 147-167.
29 Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, Paris, Gallimard, « NRF essais », 2019, p. 10.
30 Ibid., p. 11.
31 Ibid., p. 21.
32 Et le titre choisi est éloquent puisqu’il emprunte à la fiction aurevillienne cette métaphore féline pour évoquer la démarche de l’historienne.
33 Ibid., p. 21 : « historienne » est employé par Judith Lyon-Caen comme adjectif, à double titre, car il s’agit pour elle de « produire un savoir sur le passé » mais aussi de livrer une expérience de lecture, celle d’une historienne.
34 Ibid., p. 72.
35 Ibid., p. 107.
36 ŒC, II, La Vengeance d’une femme, p. 239.
37 Ibid.
38 Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps, op. cit., p. 157.
39 Ibid., p. 196.
40 Ibid.
41 ŒC, II, La Vengeance d’une femme, p. 232.
42 Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps, op. cit., p. 201.
43 Ibid., p. 212.
44 Ibid., p. 214.
45 Ibid., p. 217.
46 ŒC, II, La Vengeance d’une femme, p. 260.
47 Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps, op. cit., p. 236.
48 Ibid., p. 244.
49 Une page d ’ histoire, roman de Barbey d’Aurevilly publié en 1882, est « une histoire dont [il a], en courant, ramassé comme [il a] pu les traces effacées par le temps » (ŒC, II, Une page d’histoire, p. 368).
50 Edmond de Goncourt, Journal, Paris, Flammarion, 1956, t. iii, p. 455.