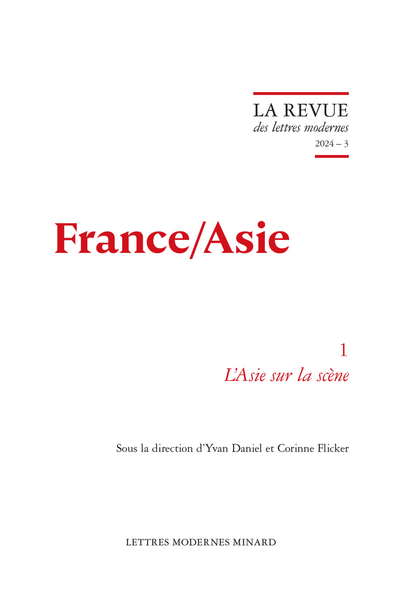
Avant-propos
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Revue des lettres modernes
2024 – 3. L’Asie sur la scène - Pages : 11 à 13
- Revue : La Revue des lettres modernes
- Série : France/Asie, n° 1
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167327
- ISBN : 978-2-406-16732-7
- ISSN : 0035-2136
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16732-7.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 17/04/2024
- Périodicité : Mensuelle
- Langue : Français
Avant-propos
Il n’existait jusqu’à aujourd’hui aucune collection ni aucune revue consacrée aux échanges littéraires entre la France et l’Asie dans le paysage éditorial français. Pourtant les espaces, les cultures et les littératures asiatiques marquent de leurs empreintes de nombreuses œuvres littéraires en langue française – ou francophones : dans la période qui relève de cette nouvelle série, du premier xixe siècle à nos jours, la Chine et l’Inde intéressent, ou même fascinent, dès le premier Romantisme, le Japon à partir de la vogue du japonisme des années 1870, le Vietnam, le Laos et le Cambodge dans le sillage de la conquête coloniale de ce qui deviendra l’« Indochine » à partir des années 1880. Le développement des communications, des transports et des voyages, la sécularisation et la multiplication des travaux de l’orientalisme savant, la publication de nombreuses traductions amplifient ces échanges au tournant du xixe au xxe siècle, jusqu’à les rendre courants de nos jours. Parallèlement, on découvre dès les xixe siècle des œuvres dues à des auteurs francophones d’origines asiatiques, elles aussi souvent fort peu étudiées.
Dans ce contexte, cette série propose donc d’envisager les œuvres littéraires qui naissent d’une expérience asiatique de leurs auteurs, que cette expérience soit indirecte ou directe, livresque ou vécue. Elle entend se pencher sur des textes français, mais aussi francophones, qui ont été marqués par l’une des cultures ou des littératures de l’Asie. Dans ces œuvres, l’Asie peut alors apparaître sous des statuts très différents, selon les périodes et les auteurs : comme un support plus ou moins imaginaire, comme un espace géographique et culturel provoquant un sentiment d’altérité extrême, comme un objet d’études et de réflexions, comme une source de thématiques, de trames narratives ou de modèles littéraires formels, par exemple.
Au xixe siècle, l’intérêt pour la Chine se trouve renouvelé à partir des premiers romantiques, qui étudient son histoire et s’inspirent de sa 12littérature en se fondant sur des sources et des médiations encore très incertaines et indirectes, chez Étienne de Senancour, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Stéphane Mallarmé, Judith Gautier, parmi d’autres. Mais la possibilité d’accéder à des traductions plus nombreuses et plus sûres, et plus encore celle de voyager ou de séjourner en Chine préparent une nouvelle vague d’écrivains bien mieux informés au tournant des xixe et xxe siècles, parmi lesquels on cite le plus souvent Paul Claudel, Victor Segalen, un peu plus tard Saint-John Perse. La découverte de la culture et de la littérature chinoises ne cesse par la suite de susciter des œuvres originales, dans tous les genres littéraires, chez de nombreux écrivains du siècle dernier (André Malraux, Simone de Beauvoir, Joseph Kessel, Pierre-Jean Remy, Raymond Queneau, Henri Michaux, Gérard Macé, Lucien Bodard, Philippe Sollers…) comme encore dans la période la plus récente (avec Jean Marie Gustave Le Clézio ou Jean-Philippe Toussaint, par exemple). Le Japon, quant à lui, apparaît principalement dans les littératures française et francophones dans la deuxième moitié du xixe siècle, avec Judith Gautier ou Pierre Loti, et exerce par la suite une fascination de plus en plus importante, par exemple à travers les œuvres de Marguerite Yourcenar ou de Nicolas Bouvier, plus récemment chez Philippe Forest, Amélie Nothomb ou Mickaël Ferrier. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge se présentent dans une perspective différente, dès lors qu’ils sont réunis dans la colonie française indochinoise, en donnant d’abord lieu à une abondante production rangée dans la littérature coloniale (Émile Nolly, Jules Boissière, Claude Farrère, Yvonne Schultz, Roland Dorgelès…) puis postcoloniale où s’imposent la figure et l’œuvre de Marguerite Duras. Au tournant du xxe au xxie siècle, ces pays, comme les souvenirs de l’Indochine coloniale, apparaissent toujours comme un sujet fécond pour la littérature française contemporaine (avec Kim Lefèvre, Patrick Deville, Pierre Lemaitre, Christophe Bataille, Éric Vuillard…). Avec ces riches corpus, on envisagera les productions en langue française d’auteurs d’origines asiatiques, qui constituent la part littéraire des francophonies d’Extrême-Orient, si rarement étudiées – par exemple François Cheng ou Gao Xingjian pour la Chine, Paprip Choudhuri ou Kichennasamy Madavane en Inde, Akira Mizubayashi ou Aki Shimazaki pour le Japon, Anna Moï ou Linda Lê au Vietnam…
L’objectif de cette série est donc de dynamiser, d’actualiser et de diffuser ces recherches originales, dans une perspective transculturelle 13souvent négligée ou ignorée, pour étudier les spécificités littéraires d’œuvres situées au point de rencontre entre deux aires géographiquement très éloignées mais entre lesquelles les contacts n’ont cessé de se multiplier et de s’approfondir depuis plus de deux siècles.