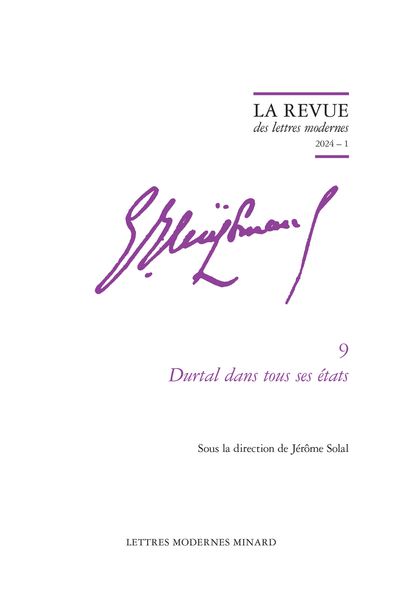
Foreword
- Publication type: Journal article
- Journal: La Revue des lettres modernes
2024 – 1. Durtal dans tous ses états - Author: Solal (Jérôme)
- Pages: 13 to 17
- Journal: Journal of Modern Literature
- Series: Joris-Karl Huysmans, n° 9
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406155775
- ISBN: 978-2-406-15577-5
- ISSN: 0035-2136
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15577-5.p.0013
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 01-24-2024
- Periodicity: Monthly
- Language: French
Avant-propos
En 1928, dans un livre de souvenirs consacré à Huysmans, qu’il considérait comme un ami et un maître, Michel de Lézinier rapporte la discussion à l’origine du choix du nom de Durtal, finalement retenu alors que Huysmans avait d’abord songé à Runan. Entre ces deux noms à la lointaine parenté phonétique, l’option Durtal l’a finalement emporté, en cohérence avec une onomastique romanesque qui puise largement à la toponymie des communes françaises : à côté des Esseintes, Hermies, Carhaix, Marles ou Felletin, Durtal désigne une bourgade du Maine-et-Loire. Par ailleurs, en ses consonances nordiques, le nom évoque une vallée (Tal) de l’aridité ou de la porte (Dur) ainsi que le remarque vite Huysmans, amateur de symbolisme. Au cœur du patronyme hollandais de l’auteur, la porte marque le point de bascule d’un imaginaire spatial où prime l’idée de seuil, avec ses connotations de féconde labilité.
De 1891 à 1903, Durtal apparaît dans plusieurs romans de Huysmans où il tient le rôle principal. Parisien, écrivain, célibataire, il est le héros peu héroïque de ce qu’on a coutume d’appeler une trilogie catholique – si l’on considère son aventure de la conversion à l’oblature – mais de ce qui en réalité s’apparente plus largement à une tétralogie voire à une pentalogiespirituelles – si l’on tient compte de l’ensemble d’un cycle littéraire incluant aussi le roman du satanisme et celui, inachevé, de l’expérience salettienne. Dans sa recherche de l’aise le désir religieux opère divers réglages, il avance, cherche des lieux d’accueil et hésite entre transgression et tradition, décryptage et recueillement, rutilance et silence.
À chaque fois la notion d’espace apparaît dès le titre, sous forme adverbiale ou nominale, pointant un domaine massif (Là-bas, Là-haut), un élan (En route), un monument (La Cathédrale) ou une façon d’habiter (L’Oblat : celui qui séjourne à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’un monastère).
14Dans ces romans à la troisième personne, largement autobiographiques et autofictionnels, Durtal se distingue de son créateur, comme prototype il lui arrive de préparer la documentation pour des livres que dans un geste de relais métatextuel Huysmans se charge en définitive d’écrire. Il se pose comme la figuration retravaillée d’un auteur tourmenté par une foi qui vient, hésite, provoque, se discute, se cabre, s’approfondit et s’impose. Cette foi chrétienne commence à se manifester par son à rebours, dans la fréquentation du satanisme, qui la présuppose néanmoins, et elle se poursuit jusqu’à la virtuosité spatiale d’une oblature qui voudrait la tenir dans la laisse de l’écriture ou du moins l’aérer en facilitant la circulation entre l’enceinte d’un monastère et la délivrance littéraire, assurant ainsi une dialectique efficace et féconde entre le dedans et le dehors. Tout au long de cette pentalogie, Durtal obéit à une aimantation spirituelle qui l’oriente vers la mystique, objet à la fois d’un savoir historique, d’une documentation littéraire poussée et d’un désir d’expérience personnelle qui confine au non-savoir le plus total.
Les textes qui composent la première partie de notre volume donnent à voir Durtal en général, circulant d’un roman à l’autre, dans la globalité heurtée de son itinéraire au long cours, fermement engagé dans ses choix en même temps qu’inquiété par les oscillations d’un combat intérieur qui ne cesse d’alimenter le murmure de la fiction.
De Là-bas à L’Oblat, Durtal peut se présenter comme le porte-étendard des idées antimodernes de son créateur. Jocelyn Godiveau le montre naviguant entre un Moyen Âge sublimé et un monde contemporain détesté, n’ayant de cesse de s’en prendre à la République bourgeoise, matérialiste, démocratique, américanisée et positiviste, et n’épargnant pas même le catholicisme moderne, honni pour sa pudibonderie et son manque d’appétence esthétique. Pascaline Hamon suit le cheminement de Durtal, entre dialogue et soliloque, entre tradition et controverse, fuyant le monde, moins converti qu’aspirant à l’être, tandis que la poétique romanesque de Huysmans vient saisir le flux de cette conscience brouillée au bord de sa nuit intérieure, en proie à un rêve où affleure l’épouvante. Analysant l’attrait de Huysmans pour la musique, Dominique Millet-Gérard évalue son degré de connaissance technique et historique de la science grégorienne, dont le cycle de Durtal fait un éloge passionné. Elle remarque qu’aux yeux de Durtal le plain-chant 15constitue le parangon de l’art liturgique, d’autant plus sublime que son dépouillement fait advenir le Verbe.
Alexandra Delattre souligne l’originalité, déconcertante pour ses contemporains, de l’itinéraire spirituel de Huysmans. Elle estime que si le récit de Durtal accorde une large place à la chair, à l’incarnation triviale, parfois à l’alimentation, il fait néanmoins voie à l’art et montre un héros qui, en proie à la matérialité, seule dicible, attend et prépare, telle une coquille vidée, la visite d’un Dieu informulable. Explorant aussi les complexités du parcours de conversion de Durtal, Émilie Sermadiras note son hypersensibilité et souligne le lien entre religion et maladie, lien ambigu car le dolorisme affiché, qui parfois s’égare dans la crédulité vis-à-vis des phénomènes organiques extraordinaires, se nuance des prudences d’un converti qui à titre personnel peine à endosser les vertus mystiques de la douleur. Posant Durtal comme incarnation du célibataire – écrivain esseulé censément désireux d’écrire mais n’écrivant plus –, Marc Smeets sonde la teneur autobiographique du cycle romanesque dont Durtal est le héros gris, et remarque que le créateur en dépendance de sa créature prend peu à peu du recul pour finir par s’en séparer et se reformuler dans Sainte Lydwine de Schiedam et LesFoules des Lourdes.
Les textes de la seconde partie saisissent Durtal en particulier, dans le moment spécifique de telle ou telle des stations qui jalonnent son parcours, chronologiquement ajusté au vécu de l’auteur sans pour autant obéir à un aiguillage et à une logique strictement linéaires. Ils l’éclairent à partir du détail d’un roman de la pentalogie romanesque que la présence continue du personnage a précisément pour effet d’unifier. Attiré par d’autres conversions que la sienne, par l’option satanique (Là-bas, 1891), par les hauteurs de La Salette où se sont proférées de redoutables prophéties (Là-haut, écrit en 1892-1893), se convertissant enfin lui-même, péniblement (En route, 1895), osant une herméneutique monumentale (La Cathédrale, 1898), associant la prière du nous et l’écriture de soi en un pari communautaire auquel met fin la raison d’État (L’Oblat, 1903), Huysmans élabore un chemin de foi où, l’une après l’autre, les stations se répondent, se rectifient, se complètent en échafaudant laborieusemet l’idéal mystique porté par Durtal.
Vincent Petitjean décide de s’arrêter à la première étape du parcours, Là-bas, et voit Durtal, qui ne porte pas encore de moustache, se tourner 16vers le Moyen Âge et trouver en Gilles de Rais et surtout Grünewald les guides d’un parcours mystique qui passe par l’exhibition fascinante de corps souffrants. La future foi en Dieu de Durtal trouve sa source dans la foi en l’art qu’il énonce déjà ici. Marie Portier s’intéresse aussi à Là-bas, dont elle retient la relation amoureuse entre Durtal et Mme Chantelouve : ce qui s’apparente à une romance anecdotique minée par la dérision conduit cependant à la manifestation du surnaturel et vient structurer l’intrigue même de ce roman agnostique qui pose la question du sens spirituel à donner au désir sexuel.
À rebours de Là-bas, première borne du cycle, roman du satanisme médiéval et contemporain, Là-haut, roman inachevé de la foi en Dieu tout juste naissante, met en son cœur le récit d’un pèlerinage à La Salette et la puissance du secret confié par la Vierge Marie à la bergère Mélanie Calvat. François Gadeyne éclaire les enjeux du récit à la lueur des écrits de Joseph-Antoine Boullan, compagnon de Huysmans sur les pentes de La Salette et modèle de l’abbé Gévresin, l’interlocuteur admiré de Durtal : par son souci militant de donner vie au symbolisme des apparitions mariales, l’abbé déchu a longtemps influencé Huysmans qui, à travers son garde-fou Durtal, tient toutefois à marquer quelque distance à l’égard de prophéties vertigineuses et porteuses d’hétérodoxie. Jérôme Solal voit dans Là-haut la quête du Bon Lieu et du Bon Livre qu’on pouvait espérer trouver dans les hauteurs de La Salette, quête qui se révèle doublement décevante, marquée à la fois par le récit d’un échec (celui de Durtal et de sa stratégie de la camera cachée) et l’échec d’un récit (celui de Huysmans, dont le roman avorte).
En route est souvent considéré comme le moment décisif de la pentalogie durtalienne, avec notamment la conversion de son héros à la trappe de Notre-Dame de l’Âtre. Charles Brion relève ce qui fait d’En route un roman de formation : Huysmans y pratique une certaine géographie spirituelle où la liturgie fédère art et religion, il montre Durtal en quête de vie unitive suivre à la trappe un parcours initiatique jalonné d’épreuves et de tentations qui le conduisent à une profonde crise intérieure avant de le faire renaître spirituellement et s’ouvrir à un espace-temps remodelé. Édouard Garancher situe Durtal, à l’instar du René de Chateaubriand, dans la lignée de l’Augustin des Confessions. Il apparie les récits de conversion de Huysmans et du Père de l’Église par le rôle qu’y jouent la contention puis la dilatation d’une âme soutenue 17par la grâce, tout en notant la spécificité de Durtal, dont l’exaltation esthétique éclipse quelque peu l’attention exclusive due selon Augustin à la précellence de Dieu.
Quant à La Cathédrale, Nadia Fartas situe sa publication dans un contexte de sécularisation où surgissent d’autres représentations de cathédrales proposées par Monet ou Proust. Chez Durtal, en partance pour Chartres puis tenté par Solesmes, elle discerne un être tiraillé par de multiples contradictions, partagé entre le désir d’action, c’est-à-dire d’écriture, et celui de contemplation, esthétique ou religieuse.
Les tensions qui valent pour La Cathédrale valent aussi pour l’ensemble du cycle durtalien. D’un récit l’autre, Durtal avance avec de nouvelles certitudes toujours déjà menacées par les obstacles extérieurs et les contradictions intérieures. Où qu’il se rende pour trouver un abri et se colliger dans un culte de la solitude ou dans la recherche d’une communauté particulière, à Saint-Sulpice, La Salette, Notre-Dame de l’Âtre, Chartres, Solesmes ou au Val des Saints – destinations proches ou lointaines et toujours françaises –, ses séjours n’offrent guère l’aise pérenne espérée et restent guettés par l’indécision, la frilosité, les tentations, l’ennui, la déception, le sarcasme, la précarité, l’usure. Le cycle de Durtal tourne dans le cercle maudit de cette infortune. Pour l’ultime pèlerinage de Huysmans, à Lourdes, le roman vire au simple récit. Ayant épuisé ses cartouches, Durtal n’hésite enfin plus : il s’est définitivement retiré de la scène, la troisième personne laissant la place au je d’un auteur sans majesté.
Jérôme Solal