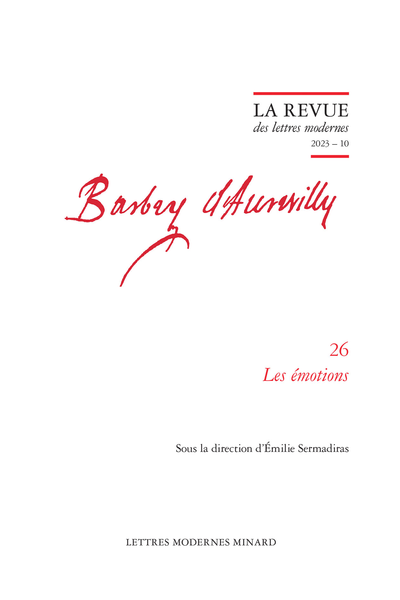
Recensions
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Revue des lettres modernes
2023 – 10. Les émotions - Auteurs : Smeets (Marc), Roldan (Sébastien)
- Pages : 219 à 227
- Revue : La Revue des lettres modernes
- Série : Jules Barbey d'Aurevilly, n° 26
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406158028
- ISBN : 978-2-406-15802-8
- ISSN : 0035-2136
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15802-8.p.0219
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/11/2023
- Périodicité : Mensuelle
- Langue : Français
Alice De Georges, Poétique du naturalisme spiritualiste dans l’œuvre romanesque de Joris-Karl Huysmans, Paris, Hermann, 2022, 348 p.
L’enjeu de ce livre est original, le défi grand : étudier le naturalisme spiritualiste dans l’œuvre de Joris-Karl Huysmans non pas d’un point de vue thématique mais stylistique. On sait qu’en 1887 Huysmans avait déjà appelé de ses vœux une nouvelle esthétique baptisée dans un premier temps « réalisme spiritualiste » (Carnet vert) et qu’il en a esquissé les contours et objectifs dans son roman Là-bas (1891). Et on sait aussi que ce faisant, l’auteur d’À rebours « a légué à la postérité un objet d’étude qui n’a pas fini de l’embarrasser1 », ainsi que nous le rappelle Jean-Marie Seillan dans la préface du livre. L’embarras semble être d’autant plus grand, étant donné que Huysmans lui-même a peu à peu abandonné cette expression oxymorique au profit d’un terme avec une « acception plus restreinte2 », à savoir le mystique. À quoi bon donc dédier tout un livre à une notion aussi temporaire que le naturalisme spiritualiste que Huysmans lui-même a rapidement délaissée ? Alice de Georges en est d’ailleurs fort bien consciente lorsqu’elle déclare qu’« on ne peut qualifier de naturaliste spiritualiste chaque page écrite par Huysmans à partir de Là-bas » (PNS, 97). Mais en même temps : quoi de plus intéressant et de tentant alors que d’essayer de « déterminer les critères qui composent l’esthétique naturaliste spiritualiste » (PNS, 17) si l’on accepte qu’elle colore l’écriture huysmansienne depuis En rade (1887) et qu’À rebours (1884) « en livre les prémices » (PNS, 31) ?
Alice De Georges procède de façon méticuleuse. Dans la première partie du livre, elle part « sur les traces d’un Huysmans en quête d’une nouvelle poétique » (PNS, 32) pour mieux pouvoir cerner cette esthétique romanesque. La question est donc de savoir comment « la permanence d’une esthétique naturaliste clairement définie » réunit avec « l’inconstance des 220tâtonnements de l’écrivain au sein des voies métaphysiques qu’il emprunte » (PNS, 40). Alice De Georges propose au lecteur de suivre une « odyssée spirituelle » (PNS, 40-74) où sont esquissées les errances et questionnements métaphysiques de Joris-Karl Huysmans et de ses personnages. Puis, elle aborde et problématise les deux variables de la formule huysmansienne : la « permanence » (le réalisme, le naturalisme, deux notions que Huysmans utilise de manière interchangeable mais que l’auteure du livre distingue l’une de l’autre de façon nuancée) et l’« inconstance » (« la part transcendante de l’esthétique huysmansienne » (PNS, 95)) dont le moteur est le principe de la transformation engendrée par la conversion. On peut regretter qu’Alice De Georges ne fasse qu’esquisser les contours de cette dernière variable et qu’elle se soit abstenue de mieux définir l’inconstance en ayant recours – tout comme elle l’a fait pour le réalisme et le naturalisme – aux « étiquettes » (-ismes) dont elle a mentionné plusieurs types dans le chapitre précédent. Mais elle semble préférer avoir recours aux termes plus insaisissables qui expriment le mouvement (« transformation », « contours mouvants », « instabilité », « variabilité ») pour mieux évoquer la « poétique de la quête », sujet de la deuxième partie du livre.
L’étude de la poétique de la quête se focalise sur la « trilogie de la conversion esthétique qui se noue autour d’En rade, Là-bas et En route », car elle concentre « les trouvailles esthétiques du naturalisme spiritualiste » (PNS, 106). Ce faisant, Alice De Georges laisse de côté un nombre de textes postérieurs à la conversion comme Sainte Lydwine de Schiedam (1901) ou Les Foules de Lourdes (1906). Bien qu’ils s’écartent « en partie de l’écriture romanesque et du naturalisme spiritualiste » (PNS, 108), ces textes présentent néanmoins un intérêt particulier. On sait qu’aux yeux de Joris-Karl Huysmans, par exemple, Sainte Lydwine, « [s]a petite Lydwine3 », rassemble tout ce qu’il y a de plus personnel et de plus « inchangé4 ». Alice De Georges avance certes un nombre de raisons qui expliquent pourquoi Sainte Lydwine n’a pas vraiment sa place dans le corpus qu’elle a constitué (appartenance générique, rattachement au naturalisme, recours aux descriptions, nature du lien entre l’âme et le corps), mais ce faisant elle montre bien que l’hagiographie – et peut-on 221vraiment qualifier d’hagiographie cet « étrange manteau d’Harlequin textuel5 » ? quel est en fait son statut générique ? – pourrait se présenter comme « l’aboutissement du naturalisme spiritualiste » (PNS, 117). On peut alors regretter que ce texte fondamental n’ait pas été considéré comme un terminus ad quem de son étude. D’autant plus qu’Alice De Georges analyse la poétique du naturalisme spiritualiste à travers trois « degrés de conversion du tangible » (PNS, 109) : l’incarnation, la transsubstantiation (la conversion des substances naturelles en principes spirituels) et la transmutation (de la matière). Rappelons que déjà de son vivant le corps pressé de Lydwine, converti en une substance unique, fut « une cassolette vivante6 ». Et pourquoi ne pas avoir incorporé le récit de la vie de la Mère Van Valckenisse esquissée dans La Cathédrale (1898) dont, trois semaines après le décès, le corps s’est liquéfié en une huile « blanche, limpide, parfumée7 » ? Liquéfaction, transfiguration du corps8, « transsubstantiation des pires ordures et sanies en de merveilleuses sublimités mystiques » (pour reprendre les termes d’Alain Buisine9), autant de vocables qui rappellent une conversion de la matière si chère à la poétique du naturalisme spiritualiste.
Ceci dit, Poétique du naturalisme spiritualiste comble une lacune dans l’éventail des études huysmansiennes. On s’en rend bien compte lorsqu’Alice De Georges étudie de près la « mise en mouvement de l’écriture » (PNS, 136) huysmansienne à travers les trois principes cités ci-dessus. Ayant pris En rade comme point de départ de la structure duelle du futur naturalisme spiritualiste (l’absence de démarcation entre le monde diurne et l’univers nocturne, la voie onirique et la voie souterraine, ou inconsciente), Alice De Georges poursuit l’analyse de la « structure narrative binaire » (PNS, 167) dans Là-bas. Conçu par Joris-Karl Huysmans pour démontrer « que les mêmes périodes d’âme se succèdent10 », le roman croise le médiéval et le moderne pour en faire un jeu de miroirs inversés qui « soude le 222passé et le présent » (PNS, 177). Il ne s’agit donc pas de voies parallèles comme l’avait écrit Joris-Karl Huysmans dans le premier chapitre de Là-bas mais plutôt d’une écriture permettant d’ouvrir « des portes qui conduisent de l’un à l’autre » (PNS, 178), d’incarner l’un dans l’autre.
La transsubstantiation, deuxième forme d’incorporation, dépasse l’union décrite dans le chapitre « Incarnations » ; elle est plutôt un changement de substance voire un doublement de médium. Apparaît ici l’importance de la technique picturale dans la poétique du naturalisme spiritualiste car « le principe de la transsubstantiation manifeste la “présence réelle” du divin dans ses ekphraseis et hypotyposes » (PNS, 183). Il s’agit donc de savoir comment la spiritualité figure dans le matériel et comment on peut « rendre visible l’invisible, sensible l’intelligible » pour reprendre la formule d’Aude Jeannerod11. Si « le dispositif pictural offre à la description sa structure » (PNS, 209), on s’étonnera alors peut-être qu’Alice De Georges n’ait pas eu recours aux travaux d’Aude Jeannerod pour étayer l’analyse de la manière dont Huysmans utilise le dispositif pictural et la palette du peintre pour réunir le spirituel et le matériel. Il n’empêche que l’analyse en soi demeure convaincante pour démontrer comment Joris-Karl Huysmans fait usage « du médium pictural pour investir son matériau d’une dimension surnaturelle » (PNS, 232).
Avec la transmutation, le troisième et dernier principe de conversion esthétique, nous entrons d’abord dans le domaine de l’art culinaire, terrain de prédilection de Joris-Karl Huysmans. Ici, Alice De Georges se propose d’analyser le réseau métaphorique culinairequi a pour but d’« éclairer la vie spirituelle sous un autre jour » (PNS, 242). Autrement dit, le phénomène de transmutation « vise à spiritualiser la matière tout autant qu’à incarner la spiritualité » (246). Alice De Georges montre, maints exemples à l’appui, que « le processus culinaire de réduction et de condensation propre à la fabrication de coulis ou de sucs, pour exhausser le goût des aliments, est autoréflexif du réseau métaphorique qui parcourt ce roman, où les deux systèmes du sacré et du culinaire sont transformés l’un par l’autre » (PNS, 252). L’autre processus de transmutation sur lequel s’attarde Alice De Georges est l’alchimie. Elle propose de lire la trilogie comme reflétant les trois phases du travail alchimique : l’œuvre au noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au rouge, l’atteinte de la pierre philosophale de la poétique surnaturaliste. 223Est-ce dire alors que Huysmans l’aurait lui-même trouvée ? Non, nous répond Alice De Georges, « parce que la conversion esthétique précède la conversion religieuse qui lui propose tout d’abord ses procédures pour en ralentir ensuite la progression » (PNS, 282). Aussi l’écriture huysmansienne, après En route, s’est-elle éloignée peu à peu du naturalisme spiritualiste.
C’est un livre novateur qu’Alice De Georges nous propose, en nous offrant une définition poétique du naturalisme spiritualiste tout en nous guidant à travers nombre de fragments et passages sélectionnés avec soin et analysés de façon précise. Ainsi montre-t-elle comment, à partir d’En rade, le spiritualisme travaille le naturalisme et vice versa. On aurait pu souhaiter qu’elle prolonge cette réflexion sur la poétique huysmansienne dans d’autres textes post 1895. Alice De Georges explique certes les raisons de son choix – et on comprend mieux la mention « œuvre romanesque » dans le titre de son ouvrage – mais on nous permettra de ne pas être entièrement convaincu, d’autant plus que, chez Joris-Karl Huysmans, le « romanesque » est l’autre nom de liberté générique. Malgré cela, saluons la tentative réussie d’avoir donné une définition et un panorama précis du naturalisme spiritualiste dans l’œuvre de Joris-Karl Huysmans, une première dans le domaine des études huysmansiennes.
Marc Smeets
Université Radboud Nimègue, RICH
*
* *
Julie Anselmini, L’Écrivain-critique au xixe siècle, Liège, Presses de l’Université de Liège, coll. « Situations », 2022, 554 p.
Le livre publié aux Presses Universitaires de Liège en 2022 par Julie Anselmini impressionne, séduit et satisfait le lecteur habitué aux travaux 224dix-neuviémistes. Il frappe l’esprit par l’ampleur du propos, il captive l’attention par l’originalité du point du vue, il assouvit le scrupule de probité par la rigueur de la démonstration. L’autrice s’est donnée pour objectif d’étudier le statut de l’écrivain-critique à travers trois de ses plus imposantes incarnations au xixe siècle : Alexandre Dumas, Théophile Gautier et Jules Barbey d’Aurevilly. « Tous trois, remarque Julie Anselmini, mènent en parallèle, publiquement, tout au long de leur carrière, écriture littéraire et écriture critique » (p. 14), si bien qu’au-delà de leurs différences (évidentes, foncières, nombreuses, variées), ces auteurs appartenant au milieu du siècle se rejoignent dans cette dualité de l’écrivain-critique, au sujet duquel on n’avait encore réalisé de synthèse. L’essai s’inscrit donc à la fois dans le sillage et en amont de celui consacré par Marie-Françoise Melmoux-Montaubin à la figure de L’Écrivain-journaliste au xixe siècle (2003), effectuant la charnière vers le siècle suivant. Pour Julie Anselmini, il s’agit ainsi « d’interroger la transformation de la critique littéraire » (EC, p. 18) au fil de la carrière de Dumas, Gautier et Barbey. De « pratique ancillaire » qu’elle était, la critique devient « une écriture participant de plein droit à la modernité littéraire » (Ibid.).
L’ouvrage, bien équilibré, se subdivise en trois grandes parties, chacune composée de quatre chapitres fédérés autour d’une question directrice. La première creuse la voie de l’histoire littéraire en retraçant la façon dont chaque auteur en est venu à exercer les deux rôles, embrigadé chacun à sa façon dans la « vaste offensive » (EC, p. 23) qui fut menée contre la critique professionnelle. La deuxième, centrée plutôt sur la posture de l’écrivain-critique, étudie l’éventail des « stratégies auctoriales » (EC, p. 13) déployées dans ce double rôle. La dernière, plus stimulante, délaisse les études médiatiques en conduisant l’enquête sur le versant esthétique du problème : « En quoi la critique d’un écrivain peut-elle être dite “créatrice”, au sens fort ? Quelles formes de critique littéraire inventent les écrivains ? » (EC, p. 14). Bénéficiant au surplus d’une introduction efficace, l’essai se recommande encore par sa capacité à faire ressortir la labilité de la démarcation entre littérature et critique tout en illustrant l’importance primordiale de cette dernière chez trois écrivains majeurs pourtant d’abord reconnus pour d’autres types d’écrits.
Qu’un chapitre débute par l’étude du cas de Dumas pour enchaîner avec ceux de Barbey puis de Gautier, le chapitre suivant adoptera sans hésiter (et sans s’encombrer de la légitimation de ce choix) une séquence 225différente : Gautier d’abord, Dumas ensuite, Barbey enfin. Il en va ainsi dans tout le volume. Cette souplesse bienvenue procure de la variété et permet de multiplier les points d’entrée dans la masse des matériaux à étudier. Cela comporte en sus l’avantage de présenter les enjeux suivant des gradations signifiantes qui favorisent la compréhension et excitent l’imagination.
Limpide, directe, précise, l’écriture de Julie Anselmini est imagée et élégante. On lui tiendra gré, à plus forte raison, de savoir l’art de faire revivre les auteurs du xixe siècle en citant volontiers, bien qu’avec mesure, certaines de leurs phrases bien trouvées qui éclairent autant le travail de l’écrivain-critique que l’esprit de l’époque. Sont cités d’autre part, et généreusement là encore, les travaux plus récents sur lesquels l’autrice appuie sa démonstration. Probe et scrupuleux, l’argument progresse à bon rythme.
C’est notamment le cas dans la première partie de l’ouvrage, où l’on prend connaissance de la manne de critiques produites par les auteurs à l’étude (chap. ii, iii et iv). Le relevé en est saisissant. Présentée de manière aussi systématique que possible à l’aide de regroupements pratiques, l’œuvre critique de Dumas, Gautier et Barbey revit grâce à un effort de classification et de commentaire enté sur une problématique spécifique à chaque auteur. Par exemple, l’intéressant chapitre sur Théophile Gautier (EC, p. 75-101) examine de près, dans ses diverses manifestations et articulations, la paradoxale conciliation de deux contraires chez l’auteur d’Émaux et Camées : sa « collaboration hyperactive aux circuits commerciaux et médiatiques de son temps » et ce « culte de la forme » qui chez lui est doublé d’un « anti-utilitarisme » (EC, p. 76).
Sans être aucunement surpris de voir Dumas, dans sa louange marquée pour Hugo, repousser l’auteur d’Hernani et des Misérables « doucement mais fermement du côté de la poésie » (EC, p. 243), on peut jouir de découvrir le jeu des positionnements auxquels se livre l’écrivain-critique. Le plaisir intervient semblablement quand l’autrice tourne son attention vers la conception que se fait Barbey, dans ses écrits critiques, de ce qu’est la poésie, laquelle serait identifiable alors à la spontanéité, l’expressivité et l’intensité qui trahissent « une intuition de l’infini, une spiritualité que Barbey reconnaît chez les vrais poètes » (EC, p. 265).
Mais c’est dans la troisième partie de l’essai que le propos se démarque le plus. L’autrice prend ici acte des ambitions de la critique 226littéraire du milieu du siècle : elles sont « à la fois herméneutiques, communicationnelles et esthétiques » (EC, p. 383). Les analyses s’y font plus enthousiasmantes, car c’est seulement là qu’on découvre enfin toute l’étendue des talents critiques des trois auteurs en vedette, lesquels apparaissent en portraitiste (Gautier), en causeur (Dumas) et en essayiste (Barbey). En effet, ce dernier s’impose par-dessus tout comme celui qui, dans l’amas de textes critiques qu’il a rédigés, s’attelle d’abord et avant tout à « l’expression d’idées philosophiques, morales, sociales, politiques et religieuses » aptes à présenter à ses contemporains « la voie qu’il faudrait ou qu’il aurait fallu prendre » (EC, p. 416). On voit ainsi, non sans délectation, l’auteur des Diaboliques « glisse[r] constamment de l’œuvre commentée au sujet de celle-ci, pour, mieux qu’elle, le traiter à son tour » (EC, p. 424).
Occasionnellement dans ce gros livre se décèle un manque de générosité. À la première page le lecteur est renvoyé aux travaux de Paul Bénichou sur la sacralisation de l’écrivain ; ils ont beau être à bon droit « désormais canoniques » (EC, p. 9, note 4), il serait bienvenu d’indiquer précisément lesquels, ou par lequel commencer : Le Sacre de l’écrivain ? Le Temps des prophètes ? Les Mages romantiques ?, etc.
Il arrive aussi que l’autrice s’appesantisse sur des considérations méthodologiques déjà réglées ailleurs dans le volume. La deuxième partie de l’ouvrage et la troisième, à la différence de la première, comportent un bref chapitre non numéroté et non répertorié dans la table des matières (EC, p. 127-129 et p. 295-298) : ce hors-d’œuvre laisse songeur sans procurer de bénéfice.
Certains segments du livre pourront sembler alourdis par un esprit excessivement théoricien. Dans la première moitié du chapitre sur « l’héroïsation du critique » (p. 130-141), Julie Anselmini prend ainsi le parti de centrer le propos sur une critique – parfois excessive ? – des travaux de Paul Bénichou sur la sacralité de l’écrivain romantique, alors qu’il serait peut-être plus productif de situer l’enquête sur l’écrivain-critique dans le prolongement de ceux-ci.
L’ouvrage se clôt par un douzième chapitre saisissant, où l’autrice entreprend de scruter les réécritures d’œuvres que ses trois écrivains-critiques ont élaborées quand ils se sont pris à rêver à ce qu’ils auraient fait, eux, avec le sujet de l’œuvre dont ils rendaient compte. On ira traquer 227la critique jusque dans des poèmes ou des fictions de Barbey, Gautier ou Dumas, lorsque l’œuvre est façonnée par « l’exercice critique » (EC, p. 477). C’est là que la brillante réflexion menée par Julie Anselmini trouve le plus d’éclat.
De ce beau livre le résultat net, positif aurait-on dit en 1850, est composite. Sa contribution au champ du savoir dix-neuviémiste consiste en partie à confirmer hors de tout doute des impressions, intuitions ou préconceptions qu’on pouvait avoir d’entrée de jeu à l’égard du travail de critique, d’écrivains de la stature de ces trois-là. Nul ne sera surpris d’apprendre, par exemple, que dans la critique du mitan du xixe siècle « [l]es commentaires consacrés à autrui sont rarement totalement désintéressés ou “objectifs” » (EC, p. 291). Au-delà des conclusions tirées auxquelles il fallait s’attendre, au demeurant utiles et qui n’enlèvent rien à la pertinence ni à la richesse des vues exposées dans cet admirable ouvrage, on retiendra la productive hypothèse explorée dans le troisième mouvement de l’essai. Car l’idée d’envisager la sympathie admirative ou son double inversé, le dégoût véhément, comme les deux faces d’une même médaille permet de donner à la notion d’écrivain-critique toute son épaisseur heuristique – quelles qu’en soient d’ailleurs les incarnations : entre un Gautier ou un Dumas enflammés et un Barbey déchaîné, la distinction est finalement secondaire, puisque ce qui les réunit, la passion, l’intensité, les fait vibrer à l’unisson.
Sébastien Roldan
Professeur associé,
Université de Winnipeg
1 Préface de Jean-Marie Seillan, Alice De Georges, Poétique du naturalisme spiritualiste dans l’œuvre romanesque de Joris-Karl Huysmans, Paris, Hermann, 2022, p. 7 (nous renverrons désormais à cet ouvrage en texte, entre parenthèses, par le sigle PNS, suivi de la référence)
2 Introduction de Jean-Marie Seillan pour Là-bas, in Joris-Karl Huysmans, Œuvres complètes, tome IV – 1888-1891, éd. Jean-Marie Seillan, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 403.
3 Lettre à Dom Thomasson de Gournay du 12 septembre 1897 (Bibliothèque de l’Arsenal, Ms Lambert 61, fo 85).
4 Comme l’a écrit Jean-Marie Seillan dans l’introduction pour Sainte Lydwine de Schiedam, « le livre hérite des plus anciennes thématiques de l’œuvre » (Œuvres complètes, tome IX – 1901-1902, éd. Jean-Marie Seillan, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 43).
5 Ibid.
6 Joris-Karl Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, op. cit., p. 335.
7 Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, in Œuvres complètes, tome VI – 1898-1900, éd. Gaël Prigent, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 206.
8 Ibid. Voir aussi Marc Smeets, « Osmazômes », Nineteenth-Century French Studies 37, no 1&2, Fall-Winter 2008-2009, p. 102-104.
9 Alain Buisine, Huysmans à fleur de peau, Arras, Artois Presses Université, 2004, p. 59.
10 Lettre de Joris-Karl Huysmans à Joseph-Antoine Boullan du 7 février 1890 (citée d’après Joris-Karl Huysmans, Œuvres complètes, tome IV – 1888-1891, op. cit., p. 363).
11 Aude Jeannerod, La Critique d’art de Joris-Karl Huysmans. Esthétique, poétique, idéologie, Paris, Classique Garnier, 2020, p. 565.