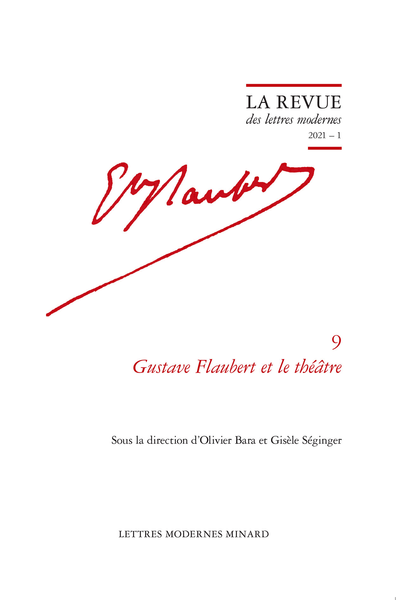
Carnet critique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Revue des lettres modernes
2021 – 1. Gustave Flaubert et le théâtre - Auteurs : Azoulai (Juliette), Postel (Alexandre)
- Pages : 255 à 267
- Revue : La Revue des lettres modernes
- Série : Gustave Flaubert, n° 9
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406112440
- ISBN : 978-2-406-11244-0
- ISSN : 0035-2136
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11244-0.p.0255
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/03/2021
- Périodicité : Mensuelle
- Langue : Français
Yvan Leclerc, Madame Bovary au scalpel : genèse, réception, critique, Paris, Classiques Garnier, 2017.
Dans un essai paru en 2017 (Réparer le monde, José Corti), Alexandre Gefen identifiait dans la littérature française contemporaine une orientation résolument empathique, voire thérapeutique, à finalité consolatrice. La même année paraissait aux Classiques Garnier la présente étude sur Madame Bovary, « cette œuvre cynique » (lettre du Procureur Général Impérial au Ministre de l’Intérieur, 24 décembre 1856), dont la lecture fit se demander à Sainte-Beuve si l’art véritable pouvait « ne vouloir pas consoler », et valut à l’auteur les remontrances outrées d’une amie de jeunesse, Gertrude Tennant : « personne n’a pu lire ce livre sans se sentir plus malheureux et plus mauvais ».
Ce recueil d’articles (publiés entre 1988 et 2014, et légèrement remaniés pour la publication en volume) se propose de suivre une autre voie que celle des innombrables « commentaires fins et savants » suscités par Madame Bovary : ni moins fine ni moins savante toutefois, l’étude s’attache principalement à recomposer et interpréter ce qui constitue « un dossier peut-être unique dans l’histoire de la littérature », à savoir l’extraordinaire masse de documents qui, des premiers scénarios aux recensions critiques après publication, en passant par les archives de la prépublication dans la Revue de Paris et la sténographie du procès, permet de faire l’anatomie du processus littéraire, de sa genèse à sa réception.
La connaissance que l’on peut aujourd’hui avoir de ce dossier doit beaucoup aux travaux menés ou coordonnés depuis près de trente ans par Yvan Leclerc : rappelons notamment la publication de Crimes écrits (1991), sur la censure et le procès, ou encore le travail d’équipe ayant abouti en 2009 à l’édition intégrale en ligne des brouillons de Madame Bovary (un texte, présenté en appendice, revient sur les étapes et les enjeux de cette aventure collective). À cet égard, ce volume apparaît comme la synthèse d’une activité critique de longue haleine. Synthèse bienvenue, dont le premier mérite est d’offrir au lecteur une vue d’ensemble, claire et précise, sur une série de phénomènes complexes et qui ont acquis, dans notre histoire littéraire, un statut quasi mythologique.
256Une première partie rassemble des textes consacrés à divers aspects de la genèse du roman. On y revient, entre autres, sur la planification rigoureuse du récit, les phases de rumination et de recopiage qui permettent à l’illusion romanesque de prendre consistance en se fixant sur des détails sensibles, les difficultés posées par « l’enchaînement des idées » dans un récit dont la première partie aspire à dépeindre une « action inactive », la fonction des notes de régie disséminées dans les scénarios et les marges, ou encore les traces de Louis Bouilhet, Maxime Du Camp et Louise Colet dans le manuscrit. Si le propos dégage des perspectives générales sur l’écriture flaubertienne (en particulier au sujet de l’intégration narrative de la « science psychologique »), il est aussi parsemé de petites énigmes, qui laissent à l’avant-texte sa part de mystère et d’opacité : comment interpréter, par exemple, cette hypothétique signature de Maxime Du Camp qui apparaît en marge du premier scénario d’ensemble ? Et lorsque Flaubert note son intention de donner à tel épisode un « mouvement fouetté », comment expliquer le choix de cette épithète ?
La deuxième partie retrace et éclaire les péripéties de la réception, à commencer par la prépublication dans La Revue de Paris et les nombreuses suppressions exigées par Laurent-Pichat et Du Camp. Dans les cinq articles qui composent cette partie, deux lignes s’entrecroisent : d’une part, le récit circonstancié d’une réception mouvementée (les tractations houleuses avec La Revue de Paris, donc, puis l’ensemble de la procédure judiciaire et enfin les réactions critiques à la parution du roman) ; de l’autre, une réflexion sur ce que signifie lire un roman en 1856-1857, c’est-à-dire sur les rapports entre littérature, justice et morale, sur la poétique du genre romanesque, ou encore sur les valeurs du mot « adultère » dans la littérature de l’époque. On s’essaye à lire Madame Bovary à travers les yeux de Laurent-Pichat, d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, d’Ernest Pinard ou d’Eugène Poitou (lauréat du prix Montyon 1857). Et l’on constate par ailleurs à quel point Flaubert se montre sensible aux divers jugements formulés sur son œuvre, moins par vanité d’auteur que par souci d’archiver la bêtise, ce qu’attestent quelques gestes singuliers, comme la sténographie, à ses propres frais, du réquisitoire d’Ernest Pinard et de la plaidoirie de Me Senard, ou le minutieux report, sur un exemplaire de l’édition Lévy, de toutes les suppressions imposées par la Revue de Paris, afin de conserver la trace de 257« mon manuscrit tel qu’il est sorti des mains du sieur Laurent-Pichat ». Cependant, cette ironie vengeresse n’est pas l’unique réponse de l’écrivain : on prend ainsi connaissance d’une note que l’écrivain rédigea pour sa défense, au moment du procès. Yvan Leclerc rappelle également qu’en quelques lieux du texte, la censure s’est muée en autocensure, comme si Flaubert s’était interdit de publier « les mots que la justice lui a volés en les souillant », par exemple le syntagme poésie de l’adultère, présent dans le texte de 1856, supprimé de l’édition Lévy.
La troisième partie, d’apparence plus hétérogène, rassemble quatre articles : sur les divers éléments qui, dans le roman, permettent à certains égards d’éclairer le devenir mythique ultérieur d’Emma Bovary ; sur l’émergence et l’évolution de la notion de bovarysme ; sur le sous-titre du roman, « mœurs de province », et ses implications ; enfin, l’ensemble se clôt par une belle lecture croisée de Madame Bovary et des Fleurs du mal, autour de la figure de Don Juan, incarnation d’une articulation impossible entre désir et passion. Il semble à la réflexion que deux questions sous-tendent cette dernière section :
–peut-on lire Madame Bovary en faisant abstraction du milieu social où se meut l’héroïne ? C’est à une telle occultation que tendent la mythologisation du personnage et les théories de Jules de Gaultier sur le bovarysme, ainsi que ses prolongements dans le discours psychiatrique ; mais que faire alors des « mœurs de province » ? Cette tension entre l’universel et le local, source d’interprétations si divergentes, est peut-être l’une des plus fascinantes réussites du roman de Flaubert.
–la question du genre : la notion de bovarysme (« pouvoir départi à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est », selon les termes de Jules de Gaultier) ne gomme pas seulement le milieu social, elle efface aussi la différence sexuelle. Par ailleurs, l’éclairage baudelairien fait surgir la figure de l’androgyne ; enfin, Yvan Leclerc rappelle l’importance du scénario de 1850, Une nuit de Don Juan, dans le processus conduisant à l’écriture de Madame Bovary, « comme si la nuit de Don Juan avait été complètement absorbée dans celles d’Emma ». À l’heure du triomphe des gender studies, on relira avec intérêt certaines réflexions sur l’impersonnalité en art, qui « passe par l’insexualité comme 258–sexualisation de ce qui n’a pas de sexe (panthéisme comme pansexualité) et perte de ce qui n’en a qu’un ».
Dans l’apologie qu’il projetait d’écrire pour son roman à l’occasion du procès, Flaubert écrit : « On ne va point par lubricité aux amphithéâtres ». Il serait certes excessif de prétendre que l’amphithéâtre où Yvan Leclerc anatomise le corps d’Emma Bovary attise la lubricité, mais on y trouve un vif plaisir.
Alexandre Postel
*
* *
Steve Murphy, Complexités d’un cœur simple, Genève, La Baconnière, « Nouvelle collection Langages », 2018.
Après avoir consacré plusieurs ouvrages aux grands poètes de la seconde moitié du xixe siècle (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine), Steve Murphy se penche sur la prose poétique de Flaubert dans « Un cœur simple ». Il en résulte une exégèse de 400 pages entreprenant d’éclairer la trentaine de pages du conte, justifiant par là le titre de l’ouvrage : Complexités d’un cœur simple.
Cette complexité résulte en partie d’un héritage herméneutique colossal, tant le conte a pu faire couler l’encre de la critique, depuis sa parution jusqu’à nos jours. Il faut saluer l’important travail de défrichage bibliographique auquel s’est livré Steve Murphy, mobilisant un nombre considérable des références issues de la critique francophone et anglophone et allant jusqu’à citer des thèses non publiées ou des conversations de vive voix avec Georges Kliebenstein au sujet de plusieurs points épineux du texte. Il n’était pas facile de manier un tel appareil critique ; pourtant Steve Murphy le fait avec beaucoup d’aisance et d’honnêteté 259intellectuelle, toujours scrupuleux de restituer la paternité de telle ou telle idée aux uns ou aux autres.
La condensation de l’écriture flaubertienne explique aussi la complexité du travail interprétatif, obligeant le critique à retourner aux avant-textes afin d’éclairer le sens de certains blancs ou de certains silences du conteur. Le manuscrit transcrit par Giovanni Bonaccorso sert ainsi régulièrement de point de repère, pour étayer les hypothèses avancées. Comme dans Logiques du dernier Baudelaire, Steve Murphy entreprend de mettre au jour les implicites du texte, afin de révéler « les logiques complexes du conte », porteuses d’une interrogation sur les rapports entre l’histoire et la condition humaine.
Le cheminement de l’ouvrage suit celui du texte. Steve Murphy y analyse chaque phase, voire chaque phrase, afin de dévoiler la signification socio-historique souterraine du récit. Il postule ainsi que loin de manifester une « prétendue disparition de l’histoire », le texte flaubertien contient « une forme d’historicité diffuse ». Le « demi-siècle » de bons et loyaux services consentis par Félicité auprès de Mme Aubain, sur lequel s’ouvre le texte, inscrit bien l’œuvre dans son siècle. Steve Murphy montre, en s’appuyant sur les brouillons, comment Flaubert livre « more balzaciano » une analyse fine des rapports entre les classes sociales dans la première moitié du xixe siècle (jusqu’à 1860, date retenue dans un brouillon pour la mort de Félicité). L’écrivain aurait ainsi mis en scène une galerie de types sociaux : le muscadin de jadis (feu M. Aubain) ; l’aristocrate ruiné par la crapule (le marquis de Gremanville) ; une ancienne « Merveilleuse » exposée au déclassement (Mme Aubain) ; des fermiers escrocs (Liébard et Robelin) en cheville avec un avoué véreux, emblème de la monarchie de juillet (Bourais) ; le libéral bourgeois de province « éminemment compatible avec la monarchie bourgeoise comme avec le Second Empire » (Paul) ; un ultra reconverti en sous-préfet Louis-Philippard (le baron de Larsonnière), etc.
Et Félicité ? C’est peut-être moins un type social qu’« un être humain qui a subi une série d’exploitations », qui « fait montre d’un esprit authentiquement populaire, patriote et internationaliste à la fois, au diapason de la pensée républicaine qui est au-devant de la scène en 1830 ». D’ailleurs, le perroquet arrive dans le conte « avec le vent chaud de la révolution de Juillet ». Le destin de la domestique de Mme Aubain serait ainsi porteur d’une politique implicite du conte, qui reste tout de 260même « dialogique » : la vision finale de Félicité, qui n’est réductible ni à une lecture hagiographique, ni à une visée parodique et anticléricale, manifesterait l’antipathie de Flaubert pour deux idéologies des années 1870 : « celle des libres-penseurs qui ont joué un rôle intolérant pendant la Commune et celle des monarchistes réactionnaires qui essaient de ramener la France vers une nouvelle et très obscurantiste Restauration ». La leçon du texte n’étant pas entièrement contenue dans sa fin, il faudrait voir dans la trajectoire de Félicité, non pas tant la soumission, le deuil et la mort, qu’« une glorification de la résistance à l’adversité et une célébration des valeurs de la vie ».
Cet ouvrage a ainsi le mérite de rendre sensible une dimension politique révolutionnaire du conte, sans chercher à masquer les difficultés d’interprétation de celui-ci. Steve Murphy pose des questions au texte, avance des hypothèses et s’efforce de les corroborer en s’appuyant sur les avant-textes, sur l’œuvre de Flaubert dans son intégralité, ainsi que sur la culture littéraire du xixe siècle (notamment Balzac, Baudelaire, Rimbaud, Zola). Plusieurs questions posées au texte s’avèrent extrêmement fécondes : par exemple sur la topographie et l’architecture de la maison Aubain, sur le sens des mots « salle », « lucarne » ou « appartement » (pour désigner la chambre de bonne de Félicité), sur le sens des dons et des cadeaux dans le récit. D’autres sont très stimulantes et neuves : n’y aurait-il pas une collusion entre Bourais et les fermiers de Mme Aubain ? les camarades de ferme de Félicité ne l’ont-ils pas attirée à la foire de Colleville pour la jeter dans les bras d’un prédateur sexuel notoire en la personne de Théodore ? les enfants Aubain jouent-ils ? La mort de Félicité n’est-elle pas imputable au « poids pathogène » de son environnement ? Certaines, cependant, semblent plus tirées par les cheveux : Loulou serait-il mort à d’une épizootie européenne qui a sévi dans les années 1830-1840 ? Aurait-il été asphyxié par les émanations de la cheminée devant laquelle Félicité le plaçait pour qu’il n’ait pas froid ? Triturant et retournant le texte sous toutes ses coutures, Steve Murphy propose de nombreuses investigations lexicologiques éclairantes, mais l’onomastique et la toponymie nourrissent quelquefois des spéculations qui tiennent davantage de la libre association que de l’argumentation logique : on peut ainsi douter que Flaubert ait attribué au médecin de Pont-L’Évêque qui n’a pas su sauver Virginie le nom de Poupart parce que c’est un synonyme de crabe-tourteau, terme lui-même synonyme de cancre.
261Il n’en reste pas moins qu’en maniant « la loupe de Sherlock Holmes », Steve Murphy nous invite à une exploration ludique et espiègle du texte.
Juliette Azoulai
*
* *
Éric Le Calvez (dir.), Flaubert voyageur, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2019.
Le sujet de ce volume collectif prend le contre-pied du cliché (volontiers alimenté par Flaubert lui-même) selon lequel l’écrivain aurait été un auteur sédentaire, ermite, enfermé dans sa tour d’ivoire, sempiternel « cul de plomb » et entreprend de révéler au contraire sa nature de « grand voyageur », comme le rappelle Éric Le Calvez dans sa précieuse préface qui récapitule la série des principaux voyages de Flaubert : dans les Pyrénées et en Corse en 1840, en Italie en 1845, à travers la Loire, la Bretagne et la Normandie en 1847, en Orient entre 1849 et1851 (voyage qui comprendra des séjours en Grèce et en Italie) ; en Algérie et en Tunisie en 1858 – liste à laquelle il convient d’ajouter les voyages mondains (à Saint-Gratien, à Nohant, à Nogent-sur-Seine ou à Londres), les voyages d’étude (dans les bibliothèques parisiennes), les voyages de santé (Vichy, Suisse) ou les voyages de repérage.
Le plan de l’ouvrage propose un parcours chronologique de la question : une première partie est consacrée aux voyages de jeunesse (1840-1847) ; une deuxième partie s’intéresse au grand voyage en Orient (1849-1851) ; une troisième partie aborde la question de l’héritage littéraire du voyage en Orient et de certains voyages ultérieurs à celui-ci. Cette structuration a le mérite de mettre en valeur l’évolution de l’écrivain et la manière dont Flaubert a pu passer de l’œuvre de jeunesse à l’œuvre de maturité – le voyage en Orient représentant une étape fondatrice dans 262la constitution de son esthétique. Comme l’écrit Nathalie Petibon, « le voyage extérieur de l’homme est le voyage intérieur de l’artiste ». Et, de ce point de vue, chaque déplacement marque une transformation de l’écrivain, qui est auscultée avec minutie par les différents auteurs.
L’exhaustivité du propos permet de mettre en valeur quelques problématiques constantes, formant une riche matière à réflexions pour le lecteur, qui est ainsi amené à faire dialoguer entre eux les différents articles.
L’écriture du voyage
Aucun des textes de voyage flaubertiens n’a paru du vivant de l’auteur, à l’exception d’un extrait de Par les champs et par les grèves, publié dans L’Artiste en 1858. Flaubert montre une attitude critique vis-à-vis du récit de voyage, très en vogue à son époque : il écrit en 1866 que « le genre voyage est par soi-même une chose presque impossible » et se refuse constamment à écrire à ses correspondants une « relation » de voyage – terme qu’il emploie avec ironie. Plusieurs auteurs de ce volume analysent donc la manière dont le refus de produire des récits de voyage est à l’origine de nouveaux modes d’écriture du voyage.
Khalid Lyamlahy propose ainsi de rapprocher l’écriture du Voyage en Italie de ce que Roland Barthes appelle la notatio comme capture sur vif, par opposition à la nota, qui correspond à une reconstruction après-coup du voyage, grâce à un travail de la mémoire. Reprenant les analyses de Claudine Gothot-Mersch qui voit dans ce texte un memento, « un aide-mémoire strictement personnel », où le voyage est consigné plutôt qu’il n’est raconté, Khalid Lyamlahy montre comment ces fragments flaubertiens de la mémoire sont le lieu d’une quête d’une écriture romanesque nouvelle – en suivant l’idée barthésienne selon laquelle « à l’horizon de la division, c’est-à-dire de la prolifération dense de la notation, il y a le roman ».
La restitution de l’expérience flaubertienne du voyage est comparée à celles d’autres voyageurs du xixe siècle – que ce soient des écrivains comme Lamartine, Chateaubriand, Nerval, Gautier (voir A. El Meknassi), des peintres comme Fromentin ou Delacroix (voir L. Amaral de Oliveira Ribeiro), ou un historien comme Edgar Quinet, parti en Grèce lors de l’expédition scientifique de Morée (voir M. Breuillot). Or, il apparaît que 263même si Flaubert tente de cerner « l’Orient vrai », en faisant abstraction des stéréotypes byroniens, il n’échappe pas toujours au cliché dans ses notes personnelles, qui empruntent aux codes du langage pictural et aux descriptions des voyageurs romantiques (L. Amaral de Oliveria Ribeiro).
Catherine Thomas-Ripault défend la thèse extrêmement stimulante selon laquelle la correspondance d’Orient constituerait un mode d’écriture permettant d’éviter les écueils du récit de voyage traditionnel, dans la mesure où il ne s’agit plus de répondre aux attentes d’un public large et anonyme, mais de trouver pour chaque destinataire le ton juste et l’angle particulier qui lui convient : à la mère de Flaubert sont réservées les considérations sur la cuisine locale et les relations mondaines ; au frère aîné la description des symptômes de maladies égyptiennes ; à l’ami Bouilhet, les grivoiseries, les scènes de rue cocasses ou grotesques. En échappant à la contrainte des passages obligés, l’écrit épistolaire permet des aperçus moins attendus, à travers une tonalité plus familière, qui s’oppose au discours spontanément lyrique du récit de voyage. Le refus flaubertien de livrer à ses correspondants une « relation » de voyage n’est donc pas à entendre comme une prétérition mais comme la revendication esthétique d’une manière originale d’écrire.
Flaubert invente aussi des formes hybrides et expérimentales, comme l’indique Biagio Magaudda à propos du Carnet de voyage à Carthage (1858), qui tient à la fois du journal intime et du calepin d’enquête rigoureux et qui permet de rendre compte de l’ambivalence du voyage flaubertien en Afrique du Nord, qui est tout à la fois un voyage érudit et un voyage sentimental.
Une éthique du voyage
Dès les années 1840, dans Pyrénées-Corse, Voyage en Italie et Par les champs et par les grèves, Flaubert développe une éthique personnelle du voyage, comme le montre Alexandre Bonafos. Le voyage est un « travail sérieux » pour le jeune écrivain, qui refuse de voyager « en épicier » et récuse les admirations convenues ou les visites incontournables, pour faire valoir un principe de liberté radicale : le voyageur buissonnier, répondant à l’appel de l’horizon, s’émancipe et s’ensauvage, au fur et à mesure d’une recherche qui le mène à la révélation d’« une sorte de vie nouvelle » (Corr. IV, p. 56), où il accède à une plénitude de l’être.
264Comme le rappelle Stéphanie Dord-Crouslé dans son article lumineux, en se fondant sur le livre de Jean-Didier Urbain, L’idiot du voyage. Histoires de touristes, le milieu du xixe siècle correspond à un moment où le terme « touriste » prend une connotation péjorative et Flaubert s’efforce en Orient de distinguer sa propre manière de voyager de celles des touristes, en préférant des séjours longs dans les lieux où il se rend, en prenant le costume des autochtones, en exprimant son irritation face aux comportements des touristes, en dénonçant les altérations que les autres voyageurs font subir aux monuments (graffitis) et aux villes qu’ils visitent (Rome, par exemple, remplie de magasins pour touristes, selon lui). Flaubert se place ainsi symboliquement du côté de l’indigène, regardant les autres voyageurs comme des étrangers. Il n’en reste pas moins qu’il consulte des guides touristiques et ne dédaigne pas de visiter certains hauts lieux du tourisme ; et Du Camp s’est plu à portraiturer son ami Gustave en « anti-voyageur » qui « s’est cru voyageur ». Stéphanie Dord-Crouslé propose finalement de sortir de la dichotomie de l’anti-touriste et du touriste pour rendre compte de la manière dont Flaubert parcourt l’Orient, qui est avant tout celle d’un futur écrivain en voyage. Il s’opère en effet en Flaubert une métamorphose existentielle qui le met sur la voie de sa future poétique : « une large ouverture sur l’extérieur », qui va de pair avec une égalisation de tous les êtres et de toutes les choses ; une forme d’indifférence, qui se formule parfois comme un égoïsme, mais qui serait plutôt un amour indifférencié de tout (« on se sent aimer autant les bêtes que les hommes, et les galets de la mer que les maisons des villes »), préfigurant l’esthétique de l’égalisation des sujets. On est loin ici de ce que Thierry Poyet désigne, dans un curieux portrait à charge du voyageur que fut Flaubert, comme le voyage « autocentré » de l’écrivain, qui manifesterait, selon lui, un « inintérêt de Flaubert pour l’autre ».
Identité/Altérité
La dialectique de l’identité et de l’altérité, qui est au cœur de l’expérience du voyage comme interrogation sur soi à travers la rencontre de l’autre, est approfondie dans plusieurs articles de ce volume. Jean-Claude Berchet évoquait à propos du voyage de Chateaubriand en Orient un « voyage vers soi », une quête autobiographique reposant 265sur l’inscription de l’identité de l’auteur dans une histoire culturelle collective.
Chez Flaubert l’écriture de soi en voyage s’inscrit dans une tension vers l’autre, comme l’indique Catherine Thomas Ripault, à propos des autoportraits que Flaubert propose à ses correspondants. Que ce soit à travers cette parole épistolaire pour l’autre, tout entière orientée vers son destinataire, ou dans l’expérience de l’altérité orientale, plusieurs auteurs de ce volume insistent sur la manière dont le voyage, et singulièrement le voyage en Orient, permet à Flaubert d’élaborer un nouveau modèle esthétique reposant sur l’impersonnalité – notion qui est à comprendre comme la « vraie personnalité » de l’écrivain, l’expression de son « moi profond », pour reprendre l’analyse paradoxale de Thibaudet (citée par Moulay Youssef Soussou). La rencontre sexuelle en Orient, de ce point de vue, apparaît comme un point de débat, dans la lignée des travaux d’Edward Saïd et d’Alain Buisine : Thierry Poyet dépeint Flaubert en touriste sexuel bourgeois, incapable de sortir de son égocentrisme et de son ethnocentrisme, mais Moulay Youssef Soussou voit au contraire dans le contact de Flaubert avec le corps de l’almée Kuchiuk-Hanem la découverte de formes d’écritures autres, plus incarnées, comme la danse ou le tatouage.
Durant son périple oriental, Flaubert est amené à penser la limite entre le même et l’autre, entre l’Occident et l’Orient : Martine Breuillot note ainsi que la frontière entre culture occidentale et culture orientale semble passer entre la Grèce et la Turquie pour Flaubert, alors que pour Chateaubriand elle se situe entre l’Italie et la Grèce.
Mais Flaubert se livre à un constat plus pessimiste et mélancolique, comme l’indique Vesna Elez : cette frontière s’efface au fil du temps, l’Orient que visite l’écrivain est à son crépuscule et perd peu à peu son altérité (« [L’Orient] s’en va, il se civilise. » Corr. I, p. 663.)
La genèse d’un écrivain et d’un imaginaire artistique
Comme le note Stéphanie Dord-Crouslé, pour Flaubert « écrire et voyager se pensent sur le même modèle » (p. 213) : ce sont deux manières d’être au monde similaires, impliquant une aspiration dynamique à un au-delà inaccessible. Dès lors l’expérience du voyage apparaît bien comme le lieu où peut se saisir la genèse de l’écriture et de l’imaginaire 266flaubertiens. Les toutes premières notes de voyage permettent de retracer la généalogie d’une poétique singulière.
Pour Abbey Carrico, l’écriture du voyage dans Pyrénées-Corse témoigne déjà d’une tension entre lyrisme et réalisme chez le jeune écrivain, qui souhaite que « [s]es phrases sentent le cuir de [s]es souliers de voyage » et qui voit dans le voyage l’occasion pour l’esprit de s’élever dans « les hautes régions de l’imagination » et de percevoir des « spectacles d’aigles » : dans cette tension entre horizontalité et verticalité se trouve déjà en germe l’esthétique bifrons du Flaubert de la maturité, qui affirmera porter en lui « deux bonshommes distincts ». Et Jeffrey Thomas montre comment lors de ce voyage de 1840 la visite des anciennes villes de l’Empire romain, comme Nîmes et Arles, et la contemplation de la Méditerranée, constituent les premières étapes dans le développement du grand rêve antique et oriental de Flaubert.
À moins que le voyage lui-même ne soit que second par rapport à un rêve antérieur, à un imaginaire historique forgé à travers la lecture : c’est l’hypothèse de Christophe Ippolito, qui voit dans Par les champs et par les grèves un récit de voyage hanté par la nostalgie d’un passé historique, proche en somme de l’écriture de Chateaubriand dans Les Martyrs ou les Mémoires d’outre-tombe. Le voyage serait donc moins un déplacement géographique à la surface des choses vues qu’une ouverture sur la profondeur du passé, nourrissant l’espoir de pouvoir le ressusciter.
Cependant Martine Breuillot remarque à propos du voyage en Grèce un intérêt conjoint de l’écrivain pour la Grèce antique et pour la Grèce moderne et Nathalie Petibon, comparant les deux voyages en Italie (celui de 1845 et celui de 1851), montre comment l’écrivain s’est, de l’un à l’autre, séparé du rêve romantique de l’italianità pour apprendre à « se faire prunelle ».
Le voyage en Algérie et en Tunisie de 1858 prend même un sens thérapeutique et hygiénique pour celui qui, dans la préparation de Salammbô, dit souffrir d’« une indigestion de bouquins » et « rote[r] l’in-folio » (Corr. II, p. 726). Le « changement d’air », comme l’explique Biagio Magaudda, devient alors un moyen de relancer l’écriture et l’imagination, tombée en panne. Toutefois, à propos de ce même voyage, Ôphelia Claudel dépeint Flaubert, en visiteur boulimique, en Moloch insatiable s’emplissant de paysages, se « fou[tant] une ventrée de couleurs, comme un âne s’emplit d’avoine » (Corr. I, p. 528). De l’imaginaire livresque à 267l’image in situ, il y va toujours d’une consommation effrénée qui seule permet « l’innutrition » (S. Dord-Crouslé) nécessaire pour restituer « la couleur de l’objectif ».
Deux articles proposent à travers une approche génétique d’étudier la manière dont l’expérience du voyage se traduit dans les manuscrits de Flaubert. Stella Mangiapane s’intéresse à la visite par Flaubert de la ferme modèle de Lisors en 1874, qui nourrit le chapitre de Bouvard et Pécuchet consacré à l’agriculture. Rosa Maria Palermo Di Stefano montre de son côté comment le voyage en Palestine permet d’éclairer la genèse du conte « Hérodias » : Jérusalem apparaît d’emblée à Flaubert comme une ville hantée par « la haine religieuse » entre diverses communautés, comme le lieu d’une « réunion des malédictions réciproques » – ce qui inspirera la scène dialogique et conflictuelle du banquet d’Hérode.
Juliette Azoulai