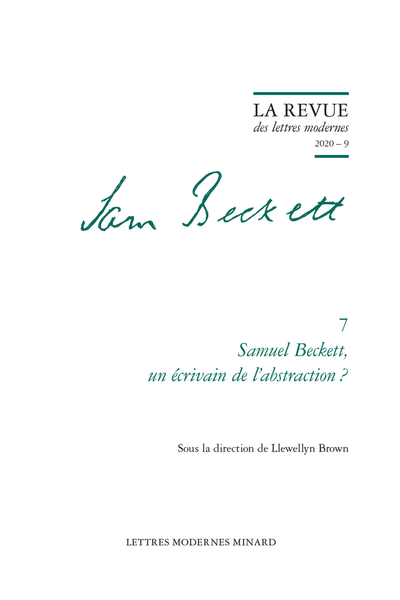
Avant-propos
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Revue des lettres modernes
2020 – 9. Samuel Beckett, un écrivain de l’abstraction ? - Auteur : Brown (Llewellyn)
- Pages : 15 à 20
- Revue : La Revue des lettres modernes
- Série : Samuel Beckett, n° 7
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406110514
- ISBN : 978-2-406-11051-4
- ISSN : 0035-2136
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11051-4.p.0015
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/12/2020
- Périodicité : Mensuelle
- Langue : Français
Avant-propos
Le terme abstraction revient de manière récurrente sous la plume des critiques beckettiens, étant devenu un lieu commun aux allures d’une évidence qui n’est pas toujours définie ou interrogée. Il est vrai, cependant, que de nombreuses caractéristiques de l’œuvre semblent justifier ce qualificatif : autant dans le théâtre que dans la fiction, les personnages et les lieux paraissent progressivement délestés de toute fonction référentielle. Ainsi, le décor des films présente des lieux stéréotypés – selon la progression marquée dans Film, de la rue vers la chambre dénudée –, ou efface toute matérialité, comme dans Nacht und Träume. Les mots aussi perdent leur fonction référentielle – encore présente dans Molloy ou Malone meurt – pour mettre en évidence les brisures sous des formes aussi diverses que les phrases incomplètes de Winnie, ou la permutation des blocs phrastiques compacts dans « Sans », allant jusqu’à Worstward Ho où le travail intense sur l’équivoque fait résonner la part du langage qui demeure hors sens.
L’objectif du présent recueil consiste donc à interroger le vocable abstraction, afin d’en déceler la complexité. Les études successives offrent autant d’éclairages mettant à jour la portée de cette notion, en sorte qu’elle n’apparaisse pas simple ou univoque, mais foncièrement problématique : la pertinence de l’idée d’abstraction paraîtra, dans le contexte beckettien, comme étant à la fois confirmée et nuancée, processus au cours duquel elle aura gagné en précision.
La première partie de ce volume – intitulée « Continuité et rupture » – aborde l’abstraction à l’aune de son émergence dans le contexte des avant-gardes. Notre texte de présentation note que Beckett rejetait l’abstraction picturale, voyant en celle-ci l’aspiration à une harmonie destinée à apaiser et à effacer toute subjectivité, en occultant une disharmonie de fond. L’abstraction comme représentative d’une unité imaginaire se distingue alors d’un autre sens qui engage une singularité liée à la solitude, et où l’altérité marque sa fonction d’empêchement : l’élimination de l’accidentel, pour accéder au hors sens.
16Deux figures de l’abstraction sont abordées. Les motifs géométriques présents dans certaines œuvres témoignent d’un formalisme qui se veut sans reste. Les mathématiques, en revanche, révèlent une dimension infinie, porteuse d’angoisse. Enfin, au lieu d’occuper un statut surplombant, la géométrie et les mathématiques apparaissent comme des motifs parmi d’autres, au sein de l’œuvre de création. C’est dans leur pureté imaginaire que l’artiste inscrit sa subjectivité comme tache.
Prenant l’exemple du surréalisme, Bernard-Olivier Posse voit l’abstraction comme une démarche structurante de l’écriture beckettienne, et qui consiste à détacher des formes de leur contexte pour les transformer, au point d’effacer leur origine. Ainsi, dans « Le Concentrisme », Beckett prétend avoir inventé les poèmes qu’il avait empruntés. Dans Dream of Fair to middling Women, le jeu sur les mots womb et tomb traduit l’état d’activité créatrice, idée que Beckett prolonge avec un énoncé emprunté au Grand Jeu, et qu’il détourne à son tour pour engendrer un nouveau réseau d’images. Le motif des « paupières fermées » revient avec une extrême fréquence, coupé de ses origines, pour devenir une image de la création artistique dénué de tout marqueur d’emprunt. Ainsi, Beckett fait perdre aux mots le sens qu’ils doivent à leur origine, afin de les réinscrire et les remotiver, dans un sens qui peut paraître hermétique.
Si le registre du visuel semble rassurant dans sa représentation de la matérialité du monde, sa qualité problématique est explorée dans notre deuxième partie intitulée « L’Image et le visuel ». Arka Chattopadhyay observe, dans Mal vu mal dit, que les objets pétrifiés – dont la condition minérale suggère le minimalisme et l’abstraction – se montrent affectés par l’œil qui les regarde. Animé et inanimé sont saisis par un même mouvement qui témoigne d’une oscillation entre apparition et disparition, concret et abstrait. Le processus d’abstraction n’est donc jamais achevé. Alors que le mouvement des chiffres – de zéro à l’infini – conduit vers l’abstrait, l’inexistence totale demeure impossible à atteindre, et dès lors qu’ils sont inscrits, les nombres montrent une matérialité qui résiste à leur mise en pièces.
Partant des liens de Beckett avec Georges Duthuit, Julie Bénard relie les tableaux de Bram van Velde aux pièces pour la télévision Eh Joe et Quad I, notant que l’écrivain rejetait le consumérisme affectant l’art. Mettant en cause le lien entre la peinture figurative et le discours destiné à en rendre compte, Beckett fait état d’un reste non figuratif qui ne cesse d’échapper, 17et qui le pousse à chercher un “langage-sensation” – que Duthuit nommait “hiéroglyphes” – pour traiter de l’expérience esthétique. Notamment, l’art abstrait souligne l’écart entre l’objet et son expression, effaçant la mise en perspective et l’impression de profondeur. Tel est l’effet produit dans Quad I, et dans Eh Joe, où le visage du protagoniste envahit le cadre – acquérant ainsi une qualité concrète –, mettant en tension l’espace représenté et la position du spectateur qui est désormais regardé, de même que Joe est médusé par la voix.
Anne-Cécile Guilbard poursuit ce fil dans son étude des œuvres télévisuelles, discernant la tension vers une abstraction qui n’est jamais complètement réalisée. Elle note que dans le gros plan d’Eh Joe, la caméra “serre le kiki” de l’espace visuel, pour faire taire les voix du dehors. Le film s’arrête quand la limite de l’image figurative est atteinte. Les yeux deviennent alors un espace autre que celui des images figuratives : l’espace ultime, abstrait parce que sans image. Dans Was Wo et Not I, le surcadrage et le halo de lumière accompagnent l’effacement de la profondeur pour engendrer la bi-dimensionnalité, la surface d’un tableau. La figuration reste néanmoins dans la représentation des locuteurs. Puis, dans Nacht und Träume, les espaces de veille et de rêve sont contigus : la durée seule assure l’impossible coprésence du rêveur et du rêve.
Dans …que nuages…, le personnage sur le plateau paraît ridicule, discréditant toute représentation réaliste, tandis que l’énonciateur et le visage féminin composent deux images prises dans un regard extérieur, comme des apparitions l’une dans le champ de l’autre. Trio du fantôme part de l’antériorité autoritaire des mots sur l’image. Cependant, le regard de S dans le miroir fait passer à l’intérieur de l’image, échappant au contrechamp composé par la voix off. La caméra pourtant ne remplace jamais le regard de S : l’intérieur de la “boîte crânienne” résiste à l’intrusion. Quant aux objets, ils deviennent des simulacres échappant à la nomination. Beckett fait taire la voix pour laisser l’image. Enfin, la musique apparaît comme le vrai lieu sans images.
Cet échec du spéculaire soulève la question de ce qui se soustrait au visible, conduisant à notre troisième partie intitulée « L’Obstacle non spéculaire ». Isabelle Ost affirme que loin de témoigner d’une prédilection pour le conceptuel, l’abstraction beckettienne traduit la soustraction du superflu, et un art de “l’échec” visant l’épuisement. Cette perspective rejoint la psychanalyse, qui conçoit la lettre comme un objet vide de tout 18contenu, et qui manque à sa place. Le vide fonctionne alors comme un chaos originaire d’où surgissent des objets-déchets, en sorte que le néant ne puisse jamais être atteint. Dans un dynamisme de “dénégation”, oui et non persistent simultanément, laissant le sujet délocalisé. L’abstraction est donc ce qui réussit dans son ratage même, lieu où la négation de la forme s’appuie nécessairement sur cette dernière.
Bruno Geneste aussi souligne la conception de l’abstraction comme une exclusion du sens qui, en extrayant des illusions de la beauté et la vérité, révèle le trou dans le savoir. Ainsi vient à jour le “sinthome”, qui témoigne d’une singularité inextinguible ancrée dans le corps. Dans son élaboration des structures cliniques, Lacan déplace la fonction phallique, pour aboutir à l’inconscient réel, marqué par un signifiant hors chaîne et ancré dans le réel. Dans la clinique, c’est le quatrième rond du nœud borroméen – représentant le dire – qui permet un arrimage, quels que soient les symptômes. On observe ce processus dans Watt, où l’étrange “glissement” révèle un “rien” indépassable et une existence hors toute échelle. L’abstraction relève d’une transcendance où nous rencontrons ce que Beckett appelle “l’empêchement” : l’objet a ou la Chose qui pulvérise l’image spéculaire figée. Le véritable trou est alors le radicalement autre, la jouissance impensable de “l’Autre de l’Autre qui n’existe pas” : lieu réel de “La Femme”, et avec lequel traite la création artistique.
Geneste oppose deux hypothèses cliniques. Dans l’une, Beckett traiterait l’abattement mélancolique en introduisant un hiatus dans l’écriture, et en restaurant l’équivoque, comme on le voit dans Worstward Ho, préservant ainsi la possibilité d’un dire. L’autre hypothèse pose un nouveau nœud borroméen ouvrant le trou du radicalement autre, écartant ainsi l’idée d’une mortification originelle par le langage. Apparaît ainsi une dimension de l’équivoque parfaite, où le mot respire. Alors, le dire est alors l’abstraction radicale, un “savoir-défaire”, déclenchant la puissance de dissipation.
Loin d’évacuer le corps, cette conception de l’abstraction fait appel à une autre modalité de vivre ce dernier, et qui est abordée dans notre quatrième partie. Pim Verhulst observe que la radio a pu jouer un rôle important dans la progression de Beckett dans l’abstraction et vers une pratique de l’intermédialité. Le corps de Maddy Rooney est très présent dans All That Fall et proche de celui d’un personnage de théâtre : seule Miss Fitt demeure entièrement éthérée. La qualité théâtrale est 19entièrement écartée, en revanche, dans Embers, où Ada apparaît comme un être spectral, mais dont la réalité est encore frappée d’ambiguïté.
Beckett réduit progressivement la présence du corps dans ses pièces radiophoniques, mettant en évidence les éléments non somatiques, et dissociant le corps de la voix dans That Time et Rockaby. L’influence des média technologiques devient manifeste dans Footfalls, qui joue sur l’ambiguïté frappant la présence corporelle. En fin de parcours cependant, Beckett opère une “ré-incarnation”, où le physique et l’immatériel entretiennent des rapports de métonymie : le corps sur scène n’est donc jamais complètement abandonné.
Cette présence du corps vient au premier plan dans l’étude d’Évelyne Clavier, portant sur les mises en scène de Cap au pire. Maguy Marin renoue avec le premier théâtre de Beckett par la danse, pour retrouver l’énergie que recèle cette œuvre. L’interprète devient non un protagoniste mais le support du texte écrit, et le spectacle déplace l’enjeu du visuel à l’auditif, dans un mouvement vers un “autre-là”, en l’absence de tout ailleurs.
Dominique Dupuy mêle Acte sans paroles I à Cap au pire, dans un spectacle mettant en œuvre l’“essayer voir” et l’“essayer dire”, où l’œil, actif derrière la paupière, cherche à “voir dans sa tête”. Le corps de l’artiste âgé laisse une grande mobilité aux mains, qui “dansent” et exécutent des gestes abstraits.
Notre propre étude aborde le corps par le biais du souffle : une part insaisissable et pourtant vitale, située en deçà de l’image corporelle. Initialement, emporté par le souffle, le sujet beckettien éprouve la difficulté de réaliser une inscription qui le doterait d’un corps consistant. Cependant, le souffle traduit aussi une existence marquée par la toute première inscription dans le langage. Il se manifeste alors dans le spasme, dans l’invasion incontrôlable et sans médiation de l’altérité, qui constitue le “trauma de la naissance”. Le motif du halètement traduit ainsi l’expérience de l’angoisse qui cause la parole et la création. La notion chinoise du Vide médian – comparable au réel lacanien – montre comment le souffle permet le mouvement et les transformations.
Si l’absence de souffle paraît comme un état ultime chez Beckett, la poussière trahit une existence impossible à résorber, une disharmonie fondamentale et irréductible. Le souffle gît au sein même des mots, permettant d’éprouver l’instant de l’abolition subjective, tout en marquant un bord mouvant et inachevé.
20Dans l’œuvre emblématique, Souffle, les fonctions corporelles sont disloquées et placées à l’extérieur, dans un corps sans chair, laissant le sujet libre de respirer. Naissance et mort sont rapprochées, donnant lieu au sujet réel. Le corps n’est alors plus qu’un souffle, qui ne laisse pas de trace.
À ce parcours thématique, deux études ouvrent une autre perspective sur l’œuvre de Samuel Beckett. La publication des lettres de l’auteur représente un événement majeur, et Éric Wessler se penche sur le quatrième et dernier volume de la série1, qui révèle l’unité profonde reliant l’homme et l’écrivain, à ce stade de la vie où l’auteur est libre de s’adonner entièrement à l’écriture. Désormais célèbre, Beckett refuse de devenir un professionnel de l’écriture, et les conseils qu’il donne aux autres concernent le travail de réduction. Pour lui, répéter qu’il n’a “rien à dire” ne revient pas à adopter une pose, mais à témoigner de son expérience de l’impuissance.
En l’absence de discours politique construit, son sentiment de fraternité à l’égard d’autres créateurs donnait un certain sens à la vie. Amitié et création littéraire se nourrissent réciproquement, de manière systématique, et quand Beckett lit le texte d’un autre, le langage seul requiert son attention.
Enfin, Florence Bernard explore les liens entre Beckett et Jean-Philippe Toussaint, dont les premiers romans s’inspiraient de la “Trilogie”. Sur le plan de la forme, on note la recherche de la sobriété du style et du “mal dit”, tandis que les thèmes manifestent aussi une parenté avec Beckett : le parcours erratique d’un personnage masculin, le corps en déshérence et une virilité défaillante. Si Toussaint s’éloigne de l’influence beckettienne dans les années Quatre-vingts, certains traits persistent.
À la fin de ce volume, un riche carnet critique témoigne de l’extrême dynamisme des études beckettiennes, offrant un premier accès à nombre d’ouvrages publiés en langue anglaise. À l’occasion aussi, ces comptes rendus ouvrent un débat sur les orientations proposées par les auteurs.
Llewellyn Brown
1 Voir les études publiées dans nos précédents volumes : Garin Dowd, « Beckett l’épistolier, ou “l’homme-à-la-bèche” » (SB4, 349-370) ; Edward Bizub, « The Letters of Samuel Beckett (1957-1965) : la griffe de Beckett : cloué à jamais, toujours entre… » (SB6, 363-388).