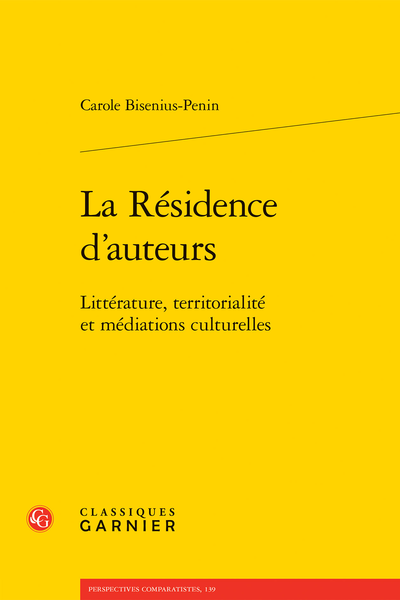
Introduction à la première partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Résidence d’auteurs. Littérature, territorialité et médiations culturelles
- Pages : 29 à 29
- Collection : Perspectives comparatistes, n° 139
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782406151869
- ISBN : 978-2-406-15186-9
- ISSN : 2261-5709
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15186-9.p.0029
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 25/10/2023
- Langue : Français
Introduction
à la première partie
En tant qu’objet polymorphe marqué par une grande hétérogénéité structurelle, le dispositif résidentiel connaît sur divers continents une réelle expansion qui interroge à la fois les écrivains, les acteurs de la chaîne du livre et les institutions culturelles et territoriales. Comment catégoriser la résidence et en fonction de quel angle ? Quels impacts la résidence peut-elle avoir sur la vie littéraire ? Faut-il la considérer comme un lieu de création ? Quels enjeux symboliques et littéraires en découlent ?
Afin d’appréhender au mieux le dispositif résidentiel, il semble important de situer tout d’abord nos investigations scientifiques dans une perspective historique et épistémique, permettant une historicisation des pratiques et de comprendre aussi de quelle manière la résidence d’auteurs s’est construite au fil des siècles dans un jeu d’interactions avec d’autres formes et modèles académiques. Après cet état des lieux, il s’agit de montrer comment et en quoi la résidence peut être considérée comme une instance de la vie littéraire qui participe à la circulation, à la légitimation et à la production des œuvres. À partir de cette hypothèse, l’objectif est de mettre en lumière la démarche conceptuelle qui sous-tend l’analyse proposée, en s’appuyant sur diverses approches critiques empruntées à la sociologie de la littérature et aux sciences de l’information et de la communication. En tant que lieu de construction auctoriale et de légitimation à un niveau symbolique, le dispositif résidentiel peut être enfin appréhendé, d’un point de vue esthétique, comme un lieu d’invention de l’espace littéraire, une mise en littérature du territoire, une hétérotopie pouvant induire de nouvelles formes de narration, de l’espace référentiel au lieu textuel.