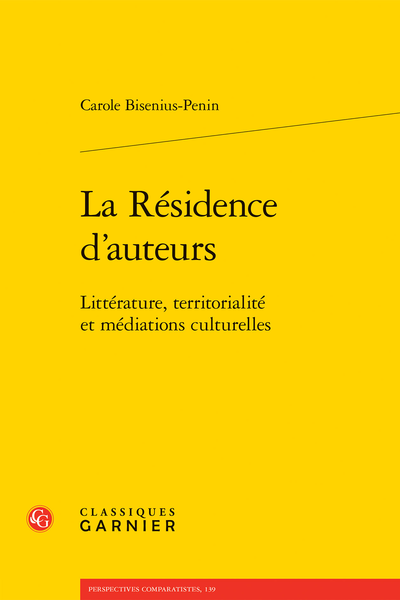
Introduction à la deuxième partie
- Publication type: Book chapter
- Book: La Résidence d’auteurs. Littérature, territorialité et médiations culturelles
- Pages: 159 to 160
- Collection: Comparative Perspectives, n° 139
- CLIL theme: 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN: 9782406151869
- ISBN: 978-2-406-15186-9
- ISSN: 2261-5709
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15186-9.p.0159
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 10-25-2023
- Language: French
Introduction
à la deuxième partie
Après avoir pu cerner les enjeux symboliques et esthétiques des œuvres littéraires résidentielles, l’objectif de cette deuxième partie est de saisir le jeu d’interactions qui se noue, en fonction des échelles choisies (strate étatique, territoriale…) et de l’éventail des acteurs (auteurs, opérateurs culturels…), entre la résidence et les divers cadrages impulsés par les politiques culturelles en vigueur. Comment le dispositif résidentiel est-il lié, d’une manière systémique, à un système politique soumis à des objectifs axés sur une dynamisation territoriale souvent affichée (plus-value économique, touristique, communicationnelle…). La question est notamment de savoir comment les différentes institutions dominantes en charge de penser la résidence d’auteurs cherchent à formaliser les pratiques résidentielles. Dès lors, faut-il considérer la résidence comme une réinscription territoriale et culturelle de l’acte littéraire ? Une forme de territorialisation de la littérature ou encore un dispositif politique et territorial ? Dans le contexte de la recherche que nous menons, il s’agit d’entrevoir la résidence comme une zone de confluence, entre délimitation et appropriation, à la jonction de divers espaces et de mettre en perspective la plurialité des récits portés par les différents acteurs du territoire qui s’expriment à travers la parole des écrivains, des institutions, des élus. Fort de ces dynamiques sociales multiples, l’enjeu relève bien de l’étude de cette articulation entre le dispositif culturel, les acteurs et les instances de régulation. Nous allons tout d’abord nous pencher sur le cadre des politiques culturelles afin d’évaluer, entre décentralisation et démocratisation, commande et injonction, cette volonté d’institutionnalisation de la résidence qui prend appui sur un processus efficient de formalisation et de pérennisation de la part des pouvoirs publics, en sachant, comme a pu le rappeler Philippe Urfalino que cette visée politique ne se limite pas aux seules actions du ministère de la 160culture, mais doit intégrer l’ensemble composite des mesures prises par toutes les autorités dans le champ culturel :
Notre conception de la politique culturelle ne se réduit pas à un ensemble de mesures, envisagées comme le résultat de l’articulation entre le travail gouvernemental et différents groupes sociaux. Les enjeux sociaux et politiques attachés au sort de l’art ou de la culture, la définition de mandats politiques et de segments administratifs spécialisés, au niveau des États comme des collectivités locales, prêtent une globalité non strictement additive à ce que l’on nomme politique culturelle. Les politiques publiques de la culture ne constituent donc qu’une composante de la politique culturelle1.
L’analyse des politiques culturelles nous amènera ensuite à appréhender la question prégnante du statut de l’auteur en contexte résidentiel, en observant certaines tensions autour de l’auctorialité et de la professionalisation des écrivains qui mettent à jour des divergences, des dissensus forts selon la perspective multi-scalaire déployée (niveau conceptuel, juridique, politique, axiologique). Enfin, outre la nécessité de clarifier le concept de dispositif à partir de l’approche de Michel Foucault et de son usage en sciences de l’information et de la communication, l’ultime chapitre sera l’occasion de revenir de manière plus précise sur la définition même du dispositif résidentiel, à partir de la construction d’une typologie des formes et contraintes permettant une compréhension nouvelle ou en tout cas plus approfondie de l’objet étudié.
1 Philippe Urfalino, « L’histoire de la politique culturelle », in Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, p. 311.