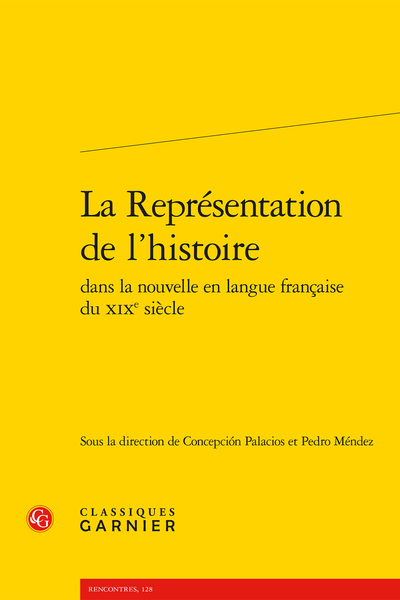
Présentation
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Représentation de l’histoire dans la nouvelle en langue française du xixe siècle
- Auteurs : Palacios Bernal (Concepción), Méndez Robles (Pedro S.)
- Pages : 7 à 18
- Collection : Rencontres, n° 128
- Série : Études dix-neuviémistes, n° 28
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812436253
- ISBN : 978-2-8124-3625-3
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3625-3.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 28/12/2016
- Langue : Français
Présentation
Ce volume, consacré à la représentation de l’histoire dans la nouvelle du xixe siècle, s’inscrit dans le cadre de deux projets de recherche1 auxquels participent des chercheurs qui portent, depuis quelques années, un même intérêt pour l’étude générale du récit bref, bien qu’appartenant à des institutions différentes. Plusieurs autres collectifs ont été déjà publiés à cet égard, El relato corto francés del siglo XIX y su recepción en España2, Le récit fantastique en langue française de Hoffmann à Poe3 et La nouvelle au xixe siècle : Auteurs mineurs4. Plus récemment vient de paraître également Femmes nouvellistes françaises du xixe siècle5. Ces volumes ont tous un objectif commun, celui d’approfondir les connaissances sur le récit bref en langue française et de contribuer à la détermination de l’histoire encore fragmentaire du genre6, bien que les répertoires publiés par René Godenne, qui participe activement à notre projet, ont permis de l’éclairer progressivement7. Mais il reste encore un long chemin à parcourir dans 8l’approche d’un genre qui vécut son âge d’or au xixe siècle. Il est bien certain que les histoires de la littérature présentent toujours les mêmes écrivains, les grands auteurs, ceux qui sont passés à la postérité, ceux qui continuent à être publiés et à être lus, soit par le grand public ou par un public plus restreint, académique et universitaire. De là notre intérêt pour récupérer des voix disparues, celles d’hommes ou de femmes, qui ont fait l’histoire du genre, qui ont contribué à l’essor de la nouvelle du xixe siècle. D’autre part, si certains sujets ou thématiques conviennent bien à ce genre, comme il advient du fantastique, il y en a d’autres qui siéent davantage au roman. Depuis la fin du xviiie siècle s’esquisse la mode du roman – ainsi que celle du drame – historique, qui s’imposera finalement au xixe siècle. Qu’en est-t-il de la nouvelle ? Peut-on parler de « nouvelle historique » ?
Le livre prétend donc s’interroger sur la représentation de l’histoire dans les nouvelles du siècle, sur les événements historiques, politiques et sociaux qui plus particulièrement ont traversé cette période, sans pour autant en omettre d’autres. Effectivement, le xixe siècle est une des périodes de l’histoire qui a été le plus souvent utilisée comme référent ou matière première dans les récits de fiction. La question n’est certes pas nouvelle, les réflexions qu’elle a nourries se concentrant surtout sur le roman, que ce soit sur le roman proprement historique ou sur l’histoire romanesque comme toile de fond de la fiction. Balzac, Hugo, Zola, parmi les écrivains français, fournissent les modèles à suivre et même Stendhal, pour qui « la politique dans une œuvre littéraire […] est comme un coup de pistolet au milieu d’un concert » nous permet de montrer le véritable rôle actantiel joué par l’histoire dans ses fictions romanesques. Toutefois le roman n’a pas le monopole de la fiction de type historique. Il s’agit d’étendre la vision de l’histoire, de voir comment elle se présente dans cette modalité romanesque que constituent les contes et les nouvelles du xixe siècle. Donc, l’enjeu scientifique auquel participent les auteurs de ce collectif est celui de comprendre et d’analyser le positionnement de l’histoire dans son rapport avec les spécificités de la nouvelle, en tant que genre narratif dans un siècle où le roman historique s’allie dans un mouvement symétrique et complémentaire à la conception scientifique de l’histoire pour raconter des histoires en racontant l’histoire.
Lors de l’analyse de la présence de l’histoire dans les récits brefs, les participants au volume ont retenu quelques questions, parmi celles 9envisageables : comment raconte-t-on l’histoire ? S’agit-il d’insérer l’histoire récente ou l’histoire ancienne, c’est-à-dire d’écrire sur les événements historiques du siècle ou de ressaisir l’histoire des temps éloignés ? Quels sont les moments les plus privilégiés de l’histoire ? S’agit-il de la grande histoire, de l’histoire en majuscule, celle des faits célèbres, ou de la petite histoire, celle de tous les jours, des petits faits vrais ? Quel déficit éprouve le récit bref par rapport au roman dit historique ? De quelle manière les événements historiques sont représentés dans les nouvelles ?
Les vingt essais rassemblés dans ce collectif répondent à ces multiples questions, et, en fait, au désir d’analyser les différents modes de présentation des événements historiques dans des textes très divers. Nous les avons regroupés en trois axes thématiques, bien que les interférences entre eux soient presque toujours présentes, étant donné les difficultés inhérentes à la création littéraire, car, ne l’oublions pas, la fiction romanesque s’y impose devant la vérité historique.
La révision de l’histoire dans la nouvelle
Roman face à nouvelle
On pourrait intituler ce premier groupement d’articles – le plus restreint – par le titre même de la contribution que nous fournit René Godenne, « Visages de l’histoire dans la nouvelle du xixe siècle ». Godenne nous facilite une fois de plus une vision globale du sujet ; selon lui, la présence de l’histoire est cette fois-ci plus importante qu’on ne le croit dans les nouvelles de la période, que ce soit à travers des œuvres de pure fiction qui utilisent l’histoire comme prétexte ou à travers d’autres œuvres qui élèvent des personnages de fiction au rang de protagonistes d’événements réels. Comme nous aurons l’occasion de montrer dans quelques-unes des collaborations du collectif, Godenne signale les deux périodes dramatiques qui survolent les nouvelles et se trouvent donc privilégiées par rapport à d’autres événements historiques, la période de la Révolution et l’Empire et celle de la guerre franco-prussienne. Pour conclure, l’auteur insiste en ce que « la nouvelle, au même titre que le roman, peut rendre compte des mille et un faits de la “réalité” de son temps ».
10Gide sentait de l’aversion pour la représentation que l’esthétique réaliste faisait de l’histoire. Son ambition dès Les Cahiers d’André Walter, où il mène une réflexion sur l’acte littéraire et le genre romanesque, est celle de renouveler le genre, de le débarrasser de l’ambition documentaire caractéristique du réalisme et du naturalisme. Elena Meseguer analyse à partir de cet ouvrage, assez éloigné de la forme romanesque traditionnelle, la définition que Gide donne de la mission du poète en tant que « représentant de l’Idée » et en conséquence pouvant exprimer les vérités essentielles en dehors de l’emprise du temps, de l’époque, du moment. Le poète manifeste son dédain pour l’anecdote. Il se soucie peu des faits. Au contraire, l’historien confond pour sa part la réalité avec les apparences, dont il reste prisonnier. Cette opposition entre poète et historien, suppose deux modes d’approches différents du réel, deux esthétiques différentes ; le réalisme et l’idéalisme, évoquées par la référence à Schopenhauer. En effet, Meseguer montre également l’importance du philosophe pour nous faire comprendre d’où vient à Gide son dégoût pour l’histoire. Or, pour l’écrivain, la voie de l’historien – celle du réalisme, esthétiquement parlant – constitue une impasse. Non pas décrire, mais découvrir, aller au-delà des apparences, voilà la voie à suivre pour le romancier qui ne laisserait pas d’être un poète, c’est-à-dire, à ses yeux, un authentique écrivain. Cette valorisation de la poésie en vient à déprécier le réalisme, puisque seule la poésie permet d’accéder à la vérité.
Yvon Houssais, pour sa part, s’interroge sur la difficulté de concilier les exigences du roman historique avec celles de la nouvelle en raison des contradictions, au moins apparentes, entre le terme « nouvelle » et le terme « historique ». Il tente de donner quelques réponses à cette contradiction en visant trois exemples parfaitement différents : Les Soirées de Walter Scott à Paris de Lacroix, La Vision de Charles XI et L’Enlèvement de la redoute de Mérimée, et La Canne de jonc de Vigny. Si dans le premier exemple l’effort de Lacroix pour inscrire la fiction dans un cadre historique aboutit à une prolifération excessive d’éléments dans la nouvelle, les récits de Mérimée s’accommodent mieux de ce que Houssais appelle le monothématisme de la nouvelle bien que le traitement de l’histoire s’y avère plus problématique puisqu’il se détourne de toute représentation. En ce qui concerne le troisième exemple, celui de Vigny, il s’agit d’un récit qui s’intéresse davantage à la représentation du parcours idéologique et politique d’une génération, qu’à la reconstitution 11d’un cadre historique, d’une couleur locale. La conclusion de Houssais est claire : la nouvelle ne peut rivaliser avec le roman historique sur son propre terrain sans aboutir à l’échec. Elle doit donc s’appuyer sur un épisode plus restreint de l’histoire en lui conférant le maximum de sens et d’intensité dramatique.
Carmen Pujante, quant à elle, réfléchit aux questions théoriques du genre et s’intéresse à établir la comparaison entre la nouvelle française et espagnole du xixe siècle dans ses relations avec l’histoire. Elle analyse surtout le passage entre la nouvelle anecdotique et d’action et la nouvelle qui « ne raconte rien », entre la conception « classique » et la conception « moderne ». Cette évolution, représentée par la dialectique Maupassant-Tchékhov, peut également être observée dans le panorama espagnol : à travers Clarín et Galdós, passe ce méridien qui place d’un côté le récit bref traditionnel « narratif » et d’un autre côté le récit moderne « a-narratif ». Pour conclure, Carmen Pujante laisse la porte ouverte à une étude comparative cherchant à approfondir le paradoxe de la coexistence de l’essor du roman et de la nouvelle, du réalisme et du fantastique, tout en ouvrant l’analyse à des tendances du récit bref au xxe siècle, époque à laquelle le récit bref a-narratif ou a-historique exercera son influence sur les « nouveaux romans ».
Le xixe siècle en scène
Ce sont les nouvelles, où la fiction se mêle aux événements historiques, qui traversent la période. Parmi les plus privilégiés – nous l’avons souligné – celles qui se situent à l’époque révolutionnaire et napoléonienne dans les premières décennies, tandis que la Commune et la guerre franco-prussienne attirent l’attention des écrivains de la deuxième moitié du siècle.
À commencer par Carmen Camero qui étudie la présence de l’histoire dans les histoires racontées para les différents narrateurs des Diaboliques, histoires ancrées dans une période historique précise avec de nombreuses références historiques bien que, face aux romans, l’écrivain ne retient dans les nouvelles que quelques traits essentiels, tant pour les événements 12qu’il présente que pour les personnages historiques. Mais comme Camero souligne à manière de conclusion, Barbey, nostalgique des temps passés, en lutte contre les idées progressistes, se sert de la description de l’histoire événementielle pour récupérer avec ses personnages fictionnels les traditions brisées de la noblesse de l’Ancien Régime.
Carme Figuerola s’occupe d’un écrivain peu connu de nos jours, Jules Sandeau, dont les nouvelles demeurent à l’ombre des ses romans beaucoup plus importants au moins en nombre. Par rapport aux faits de l’histoire présentés dans ses nouvelles, la Révolution et ses effets fait figure d’exception. L’originalité de Sandeau réside en ce qu’il n’accorde pas une trop grande importance aux faits historiques, s’attardant plutôt sur les faits divers de la vie quotidienne des bourgeois et des aristocrates, les deux classes privilégiées dans ses nouvelles qui deviennent donc des documents, au service des idées de l’écrivain sur l’évolution des mœurs de l’époque. Pour Figuerola, si Sandeau accorde une place à l’histoire dans se récits, c’est pour mieux montrer et illustrer ses principes idéologiques.
Pour sa part, Thierry Ozwald analyse deux nouvelles, L’Enlèvement de la redoute de Mérimée et Le Corps de garde russe de Vigny qui montrent deux versions différentes d’un sujet quasi-analogue de l’épopée napoléonienne. Dans les deux cas il s’agit d’abattre une citadelle de haute lutte, de faire « sauter un verrou » stratégique. Bien qu’Ozwald constate la similitude thématique et formelle des nouvelles, l’analyse du Corps de garde russe et L’Enlèvement de la redoute nous permet de déterminer une sorte de ligne de partage des eaux qui indique le lieu où deux approches littéraires apparemment similaires se dissocient précisément, partant d’une même tradition romantique, et comment des faits littéraires distincts vont s’élaborer ; d’un côté l’examen lucide et ironique des événements et des actes de guerre chez Mérimée, de l’autre, l’horreur chérie de la violence chez Vigny ou ce qui, au dire d’Ozwald, pourrait signifier le mensonge romantique face à la vérité romanesque.
À côté des romans historiques d’Erckmann-Chatrian, se trouvent des nouvelles moins connues de ces deux auteurs qui s’appuient elles aussi sur l’histoire de France. Noëlle Benhamou analyse quelques-unes des nouvelles ancrées dans l’histoire, ayant comme toile de fond celle de la fin du xviiie siècle et du xixe. Elles se nourrissent toutes d’un cadre historique, de petits faits vrais et surtout de dates qui assurent une épaisseur de vérité à la fable racontée. Dans son article, Benhamou s’interroge 13sur la place que le passé occupe dans les récits des deux Lorrains, sur les événements historiques qu’ils privilégient dans leurs contes et nouvelles et sur la place de l’histoire comme élément romanesque essentiel. Elle conclue finalement que la nouvelle chez Erckmann-Chatrian se constitue comme le refuge idéal des détails vrais, de la petite histoire de l’histoire et en conséquence, insiste sur l’efficacité de la forme brève pour évoquer les faits peu glorieux et méconnus de l’histoire officielle.
Avec sa contribution, Thanh-Vân Ton-That examine la prise de position de l’auteur des Rougon-Macquart envers la Commune dans le roman La Débâcle et dans la nouvelle Jacques Damour. Zola a développé une même matière historique en se livrant à un travail d’amplification dans le roman après avoir commencé par la nouvelle. Pour ce faire elle analyse les multiples facettes de la nouvelle par rapport au traitement romanesque, en fonction du cadre, des acteurs et du message à transmettre. Pour Thanh-Vân Ton-That la conclusion est claire. Il ne s’agit pas, nous dit-elle, d’un exercice de style et de genre de la part de Zola qui passe de la nouvelle à l’écriture romanesque d’un même sujet ; la nouvelle est moins historique et plus psychologique, étant l’intrigue amoureuse au centre du récit tandis qu’avec le roman les émotions sont remplacées par l’exacerbation des passions politiques, la vision du monde est entièrement renouvelée et les positions anti-communardes zoliennes sont plus nettes.
Edurne Jorge explore dans « La Fantaisie et l’histoire », première partie des Contes du lundi, les sentiments d’Alphonse Daudet envers, de nouveau, la guerre franco-prussienne et la Commune. Daudet fut un témoin d’exception de certaines des histoires qu’il raconte puisqu’il participa activement à la défense de Paris durant le siège, puis vécu les premières semaines de la Commune. D’après l’analyse de Jorge, l’écrivain s’intéresse surtout à montrer les impressions causées par la guerre sur les petits événements de l’histoire, sur les vies ordinaires des civils et les sentiments qui s’en dégagent. À côté de ce tableau quotidien de la guerre, Daudet revendique également l’engagement personnel de la plupart de ses compatriotes. Bien que celle-ci ait été vécue de façon différente en province et à Paris, les Français firent preuve d’une grande ardeur patriotique tout au long du conflit.
Cette même guerre laissa une forte empreinte sur l’esprit de l’écrivain Guy de Maupassant au point de se constituer en thème essentiel d’un bon nombre de ses nouvelles, sans pour autant devenir chez lui l’expression 14d’un nationalisme exalté. Maupassant détestait la guerre et la lecture des nouvelles de l’écrivain sur ce conflit doit tenir compte de cette réalité. Sous une perspective sociocritique, Lozano, en choisissant quelques exemples de divers recueils de l’auteur, s’intéresse aux différentes réponses des êtres humains par rapport à la guerre ; elle analyse dans une première partie deux contes de guerre : La Mère Sauvage et Le Père Milon, tous deux illustratifs de la monstruosité que toute guerre dévoile chez l’être humain. Dans un deuxième temps, elle étudie trois nouvelles de guerre insérées dans les Contes de la Bécasse pour conclure que la lecture des nouvelles de Maupassant traitant le thème de la guerre doit dépasser la position idéologique de l’écrivain lui-même pour se situer à travers les différentes réponses des personnages dans une perspective plus large qui nous parle de l’incohérence du monde.
L’histoire d’ailleurs
Dans cet axe, qui est le plus ample, nous avons groupé des articles racontant des histoires insérées dans l’histoire d’autres pays, dont les nouvelles qui ont comme toile de fond l’Espagne occupent une place privilégiée, puisque le pays – son histoire (ancienne ou récente), ses paysages, ses gens, ses mœurs – suscite en France une grande curiosité, jusqu’à ce qu’ils en deviennent un véritable mythe.
C’est l’Antiquité qui y est premièrement abordée. Mª Victoria Rodríguez choisit le récit de Théophile Gautier Arria Marcella pour montrer comment l’univers fantastique du texte s’insère dans l’utilisation que l’écrivain fait de l’histoire. Comme on le sait, Gautier était un passionné de l’histoire des Arts, notamment de l’histoire antique et dans cette nouvelle la vie quotidienne de Pompéi, ville antique, s’entrecroise avec la vie moderne au point que le lecteur ne parvient pas à séparer le rêve de la réalité. Gautier mêle sa fascination pour l’Antiquité à son goût du fantastique. Pour Rodriguez, Arria Marcella est plus qu’un voyage dans le temps et elle résume toute la nouvelle dans la phrase de Gautier lui-même « rien ne meurt, tout existe toujours ; nulle force ne peut anéantir ce qui fut une fois ».
15De Gautier à Richepin sans abandonner l’Antiquité latine. Cette fois-ci de la main de Pedro Pardo, qui s’intéresse à découvrir dans Les Contes de la décadence romaine de Jean Richepin plutôt que le souci d’exactitude historique, une projection esthétique dans le goût de l’époque fin-de-siècle où nous assistons à un traitement truculent des histoires aux sujets très divers dans lesquelles toutes les licences semblent permises. Pardo analyse aussi d’autres aspects, qui rendent compte non seulement du contexte historique de publication du recueil mais aussi de la personnalité de l’écrivain, tels que la fabulation et l’invraisemblable dans le traitement des histoires, bien qu’elles se veulent des témoignages historiques, ou les mutations des voix narratives dans les contes, ce qui rend difficile la compréhension du véritable message de Richepin, qui n’est autre que la réprobation globale de la décadence.
Les relations entre la France et l’Espagne tout au long du xixe siècle ont été largement étudiées. Celles-ci ont été envisagées de plusieurs points de vue, notamment du point de vue de la perspective historico-littéraire à partir du genre de la nouvelle. À cette période, en effet, l’Espagne inspire la France, avec des œuvres à saveur historico-exotique, et les Français inspirent les Espagnols, avec des sujets et des personnages littéraires tirés de l’histoire française.
Alvarez, s’occupe dans sa contribution d’analyser les nouvelles sur l’histoire d’Espagne dans deux titres emblématiques de la presse culturelle française au xixe siècle : la Revue de Paris et la Revue des Deux Mondes. Elle examine, dans un échantillon de nouvelles françaises réunies autour de deux périodes significatives de l’histoire de chaque revue, la manière dont sont traités les sujets historiques relatifs au passé lointain ou récent de l’Espagne. Alvarez constate, pour la première revue, que les nouvellistes, utilisant des thèmes chers au romantisme et partant d’une relative liberté dans le domaine fictionnel, se montrent assez respectueux des faits historiques et des connaissances courantes sur la civilisation espagnole, mais, en même temps, la quête de ce qui aurait pu vraisemblablement se passer les autorise à fabuler cette « matière d’Espagne », richement littéraire et suggestive. En ce qui concerne la Revue des Deux Mondes, l’intérêt pour l’Espagne qui s’y était fortement manifesté tout au long de la première moitié du xixe siècle, diminue ostensiblement dans la seconde et, dans le dernier tiers du siècle, seuls cinq récits français sont inspirés des « choses d’Espagne » dans lesquels prédomine en général 16une approche réaliste, bien que des éléments romantiques y soient également présents, toujours comme témoignage de la continuité du mythe espagnol, déjà façonné par le romantisme, et de son maintien dans des paradigmes plus ou moins réalistes.
Malgré la déclaration bien connue de Stendhal sur l’insertion de la politique dans un roman, il est bien conscient de l’influence de l’environnement politique et social sur le comportement des personnages. Nous présentons trois essais qui s’en occupent de la présence événementielle dans des nouvelles de l’écrivain, ayant comme sujet l’historiographie espagnole, puisque il y va déployer son « espagnolisme », cette « inclination naturelle pour la nation espagnole », que sa tante Élisabeth Gagnon lui avait inculquée. Il faut souligner en plus que, malgré ses grands romans – quelques-uns inachevés – Stendhal est attiré par les textes courts, que ce soient des nouvelles, des chroniques ou des textes autobiographiques et fragmentaires.
Le premier essai appartient à Alonso qui s’intéresse à deux nouvelles de la première époque de création de l’écrivain, Le Coffre et le revenant et Le Philtre. Dans la première, l’auteur choisit l’évocation de la période absolutiste de Fernando VII dont il retient les aspects les plus sinistres et les conséquences les plus dures pour ses personnages. Le Philtre met aussi en scène une histoire d’origine espagnole. Mais contrairement à la nouvelle précédente, Stendhal ne situe pas l’action dans le territoire espagnol, mais en France, dans la ville de Bordeaux où il évoque les conséquences funestes de l’absolutisme de Ferdinand VII sur les vies de ses personnages et l’expérience du dépaysement des gens qui se voient forcés de quitter leur terre d’origine pour éviter la persécution et la perte de liberté. Ana Alonso constate que Stendhal se démarque d’une fiction du passé, pour revendiquer l’historicité du présent. Écrire l’actuel sera pour lui, aussi dans le genre bref, une voie de modernisation et de renouvellement de la prose, un puissant outil de vérité.
Dans la deuxième contribution, Béatrice Didier revient sur Le Coffre et le revenant en montrant cette fois-ci, à partir de l’actualité espagnole, les réflexions politiques de l’écrivain qui suggère les analogies qui peuvent exister entre tous les pays – la France aussi – dès qu’il y règne l’argent, l’arrivisme, le despotisme, l’absence de liberté de pensée. Didier conclut que dans cette nouvelle écrite au même moment que Le Rouge et le Noir, on découvre une correspondance entre le récit et la situation 17politique dont il devient le symbole ; la lutte vouée à l’échec des amants contre la tyrannie du directeur de police, logé « dans l’ancien palais de l’Inquisition de Grenade », peut être interprétée comme une figure de la difficile lutte de l’écrivain en 1830, à la recherche de liberté contre une société oppressive.
En ce qui concerne la troisième collaboration consacrée à Stendhal, Ángeles Sirvent s’attache à étudier un texte inachevé de l’écrivain et inédit de son vivant, Le Chevalier de Saint-Ismier. Il s’agit d’un récit de cape et d’épée, dont les origines sont directement espagnoles et, comme souligne Sirvent, le développement de l’épisode raconté est le même chez Stendhal que dans ses sources. Le moment historique qui sert de cadre à la nouvelle est l’époque de Richelieu pendant laquelle l’histoire, donnée en petites bribes, reflète assez fidèlement la réalité. D’autres éléments comme l’ironie, l’humour, la précision du style, la critique sociale et politique et même la fameuse énergie stendhalienne sont présentes dans la nouvelle. L’auteure conclut qu’il faut changer la perception, parfois négative, que l’on a sur les récits brefs stendhaliens. Par contre ils sont révélateurs, de même que le reste de sa création littéraire, de la personnalité de l’écrivain.
Le Dumas nouvelliste attire l’attention d’Inmaculada Illanes qui analyse dans son article trois nouvelles historiques Dom Martins de Freytas, Praxède et Pierre le Cruel dans lesquelles, sous une réalité historique précise, les personnages et les anecdotes et événements fictionnels et historiques cohabitent. Toutes les trois montrent une certaine unité du fait de leur localisation dans un domaine géo-historique particulier, chargé d’évidentes connotations culturelles, l’Espagne médiévale bien que Dumas se serve de trois épisodes bien différents, éloignés dans le temps et dans l’espace. Mis à part le travail de documentation cher à Dumas, Illanes souligne également dans son étude une série de caractéristiques communes qui servent à illustrer une conception tout à fait particulière de la nouvelle historique, la structure simple et rigoureuse, la présence du « conteur », l’introduction du discours direct pour dramatiser certaines scènes ou le recours à des personnages exemplaires pour instruire le lecteur, de façon que Dumas utilise la fiction historique pour « enseigner “par” l’histoire, en plus d’enseigner l’histoire elle-même ».
Comme beaucoup de ses contemporains, la Duchesse d’Abrantès exploite le mythe d’Espagne en se servant, elle aussi, des souvenirs 18d’un pays qu’elle connaissait assez bien. Elle va également tirer parti de l’engouement pour le récit historique dans les Scènes de la vie espagnole, recueil en deux volumes composés de quatre histoires qui est l’objet d’étude de Francisco Lafarga. Les quatre récits se situent à un moment historique précis mais c’est L’Espagnole qui sert à illustrer de manière exemplaire le rapport entre fait historique et fiction littéraire. En effet, cette nouvelle développe un fait « véridique ou présentée comme véridique » dans le cadre de la Guerre de l’Indépendance : le terrible geste d’une jeune femme qui n’hésite pas à s’immoler avec du vin empoisonné pourvu que meurent avec elle les soldats français qui ont tué sa famille et envahi son village. Lafarga analyse les antécédents de cette histoire, reprise par la Duchesse dans ses Mémoires, en l’élargissant et en s’appuyant également sur ses Souvenirs d’une ambassade et d’un séjour en Espagne et en Portugal.
Enfin Marta Giné, spécialiste de Villiers de l’Isle-Adam, s’approche cette fois-ci de la présence du passé, de l’histoire ancienne surtout, dans des contes de l’écrivain traduits en espagnol. Après un rapide aperçu sur les contes « historiques » de Villiers, Giné constate qu’ils n’ont presque guère retenu l’attention en Espagne. Quant à la qualité de la traduction, elle remarque qu’il y a une évolution positive et favorable dans le temps, bien que Villiers reste toujours un écrivain difficile. Finalement Giné s’intéresse à un cas exceptionnel : l’adaptation poétique d’Impatiente de la foule faite par Manuel Reina.
Concepción Palacios
et Pedro Méndez
Parvenus au terme de ce prologue, nous remercions vivement les auteurs par la très haute qualité des contributions dont nous avons dressé ici une simple et brève ébauche mais en souhaitant vivement qu’elle invite les lecteurs de ce livre à découvrir en profondeur des perspectives diverses sur l’histoire de la nouvelle en langue française du xixe siècle.
1 Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2010-19285) et Fundación Séneca (11890/PHCS/09).
2 C. Palacios (éd.), El relato corto francés del siglo XIX y su recepción en España, Murcia, Servicio de Publicaciones, 2003.
3 C. Palacios (éd.), Le récit fantastique en langue française de Hoffmann à Poe, Valencia, Esser editorial, 2009.
4 P. Méndez et C. Palacios (éd.), La nouvelle au xixe siècle : Auteurs mineurs, Berne, Peter Lang, 2011.
5 C. Palacios et P. Méndez (éd.), Femmes nouvellistes françaises du xixe siècle, Berne, Peter Lang, 2013.
6 Cf. pages de présentation de La nouvelle au xixe siècle : Auteurs mineurs, op. cit.
7 Les premiers inventaires, élaborés en 1997 et 2002, apparaissent dans Études sur la nouvelle de langue française III, Genève, Slatkine, 2005, p. 79-131 et 134-204. Ils ont été actualisés par d’autres nouveaux répertoires dont deux ont été publiés dans Anales de Filología Francesa, no 14, 2006 et no 15, 2007, respectivement. Un huitième inventaire et un bilan ont été publiés dans La nouvelle au xixe siècle : Auteurs mineurs, op. cit., p. 163-187 et 189-240 ; ainsi qu’un répertoire spécifique sur les nouvelles écrites par des femmes dans le collectif Femmes nouvellistes françaises du xixe siècle, op. cit., p. 29-38. L’Inventaire de la nouvelle française (1800-1899). Répertoire et commentaire, publié par Classiques Garnier dans sa collection « Études romantiques et dix-neuviémistes » apparut aussi en 2013.