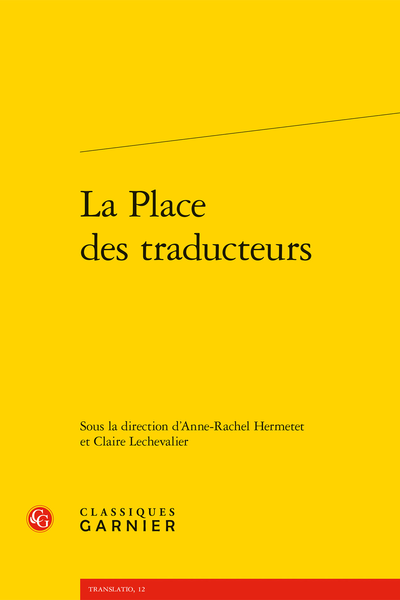
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Place des traducteurs
- Pages : 193 à 196
- Collection : Translatio, n° 12
- Série : Problématiques de traduction, n° 10
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782406128502
- ISBN : 978-2-406-12850-2
- ISSN : 2800-5376
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12850-2.p.0193
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 06/04/2022
- Langue : Français
Résumés
Anne-Rachel Hermetet et Claire Lechevalier, « Introduction. La Place des traducteurs »
Il s’agit ici de remettre en lumière les différentes modalités de la place des traducteurs, et de tenter de reconstruire son histoire pour en déceler jusqu’aux traces les plus ténues. Cette contribution observera comment s’est déployée historiquement, comment s’est organisée et pensée l’activité de médiateurs qui peut être celle des traducteurs, à travers toutes ses manifestations concrètes, en montrant que celles-ci croisent inextricablement pratiques sociales et expériences intimes de l’écriture.
Fiona McIntosh-Varjabédian, « Women in translation (1790-1820). Entre commodité de marché et engagements politiques »
Les gender studies ont réévalué un corpus assez important de romancières et d’autrices britanniques, largement lues en Grande-Bretagne au tournant des xviiie et xixe siècles. Les traductions participent de cette notoriété dans un marché français avide des romans d’outre-manche. Cet article en dresse un bilan et examine dans quelle mesure elles font place aux enjeux politiques. Il aborde le cas particulier de la traduction, ou non, des romans sur les nations sœurs et de leur message patriotique.
Claudine Le Blanc, « Romans indiens en français. Les ambivalences de la traduction »
Depuis plus de vingt ans, les romans indiens connaissent en France de grands succès de librairie. Cette présence massive masque cependant la place réduite occupée par la fiction écrite dans les très nombreuses langues de l’Inde. Se prêtant aux voix anglophones, assourdissant souvent les autres – mais pas toujours –, la traduction française des romans indiens apparaît ainsi comme un instrument d’une redoutable ambivalence, mettant en lumière les limites de la réception d’une littérature multilingue.
194Pascale Mounier, « L’énonciation auctoriale dans les deux premières versions françaises du De duobus amantibus de Piccolomini »
Le De duobus amantibus d’Enea Silvio Piccolomini est doté de nombreux énoncés auctoriaux. Le récit d’amour pathético-tragique composé en latin en 1444, qui est enchâssé dans une lettre, voit son système énonciatif enrichi dans les deux premières versions en français, élaborées par Octavien de Saint-Gelais et Antitus Faure dans les années 1490. Le discours déjà en partie contradictoire de l’« acteur » s’y trouve revu dans les passages qui le restituent et complété par celui du « translateur ».
Zoé Schweitzer, « Les traductions des tragédies antiques sont-elles théâtrales ? Une réponse à partir des paratextes »
Comment connaître la réception des tragédies traduites de l’antique qui n’ont pas été jouées ? La théâtralité des œuvres sources est-elle un enjeu pour les traductions ? Le paratexte est un outil précieux pour l’étude car il sert d’adjuvant à la réception, de trois façons différentes, qui révèlent trois manières sensiblement différentes de concevoir la traduction : en historicisant les réceptions passées, en guidant la lecture présente, en conviant à un spectacle imaginaire.
Claire Lechevalier, « Michel Vinaver et les multiples voies/voix de la traduction »
L’activité de traducteur de Michel Vinaver relève de gestes variés, qu’il s’agisse du domaine linguistique ou de la méthode utilisée. Cette activité apparaît comme indissociable de l’écriture dramatique elle-même. L’observation des archives déposées à l’IMEC, à propos de la « traduction » des Troyennes d’Euripide notamment, permet de mettre en lumière les enjeux et les modalités de la présence polymorphe du « traducteur » et du tressage des voix auquel elle peut donner lieu.
Sylvie Le Moël, « Un théâtre allemand au goût français ? Le rôle des pratiques collaboratives dans la traduction théâtrale du xviiie siècle »
Dans le processus de réception du théâtre allemand initié après 1750, la pratique collaborative entre Allemands installés en France et gens de lettres francophones joue un rôle moteur. Elle stimule des entreprises éditoriales tout comme les processus d’adaptation pour la scène, auxquels elle apporte un 195cautionnement efficace, jusqu’à servir d’alibi aux gens de théâtre qui exploitent une éphémère vogue allemande sous le Directoire et les tout débuts de l’Empire.
Sylvie Humbert-Mougin, « Les avant-gardes théâtrales et le répertoire étranger au tournant des xixe et xxe siècles. L’invention de la traduction ? »
À la fin du xixe siècle, les avant-gardes théâtrales accueillent massivement les répertoires étrangers, imposent une nouvelle façon d’aborder le texte de théâtre étranger et discréditent la pratique de l’adaptation au profit d’une exigence nouvelle de respect intégral du texte. Cette « invention » de la traduction participe d’une mise en crise du système théâtral ambiant, indissociable d’une redéfinition de l’équilibre entre texte et spectacle, et d’une nouvelle conception de la relation au public.
Nicole Nolette, « John Van Burek, Michel Tremblay ou la traduction à Toronto revisitée »
Connu pour ses traductions du joual de Michel Tremblay, John Van Burek est revisité par cet article sous l’angle de son autre rôle professionnel : celui de directeur artistique d’une compagnie de théâtre en milieu minoritaire. La traduction vers l’anglais à Toronto serait pour lui une invitation à participer au projet bilingue de la francophonie minoritaire au Théâtre du P’tit Bonheur / Théâtre français de Toronto.
Mirella Piacentini, « Enjeux et perspectives traductologiques dans la diffusion en Italie du répertoire théâtral jeunesse français »
La collection italienne de textes de théâtre jeunesse « Stelle di carta. Parole in scena » s’attache à diffuser en Italie le répertoire théâtral jeunesse français. Dans cette collection, la traduction joue un rôle crucial, ce qui ouvre la voie à des réflexions sur les enjeux traductologiques d’un texte issu du croisement du théâtre et de la littérature de jeunesse.
Claire Lechevalier, « La place des traducteurs de théâtre. Table ronde avec Denise Laroutis, Séverine Magois et Laurent Muhleisen »
Cet entretien avec Séverine Magois, Denise Laroutis et Laurent Muhleisen permet d’aborder successivement le rôle et le fonctionnement de la Maison 196Antoine Vitez quant à la promotion de la traduction théâtrale, la question des droits des traducteurs et de la place des agents, les nouvelles pratiques de la traduction théâtrale, notamment le surtitrage et la relation avec les metteurs en scène, et les questions liées à la retraduction.
Anne-Rachel Hermetet, « Entretien avec Corinna Gepner »
Cet entretien avec Corinna Gepner permet d’évoquer successivement l’histoire et les missions de l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF), la place respective des différents acteurs (éditeurs, agents, traducteurs) dans le choix des œuvres à traduire, le rôle joué par le traducteur dans la diffusion et la réception des œuvres qu’il a traduites, mais aussi la question de sa présence au cœur même du texte traduit.