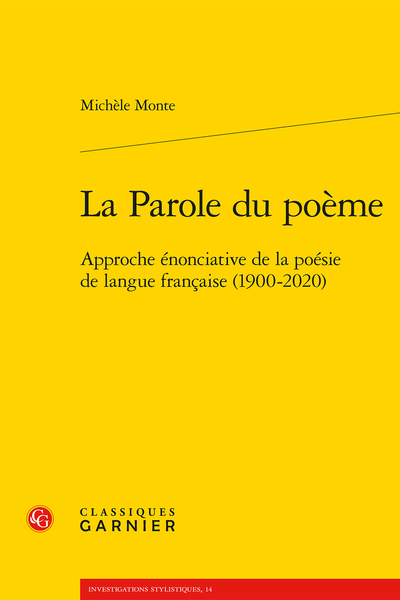
Préface
- Publication type: Book chapter
- Book: La Parole du poème. Approche énonciative de la poésie de langue française (1900-2020)
- Pages: 9 to 15
- Collection: Stylistic Investigations, n° 14
- CLIL theme: 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN: 9782406131281
- ISBN: 978-2-406-13128-1
- ISSN: 2271-7013
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13128-1.p.0009
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 09-21-2022
- Language: French
Préface
L’italien est la langue de Dante, l’anglais celle de Shakespeare, l’allemand celle de Goethe, … et l’on pourrait prolonger la liste, même si le français, avec Molière, et l’espagnol, plus nettement encore avec Cervantes, ne privilégient pas un écrivain dont le principal titre de gloire réside dans sa maitrise du vers. Les cultures qui associent ainsi un poète à l’essence de leur langue nous livrent une représentation moins univoque qu’on ne tendrait à le croire. Figure presque tutélaire, le poète aurait chaque fois porté son idiome à un état de perfection ou, tout du moins, aurait posé les jalons d’un devenir sans cesse perpétué. Mais, personne ne l’ignore, les corpus poétiques les plus prestigieux renferment des écarts, des déviations, des bizarreries que l’usage commun ne tolère pas ; les lexiques et les grammaires flanquent volontiers de l’épithète « poétique » leurs mentions de certains termes ou de certaines constructions. Et, très souvent, ce que nous décrivons comme la langue de Dante, de Shakespeare, de Goethe, ou de Marceline Desbordes-Valmore, est moins une idéalisation de l’italien, de l’anglais, de l’allemand, ou de notre français, que l’ensemble des traits qui caractérisent un objet tout à fait singulier : la parole même du poète et, dès lors, la vision du monde qu’elle est censée transmettre à ceux qui la comprennent.
À cette ambiguïté s’ajoute un malentendu tenace, que j’illustrerai ici par une anecdote exemplaire des conflits qui peuvent agiter l’univers académique. Lors d’un colloque tenu au début des années 1970, Stanley Fish entreprit de démontrer que Louis Milic, qui avait soumis la prose de Jonathan Swift à une étude statistique, n’en avait tiré aucune conclusion ferme ou pertinente, de sorte que l’utilité même d’une telle démarche demeurait sujette à caution. Le premier participant à répondre fut Richard Ohmann, qui explorait alors l’écriture littéraire avec les outils de la grammaire générative ; il ouvrit son intervention par cette phrase : « My name is Louis Milic ». Au-delà de l’éreintement ou de la pointe, cet échange confronte deux modes d’approche légitimes, mais qu’il 10s’avèrerait abusif d’opposer l’un à l’autre. Nous lisons ou écoutons les poètes parce que nous interprétons leurs textes, et parce que ce processus déclenche dans notre esprit des effets cognitifs et émotifs qui sont autant de bénéfices pour notre vie mentale. Mais si nous réservons toute la place à l’interprétation, nous risquons d’oublier que le matériau dont nous partons s’organise selon des normes, des régularités, des découpages que le contenu véhiculé, tant qu’on se borne à le paraphraser sans autre souci, ne suffit pas à prédire. La seule façon de surmonter ce biais consiste à accumuler, avec humilité et sans céder d’emblée à l’attrait de l’interprétation, des données précises sur les propriétés linguistiques des textes. Cela ne signifie pas que le pont puisse être facilement jeté entre ce travail de fourmi et l’évidence, réelle ou apparente, d’une lecture qui se voudrait pénétrante et profonde, mais qu’au moins la question se laisse formuler dans les termes d’un problème en attente de solution et non comme une énigme.
Depuis l’époque alexandrine jusqu’à nos jours, la philologie a commenté les poètes en alliant le pointillisme de la note ou de la scholie à la quête d’une interprétation référentiellement plausible, tout en multipliant volontiers, comme Servius à propos de Virgile, des rationalisations excessives. L’émergence du comparatisme et de la grammaire historique a partiellement dissipé ces œillères ou ces obsessions. L’informatique a ensuite rendu la recherche de passages parallèles moins tributaire d’une mémoire sélective ou défaillante, tandis qu’un meilleur accès aux dossiers génétiques permet désormais que se constitue une véritable philologie des textes modernes et contemporains. Avec ces développements, les poètes renommés se retrouvent, en plus d’une occasion, dans la compagnie d’écrivains plus modestes, ce qui nous oblige à revenir sur ce qui peut fonder nos jugements de valeur. Mais le discours poétique cesse aussi de nous apparaître comme ce flot verbal qui ne saurait surgir que sous une forme pure et immédiatement achevée ; les créateurs, somme toute, se rapprochent de leurs analystes puisqu’ils sont, les uns comme les autres, dépendants de sources parfois inattendues, et souvent incertains au moment de prendre la plume.
Que tous se voient ainsi confrontés au spectre de la page blanche ou mal remplie, que ce qu’ils nous offrent au bout de compte soit le fruit d’un travail nécessairement couteux, ne doit pas nous décourager. Le sort commun que partagent, malgré eux sans aucun doute, créateurs 11et analystes nous fait oublier les faux débats sur la spontanéité et la réflexion, sur l’inspiration et le décorticage. C’est, à mes yeux, l’un des mérites essentiels de Michèle Monte que de nous prouver, à chacune des pages qui vont suivre, que les méthodes de la linguistique et de la philologie peuvent s’appliquer à des œuvres contemporaines qu’elles contribuent dès lors à divulguer, sans chercher refuge dans la doxa ou la problématique préexistante que la dynamique de la recherche a peu à peu mise en place à propos de corpus plus traditionnels. Par cette prise de risque que vient récompenser, au fil des chapitres, l’obtention de résultats conceptuellement robustes, étayés par des enquêtes de grande envergure, Michèle Monte se range aux côtés d’un Jakobson, proche des Futuristes, ou d’un Leo Spitzer qui, à la veille de sa mort, se penchait sur la technique romanesque de Michel Butor. Il y a là une première leçon, précieuse à mes yeux : l’enthousiasme ne nous gagne pas facilement ; mais si nous acceptons les contraintes de nos études, nous finissons par le gagner.
En appuyant ses analyses sur un modèle graduel à trois dimensions – sémantique, esthésique et énonciative – Michèle Monte renonce à la quête prématurée d’une théorie explicative pour centrer d’abord son attention sur l’effort que les textes demandent à leurs interprétants. Un tel angle d’attaque, qui ne privilégie aucunement les traits supposés définitoires de la poésie, a l’avantage d’ancrer des descriptions objectives dans les expériences et les savoirs que les différentes écoles ont accumulés pour tout ce qui touche au fonctionnement formel, cognitif et communicatif des langues naturelles. Il ne s’agit cependant pas d’absorber la poétique dans une conception naïvement unitaire du langage, comme le structuralisme jakobsonien a menacé pour un temps de le faire, sinon par sa pratique effective, du moins selon ses postulats fondamentaux. À chaque pas en effet, et sans jamais brouiller les cartes, Michèle Monte se souvient du rapport dialectique qu’il faut instaurer, et maintenir, entre la collecte de données systématiquement catégorisées et les hypothèses que l’on a pu défendre sur cet archi-genre qu’est la poésie. Tout au long de son ouvrage, une symbiose subtile, mais non réductrice, lie ainsi l’examen du détail linguistique et philologique à la volonté de théoriser que nous ont léguée Aristote puis le romantisme allemand.
L’approche sémantique nous oblige à prendre en compte tout ce qui sépare le sens de la dénotation. Je suis de ceux qui pensent que, des deux 12pôles en cause, c’est la dénotation qui se révèle la plus complexe. Le rapport du langage au réel ne saurait obéir à un relativisme intégral – trop de soubresauts récents nous l’enseignent. Mais si la vérité ou fausseté de nombreux contenus propositionnels ne participe pas de l’arbitraire, la réalité – l’ontologie du monde – que ces contenus requièrent en vertu d’une compositionalité sémantique contrainte par la syntaxe dépend de nos facultés mentales, de notre culture, de notre histoire. Le sens se nourrit de cette réalité sans pourtant s’y réduire, puisque la parole nous permet de construire des ontologies alternatives ou, en tout cas, de brouiller le découpage ontologique préalablement disponible. Tout poète écrit donc à partir – éventuellement à l’encontre – d’un arrière-fond où se côtoient des représentations multiples et aux origines diverses. La linguistique cognitive s’attardera sur le soubassement perceptuel et expérientiel de ces représentations ; l’analyse critique du discours, sur l’émergence de conceptualisations socialement partagées ; le spécialiste de la littérature, sur les intertextes. Un autre mérite de Michèle Monte réside dans sa capacité à ne négliger aucune de ces perspectives. Le réel – la mort, la maladie, la vie du corps ou de l’esprit… – n’est jamais évacué au profit d’une combinatoire sémiotique qui succomberait au mirage de l’autotélisme radical. Mais la manière dont l’écriture poétique exploite, manipule ou retisse la trame ontologique au point d’élaborer parfois une réalité alternative en dehors de tout projet simplement fictionnel (je songe à Michaux) nourrit des commentaires où les sources causales du poème ou du recueil, ses intertextes revendiqués ou plausibles, et par conséquent les intentions créatrices que l’on peut légitimement reconstruire, font l’objet d’un traitement explicite, mais dénué de tout dogmatisme. Michèle Monte ne ruse pas, ne fait aucune impasse ; elle nous livre des matériaux ordonnés par une logique descriptive, sans se dérober par avance à nos doutes ou à nos objections possibles.
De l’esthésique relèvent les procédés touchant à la « surface des choses », qui peuvent nous apparaître, dès lors, comme plus banals, voire moins porteurs d’une signification inattendue. Mais le corpus de Michèle Monte recèle, à cet égard, bien des difficultés. Lorsque le poème possède une métrique identifiable dont les ingrédients formels – la syllabation, la concordance ou discordance entre le vers et la prosodie ordinaire, entre le vers et la syntaxe, … – sont identifiables sans hésitations majeures, le canevas fourni par le mètre segmente le texte 13en autant de jalons par rapport auxquels nombre de parallélismes ou de contrastes additionnels se laissent assez facilement déceler. À l’inverse, les œuvres contemporaines nous confrontent très souvent à une prosodie incertaine (le trop célèbre « e muet », les synérèses ou diérèses, …) et à l’inexistence d’un mètre réglé et d’emblée sensible, de sorte que la dimension esthésique d’une pièce ne s’offre plus à l’analyste comme un treillis déjà mis en place, mais comme un mode d’organisation qu’il faut construire simultanément à la prise en charge des dimensions sémantique et énonciative. À cet égard, les poètes d’aujourd’hui, sans abolir le dualisme du discours poétique, bouleversent la production et le traitement de cet objet à deux faces. Là où le vers et la strophe classiques, au prix de contraintes fortes et uniformes, permettaient de composer et d’assimiler sans peine de longues tirades ou des descriptions interminables, le texte contemporain fait d’abord obstacle et sollicite une attention accrue. J’ai longtemps lu, chez Apollinaire, Les marmites donnaient aux rondins des cagnats / Quelque aluminium où tu t’ingénias / À limer jusqu’au soird’invraisemblables bagues sans réaliser que les marmites étaient des obus de gros calibre, et qu’elles ne donnaient rien, bien sûr, aux abris de tranchées (les cagnats) puisqu’après les bombardements de l’artillerie allemande, les soldats récupéraient les douilles des obus explosés afin d’en aplatir l’aluminium en utilisant, dans ce but, les rondins qui servaient normalement à édifier les cagnats (on dit, de même : Ce vernis donne, au pinceau, un très beau résultat). Si j’ai pu demeurer sans beaucoup de gêne dans un tel état d’ignorance, c’est que la « musique » familière des alexandrins me suffisait ; « le mètre », disait déjà Aristote, « distrait l’attention ; car on se demande quand reviendra le même mètre ». Le passage eût-il été écrit en vers libres, je me serais montré plus inquiet. Cette inquiétude, nous la rencontrons chaque fois que Michèle Monte aborde un matériau étranger à la versification classique. On aura tout avantage à ne jamais négliger ces développements, qui montrent comment nos contemporains renouvellent l’archi-genre poétique par des procédés certes moins répétitifs ou prédictibles que par le passé, mais qui ne rompent pas avec une démarche d’écriture multiséculaire à laquelle il leur arrive de nous renvoyer.
Aux yeux d’un linguiste qui vient, comme moi, de la grammaire générative et qui se réclame volontiers de la philosophie analytique et de la logique, l’apport le plus innovateur du volume réside dans les 14nombreuses pages que Michèle Monte consacre à la dimension énonciative de la poésie. Dans les modèles théoriques sur lesquels je m’appuie spontanément, tout s’organise autour d’un objet pourvu de ces deux volets que sont la syntaxe (éventuellement « profonde ») et la prosodie (dérivable de la syntaxe par des « règles d’ajustement ») : à partir de la syntaxe se construit une sémantique compositionnelle dont la pragmatique spécifie ou enrichit ensuite les contenus ; de la structure prosodique dérivent des représentations phonologiques puis phonétiques dont le détail variera selon les exigences de la description à fournir. Michèle Monte se nourrit d’un autre programme de recherches, qu’incarnent en France des auteurs comme Émile Benveniste ou Oswald Ducrot. À la séquentialité de la triade syntaxe – sémantique – pragmatique se substitue une approche qui, par la place centrale conférée à l’énonciation, aboutit à une vision beaucoup plus intégrée du sens. De nombreux paramètres qui relèvent de la pragmatique au sens anglo-saxon du terme (la scénographie des personnes, des temps ou des modes, les connexions argumentatives, la fixation et la coexistence des points de vue, …) viennent dès lors déterminer le statut précis, et contextuellement ancrable, des énonciations et des énoncés. Les bénéfices descriptifs de cette stratégie ne font aucun doute, surtout lorsqu’il s’agit de saisir la nature singulière d’une écriture poétique. Mais, du fait même que le phénomène énonciatif absorbe alors de multiples mécanismes qui dépassent largement le cadre des énoncés ou des discours élémentaires, le lien risque d’être rompu avec les typologies que se donnent les théories linguistiques les plus rigoureuses. On peut être tenté par l’hypothèse qu’il existerait une énonciation spécifiquement poétique, lyrique, épique, dramatique, romanesque…, voire hugolienne, là où la théorie des actes de langage ou de discours postule des catégories beaucoup plus générales, et d’un nombre beaucoup plus restreint. Mais rien n’interdit de penser qu’une typologie parcimonieuse suffit à partir du moment où l’on reconnaît le rôle considérable que les interactions entre le sémantique, l’esthésique et l’énonciatif jouent dans le traitement du texte par l’interprétant. Michèle Monte choisit, sans obéir à aucun préjugé doctrinal, de ne pas céder à la profusion typologique ; et ses analyses montrent, à chaque fois, comment des outils adaptés aux usages ordinaires permettent, par leur insertion dans un réseau de paramètres indépendants, de décrire au plus près une parole qu’on jugerait trop vite rétive à toute théorisation. 15Les rapports divers – de similitude ou de contraste, de parodie ou de démarcation, … – que la poésie entretient avec d’autres (archi-)genres discursifs, et donc au premier chef avec la rhétorique, se prêtent alors à des études rigoureuses qu’un cloisonnement énonciatif rendrait vite impossibles.
Je conclurai cette préface par une dernière remarque. Les poéticiens dont l’œuvre m’est la plus familière n’ont guère prêté d’attention aux recueils. Il est vrai qu’à l’origine, le recueil poétique procédait d’une volonté de collecte ou d’anthologisation étrangère à l’auteur. On ne saurait nier, en outre, que la plupart des poèmes s’écrivent et se publient dans un ordre temporel que le recueil ne restitue que rarement, quand il ne le distord pas. Mais les recueils ont très vite bénéficié d’une identité propre, voulue en tant que telle par les poètes ; et ce n’est pas parce que j’ai acheté mes livres au hasard de mes découvertes chez les libraires ou chez les bouquinistes que leur rangement dans ma bibliothèque doive refléter ce processus largement aléatoire. Michèle Monte, à de nombreuses reprises, se penche sur la structure des recueils étudiés et sur la distribution de certains traits à l’intérieur des composants qui les constituent. Parallèlement, et comme pour illustrer une fois de plus la solidarité dans le travail que partagent poètes et analystes, son livre, fruit d’enquêtes et de réflexions dont témoignent des articles parus au long d’une quinzaine d’années, est un authentique traité où nulle solution de continuité ne sépare les hypothèses avancées de leur mise à l’épreuve empirique et des observations cernant l’irréductible individualité de chaque démarche créatrice.
Marc Dominicy