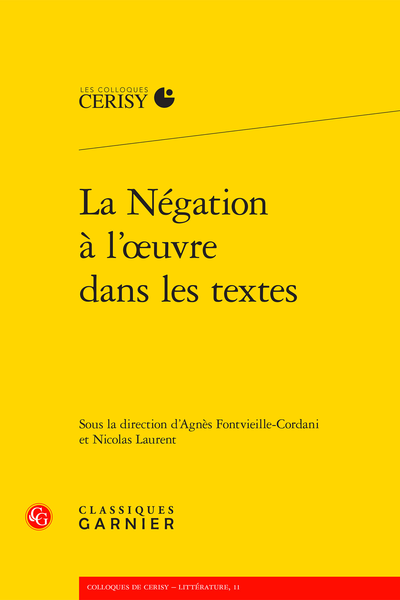
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Négation à l’œuvre dans les textes
- Pages : 531 à 537
- Collection : Colloques de Cerisy - Littérature, n° 11
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406142003
- ISBN : 978-2-406-14200-3
- ISSN : 2495-2788
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14200-3.p.0531
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/05/2023
- Langue : Français
Résumés
Agnès Fontvieille-Cordani, « Prologue I. Négation et figure »
Comment la négation fait-elle figure ? Les figures de points de vue, fondées sur la contradiction et l’inférence, consistent en un dédoublement du dire produisant une tension (1) tantôt entre ce que l’on dit et ce qui est, (2) tantôt entre les points de vue, (3) tantôt entre le dit et ce qui est sous-entendu. Opérateur d’ajustement énonciatif, la négation s’emploie, dans les romans de la voix des xxe et xxie siècles, à fonder une textualité négative empruntant les voies mystérieuses du déni.
Nicolas Laurent, « Prologue II. Sémantique du style et négation »
Les marques de négation invitent à un parcours complexe, qu’il s’agisse des modalités de la présence du positif à travers le négatif et des jeux figuraux concernant un possible positif imposé, visé ou suggéré, des modes de contextualisation du morphème négatif qui peut condenser, impliquer, tout un discours, ou encore du rôle dévolu à la négation dans la structuration en un espace logique qui participe du style de l’œuvre. La négation est un agent dynamique de la forme et de la pensée.
Sophie Milcent-Lawson, « “Romances sans paroles” et “sourire sans chat”. Négation et reconfiguration du sens dans les syntagmes de type N1 sans N2 »
L’étude aborde, à partir d’un corpus littéraire, une configuration morphosyntaxique singulière, celle où la négation de type [N1 sans N2] revêt une dimension paradoxale selon le modèle de Romances sans paroles. Sont examinées l’aptitude de ce schème à se convertir en patron prosodique et figural, ainsi que les déterminations structurales internes qui le prédisposent à modéliser un questionnement sur le langage et sur le monde.
532Sibylle Orlandi, « La négation chemin faisant. Poésie et via negativa chez René Daumal et Jacques Roubaud »
La pratique de la via negativa innerve les créations poétiques de R. Daumal (Le Contre-Ciel) et de J. Roubaud (Quelque chose noir). Les manifestations linguistiques de la négation dans les recueils témoignent d’un héritage et d’une subversion : vidée de son substrat théologique, la via negativa ouvre chez Daumal sur une ascèse individuelle, tandis qu’elle donne forme, chez Roubaud, à une expérience de l’absence.
Stéphanie Thonnerieux, « Négation et poésie du deuil. Les morts (ne) sont plus que des mots »
La poésie du deuil de la fin du xxe siècle (Deguy, Roubaud et Sacré) présente des énoncés négatifs singuliers associant glissements énonciatifs (maintien de l’adresse) et paradoxes référentiels (être inexistant). L’étude du mot rien, très polyvalent sur les plans syntaxique et sémantico-référentiel, confirme le statut particulier donné à l’être disparu, celui d’un absent-présent dans une parole consciente des excès de la subjectivité et de la naïveté d’une consolation poétique.
Émily Lombardero, « Aimer ou ne pas haïr. La litote en question dans les nouvelles historiques et galantes »
Cet article est consacré à l’interprétation en litote de la négation ne pas haïr : en examinant cette expression dans la fiction en prose du xviie siècle, nous souhaitons interroger le lien qui unit la litote à la négation, et évaluer le rendement stylistique de cette figure, symbole des contraintes qui pèsent sur la représentation et l’expression du désir féminin.
Suzanne Duval, « La négation grammaticale à l’œuvre dans la subjectivité épistolaire du premier xviie siècle »
L’écriture des recueils épistolaires publiés dans les premières décennies du xviie siècle, à ce jour peu étudiée, se caractérise par une abondance de tournures négatives déterminées par les contraintes de la politesse, mais favorisant aussi l’expression stylisée de la subjectivité du scripteur.
533Marc Bonhomme, « Modalités et fonctions de la négation dans l’interrogation rhétorique. L’exemple des Fables de La Fontaine »
Cet article étudie l’interrogation rhétorique chez La Fontaine à travers ses renversements de valeurs de vérité qui touchent la négation et la négativité. Sont analysés les modalités énonciatives de cette figure, ses mécanismes d’inversion entre polarités positives et négatives, ainsi que le rôle du cotexte dans ce processus inversif. L’article examine enfin les fonctions de ces jeux de bascule, en liaison avec le style des fables.
Sémir Badir et Thomas Franck, « Rhétorique de la négation dans l’œuvre de Roland Barthes »
L’écriture de Barthes a travaillé la négation au point de la produire comme une figure de pensée. Selon les livres, cette négativité figurale intervient à des titres distincts, et même contrastés. Dans Mythologies, elle dénonce dans le discours du mythologue la positivité du mythe. Dans Fragments d’un discours amoureux, en revanche, elle se présente en excès, tel un lapsus révélateur. Toujours, cependant, elle a soutenu un projet éthique.
Isabelle Serça, « Nier, est-ce contredire ou dire l’absence ? »
Negare, « affirmer que… ne… pas ». De l’usage de l’inverseur justement chez Giraudoux (La Guerre de Troie n’aura pas lieu) au mot-trou de Duras (Le Ravissement de Lol V. Stein), on s’interrogera sur les différents types de négation : nier, est-ce contredire ou dire l’absence ? On s’appuiera sur la conception de Ducrot, selon laquelle l’affirmation est au cœur de la négation, dans un parcours qui nous mènera de la linguistique à la littérature, la philosophie ou la psychanalyse.
Ilias Yocaris, « “Ne pensez pas que je cherche à vous convaincre de quoi que ce soit”. Réfutation, polyphonie et (dé)négation dans Les Bienveillantes »
Les énoncés négatifs observables dans Les Bienveillantes s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie argumentative implicitement apologétique, typique du discours politique de l’extrême droite. Afin de décrypter cette stratégie, on étudiera dans le roman de J. Littell les rapports entre négation et polyphonie, les rapports entre négation et discours implicite ainsi que les prolongements psychanalytiques des tournures négatives.
534Éric Bordas, « “Non, c’est non !”. Négation et tautologie »
Dans les discussions contemporaines autour des rapports sexuels consentis ou non, la compréhension de la négation est devenue un objet juridique considérable. En avertissement se sont multipliées les sentences du type : Non, c’est non ! ; Quand c’est oui, c’est oui. Quand c’est non, c’est non. L’emploi d’une négation implique à la fois la valeur particulière du signe en cause et les effets présuppositionnels qui en dérivent. Jamais l’on ne comprend aussi bien que toute négation est tautologique.
Fabienne Boissiéras, « Mouvements involontaires et renversements spectaculaires. Les opérations négatives dans les comédies de Marivaux »
En privilégiant la négation dans ses comédies, Marivaux parie sur une stylistique transformationnelle capable de renseigner le spectateur sur les couches profondes de la signification. Fondée sur l’émergence d’une identité dynamique, sa comédie met à nu des obstacles internes que le principe de contradiction sait trahir par surprise. Devançant les investigations modernes sur la psyché, Marivaux dévoile « l’intelligence de la négation » (Paul Ricœur) à décoder dans un dédale de phrases négatives.
Denis Vigier et Martine Groult, « Négation et polyphonie chez d’Alembert dans la querelle des forces vives »
En choisissant le point de vue de l’homme, la philosophie des Lumières effectue un changement de perspective pour l’explication du monde. Cela ne s’est pas fait sans querelles. Celle « des forces vives » est l’une des plus présentes dans l’Encyclopédie. En croisant les points de vue de la philosophie, de l’épistémologie et de la linguistique, nous montrons en quoi la négation projette le lecteur au cœur de cette controverse qui a occupé quinze années de la vie de d’Alembert.
Sandrine Vaudrey-Luigi, « La textualité négative de Réparer les vivants de Maylis de Kerangal »
Réparer les vivants est la narration d’un éventuel refus qui se transforme en acceptation par des parents de laisser prélever les organes sur leur fils de 19 ans. En ce sens, la syntaxe de la négation est inséparable d’une dimension ontologique qui engage sa représentation mais également du matériau 535stylistique. La langue construit ainsi une scénographie négative qui engage la syntaxe et la textualité et donne à lire de véritables emblèmes stylistiques au service d’une poétique négative.
Philippe Wahl, « Poétiques négatives. Beckett en diachronie »
Contre les lectures négatives de l’œuvre de Beckett, on insistera sur l’énergie et le pouvoir configurant d’une écriture cherchant sa voie dans un « mal voir, mal dire », à travers trois moments de la création : la logique sceptique des jeux combinatoires de Watt ; la dramaturgie énonciative de L’Innommable ; les dispositifs expérimentaux du minimalisme tardif. D’âge en âge, la vis negativa au principe de l’ascèse méthodique dessine un processus de stylisation littéraire.
Lucile Gaudin-Bordes, « “Elle n’avait rien à voir, aussi bien était-elle…”. Négation et étalement discursif dans Un été de glycine de Michèle Desbordes »
L’article étudie la négation en l’abordant à trois niveaux différents, comme mode indirect de donation du référent (niveau sémantique), comme moyen de convoquer les discours en circulation sur les objets décrits (niveau dialogique), comme outil de récriture des textes de Faulkner, auquel Desbordes rend hommage, et à propos duquel la négation est régulièrement évoquée comme un stylème d’auteur (niveau intertextuel).
Romain Benini, « La négation dans l’écriture métrique. Quels enjeux ? »
Observer les marqueurs de négation et leurs propriétés syntaxiques et prosodiques permet de faire émerger plusieurs éléments complexes de la structuration du vers classique. Cet article vise à identifier les éléments en question et à exposer ce que la place de la négation dans les vers peut nous apprendre, d’une part, de la convergence entre les unités linguistique et le patron métrique et, d’autre part, de l’évolution de cette convergence.
Roselyne de Villeneuve, « D’un Cid à l’autre. Négation, “tragédisation”, exception »
La tragi-comédie du Cid (1637) est recatégorisée comme tragédie en 1648 et remaniée en 1660. Quelle est la part de la négation dans ce travail 536de tragédisation ? À partir de données statistiques, le phénomène microtextuel de la négation est articulé à des questions de dramaturgie et de genre. On souligne sa fréquence dans les réécritures et l’importance de la négation exceptive, vectrice d’un tragique conçu comme entrave à la volonté.
Claude Muller, « Négation et récits à présentation autobiographique »
La négation ajoute ici à son registre habituel les effets de subjectivité du narrateur qui nie. Les quatre textes choisis montrent comment la négation intervient dans la recherche du vrai, mais aussi dans la description d’un malaise ou d’un désaccord, personnel ou social. La négation, souvent liée à la dépréciation, est aussi rupture ou révolte, et toujours un outil essentiel de structuration du texte.
Christelle Reggiani, « La négation du voyage »
Ayant par définition affaire à des référents relevant d’une forme d’altérité, le récit de voyage suppose, comme genre factuel, une accommodation linguistique. On se propose ici de montrer que la négation occupe une place cruciale dans cette économie, dans la mesure où la bascule du sens qu’elle représente fonde un art d’écrire capable de résoudre l’aporie constitutive d’un genre attaché par vocation à dire l’ailleurs avec les mots de l’ici.
Michèle Audin, « Ne pas oublier »
Négation => liberté => création littéraire : cette suite d’implications logiques lues dans Histoire du siège de Lisbonne de José Saramango (1992) permet de mieux comprendre le chemin de négation qui contraint par défaut les récits de Une vie brève (2013) à Oublier Clémence (2018). L’injonction de « ne pas oublier » réunit alors l’écrivaine, la mathématicienne et l’historienne.
Agnès Fontvieille-Cordani et Nicolas Laurent, « Hervé Massard, La Mer à bord. Entretien »
Dans un entretien avec Agnès Fontvieille Cordani et Nicolas Laurent, le photographe franco-autrichien Hervé Massard retrace avec humour et acuité son projet The Sea aboard. Convaincu des impasses de la représentation, il a 537délaissé la photo pour « prendre la mer », confrontant ainsi une vision stéréotypée de la mer avec la mer qu’on prend, lorsqu’on navigue. De négation il est question au travers de ce geste radical mais aussi dans la manière dont s’énoncent les « Dix ans de la biographie d’une idée ».