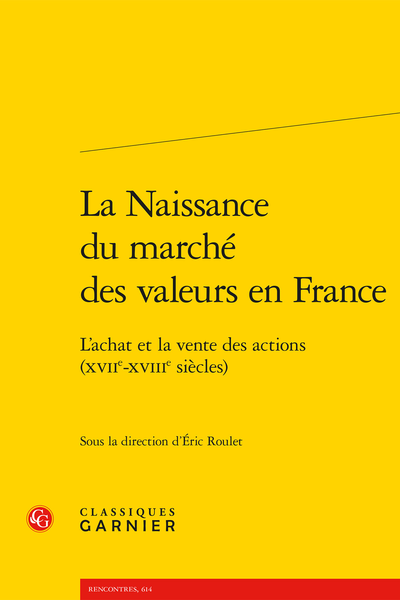
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Naissance du marché des valeurs en France. L’achat et la vente des actions (xviie-xviiie siècles)
- Pages : 197 à 199
- Collection : Rencontres, n° 614
- Thème CLIL : 3344 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique -- Histoire des institutions et marchés monétaires et financiers
- EAN : 9782406161189
- ISBN : 978-2-406-16118-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16118-9.p.0197
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 27/03/2024
- Langue : Français
Résumés
Éric Roulet, « Introduction »
Les compagnies qui apparaissent en France au début du xviie siècle pour le commerce au lointain reposent sur un nouveau mode de financement, les actions qui s’échangent, circulent et passent de main en main. Mais qu’est-ce qu’une société par actions sous l’Ancien Régime ? L’examen des modalités de vente et d’achat des actions peut nous permettre de mieux comprendre ces sociétés et leur développement quand la fièvre spéculative gagne les investisseurs. Dans quelle mesure la puissance publique tente-telle d’encadrer les pratiques ?
Éric Wenzel, « Les compagnies coloniales du xviie siècle fondatrices des sociétés de capitaux modernes ? »
Alors que les compagnies néerlandaises et anglaises se tournent vers des formes modernes d’actionnariat dès le début du xviie siècle, les compagnies françaises semblent plus frileuses à sortir d’un fonctionnement plus « traditionnel » ou bien optent pour un mélange des genres. En France, on préfère le soutien des pouvoirs publics, ce qui permet de sortir du cadre étriqué du droit commercial de l’époque, au risque de freiner la liberté essentielle au développement du commerce international.
Éric Roulet, « Les modalités d’acquisition et de cession des actions au xviie siècle d’après les statuts et les actes des compagnies »
Les auteurs du xviie siècle évoquent peu les modalités de transmission des actions des compagnies, pourtant, cette question est essentielle car elles conditionnent la circulation et la valorisation des titres. Les statuts des compagnies y attachent davantage d’importance en consacrant de nombreux articles aux conditions de cession des actions. Leur analyse permet de mieux comprendre ces processus complexes et leur impact sur la circulation du capital et la notion même d’investisseur.
198Nicolas Buat, « Destins parallèles. Les actionnaires des sociétés de canaux de Briare (1638) et d’Orléans (1681) »
Les canaux de Briare (1642) et d’Orléans (1681), qui ont de nombreuses affinités techniques et géographiques, se distinguent par leur structure actionnariale jusqu’à leur nationalisation en 1860. Alors que la première de ces deux compagnies connaît une grande stabilité en dépit de la Révolution, la seconde ne dure que cinq ans sous sa forme initiale. Ce sont les déboires de son principal investisseur, François Vedeau de Grandmont (1641-1718), qui permettent d’en connaître le fonctionnement.
Benjamin Steiner, « “Une société sacrée et immuable” ? Actions et actionnaires de la Compagnie du Sénégal à l’époque de Louis XIV (1673-1718) »
De 1673 à 1718, le commerce avec l’Afrique en France relevait de la Compagnie du Sénégal qui a été à plusieurs reprises dissoute et reformée. Comment fonctionnaient exactement les ventes et achats de ses actions ? Les contrats de vente, les arrêts du roi et les mémoires sur la situation de la Compagnie permettent de mieux saisir ces transactions. Quel rôle l’administration royale joua-t-elle ? Mais l’achat et la vente d’actions n’étaient-ils pas limités à la période de liquidation et de rétablissement des sociétés successives ?
Éric Roulet, « Actions et agiotage à l’époque de la Régence. L’effervescence parisienne vue par un contemporain. Jean Buvat raconte »
Les actions de la Compagnie d’Occident proposées sous la Régence et les belles promesses qui sont faites à leurs détenteurs suscitent un réel engouement de toute la société française. Le témoignage de Jean Buvat (1660-1729) est précieux car il livre au jour le jour le récit de la crise à Paris et nous permet de goûter à cette effervescence parisienne entre 1719 et 1720 et de connaître les lieux de vente des actions et les pratiques des agents et autres « agioteurs » durant ces années.
Ludovic Laloux, « Les tensions entre actionnaires de la société des mines d’Aniche à la fin du xviiie siècle »
En 1773, le marquis de Trainel fonde l’Association pour les Fosses de Villers-au-Tertre. Les positions des directeurs divergent sur la stratégie à 199tenir : des liens entretenus par certains d’entre eux avec la Compagnie minière d’Anzin laissent penser à un manque de fidélité par rapport au marquis ; de plus, certains se laissent griser par les premiers succès d’exploitation, sans se rendre compte que ces derniers obèrent des résultats qui auraient été susceptibles d’être plus importants avec d’autres choix humains, techniques, stratégiques et financiers.
Guillaume Garner, « Privilèges d’entreprise et marché aux xviie et xviiie siècles »
L’article revient sur l’opposition, affirmée à la fois dans les discours économiques de l’époque moderne et dans l’historiographie, entre privilèges d’entreprise et marché. La portée économique des privilèges ne peut être appréciée qu’en prenant congé d’une vision ahistorique du marché et en tenant compte des spécificités économiques, juridiques et sociales des marchés modernes. Les effets du privilège se retrouvent dans les compagnies de commerce qui confirment l’hypothèse d’un lien entre capitalisme et privilège.
Éric Roulet, « L’État et la régulation du marché des valeurs mobilières au xviiie siècle »
Les achats et les ventes d’actions se font le plus souvent aux sièges des compagnies au xviie siècle. La circulation des papiers, que ce soient des actions ou des billets d’emprunts d’État, toujours plus nombreux lors du siècle suivant, conduit à envisager la création d’un marché et à encadrer toutes les transactions financières. L’État est soucieux de remettre de l’ordre après la crise boursière des années Law. La législation abondante en la matière ne montre-t-elle pas aussi les tâtonnements et les hésitations du pouvoir et le manque d’efficacité des mesures décidées ?
Éric Roulet, « Conclusion »
Il est difficile de parler d’un marché primaire pour la première moitié du xviie siècle, quand naissent les compagnies par actions en France, dans la mesure où les actions sont souvent proposées à des proches sans appel public. Mais par la suite, la fondation de grandes compagnies désireuses de fonds importants nécessite d’intéresser davantage de personnes. Les interventions de l’État visent alors à réguler les transactions et à organiser le marché.