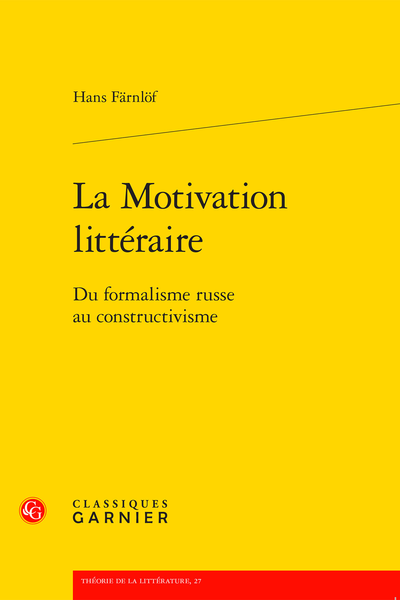
Introduction
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Motivation littéraire. Du formalisme russe au constructivisme
- Pages : 11 à 20
- Collection : Théorie de la littérature, n° 27
- Thème CLIL : 4053 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Théorie Littéraire
- EAN : 9782406131052
- ISBN : 978-2-406-13105-2
- ISSN : 2261-5717
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13105-2.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 17/08/2022
- Langue : Français
Introduction
La motivation semble une notion particulièrement difficile à circonscrire dans les études littéraires. Elle s’emploie souvent dans une acception psychologique pour rendre compte de la façon dont le comportement du personnage s’harmonise avec sa personnalité (« Charles Bovary ne découvre pas l’adultère d’Emma parce qu’il est trop bête », « Julien Sorel veut monter en grade parce qu’il est orgueilleux »). La motivation peut aussi concerner les rapports de plausibilité qui existent entre milieu, personnages et évènements (« Il est naturel que des gens de toutes sortes se rencontrent dans l’auberge de Don Quichotte » ; « La situation de la guerre incite les personnages à quitter Rouen dans “Boule de suif” »). Véhiculées par des vocables d’apparence objective, comme « parce que », « par conséquent », « naturellement », etc., ces explications imposent au texte un réseau de motivations pseudo-objectives, pour reprendre le terme de Spitzer (1980).
Sur le plan de la composition, la motivation s’utilise pour commenter la mise en intrigue (« Si Charles ne découvre pas l’adultère d’Emma, c’est pour permettre à l’auteur de développer cette thématique durant une bonne partie du roman ») ou la façon dont l’insertion de certains éléments narratifs justifie l’utilisation de procédés poétiques (« L’attente d’un personnage à un rendez-vous crée l’occasion pour Zola d’insérer des descriptions du milieu »). Dans la perspective de la création littéraire, la motivation renvoie à l’intention de l’auteur, à un projet esthétique, voire à une thèse philosophique (« Dans ce roman, Balzac veut expliquer les rouages de la société ») ou, comme chez Biagini (1998), à la raison d’être de l’œuvre (« Madame Bovary entend s’inscrire contre une certaine tradition romanesque »). D’après Todorov (1978) et Culler (2002), le lecteur peut motiver le récit en lui attribuant un sens par l’acte de l’interprétation, pensée prolongée par Pennanech (2012), qui attribue la même fonction au critique, dont la lecture avertie motiverait en quelque sorte le texte.
12Déjà polysémique par ses emplois dans d’autres secteurs (selon le dictionnaire : en psychologie, psychopédagogie, philosophie, économie et linguistique), la notion de « motivation » embrasse ainsi un champ considérable de pistes d’investigation dans le domaine littéraire seul : causalité, cohérence, lisibilité, vraisemblance des enchaînements et des comportements des personnages, justification de l’emploi de telle thématique ou de tel procédé, conformité avec l’encyclopédie courante, composition et finalité du récit, intention du personnage et de l’auteur, sens, visée et justification de l’œuvre… Aussi n’est-il pas étonnant de trouver dans les ouvrages de référence en théorie littéraire des définitions multiples, et parfois difficilement compatibles, de la motivation littéraire1.
Ce statut problématique de la notion de la motivation est encore renforcé par deux tendances observables dans le champ de la théorie littéraire ces dernières décennies. D’une part, on note l’omission fréquente de cette notion dans des ouvrages où sa mention aurait pourtant été justifiée (dictionnaires terminologiques, survols de théorie littéraire, ouvrages de narratologie générale, réflexions sur la représentation du réel, analyses de causalité narrative, etc.)2. D’autre part, on voit la réduction de la motivation à sa seule acception psychologique et référentielle3. L’ouvrage de référence actuel en narratologie, à savoir The Living Handbook of Narratology (Meister, s. d.), confirme ces deux tendances : seuls huit articles sur les quelques soixante-dix mentionnent la motivation, et 13avant tout dans le sens de l’intention du personnage4. Avec quelques exceptions, c’est aussi dans ce sens qu’on aborde la motivation dans le colloque récent Raisons d’agir : les passions et les intérêts dans le roman français du xixe siècle (Lyon-Caen, 2020). À cette réduction théorique s’ajoute la tradition d’associer l’emploi de la motivation à l’étude d’un seul type de littérature, à savoir le discours réaliste, pour cerner l’ensemble des procédés qui assurent au récit une certaine vraisemblance, ce qui limite encore le champ d’application de la notion de la motivation.
À juste titre, les deux chercheurs qui se sont penchés sur la question de la motivation littéraire de manière approfondie ont constaté le besoin de définir, voire de redéfinir cette notion comme concept d’analyse en élargissant son champ conceptuel. Cela vaut pour le bilan magistral de Sternberg (2012), qui reprend et développe son propre essai, plus condensé, de 1978, tout comme pour l’excellente étude de Schmid (2020) sur l’évolution de la motivation littéraire depuis la Renaissance jusqu’au postmodernisme5. La présente étude poursuit ce travail critique de clarification : l’objectif est de remédier à un certain flou théorique en offrant une synthèse des différents emplois de la notion de la motivation ainsi que d’élaborer une méthodologie susceptible de faire de cette notion un outil d’analyse à incorporer de façon plus généreuse dans les études littéraires.
Cet ouvrage complète les travaux de Sternberg et de Schmid, qui couvrent les domaines anglophone et allemand, tout d’abord sur le plan linguistique (le domaine francophone ne compte jusque-là aucun ouvrage majeur sur la motivation), mais aussi, en partie, sur le plan critique. Ni Sternberg ni Schmid ne citent les travaux de Hamon (1982, 1993 et 1998). Schmid parle bien peu de Genette (1968) et presque pas de Sternberg, mais passe soigneusement en revue les domaines russe (Chklovski, Tynianov, Tomachevski) et allemand (Blanckenburg, Vischer, Lugowski, Martínez). Haferland (2016), compatriote de Schmid, opère une synthèse partielle de cette tradition critique germano-slave, sans citer Hamon ni Culler, et en parlant de Genette dans une note. Il mentionne Sternberg 14seulement deux fois (dont une fois pour souligner que ce dernier ne cite pas les théoriciens allemands). Inversement, les travaux en français qui touchent à la motivation prennent d’habitude leur point de départ dans l’article de Genette, comme le montre le colloque mentionné sur les Raisons d’agir (Lyon-Caen, 2020), où un grand nombre d’intervenants traitent de la motivation sans mentionner les formalistes russes, Culler ou Sternberg. La sphère linguistique se rapproche ainsi d’une sphère intellectuelle. Afin de proposer un véritable tour d’horizon de l’état de la recherche sur la motivation, le présent ouvrage s’appuiera sur des ouvrages critiques en français, espagnol, italien, anglais, allemand, danois, suédois, croate, polonais et russe6.
Pour fonder cette synthèse, notre réflexion remonte en premier lieu aux écrits des formalistes russes. Certes, nombreux sont les penseurs qui ont étudié la mise en intrigue et l’emploi de procédés littéraires qui s’apparentent à la motivation sans recourir à ce terme ou en l’utilisant dans d’autres sens. Sternberg (2012, p. 331) cite La Poétique d’Aristote, le traité sur le sublime attribué à Longin, le classicisme en France, Laocoon de Lessing ainsi que les pensées de Poe et de Henry James sur la genèse de l’œuvre littéraire. Schmid (2020, p. 8-11) présente les idées de Blanckenburg sur la nécessité et celles de Vischer sur la motivation littéraire. Flaker (1964a) rattache même son étude de la motivation à une lettre d’Engels (!) où ce dernier discute la composition d’un drame de Lassalle. Dans le domaine français, on évoque fréquemment Valéry et son Cours de poétique au Collège de France7.
Malgré toutes ces contributions, il n’en reste pas moins que ce sont les formalistes russes qui ont délimité le champ d’application de la motivation littéraire et c’est aussi par rapport à leurs écrits que tout théoricien de la motivation doit se positionner. D’après les spécialistes en formalisme russe, comme Erlich (1980), Sternberg (2012) et Schmid (2020), la motivation s’affiche même comme une de leurs notions clés8. Les chercheurs russes 15introduisent plus précisément le terme de motivirovka pour analyser la motivation littéraire, à distinguer de la motivation référentielle, nommée motivacija, opérante dans le monde extralittéraire. Cette notion de motivirovka exerce une double fonction. D’une part, elle désigne l’articulation des actions et des évènements dans l’histoire racontée (ce qui rejoint les polémiques sur l’« effet de réel », la lisibilité, la naturalisation, la vraisemblance, le discours réaliste, la mimésis, le post hoc ergo propter hoc, etc.) ; d’autre part, elle décrit les principes téléologiques du récit, qui conditionnent la mise en œuvre des éléments narratifs au nom de la construction artistique (c’est la poétique du récit, la stratégie auctoriale, le jeu narratif, l’effet textuel, etc.). Pourtant, peu d’ouvrages généraux, parmi ceux qui incluent des passages ou des entrées où l’on aborde la motivation littéraire, tiennent compte de cette double fonctionnalité9.
À condition de considérer cette double fonctionnalité et ses rapports avec le monde extralittéraire, on entre au cœur de la problématique essentielle concernant réalité et fiction, mimésis et sémiosis, histoire et récit, action et fabrication. C’est de cette problématique, et de cette définition double de la motivation littéraire, que part cet ouvrage, avec l’ambition d’affiner sa typologie. En nous inspirant des formalistes russes ainsi que des écrits postformalistes qui poursuivent (explicitement ou implicitement) leur tradition critique ou qui exploitent la motivation par d’autres manières, l’idée est de passer en revue les positionnements critiques les plus importants par rapport à la motivation littéraire (il sera notamment question du structuralisme français, de la théorie des mondes possibles et de la narratologie cognitive).
Comme notre ouvrage propose une synthèse critique qui vise un certain renouvellement de l’étude de la motivation littéraire, les divergences – plus ou moins prononcées – avec certaines autres études seront inévitables. Nous prions le lecteur d’aborder nos prises de position comme un dialogue avec la recherche antérieure, comme une proposition de 16lecture critique et non comme une réfutation catégorique de perspectives et d’approches alternatives10. Soulignons aussi que cette entreprise nécessite, bien entendu, certaines démarcations. Chez les formalistes comme dans le paysage postformaliste, les écrits sur la motivation littéraire se forment en symbiose avec des remarques sur maintes autres notions. Bien entendu, il sera impossible d’approfondir l’étude de tous les procédés ou effets (lisibilité, vraisemblance, cohérence, effet de réel, composition, etc.) qui entrent en interférence avec le sujet principal du présent ouvrage ; l’intention sera surtout d’en cerner les aspects pertinents pour mieux comprendre l’essence et la portée de la motivation littéraire.
Ce faisant, le premier chapitre, Points de départ, récapitule dans un premier temps l’entrée des formalistes sur la scène littéraire, leurs prises de position les plus importantes et leur évolution interne. Cette section, assez sommaire, sert avant tout à présenter les principes de base nécessaires pour mieux saisir les implications de la partie méthodologique sur la motivation qui organise la deuxième section de ce premier chapitre (tout lecteur familier avec les principes et les notions clés de l’école formaliste pourra aller directement à cette section). Pour des présentations plus exhaustives des travaux formalistes, voir Erlich ([1955] 1980), Striedter (1969 et 1989), Thompson (1971) ou Steiner (1984), de même que les bilans plus critiques de Medvedev et Bakhtine ([1928] 1978) et de Jameson (1972). Dans le domaine français, l’ouvrage d’Aucouturier (1994) est malheureusement difficile d’accès, à la différence du récent numéro de Communications (Depretto et al., 2018) consacré aux formalistes russes. Ces ouvrages se complètent par l’étude historique de Depretto (2009) et le survol de Hansen-Löve (1988). Le bilan d’Eichenbaum (2001a) donne un aperçu précis et initié des principes et de l’évolution de la pensée formaliste entre 1916 et 1925, complété par l’introduction de Todorov (2001) à son anthologie des écrits formalistes.
Pour clarifier les pistes multiples qu’ouvre l’étude de la motivation littéraire, telle que nous l’esquisserons dans le présent ouvrage, les quatre chapitres suivants seront consacrés aux principes fondamentaux de sa théorisation telle qu’elle apparaît chez Chklovski, Jakobson, Tynianov 17et Tomachevski. Outre que d’aider à caractériser des pistes théoriques et méthodologiques suivies par la recherche postformaliste, cette disposition illustrera les nuances qui existent entre les chercheurs formalistes ainsi qu’entre les phases de leur période active. C’est dire que nous tenterons d’éviter d’esquisser une image collective et figée du formalisme russe, approche réductrice ayant déjà été dénoncée par Depretto-Genty (1991b, p. 9) lorsqu’elle rappelle que « […] les critiques ont eu tendance, en effet, à les présenter comme toujours “ensemble” et à vouloir leur attribuer une doctrine “commune”11. » Cette disposition n’implique pas que ces chercheurs auraient eu chacun une conception unique de la motivation littéraire, à séparer catégoriquement des autres (bien au contraire, les formalistes russes coopéraient souvent et s’inspiraient mutuellement12). Pour emprunter aux formalistes russes un autre de leurs termes favoris, il s’agit plutôt de caractériser et de suivre dans chaque chapitre une « dominante » attachée au chercheur respectif13.
Chklovski apparaît comme le premier formaliste à étudier pour quatre raisons : les sources consultées le désignent comme l’inventeur de la motivation littéraire14 ; c’est de loin le chercheur formaliste qui exploite cette notion le plus ; son emploi de la motivation a provoqué des polémiques importantes qu’il convient d’élucider avant d’aborder les écrits des autres formalistes ; ses travaux appartiennent essentiellement à la première phase des formalistes, focalisée sur les procédés littéraires. Au centre se trouve La motivation comme prétexte artistique, subordonnée aux procédés qui permettent d’identifier la littérarité de l’œuvre. Cette 18approche trouve sa meilleure continuation dans les travaux de Hamon (1982, 1993 et 1998) sur l’écriture perpétuellement justificatrice du discours réaliste, travaux qui ont eu à leur tour une influence considérable sur l’appréciation des techniques de la description motivée.
Le chapitre suivant explorera avant tout les observations de Jakobson sur l’emploi conséquent de la motivation littéraire comme une des possibles acceptions du réalisme. Cela nous conduira à examiner l’association fréquente de ces deux notions et à constater le rejet, chez certains critiques, d’autres types de motivations, notamment celles qu’on trouve fréquemment dans le discours romanesque. Par association au grand linguiste qu’était Jakobson, nous passerons aussi en revue le parallèle entre la motivation linguistique (celle de la tradition « cratylique ») et la motivation littéraire, parallèle passablement schématique que nous tenterons de bien différencier de l’idée consistant à considérer la motivation linguistique, ou sémiotique, comme une variante de la motivation littéraire. Ces deux pistes expliquent l’épithète doublée du chapitre sur Jakobson, Le réalisme de A à E et la motivation linguistique.
Le passage à Tynianov et au chapitre La motivation comme « fait littéraire », d’après une de ses notions clés, illustrera l’évolution des travaux des formalistes vers une approche plus structurelle et dynamique de la motivation, dans laquelle s’analyse son emploi par rapport au texte comme système, considéré par rapport à des paramètres externes comme la tradition littéraire, le système des genres ou l’encyclopédie du public. Tynianov développe une « poétique de la relativité » (Weinstein, 1996), où l’évolution littéraire modifie toute donnée littéraire, ce qui rend la motivation susceptible de varier dans ses formes et fonctions, d’être parodiée et finalement remplacée par d’autres procédés ou d’autres variantes. Cela invite à des études historiques diachroniques et synchroniques de la motivation, de même qu’à des réflexions sur le texte comme monde possible.
Le dernier formaliste présenté, Tomachevski, a exercé une influence fondamentale sur les études postformalistes. Son insistance sur Motivation, organicité et vraisemblance inaugure une tradition qui se poursuit chez Genette (1968) et Culler (2002), et qui rejoint en partie une déclaration assez énigmatique d’Aragon (1969), selon laquelle le réalisme ne serait qu’une conséquence de la cohérence du récit. À la suite de ces travaux, la narratologie constructiviste actuelle réduit la motivation à la psychologie 19du personnage telle qu’elle se lit entre autres à la lumière du scriptible et des théories cognitives.
Ces quatre chapitres, qui se terminent tous par un court bilan, obéissent à un schéma simple. La première section, désignée tout simplement par le nom du chercheur (« Chklovski », « Jakobson », « Tynianov » et « Tomachevski »), présente la dominante théorique du chercheur formaliste en question pour ce qui est de la motivation. La deuxième section explore la destinée de cette dominante dans le paysage postformaliste, phénomène illustré par le titre « (D’)après Chklovski », « (D’)après Jakobson », etc. La troisième section, intitulée « À la Chklovski », « À la Jakobson », etc., vérifie la piste théorique respective par quelques analyses littéraires, entamées dans l’esprit de chaque formaliste respective.
Les analyses puiseront dans la littérature française, peu couverte par la recherche la plus importante sur la motivation, dont les représentants ont pour la plupart exploré d’autres littératures, à commencer par les formalistes, qui se centraient surtout sur le domaine russe et anglophone. Flaker (1964b) privilégie le canon croate et Sternberg (2012) le canon anglophone. Parmi la vingtaine de textes analysés par Schmid (2020), seuls deux appartiennent au domaine français (« La Vénus d’Ille » et La Jalousie). Dans la critique française, ce sont surtout les études sur la motivation chez Balzac (Genette, 1968) et Zola (Hamon, 1998) qui font autorité. Dans nos analyses, nous poursuivons leur piste : la grande majorité des textes analysés datent du xixe siècle. Certes, comme le montre Schmid (2020), rien n’empêche d’entreprendre une étude historique de la motivation. Or, le présent ouvrage vise à faire la synthèse des divers emplois de la notion de la motivation dans une perspective théorique (et non d’étudier l’emploi concret de la motivation dans des textes littéraires à travers l’Histoire). D’où le choix du xixe siècle, période qui déploie une tension constante entre composition réaliste et romanesque, ce qui fait de ses manifestations littéraires un objet d’étude particulièrement pertinent pour illustrer la problématique théorique de la motivation littéraire. Aussi reverrons-nous l’emploi de la motivation chez Balzac, Flaubert, Daudet, Zola et Maupassant, mais aussi chez George Sand, Stendhal, Nodier, Mérimée et Jules Verne. Nous couvrirons des genres variés : roman de mœurs, roman d’aventures, roman didactique, nouvelle, fantastique gothique, fantastique réaliste. Comme ouverture 20diachronique, nous inclurons aussi une analyse des réécritures récentes des contes de Perrault par Nothomb et Ben Jelloun.
Les Points d’arrivée seront naturellement le pendant des points de départ évoqués dans notre premier chapitre. Ce sera l’occasion de présenter une réflexion critique sur nos modèles d’analyse et nos prises de position théoriques et méthodologiques articulées tout au long de l’étude. Nous développerons quelques perspectives autour de la problématique de la motivation littéraire avant de clore l’ouvrage dans l’espoir d’avoir suscité l’intérêt approfondi, continu et peut-être modifié pour l’emploi de cette notion dans les études littéraires tout aussi bien que dans le champ de la théorie littéraire.
Pour la réalisation de ce bilan, je remercie en particulier Sophie Guermès et Philippe Hamon pour leur aide continue et Gabrielle Hirchwald pour sa relecture du manuscrit. Marjorie Colin, Corentin Lahouste, Yvan Leclerc, Jean-Sébastien Macke, Buata Malela, Christophe Premat et Éléonore Reverzy ont aussi perfectionné le texte par la lecture attentive d’un chapitre.
1 Pour Selden (1989, p. 14), la motivation ne serait qu’un type de réalisme ; Beckson et Ganz (1990, p. 167) et Von Wilpert (1989) délimitent la motivation à concerner la combinaison des circonstances et du tempérament qui déterminent l’action du personnage ; Carey et Snodgrass (1999, p. 93) précisent que la motivation justifie le choix d’un personnage face à un dilemme ; Wellek et Warren (1971, p. 217-218) étendent le sens jusqu’à concerner la composition entière du récit, etc.
2 Voici quelques exemples d’ouvrages qui ne listent pas la motivation dans leurs index ou qui ne mentionnent pas le terme de la motivation littéraire : Fowler (1987), Milly (1992), Brés (1994), Childers et Hentzi (1995), Lentricchia et McLaughlin (1995), Fludernik (1996), Holmberg et Olsson (1999), Hawthorne (2000), Van Gorp et al. (2001), Halliwell (2002), Kafalenos (2006), Baldick (2015), Bareis et Nordrum (2015), De Fina et Georgakopoulou (2015), Hebert (2015), Pier (2020).
3 Voir ces définitions récentes de la motivation comme (part de) la psychologie du personnage : « thoughts, feelings, or motivations » (Keen, 2003, p. 57) ; « motivations, beliefs, goals, and other mental states » (Herman, 2009, p. 159) ; « action (consisting of goals, motivations, and agents) » (Pier, 2011, p. 344). La notion de la motivation peut aussi désigner uniquement le motif d’agir : « What a character […] wants ; the reasons […] for a character’s actions » (Kennedy et al., 2009) ; « the entirety of psychical processes that initiate, maintain and regulate behaviour » (Eder et al., 2010, p. 24).
4 Le terme de « motivation » apparaît sous les rubriques Character, Cognitive Narratology, Narrative strategies, Narratology, Coherence, Experientiality, Non-temporal Linking in Narration, Plot et Possible worlds. Seuls « Character » (Jannidis, 2014) et « Narrative strategies » (Tjupa 2014) mentionnent, en passant, la dimension compositionnelle de la motivation.
5 Nos travaux initiaux sur la motivation littéraire sont antérieurs à l’article principal de Sternberg (2012) et à l’ouvrage de Schmid (2020). Le lecteur trouvera notre première synthèse, incomplète et d’une précision insuffisante, dans Färnlöf (2004).
6 Nous ne maîtrisons cependant ni le russe, que nous avons lu le plus souvent en traduction, ni le polonais. La consultation des écrits dans ces deux langues, dans leur version originale, reste basique.
7 En suivant Roussin (2018), qui démontre comment l’appréhension de la forme chez Valéry se distingue de la conception des formalistes, nous n’inclurons pas les réflexions poétiques de l’auteur de Charmes dans le présent ouvrage.
8 Sierotwiński (1986), Orr (1991) et Baladier (1991) sont les éditeurs de quelques rares ouvrages généraux qui mettent en relief ce fait. En revanche, certaines présentations (pourtant développées) de la théorie formaliste, comme Kittang (1997) et Wellek (1991), ne mentionnent pas la motivation.
9 Parmi les exceptions se trouve Hansen-Löve (1989), qui profite du vocabulaire allemand pour expliquer la différence entre la motivirovka (en allemand : Motivierung) et la motivacija (en allemand : Motivation). Schmid (2020, p. 4-8) procède de manière semblable, mais réserve, de façon quelque peu curieuse, le terme de Motivation à la psychologie du personnage, qu’il distingue du reste de la causalité diégétique. Voir aussi Prince (1987, p. 55), Harris (1992, p. 111) et Phelan et Rabinowitz (2005, p. 548).
10 Quant aux différentes perspectives, citons l’admirable déclaration de Chatman (1990, p. 5), que nous souhaiterions adopter pour le présent ouvrage : « Where I differ with colleagues, I do so out of respect for their efforts and conclusions. If in the heat of arguing my own views I seem to belittle theirs, I apologize in advance. »
11 Parmi les exceptions dans le domaine français se trouve Tadié (1978, p. 17-44), qui résume à partir de Todorov ([1965] 2001) les propos de Chklovski, Tynianov, Jakobson et Tomachevski séparément.
12 Comme le confirme Turner (1972, p. 68) : « […] the Formalists worked in close collaboration with one another and borrowed ideas freely not only from each other’s published works but also from suggestions verbally expressed. »
13 Introduit par Eichenbaum (selon Depretto, 2012), le terme de dominante est développé par Tynianov et doit son exposé le plus connu à Jakobson (1977b, p. 77), qui définit le terme comme « l’élément focal d’une œuvre d’art : elle gouverne, détermine et transforme les autres éléments. »
14 À l’exception d’Erlich (1980, p. 77), qui attribue ce rôle à Jakobson, prenant alors le contrepied des formalistes eux-mêmes. Eichenbaum (2001a, p. 51) et Tynianov (1978, p. 130) désignent tous les deux Chklovski comme l’inventeur du terme (Tynianov mentionne aussi qu’Eichenbaum était à l’origine de cette notion). Leur témoignage est naturellement plus fiable que celui d’Erlich, malgré ses connaissances encyclopédiques du formalisme russe.