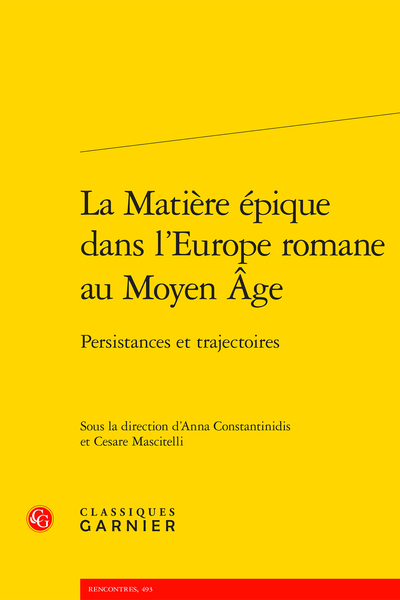
Résumés des contributions
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Matière épique dans l’Europe romane au Moyen Âge. Persistances et trajectoires
- Pages : 235 à 237
- Collection : Rencontres, n° 493
- Série : Civilisation médiévale, n° 41
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406111009
- ISBN : 978-2-406-11100-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11100-9.p.0235
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 12/04/2021
- Langue : Français
Résumés des contributions
Anna Constantinidis et Cesare Mascitelli, « Préface »
Partant de considérations relevant des théories des genres et de la réception, cette contribution aborde la question de la centralité de la chanson de geste dans la culture textuelle médiévale, en introduisant le concept de « matière épique ».
Mattia Cavagna, « La légende d’Ami et Amile entre historiographie et épopée »
L’étude examine plusieurs actualisations de la légende d’Ami et Amile, en latin et en français. Les éléments les plus instables, voire incohérents, de la légende et de son prétendu ancrage historique permettent de formuler une série d’observations concernant ses origines et son attraction progressive au sein du chronotope carolingien et de l’univers épique.
Pierre Courroux, « Chroniques épiques ou épopées historiques ? Réflexions sur quelques chroniques rimées des xive-xve siècles »
À travers trois domaines (la forme, le style et les thématiques) sont cernés un nombre assez restreint d’éléments qui peuvent être considérés comme des marqueurs de la chanson de geste dans les chroniques rimées de langue française. Puis grâce à ces critères est étudié le cas de quatre œuvres frontières de la seconde moitié du xive siècle, mêlant histoire et chanson de geste, afin de voir s’il est juste de les considérer comme des chroniques épiques ou même des épopées historiques.
Marco Veneziale, « Anthroponymes épiques dans quelques romans arthuriens en prose »
Cet article propose d’étudier la présence d’anthroponymes épiques dans les romans en prose arthuriens. Pour ce faire, il se concentre sur les noms 236épiques attribués aux guerriers à l’intérieur de la Suite Vulgate du Merlin, aussi bien que sur ceux contenus dans une rédaction particulière de Guiron le Courtois transmise par le ms. Paris, BnF, fr. 12599. Cette dernière permet en particulier d’émettre une nouvelle hypothèse sur la circulation d’Aliscans en Italie au xiiie siècle.
Jean-Charles Herbin, « La Geste des Loherains. Avatars, échos, résurgences »
La Geste des Loherains a connu un succès considérable pendant plus de quatre cents ans. On ne s’étonnera donc pas d’en trouver la trace, même déformée, altérée ou recadrée, dans plus de soixante textes littéraires de tous genres, depuis le xiie siècle (dès le Pseudo-Turpin au moins) jusqu’à l’époque moderne, ainsi que dans d’autres domaines, comme le discours historique (qui l’a traitée comme source authentique jusqu’au xvie siècle) ou même – plus surprenant – l’espace religieux.
Paolo Di Luca, « Réflexions autour de l’influence de l’épique française sur la poésie lyrique romane du Moyen Âge »
L’article envisage l’influence de la poésie épique française sur la lyrique occitane à différents niveaux : citations de héros épiques, inspiration stylistique et thématique, emprunts à la versification épique. Ces suggestions dérivant de la matière de France se retrouvent interconnectées dans l’œuvre de Raimbaut de Vaqueiras : le troubadour s’approprie les contenus et les formes de la chanson de geste, forgeant un registre épico-lyrique inédit.
Jéromine François, « L’(anti-)épopée dans le Libro de buen amor. État de la question et perspectives »
La matière épique occupe une place particulière au sein des sources du Libro de buen amor, d’une part parce qu’elle mobilise des modèles variés, d’autre part parce qu’elle fournit à Juan Ruiz un répertoire de formules stylistiques et de motifs polymorphes. Cette étude dresse un bilan des recherches menées au sujet des formes et fonctions de la matière épique dans le Libro de buen amor, avant d’analyser les détournements architextuels faisant de ce texte une anti-épopée en prise avec son temps.
237Anna Constantinidis et Cesare Mascitelli, « La Chanson d’Aspremont dans l’épopée franco-italienne. Formes et fonctions du réemploi »
La fortune de la Chanson d’Aspremont dans l’Italie médiévale est attestée, au-delà des copies d’origine péninsulaire et des réécritures vernaculaires, par l’abondance des références à son univers diégétique. Partant d’un corpus d’œuvres épiques franco-italiennes, cette contribution vise à illustrer les modalités et les fonctions du réemploi de ces réminiscences, afin de montrer la centralité de la Chanson d’Aspremont au sein de la culture littéraire de la Péninsule entre xiiie et xve siècle.
Antonella Negri, « La thématique de la trahison entre persistances et variations. Du Renaut de Montauban aux Cantari di Rinaldo : le prologue »
Dans le prologue du Renaut de Montauban, la trahison constitue l’élément déstabilisant majoritairement une organisation du pouvoir rigide, et elle assume des valeurs parfois contradictoires selon que l’acteur en soit l’empereur ou le vassal. Dans les Cantari, cette thématique subit un processus de rationalisation et, bien qu’elle maintienne sa contextualisation sur le plan politique, elle est représentée comme une trahison amoureuse qui finit par miner les rapports entre empereur et vassal.
Maria Luisa Meneghetti, « Espace et temps des “cavallieri antiqui” »
Cet article vise à caractériser le cadre spatial et temporel de la narration du Roland furieux de l’Arioste. Si, pour ce qui est des espaces, l’Arioste a tendance à créer une sorte de fond neutre, né de la convergence des espaces caractéristiques du roman courtois et de la chanson de geste, pour ce qui est du temps il inscrit le récit et les personnages qui y figurent dans une diachronie fictionnelle très clairement structurée.
Nicola Morato, « Conclusions. Matière épique et culture textuelle »
Conclusions du volume, comprenant une exposition des principaux problèmes littéraires et philologiques abordés et une présentation synthétique des contributions.