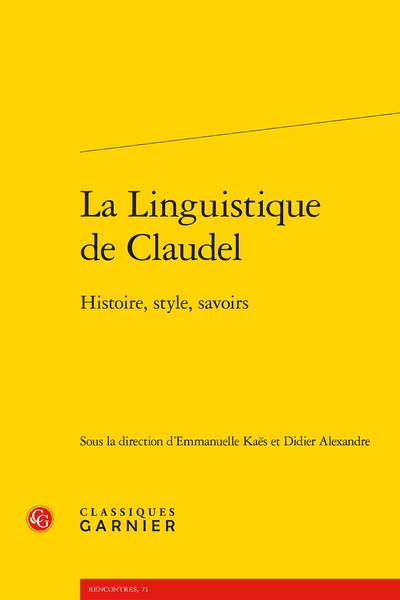
Avant-propos
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Linguistique de Claudel. Histoire, style, savoirs
- Auteur : Kaës (Emmanuelle)
- Pages : 9 à 13
- Collection : Rencontres, n° 71
- Série : Littérature des xxe et xxie siècles, n° 9
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812417474
- ISBN : 978-2-8124-1747-4
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1747-4.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 18/04/2014
- Langue : Français
Avant-propos
« La linguistique de Claudel » : ce titre peut surprendre. Sous ce terme, les contributions réunies dans ce volume envisagent la pensée linguistique de Claudel dans une perspective large : elle est saisie à la fois dans sa profondeur historique, dans ses orientations imaginaires et dans ses prolongements poétiques. Le mot de linguistique vise au premier chef le savoir personnel sur la langue élaboré par l’écrivain tout au long de son œuvre, de la linguistique conceptuelle de l’Art poétique aux réflexions disséminées dans ses essais et sa critique littéraire. Il vise aussi la manière dont Claudel pense l’articulation des formes littéraires (tout particulièrement le vers) avec les propriétés syntaxiques, rythmiques et phonologiques du français : la linguistique du poète ouvre sur une stylistique. Au-delà, cette « linguistique » s’inscrit dans une contextualisation large du style de Claudel et voudrait embrasser les représentations et l’imaginaire de la langue tels qu’ils agissent dans le discours du poète et dans la réception critique de ses œuvres.
Des travaux importants ont déjà été consacrés à ce champ de la recherche claudélienne. Après la monographie d’Henri Guillemin, Claudel et son art d’écrire en 1955, Gérald Antoine a apporté une contribution majeure à la recherche universitaire, s’attachant aussi bien à la pratique stylistique de Claudel qu’à sa réflexion sur la langue (« Claudel et la langue française », « Claudel et le mot »). Les publications de Dominique Millet-Gérard sur l’exégèse s’appuient régulièrement sur l’approche stylistique et rhétorique des textes. Avec son ouvrage Paul Claudel et la langue, Emmanuelle Kaës a récemment fortifié ce domaine des études claudéliennes. Si certaines questions sont désormais bien balisées (comme celle du vers claudélien), l’œuvre immense du poète offre encore de nombreux objets à la lecture des linguistes et des stylisticiens ; elle mériterait des études systématiques sur la stylistique de la prose, la pragmatique du langage dramatique ou encore sur la question du latin.
Le présent ouvrage regroupe des études de stylisticiens et de spécialistes de l’œuvre de Claudel autour de trois principaux thèmes. Celui, tout d’abord, d’un domaine majeur de la linguistique de Claudel : sa réflexion sur le mot, envisagée ici à la fois dans son substrat philosophique et savant et dans sa dimension poétique. Dans « L’âme des mots », Didier Alexandre retrace la généalogie de la notion d’idéogramme, en la rattachant à la linguistique développée dans l’Art poétique. Le poète introduit dans sa définition du mot la notion d’image, indissociable de l’émotion du sujet : « le mot, le mouvement particulier qui est le motif de chaque être et dont l’émotion de celui qui l’énonce est l’image » (Po., p. 195). C’est précisément le mot en tant que chiasme, « chair partagée du sujet et du monde », dont traite Claudel dans « Les idéogrammes occidentaux » (1926), « L’harmonie imitative » (1933), « Les mots ont une âme » (1946), mais aussi dans les centaines d’idéogrammes disséminés dans son Journal. De l’Art poétique aux notes les plus tardives du Journal, l’idéogramme est pensé dans une intrication constante avec le calembour et l’étymologie qui relèvent, eux aussi, de « l’un des problèmes fondamentaux de la poésie et du langage » : celui « des rapports du son et du sens, de la lettre et de l’esprit, de l’idée et de sa représentation sonore et graphique » (Pr., p. 96). Didier Alexandre montre que la lecture idéogrammatique des mots du français repose sur les grands principes de sa poétique, le mouvement et le rapport, et met en valeur le rôle du mimétisme sonore, négligé par Gérard Genette dans ses Mimologiques, en soulignant le continuum – celui-là même du corps – qui le relie à la dimension graphique du signe. Le poète pense ensemble la bouche et l’œil, la voix et le tracé : « Tous les mots sont constitués d’une collaboration inconsciente de l’œil et de la voix avec l’objet, et […] la main dessine en même temps que la bouche intérieure rappelle » (Pr., p. 90). La méditation de Claudel sur le mot est également nourrie par les apports savants : Emmanuelle Kaës s’est intéressée aux greffes, aux transferts de la grammaire comparée dans l’œuvre du poète. Ils sont multiples. Dans son Journal et dans l’Art poétique, Claudel s’essaie à la mise à jour des parentés entre langues ; la notion savante de racine, héritée de la grammaire comparée par la médiation des Mots anglais de Mallarmé, est intégrée à la poétique de l’idéogramme ; les métaphores biologiques et l’idée de la langue comme organisme en développement travaillent sa poétique et son imaginaire de la langue. Mais c’est aussi le poète chrétien qui s’empare de ces discours savants. Ainsi, l’apologétique du Magnificat reprend les mots
du comparatiste Max Müller : l’évocation des païens, ces « parleurs de paroles » qui, « du surplus de leurs adjectifs » (Po., p. 251), se sont fabriqué des idoles, transpose poétiquement l’explication linguistique du mythe : la racine adjectivale devenue, par transfert catégoriel, le nom d’un Dieu. C’est, plus nettement encore, avec sa théorie de la métaphore que le poète catholique bouscule le cadre de la science linguistique contemporaine dont il prend pourtant acte. Le postulat savant de la nature métaphorique des langues se renverse chez Claudel en métaphoricité naturelle – « énonciation arborescente » et « texte forestier » –, produit de l’acte créateur divin répété par la métaphore poétique. Au-delà de son élaboration conceptuelle, c’est aussi à la dimension proprement poétique de cette linguistique du mot que s’attachent ces deux études. Elles se rejoignent dans la mise au jour du primat du sujet dans le signe : la capacité du mot à dire le monde est inséparable pour Claudel de la présence du sujet, elle est liée à son « énergie » et à son « émotion ». Dans cette perspective, le mot apparaît comme le point de départ d’un processus de subjectivation généralisée du langage qui va de la lettre au mot, puis du mot à la phrase (et au vers), pour gagner le poème.
Deux études, complémentaires, s’attachent au vers claudélien. Carla Van den Bergh met en lumière l’historicité du vers libre de Claudel, son enracinement dans le « terreau symboliste » des premiers poèmes en vers libres parus dans La Vogue, des poèmes de Vielé-Griffin et de Maeterlinck, des traductions de Walt Whitman par Jules Laforgue. Dans une analyse qui embrasse un large corpus, elle examine également dans une perspective interne l’évolution des rapports entre vers et syntaxe, depuis les enjambements à l’intérieur d’un mot dans Tête d’Or jusqu’au vers du Soulier, en passant par les Cinq Grandes Odes ou L’Otage. À partir de 1912, la perspective de la scène travaille l’écriture du vers qui évolue vers la concordance syntaxique, adopte le plus souvent une configuration binaire et s’oriente vers un style « périodique » qui connaîtra son accomplissement dans les vers-paragraphes du Soulier de satin. Elle met également en lumière les effets sur le vers libre claudélien de l’interaction entre les genres lyrique et dramatique : le vers des premiers drames est « transporté » dans les Odes qui, elles-mêmes, portent la trace de l’expérimentation contemporaine d’une forme nouvelle de vers dans la poésie. Ce continuum est au fondement du vers iambique, commun, selon Claudel, au drame et à la poésie. Si Carla Van den Bergh mène son analyse du vers de Claudel en se déprenant de
sa théorie de « l’ïambe fondamental », c’est précisément à cette notion empruntée à la métrique antique que Pascal Lécroart s’attache. Il met en lumière l’influence d’un article du pédagogue Louis Marchand sur la rédaction des Réflexions et propositions sur le vers français, qui a amené dans l’essai des développements inédits : l’ïambe qui, jusqu’alors, était la transposition du couple brève-longue en termes de timbres vocaliques, devient la catégorie qui modélise le rythme linguistique du français. Conçu sur le modèle de l’alexandrin comme une structure binaire dotée d’une « césure » et d’une « rime », d’une « dominante » et d’une « tonique », l’ïambe permet à Claudel de promouvoir l’idée d’une continuité rythmique entre prose et vers.
Deux contributions sur la langue théâtrale s’attachent à l’articulation entre la voix singulière de l’écrivain et le matériau lexical et syntaxique que la langue met à sa disposition, qu’il soit saisi dans son épaisseur historique ou en synchronie, dans « le répertoire où nous allons chercher aujourd’hui nos moyens de communication » (Pr., p. 99). Si l’histoire de la langue n’est pas au premier plan de la réflexion de Claudel, Christelle Reggiani montre qu’elle est présente en acte dans son écriture, dans les archaïsmes lexicaux et sémantiques dont le premier théâtre est si riche ou dans la facture globalement « classique » de sa syntaxe. La langue claudélienne puise au latin et à différentes strates du français, langue médiévale de fantaisie de La Jeune Fille Violaine ou de L’Annonce, mais surtout langue classique. Cette disparate produit des décalages historiques qui maintiennent cependant leurs effets dans les limites de la lisibilité. Elle inscrit aussi dans l’écriture une dimension verticale proprement herméneutique et l’effet de « désancrage » temporel obtenu par ce dialogue de différents états de la langue sert la visée catholique « universelle » de l’œuvre. C’est aussi, selon d’autres voies, à cette inscription de la catholicité claudélienne dans les formes linguistiques que s’intéresse Frédéric Calas dans « Formes discursives de l’intradiscours catholique dans Le Soulier de satin ». Se situant dans le cadre théorique de l’analyse du discours, il s’attache à la structure syntaxique insistante, « fil d’Ariane continu mais discret », des phrases clivées (« c’est l’amour qui doit me donner les clés du monde ») et pseudo-clivées (« ce n’est pas en ingénieur que j’ai travaillé, c’est en homme d’État ») dans Le Soulier de satin. Frédéric Calas en propose une typologie et montre comment cette structure répond aux enjeux du drame. Elle constitue, d’abord, un procédé particulièrement efficace dans
le cadre du dialogue dramatique, dont Claudel exploite la force affirmative, « thétique ». Au plan sémantique, elles engagent une vision du réel. Resserrant les éléments porteurs d’une vision du monde, elles les imposent à l’interlocuteur et au spectateur sur le mode de l’évidence partagée : ce sont avant tout les mots de la Création et du catholicisme, en particulier ceux de l’axiologie catholique, qui sont mis en vedette.
C’est également au Soulier de satin que s’est intéressée Christèle Barbier dans son étude de la réception de la langue et du style du drame, centrée sur trois moments : la parution de la Première journée en 1925, la publication en volume en 1929, puis la mise en scène du drame par Jean-Louis Barrault dans la France occupée de 1943. Le Soulier marque un tournant dans la réception de l’œuvre de Claudel. La critique reprend à son sujet les grands poncifs de la disqualification néoclassique : obscurité (« charabia qui frise le pathos », lit-on encore en 1943), emprunts aux langues étrangères, transgressions syntaxiques et « incontinence » des images. Christèle Barbier montre l’interaction entre discours critique et processus créatif : les violentes accusations contre la langue des années vingt ont déterminé les conditions d’écriture du Soulier mais, par la place qu’il leur a faite à l’intérieur du drame, y compris dans leurs prolongements politiques et idéologiques, le dramaturge programme aussi la réception des années 1930-1940, anticipant par exemple la réaction rageuse d’un Thérive en 1930 pour qui Claudel « jette des sarcasmes sur la superstition des œuvres claires et l’esprit de méthode ». Prenant le contre-pied de cette lecture de « pilier du Grammaire-Club », on voit émerger au début des années trente une critique catholique. Avant tout soucieux de la valeur religieuse et humaine de l’œuvre, ces critiques renvoient la question de la langue à des « chicanes grammaticales » dépourvues d’intérêt et réhabilitent l’œuvre claudélienne au nom d’un classicisme « supérieur », non plus d’ordre formel mais spirituel qui prolonge l’approche, elle aussi classicisante et peu soucieuse de la langue, développée dans les trois articles consacrés à Claudel dans la N.R.F. à l’occasion de la parution du drame.
Emmanuelle Kaës