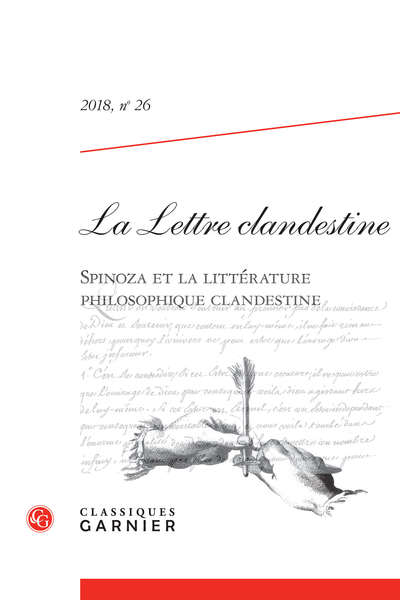
Bulletin bibliographique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Lettre clandestine
2018, n° 26. Spinoza et la littérature philosophique clandestine - Pages : 287 à 332
- Revue : La Lettre clandestine
- Thème CLIL : 3129 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie moderne
- EAN : 9782406080664
- ISBN : 978-2-406-08066-4
- ISSN : 2271-720X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08066-4.p.0287
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/05/2018
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Bulletin bibliographique
Éditions
[Anonyme], Le Prince De Fra Paolo. Édition critique par Romain Borgna, Paris, Champion, coll. « Libre pensée et litterature clandestine », 2017, 220 p.
« Faussement attribué au penseur et théologien vénitien Paolo Sarpi, Le Prince de Fra Paolo [1751] expose et dispense des conseils de pratique politique inspirés par le juridictionalisme et la raison d’État machiavélienne. L’opuscule apocryphe se trouve à la croisée des genres littéraires, entre le miroir aux princes médiéval et le manuel d’éducation du souverain moderne. Il s’adresse sans détour au groupe des Giovani vénitiens du xviie siècle, dont il réaffirme avec vigueur le fonds culturel et idéologique. À une époque où la fabuleuse constitution mixte de la Sérénissime se morfond dans une profonde léthargie politique et institutionnelle, les Giovani prennent la plume et investissent l’espace public. Le Prince de Fra Paolo dispense à ces patriciens révoltés de précieuses et virulentes maximes de philosophie politique, destinées d’une part à défendre un retour aux valeurs fondamentales de la Serrata de 1297 et d’autre part à condamner les perversions et les abus de leur siècle. Ainsi, plus qu’une simple relecture du Prince de Machiavel, il s’agit d’une véritable adaptation de ses concepts fondamentaux aux particularismes vénitiens. »
– Introduction.
– Du manuscrit à l’imprimé : l’histoire d’une diffusion. Aux origines de l’ouvrage (années 1670) [Les premiers manuscrits. L’historien Danaïde. Autour de la paternité de l’ouvrage. Vers l’imprimé ; de la fixation d’un texte à l’affirmation d’une idéologie]. Les premiers imprimés de l’Opinione (1680-1690) [La « fortune éditoriale » des écrits de Paolo Sarpi. Les « falsi Meietti ». De l’évolution du titre à la mutation dans la perception de l’écrit]. De l’Opinione au Prince de Fra Paolo (1690-1751). [L’histoire de la Sérénissime, une curiosité française. Nicolas Amelot de La Houssaye, médiateur entre l’histoire vénitienne et Le Prince de Fra Paolo. Le « pacte de traduction »].
– Pour une historiographie du Prince de Fra Paolo. Repenser l’histoire vénitienne : les premiers intérêts historiographiques au xixe siècle [Repenser l’histoire vénitienne ; les premiers intérêts historiographiques au xixe siècle. 288La République suicidée. Pierre Daru et l’anti-mythe vénitien. Aurelio Angelo Bianchi-Giovini : la stagnation de l’étude. L’Opinione, Le Prince de Fra Paolo : regards croisés sur l’application d’une méthode historique]. Mythe, anti-mythe et « mythe faible » (xxe siècle) [Venise ressuscitée ; pour une étude renouvelée du patriciat vénitien. « Mythe faible » et « clair-obscur ». Autour de Gaetano Cozzi et Claudio Povolo. Venise repensée ; la renaissance historiographique de la forma mentis du patriciat vénitien]. Les derniers renouvellements historiographiques (années 1990-2010) [Pour une relecture de l’Opinione. La somme des valeurs patriciennes. L’image magnifiée de soi du patriciat].
– “Forma mentis” et paradigme identitaire des Giovani. « Confortare et esto robustus ». Le juridictionalisme vénitien à l’œuvre [Aux fondements du juridictionalisme. La « guerre des écritures », ou l’affirmation du juridictionalisme vénitien durant l’affaire de l’Interdit (1606-1607). La critique acerbe de la politique pontificale de Jules II]. « Per fas et nefas » : la tradition machiavélienne et la raison d’État [Aux fondements de la raison d’État. La République intemporelle. Raison d’État, légalisme et constitution mixte à Venise. Droit, envie, facilité. De la raison d’État appliquée à la politique internationale vénitienne]. Le Prince de Fra Paolo, un ouvrage didactique [L’ambivalence du miroir aux princes. L’ambition didactique de l’ouvrage. La transmission de la forma mentis des Giovani patriciens au xviie siècle].
– Conclusion.
[ÉDITION Le Prince De Fra Paolo ou conseils politiques adressés à la noblesse de Venise. Avertissement. Le Prince de Fra Paolo, ou conseils politiques, adressés aux nobles de Venise. Du Gouvernement de la Ville. Du Gouvernement de Terre Ferme. De la manière de traiter avec les Princes (Du Pape. De l’Empereur. De la France. De l’Espagne. Des Princes italiens. Des autres Princes ultramontains. Du Turc).
– Bibliographie. Index des noms propres. Index des noms de lieux. Index des notions.
Argens, Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’, Lettres cabalistiques. Édition établie et présentée par Jacques Marx. Tome premier – Tome troisième, Paris, Champion, coll. « L’Âge des Lumières », 2017, 2 vol. [Tomes 1-3 et 4-7], 1352 p.
« Les Lettres cabalistiques (1737-1738) forment le deuxième volet de la vaste trilogie philosophique conçue par Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens (1703-1771), dans le sillage de Pierre Bayle, sous le titre Correspondance philosophique, historique et critique, publiée en Hollande entre 1736 et 1740. L’ouvrage s’inscrit dans la tradition de la fiction épistolaire orientale, mise au goût du jour par les célèbres Lettres persanes de Montesquieu, et comporte près de six cents lettres en tout, qui furent d’abord publiées selon la formule – presque encore inédite à l’époque – de la diffusion journalistique, répandues deux fois par semaine, avant d’être ensuite rassemblées pour former des éditions séparées, jamais rééditées depuis le xviiie siècle.
289Les Lettres juives (1736-1737) – un des grands succès éditoriaux du siècle des Lumières – qui précèdent les Lettres cabalistiques ; et les Lettres chinoises (1739-1740) qui les suivent, accueillent une série de protagonistes imaginaires engagés dans un commerce épistolaire, auquel leur qualité d’étrangers par rapport aux pays qu’ils visitent confère la capacité de distanciation leur permettant de formuler – souvent sur le mode satirique – des appréciations et des jugements sur les hommes et les institutions civiles ou religieuses.
Mais, par rapport aux deux autres volets de la trilogie, la particularité des Lettres cabalistiques consiste dans l’intervention d’“esprits élémentaires” inspirés des personnages inventés par l’abbé Montfaucon de Villars (1635-1673) dans Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes (1670), aimable fantaisie littéraire démystificatrice et moqueuse, arc-boutée sur le dialogue d’idées. Si l’objectif des Lettres juives et des Lettres chinoises visait la mise en place d’une sorte de “géographie philosophique” confrontant deux Europe ; celle des ténèbres, de la superstition et de l’ignorance – dont le symbole est l’Espagne, vilipendée par tous les protagonistes – et celle des Lumières, représentée par la Hollande, celui des Lettres cabalistiques est de remonter aux sources en évoquant les civilisations et les systèmes de pensée du passé, et de faire succéder l’enquête historique à l’enquête géographique. De là l’activisme frétillant d’épistoliers aux noms pittoresques (Abukibak, Oromasis, Astaroth) – diables, gnomes, sylphes, ondins – capables de se déplacer non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps, par ailleurs gardiens des âmes dans un lieu qui ressemble singulièrement à un purgatoire peuplé, comme dans les Dialogues des morts de Lucien, de quantité de personnalités célèbres, parmi lesquelles un nombre impressionnant de papes et d’ecclésiastiques de tous bords. D’où l’insertion, dans la trame narrative, de dialogues mettant en scène des couples improbables : Jean Guignard – ce jésuite précepteur de Jean Châtel, qui avait frappé Henri IV d’un coup de couteau en décembre 1594 – et le bandit Cartouche ; l’Arétin et le libidineux casuiste Thomas Sanchez ; Pierre Jurieu et Bernard de Clairvaux ; Ignace de Loyola et Luther, Spinoza et le jésuite Juan de Mariana, apologiste du régicide, etc.
Toutefois, au-delà de la mise en scène pittoresque et ironique de toutes les formes d’extravagance théologique ou de déviation spirituelle auxquelles s’attaque d’Argens, en habit de superstitionis destructor, se donne à lire une contestation majeure des défaillances de l’esprit humain, auxquelles n’échappent que les adeptes de la “bonne philosophie” – celle des Locke, Newton et Gassendi – c’est-à-dire les penseurs déistes qui ont su se libérer des entraves imposées à la liberté de pensée.
Au total, l’édition des Lettres cabalistiques permettra au lecteur de mieux comprendre la machine de guerre mise en place par un “journaliste-philosophe”, sceptique confirmé, adepte inconditionnel de la “philosophie du bon sens”, parfois tenté par les “Lumières radicales” ; mais surtout architecte d’un monument d’érudition imposant, appuyé sur un formidable réseau référentiel, dans lequel courent et s’entrecroisent, à tous les niveaux – textes, notes, références, insertion de préfaces et d’avertissements multiples – une 290multitude de filiations formant un système complexe d’échos, de rappels et de redites hérités de la grande tradition du libertinage érudit. »
– Structure de la Présentation : Les Lettres cabalistiques dans la Correspondance philosophique, historique et critique. Éditions des Lettres cabalistiques. Traductions. Les sources des Lettres cabalistiques. Les protagonistes du commerce épistolaire. L’organisation de la matière. Le système référentiel de la Correspondance. L’accueil de la critique. Le contenu des Lettres cabalistiques.
– L’édition est suivie d’une Bibliographie et d’un Index des noms de personnes.
Voir le compte rendu d’Antony McKenna dans le présent volume.
Bayle Pierre, Correspondance, éd. †Élisabeth Labrousse et Antony McKenna, Wiep van Bunge, Edward James, Bruno Roche, Fabienne Vial-Bonacci et Éric Olivier Lochard1, Oxford, The Voltaire Foundation, 1999-2017, 15 vol., cccxcii+8202 p., 192 illustrations
Au moment de l’achèvement de l’édition de la correspondance de Pierre Bayle, nous annonçons la mise en ligne d’un document PDF portant sur l’histoire bibliographique de son Dictionnaire historique et critique : l’ensemble de ses éditions, la structure des pages, les gravures et la table des articles selon la date de leur parution, avec des liens hypertextuels permettant d’accéder directement à l’une ou à l’autre des onze éditions.
Disponible au téléchargement sur le site de l’Université Jean Monnet dédié à la correspondance de Bayle (http://bayle-correspondance.univ-st-etienne.fr/?Dictionnaire-de-Bayle) et sur le portail HAL-SHS (https://hal-ujm.archives-ouvertes.fr/ujm-01531000v1), ce document exceptionnel a été réalisé par les soins de Jean-Michel Noailly, en collaboration avec Emmanuelle Perrin, Fabienne Vial-Bonacci et Antony McKenna.
Dupuis, Charles-François, Abrégé de l’origine de tous les cultes (Édition de 1798), éd. Céline Pauvros, Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », 2017, 423 p.
Cette réédition de l’Abrégé de l’origine de tous les cultes est précédée d’une introduction qui rappelle le contexte savant et politique de l’œuvre. « Le texte est complété par les notes manuscrites ajoutées par l’auteur. Elles sont issues de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France. »
Geulincx, Arnold, Métaphysique. Édition d’Hélène Bah Ostrowiecki, Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », 2017, 223 p.
291« Arnold Geulincx, cartésien flamand, développe un occasionnalisme original qui associe une priorité de l’éthique et la thèse d’une influence minimale de l’homme dans le monde. Sa Métaphysique (1691) présente une conception du sujet centrée sur l’expérience de l’humanité, définie par ses limites. »
Holbach, Paul Henri Dietrich d’, Essai sur l’art de ramper à l’usage des courtisans ; suivi de Remy de Gourmont, Paradoxe sur le citoyen et autres textes, Paris, Berg International, coll. « Dédales », 2017, 50 p.
La Beaumelle, Laurent Angliviel de, Correspondance générale, éd. Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle, t. XIII, août 1759-février 1761, Oxford, Fondation Voltaire, 2017, xxviii + 520 p., 19 ill.
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Dialogues sur la morale et la religion. Introduction, traduction et notes par Paul Rateau, Paris, Vrin, « Bibliothèque des Textes philosophiques », 2017, 176 p.
« Ces dialogues sur la morale et la religion, dont Jean Baruzi n’avait édité qu’une partie sous le titre Trois dialogues mystiques inédits de Leibniz (1905), portent sur la piété ou amour de Dieu sur toutes choses. Cet amour consiste, selon Leibniz (1646-1716), dans la connaissance de la nature et de son divin auteur, ainsi que dans une action orientée vers le bonheur du genre humain. Écrits vers 1679, les dialogues sont un éloge de la raison et une exhortation à l’employer, dans le domaine théorique comme pratique, contre toutes les formes que peut prendre l’antiphilosophie (fidéisme, indifférentisme, scepticisme). La science doit être cultivée car elle est une célébration de Dieu autant qu’une œuvre au service de l’homme. Leibniz la conçoit comme le fruit d’un travail collectif, inlassablement poursuivi, qui suppose une étroite collaboration entre les savants, leur respect commun de certains principes et l’appui des autorités politiques. Le lien essentiel entre progrès scientifique, félicité de l’homme et gloire de Dieu est particulièrement illustré par le Mémoire pour des personnes éclairées et de bonne intention (rédigé entre 1692 et 1695), publié en appendice. »
Seidel, Martin, Origo et fundamenta religionis christianae. Un tratado clandestino del siglo xvii. Edición, traducción y estudio Francisco Socas y Pablo Toribio Pérez, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017, 532 p.
« Ce livre représente la première édition critique du traité clandestin Origo et fundamenta religionis christianae (ca. 1600), basée sur tous les témoins manuscrits et imprimés disponibles. Son auteur, Martin Seidel, apparaît dans l’Allemagne réformée comme le premier critique radical de la religion chrétienne qui, en plus de nier tout caractère surnaturel à l’Ancien Testament, démonte le lien présumé du Nouveau avec les écrits historiques 292et prophétiques de la tradition juive, également réduite à des limites naturalistes. Seidel assume, défend et, autant que possible, élabore une sorte de religiosité minimale de nature déiste. Son œuvre représente l’un des premiers traités libres et critiques de la religion dominante en Europe placée sous le nom d’un auteur un peu connu. »
(nota. Martin Seidel naquit à Olawa, en Pologne, vers 1545. « En 1564, il s’inscrit à l’Université de Heidelberg. Quelques années après son admission, des rumeurs commencent à circuler dans l’Université, visant l’orthodoxie douteuse de ses opinions sur le Nouveau Testament et la religion chrétienne. Aucune indication n’a été trouvée concernant la date de sa mort. »)
Presentación. Introducción. Conspectus siglorum. Origo et fundamenta religionis christianae. Apéndices. Índices. Bibliografía.
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, Complete Works, Correspondence and Posthumous Writings, III, 1 : Correspondence I. Letters 1-100 (December 1683 – February 1700). Edited and annotated by Christine Jackson-Holzberg, Patrick Müller and Friedrich A. Uehlein (avec la collaboration de Wolfram Benda), Stuttgart-Bad Canstatt, Frommann-Holzboog, 2018, 478 p.
« The first volume of the Standard Edition’s correspondence series presents the extant letters from the period December 1683 to February 1700. Numbering one hundred in all, they appear here interspersed with biographical details from various other manuscript sources and are supplemented with six appendices that offer additional material designed, for example, to illuminate the future third Earl’s family background ; the whole is accompanied by explanatory notes.
The picture thus created shows the young Shaftesbury emerging from a childhood that was to some extent overshadowed by the political career and fate of his grandfather, rapidly assuming responsibility for his immediate family and the management of the estate he was to inherit, as well as seeking to take the place in local and national politics his background and early personal sense of public duty demanded of him. Alongside all that, he can be seen pursuing from the mid-1680s, as often as possible, a rigorous course of intensive study—the reading, observing, reflecting, and discussing (frequently encouraged by John Locke and stimulated by his own growing awareness of the differences in their thinking) that developed gradually and consistently into the ideas he would begin to publish in the late 1690s. Many of the letters allow us to trace, moreover, Shaftesbury’s ties to Holland—his personal acquaintance, for example, with Pierre Bayle and Benjamin Furly—also his keen interest in the situation of Huguenot exiles. »
Voir https://www.frommann-holzboog.de/autoren/shaftesbury_anthony_ashley_cooper?lang=en-gb
293Vénus et Priape. Anthologie de poésie érotique néo-latine du Quattrocento. Édité et traduit par Charles Sénard, Genève, Droz, coll. « Texte courant », 2017, CIV-248 p.
Les grands poètes néo-latins de l’Italie du Quattrocento ont consacré une part importante et méconnue de leur œuvre à célébrer les plaisirs de la chair ; cette anthologie en rassemble et en traduit les plus belles réussites. Voilant leur audace par le recours à une langue élitiste et revendiquant l’imitation de prestigieux modèles antiques, ces poèmes contredisaient les discours théologiques, médicaux et philosophiques du temps. Le corpus érotique ainsi constitué est parcouru par deux veines d’inspiration divergente : l’une, sensuelle, imite principalement les élégiaques : Tibulle, Properce et surtout Ovide ; l’autre, crue et provoquante, s’inscrit dans la lignée d’un Catulle ou d’un Martial. Oscillant entre littérarité (par cette appartenance à une tradition poétique) et littéralité (en stimulant l’imagination de leurs lecteurs), ces textes étonnants, qui font entendre un « mâle » discours sur les femmes et la sexualité, sont susceptibles d’initier un large public aux charmes de la littérature (néo-)latine.
[I] Introduction.
– La sexualité et sa représentation dans l’Italie du Quattrocento (Un discours littéraire sur la sexualité confronté à des discours théologiques, philosophiques et médicaux antagonistes. Un discours littéraire profane favorable à la sexualité. La procréation comme fonction principale dans le discours théologique. Le discours philosophique sur la sexualité : entre condamnation et éloge « épicurien ». Le discours médical sur la sexualité : de la santé comme fonction principale à l’affirmation progressive d’un « droit au plaisir ». Vers une certaine libéralisation des mœurs au Quattrocento).
– Les représentations de la sexualité dans la poésie néo-latine (Gravures pornographiques et peintures érotiques). Audaces latines, pudeurs vernaculaires. Vénus et Priape : sensualité et crudité dans la poésie néo-latine. Les enjeux de la représentation de la sexualité : entre littérarité et littéralité. Un mâle regard sur la femme et la sexualité.
[II]. Anthologie de poésie érotique néo-latine du Quattrocento. Antonius Panhormita. Aeneas Sylvius Piccolominus. Pacificus Maximus. Titus Vespasianus Strozzius. Cristophorus Landinus. Ioannis Iovianus Pontanus. Ianus Pannonius. Alexander Braccius. Michael Marullus. Angelus Politianus. Actius Sincerus Sannazarus.
– Bibliographie indicative. Index.
294Études critiques
Addante, Luca, « Du radicalisme religieux au déisme. Notes sur un lien oublié par la recherche historique », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 31-44.
« Partant du débat historiographique sur les relations entre la dissidence religieuse radicale du xvie siècle, le libertinage et le déisme, l’article vise à proposer une nouvelle interprétation, différente de la lecture traditionnelle. Les modèles interprétatifs dominants, anciens ou actuels, nient toute relation entre libertins, déistes et dissidence religieuse. En se basant sur les mouvements les plus radicaux de la Réforme italienne, l’article suggère une continuité conceptuelle (non exempte de transformations) entre les bataille des mouvements religieux radicaux et certaines des idées libertines et déistes les plus poussées. Il montre enfin comment les “hérétiques italiens du Cinquecento” eurent un rôle crucial dans la généalogie de la culture moderne occidentale. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Albert, Jean-Pierre, « À propos de l’incroyance (xiiie-xvie siècle) », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 15-30.
« Cette contribution explore, à partir de l’exemple du christianisme médiéval, la possibilité de différentes formes de critique de la religion (de l’athéisme à l’irréligion et à l’anticléricalisme) en soulignant – dans une libre référence à l’anthropologie cognitive – la vulnérabilité des idées religieuses : des critiques fondées sur le sens commun ou des modes de pensée du soupçon sont peut-être toujours opposables à l’invraisemblance de certaines vérités de foi, dont la crédibilité a pour principal support l’autorité de l’Église. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Ansaldi, Saverio, Les Liens de la métamorphose. Philosophie et Magie de la Renaissance à l’âge classique, Paris, Kimé, Kimé, Coll. « Philosophie, épistémologie », 2017, 122 p.
« Cet ouvrage interroge le sens de la relation entre le lien magique et la métamorphose en essayant de dégager des perspectives philosophiques et politiques spécifiques à la Renaissance et à l’âge classique. La pensée de Giordano Bruno demeure dans cette optique une référence essentielle. Le philosophe nolain n’a de cesse de réfléchir sur le sens de cette relation, puisque c’est à travers elle 295qu’il construit aussi bien l’art de la mémoire que la pratique magique comme art du lien. Des thèmes comme celui de la fureur héroïque, de la différence entre l’homme et l’animal, de l’action magique ne sont compréhensible qu’à partir de la relation constitutive entre le lien et la métamorphose. C’est par conséquent en étudiant les “liens de la métamorphose” que l’on peut faire apparaître la constitution d’un spectre de savoirs (magie, philosophie, politique) traversant l’histoire européenne de la Renaissance et de l’âge classique. Cela permet également d’insister sur le rapport que ces savoirs entretiennent avec les pratiques sociales. La philosophie et la magie, loin d’apparaître comme des savoirs abstraits et purement nominaux, s’affirment en réalité comme des discours performatifs légitimant la constitution des liens civils et sociaux. »
Artigas-Menant, Geneviève, article « Manuscrits philosophiques clandestins », dans Didier Masseau (dir.), Dictionnaire des Anti-Lumières et des Anti-Philosophes (France 1715-1815), Paris, Honoré Champion, 2017, t. II, p. 1040-1047.
Artigas-Menant, Geneviève (dir.), Inventaire des manuscrits philosophiques clandestins de la Bibliothèque Mazarine, sur http://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/impc
Baldin, Gregorio, Hobbes e Galileo. Metodo, materia e scienza del moto, Firenze, Olschki, coll. « Biblioteca di “Galilaeana” », 2017, XXIV-244 p.
« Cette étude analyse l’influence profonde de Galilée sur la philosophie de Hobbes, ainsi que l’importante médiation de Mersenne à cet égard. L’auteur met en évidence les nombreux aspects du “galileisme” hobbesien : méthodologiques, épistémologiques, mais aussi les similitudes conceptuelles et lexicales dans le champs de la physique, pour arriver à une comparaison des deux auteurs au sujet de la structure de la matière, d’où émerge une même conception mécaniste de l’univers. »
Barthas, Jérémie, « Une canaille et des libertins. Toscane, années 1520 », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 45-76.
« Reprenant le dossier de sémantique historique sur le mot libertin, Jérémie Barthas étudie la genèse de l’attitude des groupes d’intellectuels et révolutionnaires qui, dans les années 1520 en Toscane, s’appelèrent eux-mêmes “libertins” parce qu’ils combattaient pour la liberté. Il fait apparaître le rôle de l’expérience démocratique du Grand Conseil (1494-1512) et de Machiavel, qui en fut le principal théoricien. Enfin, des écrits de Pier Filippo Pandolfini (1499-1534), une des figures les plus notables du mouvement libertin entre 2961527 et 1530, il dégage les “principes du gouvernement libertin” ». (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Benítez, Miguel, Chronologie et critique biblique à l’époque des Lumières : les travaux de Pierre Michel, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2017, 536 p.
« Pierre Michel (1703-1755) est l’un de ces esprits mutins qui ont tant œuvré aux temps modernes pour répandre les Lumières. Historien et chronologiste connu dans les milieux érudits, il publie en 1733 la première partie d’un Système chronologique sur les trois Textes de la Bible, avec l’Histoire des anciennes Monarchies, expliquée et rétablie. Il propose dans cet ouvrage une nouvelle chronologie biblique établie par amalgame des textes hébreu, grec et samaritain, tous trois également fautifs. Il y enseigne aussi que les livres de Moïse s’inspirent des écrits des anciens Chaldéens ; par suite, le Dieu biblique n’aurait fait qu’arranger une matière existant de toute éternité et Adam serait en réalité le premier des rois de la dynastie chaldéenne. Les jésuites ont dénoncé ces écarts dans les Mémoires de Trévoux, ce qui a empêché l’impression de la seconde partie de l’ouvrage. Michel n’a plus rien publié, et pour cause, les écrits qui nous restent de lui sentant le libertinage. En effet, une longue Dissertation sur les 70 semaines de Daniel nie que le prophète annonce la mort du Messie des chrétiens : il raconterait plutôt les événements arrivés sous le règne d’Antiochos Épiphane, au temps de la révolte des Maccabées. Il enlève par là à l’apologétique chrétienne l’une de ses armes les plus puissantes dans la dispute avec la critique juive. Une seconde Dissertation où l’on prouve contre le P. de Colonia, jesuite, que l’on ne peut par le temoignage des auteurs payens etablir la divinité de J.C. et la verité de sa religion se penche sur le témoignage des païens, grecs ou romains et chinois, pour mettre en cause la signification de l’éclipse prétendument survenue au moment de la Passion. »
– [Introduction :] Deux écrits attribués à Pierre Michel, dit Michel de Toul.
– Système chronologique sur les trois textes de la Bible, avec l’histoire des anciennes monarchies, expliquée et rétablie. Une tentative originale de conciliation de l’histoire sacrée et de l’histoire profane (Un texte Composite ? La chronologie des Juifs, « Cet embarras immense ». Une nouvelle approche de l’histoire des anciennes monarchies). La réception du Système chronologique sur les trois textes de la bible (Les milieux savants : un accueil d’abord respectueux ; polémique avec les jésuites ; l’accusation de plagiat ; « un silence de plomb ». La Littérature clandestine).
– Dissertation sur les Soixante-dix semaines de Daniel. L’état matériel du texte, sa restitution et sa datation. Édition du texte. [Commentaire :] Un point d’histoire, non pas un dogme de foi.
– Dissertation où l’on prouve contre le P. de Colonia, jesuite, que l’on ne peut par le temoignage
297des auteurs payens etablir la divinite de J.C. et la verité de sa religion. L’état matériel du texte, pratiquement achevé et tardif. Édition du texte. [Commentaire :] L’inanité d’une apologétique à l’encontre des libertins : un nouveau genre de démonstration de la vérité de la religion ; la Dissertation de Pierre Michel contre le P. de Colonia.
– Conclusions : Michel est-il un libertin ?
– Bibliographie des ouvrages cités. Index analytique des matières. Index des noms.
Biagioni, Mario, The radical Reformation and the making of modern Europe : a lasting heritage, Leiden et Boston, Brill, 2017, XI-180 p.
L’auteur présente un récit des vies et des pensées de quatre réformateurs radicaux du xvie siècle (Bernardino Ochino, Francesco Pucci, Fausto Sozzini et Christian Francken) et montre que la « Réforme radicale » ne représenta pas simplement un épiphénomène hérétique de la Magisterial Reformation, mais un formidable laboratoire d’idées qui a joué un rôle central dans l’avénement de l’Europe moderne : elle influenca le processus intellectuel menant à la révolution culturelle des Lumières. « Laïcité, tolérance et rationalisme, ces trois principes fondamentaux de la civilisation occidentale, s’inscrivent dans son héritage culturel. »
– Foreword
– I. A broader vision of the Radical Reformation. Some historiographical remarks. 1. Bainton, Cantimori and “Eretici italiani del Cinquecento”. 2. The Radical Reformation in the historiography of the second half of twentieth century. 3. A broader vision of the Radical Reformation.
– II. Travellers of utopia : the other Europe of the Italian exiles religionis causa. 1. Travellers of Utopia. 2. Parallel escapes : Pietro Martire Vermigli and Bernardino Ochino. 3. The hard choice of Fausto Sozzini. 4. Francesco Pucci and the realistic utopia.
– III. Toleration and Adam’s immortality : a particular example of the relationship between Locke and the Socininians. 1. Immortality of Adam and wideness of the kingdom of God in Locke’s writings. 2. Adam, Locke and the Socinians. 3. The debate between Fausto Sozzini and Francesco Pucci on the Adam’s immortality. 4. The issue of Adam’s immortality in the Socinian thought after Fausto Sozzini. 5. Immortality of Adam, salvation of mankind and toleration : what relationship ?
– IV. Infinite mercy and infinite universe : Francesco Pucci and Giordano Bruno. 1. The infinite amplitude of the kingdom of God. 2. Erasmian affinities : Francesco Pucci and Giordano Bruno. 3. A lasting heritage : a brief history of the Puccianism in the seventeenth century.
– V. Christian Francken sceptical : the origins of the sixteenth-century scepticism. 1. The descent of Christian Francken in immensum. 2. Christian Francken and the criterion of truth. 3. Christian Francken and the Dispute between a philosopher 298and a theologian on the uncertainty of Christian religion. 4. Christian Francken and the sixteenth-century origins of the treatise De tribus impostoribus.
– VI. Conclusions. 1. The Radical Reformation and the Making of Modern Europe. 2. Secularism 3. Toleration and rationalism. 4. The break of Modernity.
– Bibliography.
Bianchi, Lorenzo, Gengoux, Nicole et Paganini, Gianni, Philosophie et libre pensée / Philosophy and Free Thought, xviie et xviiie siècles, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre Pensée et Littérature Clandestine », 2017, 582 p.
« À l’origine de ce recueil, un double colloque international, l’un à Lyon, l’autre à Naples, a réuni des spécialistes de philosophes du xviie siècle et du xviiie siècle pour traiter de l’apport des courants dits “libertins” et, plus largement, de la libre pensée à ceux qu’une historiographie traditionnelle, mais encore vivace, reconnaît comme seuls “philosophes” : Hobbes, Descartes, Spinoza, Pascal, Bayle, Leibniz, Kant… Il s’agit donc, d’une part, de reconnaître l’apport de la libre pensée à l’évolution des idées et, d’autre part, de mettre les grands penseurs en dialogue avec le contexte historique qui fut le leur. L’ensemble des interventions met remarquablement en évidence l’importance des arguments de la pensée critique et de la libre pensée à l’âge classique, qu’ils soient acceptés, refusés ou réutilisés, tout en montrant la complexité d’une époque où, malgré la censure régnante, les idées progressent à travers et grâce à un dialogue constant, qu’il soit paisible ou conflictuel, entre les penseurs plus ou moins religieux. »
– Présentation par Lorenzo Bianchi, Nicole Gengoux, Gianni Paganini.
– Jean-Pierre Cavaillé : « Qu’est-ce qu’un “philosophe libertin” au xviie siècle ? » ; Winfried Schröder : « Alogos pistis. Early Modern Free-Thinkers and the Heritage of the Late Antique Critics of Christianity » ; Germana Ernst : « Effigies miranda viri mirabilis. La rencontre entre Campanella et Naudé : entre attraction et déception » ; Anna Lisa Schino : « Les libertins et la médecine. Peut-on échapper à la mort ou la retarder ? Les réflexions de Gabriel Naudé dans la Quaestio de Fato » ; Claudio Buccolini : « Mersenne et les libertins. Du libertinage à l’athéisme mathématisant » ; Denis Kambouchner : « Descartes et les libertins : peut-on parler d’une incroyance cartésienne ? » ; Emanuela Scribano : « Les animaux et les horloges. Descartes contre les “esprits faibles” » ; Nicole Gengoux : « Le Theophrastus redivivus et le libertinage ; une hypothèse à partir des Dialogues faits à l’imitation des Anciens de François de La Mothe Le Vayer » ; Cecilia Muratori : « Food for “Free Thought” : Diet and Libertinism in Theophrastus redivivus and its Sources » ; Hélène Bah Ostrowiecki : « Pascal et le Theophrastus redivivus : la philosophie et l’autorité » ; Antony McKenna : « La cohérence de l’argument apologétique que Pascal adresse au libertin » ; Gianni Paganini : « Hobbes, les “semences naturelles” de la religion et le discours libertin » ; Anne Staquet : « Comparaison entre Hobbes et Montaigne sur les conceptions religieuses » ; Hubert Bost : « Bayle ou la rétorsion du 299libertinage » ; Jean-Michel Gros : « Bayle et les libertins » ; Oreste Trabucco : « Aristotélisme et libertinisme : le cas de Fortunio Liceti » ; Mogens Lærke : « Pigros semper festinare. Leibniz, les libertins et la raison paresseuse » ; Maria Susana Seguin : « Fontenelle, au tournant des xviie et xviiie siècles » ; Bertram Eugene Schwarzbach : « Répéter une assertion n’est pas la démontrer (Richard Popkin sur les origines des Lumières) » ; Wolfgang Rother : « Epicureanism, Scepticism and Atheism in Jacob Brucker’s Philosophical Historiography » ; John Christian Laursen : « Christian Thomasius as Lawyer for the Atheists : Defending the Autor of The History of the Sevarambians » ; Pierre Girard : « Libertins et libertas philosophandi à Naples à l’âge classique » ; Maurizio Torrini : « Le Lettere sugli atei di Magalotti. Apologia o libertinismo ? » ; Roberto Osculati : « Gottfried Arnold e la “cosiddetta cristianità” del xvii secolo » ; Lorenzo Bianchi : « Montesquieu et les libertins » ; John Christian Laursen : « From Libertine Idea to Widely Accepted : the Human Right to Sexual Satisfaction. A Research Program for the Study of the Idea from Carl Friedrich Bahrdt to the Present » ; Ann Thomson : « Second Thoughts on Free Thought » ; James Vigus : « The “Owlet Atheism” in the 1790s : An Essay on Samuel Taylor Coleridge and Henry Crabb Robinson » ; Paolo Quintili : « Kundera et Diderot. Échos des Lumières et du libertinisme dans le roman contemporain » ; Pierre-François Moreau : « Kant. La croyance et l’incroyance ».
– Index.
Boros, Gábor, Szalai, Judit, Tóth, Olivér István (dir.), The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy, Budapest, The Dean of the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University, 2017, 293 p.
Ce volume (téléchargeable sur : http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/gabor-boros-judit-szalai-oliver-istvan-toth-eds-the-concept-of-affectivity-in-early-modern-philosophy-2/) rassemble les contributions au Premier Séminaire de Budapest sur la philosophie du début de l’époque moderne (Université Eötvös Loránd, 14-15 octobre 2016). « En composant ce volume, notre but n’était pas de présenter une étude systématique de l’affectivité dans la philosophie moderne. Il était plus modestement de favoriser la collaboration entre les chercheurs travaillant autour de ce sujet dans différents pays et suivant diverses traditions. »
I. Ádám Smrcz : « A Neo-Stoic Theory of Natural and Unnatural Affections ». II. Maximilian Kiener : « The Compulsion to Believe Something : On Affectivity of Indubitable, Clear and Distinct Perceptions in Descartes ». III. Jan Forsman : « Descartes on Will and Suspension of Judgment : Affectivity of the Reason for Doubt ». IV. Hanna Vandenbussche : « Descartes and Pascal on Imagining Love and Imaginary Love ». V. Judit Szalai : « Medicine, Emotion Management and Mind-Body Interaction in the Later Descartes and Early Cartesianism ». VI. Davide Monaco : « A New Account of the Objective-Formal Distinction in Spinoza’s Parallelism Theory ». VII. Filip 300Buyse : « A New Reading of Spinoza’s Letter 32 to Oldenburg : Spinoza and the Agreement between Bodies in the Universe ». VIII. Keith Green : « Spinoza on Reflexive Affects and the Imitation of Affects ». IX. Gábor Boros : « Life as Death in Spinoza ». X. Olivér István Tóth : « Is Spinoza’s Theory of Finite Mind Coherent ? – Death, Affectivity and Epistemology in the Ethics ». XI. Brian Glenney : « Spinoza on Passionate Misperception ». XII. Christopher Davidson : « An Affective Aesthetics in Spinoza and Its Political Implications ». XIII. Zsolt Bagi : « Emancipation of the Body in Spinoza’s Political Philosophy. The Affective Integration ». XIV. Dávid Bartha : « The Human Passions and the Purely Active Will of God : An Introduction to Berkeley’s Theory of Emotion ». XV. Dan O’Brien : « Hume, Sympathy and Belief ». XVI. Hans D. Muller : « Hume on Sympathy, Pity and Impartiality ». XVII. Csaba Olay : « Alienation in Rousseau ».
– Contributors. Index of Names.
Brucker, Nicolas, compte rendu de La Lettre clandestine, no 24, 2016 : Le Traité des trois imposteurs et la littérature philosophique clandestine, dans Dix-huitième siècle, 49, 2017, p. 750-752.
Cavaillé, Jean-Pierre, (dir.), Libertinage, athéisme et incrédulité : Littératures classiques, 2017-1 (no 92) et 2017-2 (no 93), 196 p. et 202 p.
« Ce dossier spécial consacré au libertinage, à l’athéisme et à l’incrédulité est réparti sur deux numéros (no 92 et 93). La cohérence de ces deux livraisons est thématique et théorique. En effet, en s’appuyant sur des outils méthodologiques variés, ce dossier montre combien il est absurde d’imaginer, comme certains historiens ont pu le faire, qu’il a existé et qu’il existe encore des sociétés où l’incroyance en matière religieuse serait impossible. Il permet de cerner précisément les notions polémiques d’“incroyance”, d’“irréligion”, d’“athéisme”, d’“hérésie”, de “déisme”, de “libertinage”, en les confrontant entre elles, en les situant dans leur contexte (du xvie siècle aux Lumières), et en les soumettant à un examen critique. Ainsi, ce numéro permet de passer en revue les concepts clés nécessaires à la compréhension des relations conflictuelles qui unissent les démarches apologétiques et les démarches critiques, plus ou moins radicales et plus ou moins dissimulées, qu’il est convenu de qualifier de “libertines”. »
– Introduction, par Jean-Pierre Cavaillé.
– Apports méthodologiques et renouvellement historiographique. Jean-Pierre Albert : « À propos de l’incroyance (xiiie-xvie siècle) » ; Luca Addante : « Du radicalisme religieux au déisme. Notes sur un lien oublié par la recherche historique » ; Jérémie Barthas : « Une canaille et des libertins. Toscane, années 1520 » ; Stéphane Van Damme : « La mappemonde sceptique : une géographie des “libertins érudits” ».
301– La catégorie en question. Alain Mothu, Hartmut Stenzel, Jean-Pierre Cavaillé, Ettore Lojacono : « Discussion. Faut-il en finir avec les libertins ? » ; Bérengère Parmentier : « Reformuler le christianisme : l’expertise lettrée dans les années 1620. Le cas Jean de Silhon » ; Ioana Manea : « Morale sceptique contre morale païenne ? Le dixième trope sceptique chez le libertin La Mothe Le Vayer » ; Sylvia Giocanti : « Réponse à l’article de Ioana Manea “Morale sceptique contre morale païenne ?” Le dixième trope sceptique chez le libertin La Mothe Le Vayer ».
– Athéisme et irréligion. Jean-Michel Gros (Jean-Michel), « L’athéisme à la croisée des chemins. Dévots et libertins : Pascal et Cyrano, Leibniz et Bayle » ; Sophie Houdard : « Un cas d’athéisme spirituel aux Pays-Bas espagnols : les Dix Lamentations de Jérôme Gratien (1611) » ; Alain Mothu : « Vicissitudes de la “foi du charbonnier” » ; Gianni Paganini : « Le théâtre, le jeu et le jouet. Métaphores de la condition humaine chez les libertins du xviie siècle » ; Anne Staquet : « Comment Hobbes tente de rendre son matérialisme acceptable dans les appendices du Léviathan » ; Nicole Gengoux : « Dans quelle mesure l’athéisme est-il inacceptable pour l’auteur du Theophrastus redivivus et pour Spinoza ? »
– Libertinage et Lumières. Azzurra Mauro : « L’abbé Galiani alias le Chevalier Zanobi : un philosophe qui “ne croit rien en rien sur rien de rien” » ; Didier Foucault : « Des philosophes dans le boudoir ? Apports philosophiques des romans libertins aux combats des Lumières »
Chomety, Philippe et Rosellini, Michèle, (dir.), Traduire Lucrèce. Pour une histoire de la réception française du De rerum natura (xvie-xviiie siècle), Paris, Champion, 2017, 396 p.
« “Combien la religion suscita de malheurs !” Le constat de Lucrèce est terrible. Il le reste. Tout son poème a été et demeure un puissant antidote aux délires de l’obscurantisme. Depuis sa redécouverte à l’aube de la Renaissance, le De rerum natura s’est offert comme objet d’admiration, source de savoirs scientifiques, support de réflexions critiques, mais aussi cible de la censure. Dans ce contexte polémique, traduire le “poète-philosophe” a été un défi pour les hommes de lettres. L’ouvrage que l’on présente ici se propose de saisir les modalités particulières de l’influence du poème de Lucrèce dans l’espace français à travers ses traductions. Conçu dans une perspective expérimentale, il s’articule autour de trois grandes parties : une étude critique globale visant à restituer, à partir d’une documentation de première main, les débats idéologiques qu’ont suscités ces traductions ; des études monographiques mettant en lumière les singularités individuelles dans l’appropriation du poème de Lucrèce ; un dossier anthologique quasi exhaustif permettant d’approcher la traduction comme pratique littéraire spécifique. Son intérêt est d’ouvrir un chapitre inédit de l’histoire culturelle française entre humanisme et esprit des Lumières. »
302I. Traduire Lucrèce à l’Âge classique : un défi impossible ? Le moment de l’appropriation : pourquoi éditer le De rerum natura, comment le lire ? (De quelques principes d’appropriation du De rerum natura. Emprunts et insertions de vers lucrétiens. Fragments de traduction. De nouvelles bases pour traduire Lucrèce). Le Lucrèce subversif des libertins du premier xviie siècle. Le contexte de réhabilitation de l’épicurisme dans la seconde moitié du siècle : un terreau pour l’émergence d’une traduction du de rerum natura ? Les traductions du de rerum natura au tournant du siècle : émancipation des esprits ou mondanisation de lucrèce ? (La traduction en vers de 1677 : hypothèses et interrogations sur l’auteur. Enquête sur une traduction introuvable. Vers une classicisation de « Lucrèce poète » ? Traduire Lucrèce : une expression de la libre pensée). Le lucrèce des Lumières (De Lucrèce à l’Anti-Lucrèce. Une traduction résolument matérialiste. Vers une contre-offensive dévote). Retraduire Lucrèce (Lucrèce, poète morcelé : imitations et (re)traductions par fragments. Le De rerum natura et ses traductions : une « production littéraire » ? La réception française des traductions du De rerum natura en langues étrangères. Lucrèce poète déiste. La figure du traducteur de Lucrèce comme « triste héros » de l’impiété).
II. Pourquoi et comment traduire Lucrèce ? Regards actuels sur une question ancienne.
– Introduction
1) Traduire, transformer, assimiler. Violaine Giacomotto-Charra : « De la physique à la poésie : citations, traductions et réécritures des fragments scientifiques de Lucrèce au xvie siècle » ; Fanny Rouet : « Volonté et plaisir : Montaigne lecteur du clinamen de Lucrèce » ; Nicole Gengoux : « Lucrèce ou “la voix de la nature” dans le Theophrastus redivivus » ; Yves Le Pestipon : « La Fontaine traducteur de Lucrèce ? » ; Jean-Pascal Boulet : « Trois exemples d’imitation de Lucrèce dans la poésie de la période prérévolutionnaire (1770-1789) ».
2) Traduire, dévier, détourner. Florence de Caigny : « Les commentaires de Marolles sur ses traductions de Lucrèce en prose : vers une réception moderne orientée » ; Frédéric Tinguely : « Du clinamen idéologique dans les traductions anciennes de l’“Hymne à Vénus” (xvie-xviiie siècle) » ; Bénédicte Delignon : « Les singularités lexicales du poème : un défi aux traducteurs » ; Philippe Chométy : « Du clinamen au galimatias : l’imitation de Lucrèce d’Antoinette Deshoulières » ; José Kany-Turpin : « L’épreuve du vif par une langue morte : l’entre-deux d’une traduction ».
III. Traduire l’« hymne à vénus » : un défi toujours nouveau (anthologie).
– Introduction. Tableau synoptique des variantes.
– Lucrèce : Prooemium primum ad Venerem. Du Bellay : Ô Vénus, tu maintiens toute espèce en éternel plaisir. Cotin : La nature et l’amour, sans qui rien n’est heureux, sans qui rien n’est aimable. Marolles : La terre ornée d’une infinité de variétés. Marolles : Ô céleste Vénus, mère, source divine. Dehénault : Ô Vénus ! Sans toi rien n’est beau, rien n’aime, et n’est aimable. Des Coutures : Aimable Vénus, c’est à vous seule que la naturedoit sa conduite. Deshoulières : Ces sources intarissables où la nature puise et sa force et ses feux. Panckoucke : Sans vous, la terre ne serait qu’une horrible solitude. Lagrange : Puisque tu es l’unique souveraine de la nature, la 303créatrice des êtres. Masson de Morvilliers : Tout s’anime dans la nature ; un sourire a su la changer ! Le Blanc de Guillet : Déesse bienfaisante, la nature active obéit
à ta voix. Legouvé : Il faut que Mars toujours soit l’amant de Vénus. Baour-Lormian : Le besoin de créer tourmente la nature. Chénier : Ô Vénus ! Je tâche de m’ouvrir le sein de la nature. Delavigne : Tout ressent de Vénus la puissante chaleur. Pongerville : Tout fermente d’amour aux cieux, au sein des eaux ;
– Éléments de bibliographie. Résumés des articles de la deuxième partie. Les auteurs. Index nominum.
Delia, Luigi, compte rendu d’Elisabetta Mastrogiacomo, Libertinage et Lumières. André-François Boureau-Deslandes (1689-1757) (Paris, Champion, 2015) dans Dix-huitième siècle, 49, 2017, p. 772-773.
Della Rocca, Michael, (dir.), The Oxford Handbook of Spinoza, Oxford, Oxford University Press, 712 p.
« Jusqu’à peu, Spinoza a occupé une place relativement faible dans les études philosophiques anglophones, semblant confirmer l’évaluation de Friedrich Heinrich Jacobi qui le disait “un chien mort”. Cependant, une explosion exubérante d’excellentes études sur Spinoza a fini par envahir le champ de philosophie de la première modernité. Cette résurgence est due en grande part au renouveau récent de la métaphysique dans la philosophie contemporaine et à l’appréciation accrue du rôle de Spinoza comme figure hétérodoxe pivot, peut-être centrale, dans le développement de la pensée des Lumières. L’articulation pénétrante de son rationalisme extrême en fait un philosophe exigeant qui propose des défis profonds et visionnaires à toutes les approches philosophiques ultérieures, inévitablement moins radicales. Les vingt-six articles de ce volume […] se saisissent des arguments les plus importants de Spinoza et cherchent aussi à identifier et expliquer les dettes de Spinoza envers la philosophie antérieure, aussi bien que leur sens pour la philosophie contemporaine et pour nous-mêmes. »
Michael Della Rocca : Introduction. Aaron Garrett : « The Virtues of Geometry » ; Kenneth Seeskin : « From Maimonides to Spinoza : Three Versions of an Intellectual Transition » ; Tad M. Schmaltz : « Spinoza and Descartes » ; Yitzhak Y. Melamed : « The Building Blocks of Spinoza’s Metaphysics : Substance, Attributes, and Modes » ; Charlie Huenemann : « But Why Was Spinoza a Necessitarian ? » ; Martin Lin : « The Principle of Sufficient Reason in Spinoza » ; Eric Schliesser : « Spinoza and the Philosophy of Science : Mathematics, Motion, and Being » ; Don Garrett : « Representation, Misrepresentation, and Error in Spinoza’s Philosophy of Mind » ; Ursula Renz : « Finite Subjects in the Ethics : Spinoza on Indexical Knowledge, the First Person, and the Individuality of Human Minds » ; Dominik Perler : « Spinoza on Skepticism » ; John Carriero : « The Highest Good and Perfection in Spinoza » ; Olli Koistinen : « Spinoza on Mind » ; Steven Nadler : « The Intellectual Love of God » ; Lilli Alanen : « The 304Metaphysics of Affects or the Unbearable Reality of Confusion » ; Karolina Hübner : « Spinoza’s Unorthodox Metaphysics of the Will » ; Chantal Jaquet : « Eternity » ; Carlos Fraenkel : « Spinoza’s Philosophy of Religion » ; Michael A. Rosenthal : « Spinoza’s Political Philosophy » ; Mogens Lærke : « Leibniz’s Encounter with Spinoza’s Monism, October 1675 to February 1678 » ; Michael Della Rocca : « Playing with Fire : Hume, Rationalism, and a Little Bit of Spinoza » ; Omri Boehm : « Kant and Spinoza Debating the Third Antinomy » ; Paul Franks : « “Nothing Comes from Nothing” : Judaism, the Orient, and Kabbalah in Hegel’s Reception of Spinoza » ; Yirmiyahu Yovel : « Nietzsche and Spinoza : Enemy-Brothers » ; Michael L. Morgan : « Spinoza’s Afterlife in Judaism and the Task of Modern Jewish Philosophy » ; Samuel Newlands : « Spinoza’s Relevance to Contemporary Metaphysics » ; Rebecca Newberger Goldstein : « Literary Spinoza ».
Del Prete, Antonella et Berns, Thomas, Giordano Bruno. Une philosophie des liens et de la relation, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie politique : généalogies et actualités », 2016, 168 p.
« L’œuvre de Giordano Bruno ne pourrait-elle se comprendre dans son intégralité comme la plus vaste tentative philosophique de penser à partir des relations ? L’anti-aristotélisme de Bruno le pousse en effet à échapper, autant que possible et de manière exceptionnelle, à l’antériorité ontologique de la substance sur la relation via une véritable philosophie du lien, au point que tout étant, du plus infime au plus vaste, ne se comprenne que par ce qui le lie. Un de ses derniers écrits, le traité De vinculis, rédigé peu avant le long procès qui le mènera au bûcher, apparaît d’ailleurs comme une tentative unique d’aborder la réalité, de la manière la plus synthétique mais aussi la plus opératoire, à partir des liens qui la construisent et la font tenir.
L’objet de ce volume est de traiter sur un mode transversal de cette idée de la relation et du lien dans l’œuvre très diverse du philosophe de Nola : dans le domaine de la théologie, de la métaphysique, de l’éthique, de la magie naturelle, de l’anthropologie ou de la géographie, voire, dans un registre resté étrangement implicite mais auquel il était urgent d’offrir une place, de la politique. Seront ainsi abordées sans détour des questions massives, mais renouvelées de fond en comble par Giordano Bruno, comme la puissance, l’ontologie fonctionnelle ou le rapport entre Dieu et l’univers, mais aussi des enjeux plus spécifiques comme la coïncidence des contraires, le désir et l’amour, l’imagination et la fureur poétique, le lien civil, la pratique magique et l’art de la mémoire. Tous ces champs ou ces thèmes sont analysés dans ce volume par quelques-uns des meilleurs spécialistes de l’œuvre du philosophe nolain en étant chaque fois renvoyés à l’idée générale d’une philosophie de la relation qui lui assure ainsi sa cohérence. Il apparaîtra de la sorte que, pour Giordano Bruno, réfléchir le monde à partir des liens qui s’y développent, c’était aussi se donner l’occasion d’être attentif à la fois à ses variations ou sa diversité et à son unité ou sa consistance. »
305Maria Elena Severini a rendu compte de ce livre dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXIX-1, 2017, p. 269-270.
Thomas Berns : « Des Liens : désir, variation et philautie » ; Antonella Del Prete : « La relation entre Dieu et l’univers chez Giordano Bruno » ; Jean-Michel Counet : « Nicolas de Cues, Giordano Bruno et l’ontologie fonctionnelle » ; Sébastien Galland : « Image, lien des liens et coïncidence des contraires : Giordano Bruno et le mundus imaginalis » ; Luca Salza : « Le “vinculum” comme puissance de relations mutuelles » [Accompagné d’une traduction de la lettre de Giordano Bruno à Rodolphe II, parue en préface aux Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos] ; Fabio Raimondi : « Liens et serments : magie et politique dans le Cantus Circaeus de Giordano Bruno » ; Saverio Ansaldi : « Relation civile, fureur et poésie à la Renaissance. Giordano Bruno et Dante » ; Enrico Nuzzo : « Les lieux de l’humain. Caractères des peuples et des sites naturels chez Bruno » ; Eugenio Canone : « Notes pour conclure : penser la relation ». Bibliographie. Biographies.
Del Prete, Antonella et Carbone, Raffaele, (dir.), Chemins du cartésianisme, Paris, Classiques Garnier, 2017, 276 p.
« Cet ouvrage contribue au vaste domaine d’études qu’est l’histoire du cartésianisme. Analysant une pensée qui reste vivante à cause de sa capacité de se réfracter sous des aspects inattendus, il explore des sujets qui se situent à l’intersection de plusieurs champs thématiques : théologie, physique, médecine, etc. » On trouve des résumés des contributions sur https://www.classiques-garnier.com/doi/article-pdf?article=RcnMS02_271
– Introduction par Antonella Del Prete et Raffaele Carbone.
– Antonella Del Prete : « Lire la Bible en cartésien. Lambert van Velthuysen et le mouvement de la Terre » ; Wiep van Bunge : « Balthasar Bekker Revisited » ; Domenico Collacciani et Sophie Roux : « La querelle optique de Bourdin et de Descartes à la lumière des thèses mathématiques soutenues au collège de Clermont » ; Frédéric de Buzon : « La nature des corps chez Descartes et Clauberg. Physique, mathématique et ontologie » ; Delphine Antoine-Mahut : « Qu’est-ce qu’un cartésien peut vraiment connaître de l’âme ? La réponse du docteur Regius » ; Francesco Toto : « La théorie de l’estime de Descartes et Spinoza. Passions de l’âme et Éthique » ; Manuela Sanna : « L’expérience anti-cartésienne de Biagio Garofalo (1677-1762) » ; Andrea Lamberti : « Cartésianisme et critique philosophique dans l’œuvre d’Antonio Genovesi » ; Roberto Mazzola : « La vita longa de Monsieur Descartes » ; Sarah Carvallo : « Les effets rétrospectifs de Stahl sur Descartes. Cartésianisme et anti-cartésianisme en Europe entre 1650 et 1875 » ; Raffaele Carbone : « Le “physique” et le “moral” entre philosophie et médecine. Louis de Lacaze et le dualisme cartésien ».
– Index nominum. Résumés.
306Deniel-Ternant, Myriam, Ecclésiastiques en débauche (1700-1790). Préface de Monique Cottret, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2017, 388 p.
« Au xviiie siècle, grâce aux efforts redoublés de l’Église, le clergé semble davantage moralisé, comme en atteste le topos littéraire du “bon prêtre”. L’étude d’un corpus de sources éclectiques, issues des archives de la Bastille, du parlement et de l’officialité de Paris, révèle la persistance d’un contingent non négligeable de membres déviants. Enjeux d’une surveillance multiforme, les ecclésiastiques contreviennent à l’impératif de chasteté en entretenant des relations ancillaires, sodomites et tarifées, de manière fortuite ou régulière. Outre la mise en lumière de leurs pratiques sexuelles et d’une géographie de la capitale tentatrice, la confrontation des sources souligne l’existence de plusieurs effets de seuils entraînant scandale, saisine de justice et répression. »
– Introduction.
– Ière partie : Surveillances. 1. Au centre de toutes les attentions (Figure de proue de la Réforme tridentine. Chantre des bonnes mœurs. Au regard de ses pairs). 2. Que fait la police ? (Omniscience policière. La ville quadrillée. Le clergé sous surveillance). 3. La « chasse aux abbés » (Des ecclésiastiques aux abois. De multiples acteurs à l’affût. Des empreintes à peine lisibles).
– IIe partie : Déviances. 4. Le profil des coupables (Esquisse de portrait. Qualités et fonctions du clergé incontinent). 5. Des ecclésiastiques de tous horizons (Géographie. Lieux de perdition ecclésiastique. Criminalité réticulaire). 6. Le clerc et la prostituée (La prostitution, une jouissance de l’autre. L’assourdissant silence de la jouissance. « C’est pour mieux te voir, mon enfant ». « Je portais une main tremblante… ». Goûter au fruit défendu. Fréquenter une prostituée pour l’habiter charnellement).
– IIIe partie : Répressions. 7. Transgresser une norme, franchir un seuil (Une inconduite réitérée et protéiforme. L’existence d’un effet de seuil. Le scandale, circonstance aggravante ou condition de la judiciarisation ?). 8. Museler pour circonscrire le scandale (La peine de mort, entre silence éternel et exhibition. Jeter le voile sur le crime. Cacher ce déviant que l’on ne saurait voir. La promesse de l’oubli). 9. Dire et punir pour parfaire (Le tribunal de la confession. L’omniprésence de la parole collective. Vertus d’une pénologie remédiatrice).
– Conclusion.
– Annexes. Prosopographie des ecclésiastiques pris en flagrant délit… La lettre de cachet au secours d’une famille. Dédales de la procédure judiciaire et sentence de l’official de Paris. L’abbé, la fille d’amour et l’inspecteur. À la recherche du jeune homme à corrompre. L’enfance offensée.
– Sources. Bibliographie.
Foucault, Didier, « Des philosophes dans le boudoir ? Apports philosophiques des romans libertins aux combats des Lumières », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 169-184.
307« Longtemps considérés comme des productions mineures, les romans libertins du xviiie siècle ne retiennent l’attention des chercheurs que depuis quelques décennies. Cette réhabilitation littéraire ne s’accompagne pourtant pas d’une réévaluation de leur apport philosophique. En valorisant le libre usage de tous les plaisirs, ils ont grandement contribué à ruiner les préceptes moraux du christianisme et même certains fondements de la religion. La large place accordée aux personnages féminins a conduit des auteurs à se pencher sur la condition des femmes et à développer des idées féministes dépassant de loin celles des philosophes des Lumières plus en vue. Enfin, les romanciers ont vulgarisé bien des thèmes défendus par ces derniers, en touchant un public bien plus large. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
García-Alonso, Marta, (dir.), Les Lumières radicales et le politique. Études critiques sur les travaux de Jonathan Israel, Paris, Honoré Champion, coll. « Les Dix-huitièmes siècles », 2017, 445 p.
« L’œuvre monumentale de Jonathan Israel a suscité l’intérêt des historiens et des philosophes, mais également des experts en sciences politiques. On peut affirmer sans exagérer que ses travaux constituent une lecture incontournable pour tous ceux qui travaillent actuellement sur les Lumières, soit pour étayer ses thèses, soit pour les critiquer, mais toujours dans le cadre du dialogue avec ses propositions. » Cependant « ses thèses politiques ont été quelque peu négligées » par rapport aux « aspects religieux et philosophique » du projet. Or « les institutions démocratiques, les théories républicaines et les révolutions mêmes du xviiie siècle trouvent leurs racines dans cette idéologie radicale » suivant laquelle « le combat contre l’erreur et l’ignorance (va) de pair avec la lutte contre la corruption institutionnelle et politique qui touch(e) particulièrement la religion. » Les textes sont issus en grande partie d’un séminaire qui s’est tenu au Collège d’Espagne à Paris en novembre 2013.
Julie Henry : « L’égalitarisme et la rationalité sont-ils des visées radicales et spinozistes ? » ; Antony McKenna : « La place de Pierre Bayle dans les Lumières radicales » ; Elena Muceni : « Mandeville et les “Lumières radicales”. Le rôle de la Fable des abeilles dans l’élaboration de la conception moderne d’une “morale sociale” et la fondation de l’économie politique » ; Fabrizio Lomonaco : « Jonathan I. Israel lecteur de Vico » ; Benoit Caudoux : « “La philosophie des heureux du siècle”. Philosophie moderne et sociabilité dans la critique de Rousseau » ; Péter Balázs : « Jean-Jacques Rousseau est-il un auteur radical ? » ; Olivier Ferret : « D’une politique de Voltaire à une pensée du politique » ; María José Villaverder : « L’abbé Raynal, philosophe radical, d’après Jonathan Israel » ; Paolo Quintili : « Diderot dans les Lumières radicales, selon J. Israel. De quelle “radicalité” parle-t-on ? » ; John Christian Laursen et Whitney Mannies : « Diderot and Diez : complicating the radical enlightenment » ; Javier Peña : « Lumières radicales et démocratie : quelques remarques » ; Charles Devellennes : « D’Holbach radical : contrat social et éthocratie dans 308la pensée politique du baron » ; Marta García-Alonso : « Modération non sans tentations radicales : le cas Montesquieu Jonathan Israel et Carl Schmitt : révolution philosophique versus contre-révolution théologique » ; Jonathan Israel : « Les “Lumières radicales” comme théorie générale de la modernité démocratique séculière, et ses critiques ».
– Index des noms de personnes.
Gengoux, Nicole, « Dans quelle mesure l’athéisme est-il inacceptable pour l’auteur du Theophrastus redivivus et pour Spinoza ? », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 117-152.
« L’auteur anonyme du Theophrastus redivivus (1659), tout en critiquant radicalement la croyance en Dieu, affirme qu’il faut chasser l’athéisme de la cité. Son athéisme est pourtant pensable : non seulement le mot n’est pas anachronique pour le xviie siècle, comme l’affirment de nombreux commentateurs, mais le traité lui-même fait la généalogie de la croyance tout en exposant un système de pensée cohérent qui se passe de tout dieu. Par-delà les raisons d’ordre moral (l’athée est celui qui se laisse entraîner par ses instincts et transgresse les lois), la question pour l’auteur anonyme est de concilier l’ordre social avec l’absence d’un bien et d’un mal absolus. Dix ans plus tard, le nécessitarisme de Spinoza, en dépit de différences notables (utilisation du terme de Dieu pour désigner la nature), présente des similitudes avec le système du Theophrastus redivivus. Aussi, son même rejet de l’athée, parce qu’il ne contrôlerait pas ses instincts, permet de mieux comprendre celui de l’auteur anonyme : point de stratégie de dissimulation, non plus, chez Spinoza, mais une volonté de se faire comprendre fondée sur une anthropologie nouvelle où pensable se confond avec communicable. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
George, Alexander, The everlasting check : Hume on miracles, Cambridge, Mass., Harvard University press, 2016, XIII-98 p.
Hume’s miracles. Hume’s theorem. Hume and self-undermining. Hume and testimony. Objections to Hume. Too big for a blunder ?
Giglioni, Guido, « Germana Ernst interprete di Girolamo Cardano », Lexicon Philosophicum, vol. 5, 2017, p. 194-198.
Giocanti, Sylvia, « Réponse à l’article de Ioana Manea, “Morale sceptique contre morale païenne ? Le dixième trope sceptique chez le libertin La Mothe Le Vayer” », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 171-182.
309« Est-il envisageable que La Mothe Le Vayer soit un sceptique chrétien, et non un sceptique libertin ? Telle est la thèse soutenue par Ioana Manea. Cet article, à titre de réponse, se propose de montrer que la philosophie de La Mothe Le Vayer est incompatible avec l’entreprise apologétique, en raison des caractéristiques de son argumentation, du statut conféré à la raison, et de la dévalorisation morale de la religion. Il fait aussi état des conditions de la lecture libertine d’une œuvre : la capacité du lecteur à prendre au sérieux l’athéisme comme position et à la considérer comme possible au xviie siècle, même si la prudence interdisait de le proclamer. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Gros, Jean-Michel, « L’athéisme à la croisée des chemins. Dévots et libertins : Pascal et Cyrano, Leibniz et Bayle », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 9-32.
« À travers l’exemple de deux couples comprenant chacun un esprit libertin et un apologiste – Cyrano et Pascal, Bayle et Leibniz –, on a voulu montrer que c’est le plus souvent à travers les contaminations réciproques des positions antagonistes que celles-ci s’exacerbent et que les limites de l’inacceptable sont franchies de part et d’autre. Cyrano et Pascal, sans s’être lus, utilisent les mêmes thèmes : le divertissement, la cironalité universelle, l’immortalité de l’âme, et surtout le pari et le “Dieu caché”. Chacun tire évidemment ces thèmes vers des conclusions diamétralement opposées : le sarcasme libertin oblige Pascal à dramatiser le vieux topos apologétique du pari tout en cherchant à le rationaliser alors que la dérision libertine semble miner par avance cette tentative énergique de convertir l’athée dans un monde où un dieu “sot ou malicieux” joue à “cligne musette”. Leibniz, quant à lui, tente par un discours métaphysique – la Théodicée – de faire barrage aux terribles questions des grands articles sur le mal du Dictionnaire historique et critique de Bayle. Mais il ne comprend pas, quelle que soit la rigueur de son argumentation, que ces articles n’attendent aucune réponse : ils mettent seulement en scène l’inanité de toute tentative de mettre la raison au service d’un discours, celui de la théologie ou de la métaphysique apologétique, qui lui impose comme point de départ un dogme qu’elle ne peut interroger, ce qui va à l’encontre du principe même de tout usage de la rationalité philosophique. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
Houdard, Sophie, « Un cas d’athéisme spirituel aux Pays-Bas espagnols : les Dix Lamentations de Jérôme Gratien (1611) », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 33-50.
« L’athéisme spirituel, tel que le carme Jérôme Gratien de la Mère de Dieu le décrit dans sa cinquième Lamentation, est une attaque de l’orthodoxie thérésienne qu’il incarne à Bruxelles pour la défendre des mouvements spirituels 310 La Lettre clandestine
desquels il est nécessaire de se démarquer, comme les alumbrados, au moment où les condamnations empêchent le développement de toute forme de spiritualité alternative au catholicisme tel que le concile de Trente le définit. Gratien règle ainsi des comptes avec les capucins français qui, sous l’égide de Benoît de Canfield, se recommandent d’une spiritualité abstraite ou essentialiste qui “contamine” l’orthodoxie thérésienne du tout nouveau Carmel français. La bataille entre les diverses spiritualités montre comment l’athéisme est un terme relatif, elle montre aussi comment les tendances mystiques se heurtent à l’orthodoxie de la Contre-Réforme, qui croit reconnaître chez ceux que Gratien nomme de manière péjorative les “perfectistes”, la perfection condamnée chez les béguines et les tenants du Libre Esprit, en particulier la divinisation de l’homme. En faisant des spirituels essentialistes des athées, le carme Jérôme Gratien laisse émerger des conséquences radicales que les capucins ne peuvent ni ne veulent assumer ; ce faisant il permet de voir dans la mystique des tendances anti-institutionnelles fortes et des origines doctrinales hétérodoxes publiquement inacceptables pour les spirituels, au moment où se renforcent la dogmatique et l’intransigeance du catholicisme de la Contre-Réforme. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
Israel, Jonathan, Une révolution des esprits. Les Lumières radicales et les origines intellectuelles de la démocratie moderne. Traduit de l’anglais par Matthieu Dumont. Préface de Jean-Jacques Rosat, Marseille, Agone, 2017, 288 p.
Traduction de A Revolution of the Mind : Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton U.P., 2010. « 1770. Depuis un siècle, deux camps s’affrontent au sein des Lumières. Héritiers de Locke, Leibniz, Montesquieu, les modérés dominent. Sous la houlette du vieux Voltaire, ils s’efforcent de maintenir le corps et l’âme séparés, de concilier raison et religion, de réformer la société en préservant l’aristocratie et la monarchie, et de réserver les lumières aux élites dirigeantes. Face à eux, les radicaux, héritiers de Bayle et Spinoza, n’ont pas de meilleure arme que leurs livres clandestins, massivement diffusés dans toute l’Europe. Sous l’impulsion de Diderot et de d’Holbach, ils placent l’homme au sein d’une nature sans transcendance, opposent la raison à toute autorité religieuse, combattent pour l’abolition des privilèges, pour l’égalité des peuples et des sexes, et inclinent vers une démocratie représentative. 1770 : les radicaux prennent le dessus. S’opère alors, en deux décennies, une révolution des esprits qui va rendre possible dès 1789 la révolution en acte. Ce livre offre un panorama clair et vivant des affrontements entre radicaux et modérés sur la plupart des grandes questions philosophiques, morales, économiques, politiques en ce moment charnière. »
Préface. Introduction. I. La question du progrès. II. Hiérarchie sociale ou démocratie ? III. Égalité ou inégalité. IV. La critique de la guerre et la quête d’une “paix perpétuelle”. V. Deux philosophies morales en conflit. V. Voltaire contre Spinoza. Conclusion. Bibliographie. Notes de référence. Index des noms de personnes.
311Bulletin bibliographique
Keller-Rahbé, Edwige, (dir.), Privilèges de librairie en France et en Europe, xvie-xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études et essais sur la Renaissance », 2017, 539 p.
« À l’intersection de plusieurs disciplines – histoire du livre, histoire du droit, histoire de la littérature et histoire de l’art –, les contributions réunies dans cet ouvrage proposent des chemins de lecture pour aborder les privilèges de librairie, en France et en Europe aux xvie et xviie siècles. »
– Présentation par Edwige Keller-Rahbé.
– Première partie : privilèges de librairie en France. Marthe Paquant : « “Privilège”. Étude lexicologique et lexicographique » ; Laurent Pfister : « Les conditions d’octroi des privilèges d’imprimerie de 1500 à 1630 » ; Marie-Christine Pioffet : « Privilèges factices et autres supercheries éditoriales dans les controverses religieuses au tournant des xvie et xviie siècles » ; Jean-Dominique Mellot : « Périodiques et privilèges dans la France du xviie siècle, entre monopoles et exceptions » ; Alain Riffaud : « Privilèges imprimés dans le théâtre du xviie siècle » ; Jean Leclerc : « Privilèges et vogue du burlesque » ; Éliane Itti : « Les privilèges de librairie de Madame Dacier » ; Henriette Pommier : « Estampes et privilèges sous l’Ancien Régime » ; Daniel Régnier-Roux : « Privilège de librairie et image. Le livre d’architecture aux xvie et xviie siècles » ; Sylvie Deswarte-Rosa : « Privilèges épigraphiques au xvie siècle ».
– Deuxième partie : privilèges de librairie en Europe. Angela Nuovo : « Naissance et système des privilèges à Venise du xve au xvie siècle » ; Jane C. Ginsburg : « Le Vatican, privilèges et proto-propriété littéraire et artistique au xvie siècle » ; María Luisa López-Vidriero Abelló : « Privilèges d’impression en Espagne, xve-xviie siècles » ; Ian Maclean : « Saint Empire romain germanique et Allemagne, les privilèges d’impression du xve au xviie siècle » ; Paul G. Hoftijzer : « Privilèges de librairie dans les anciens Pays-Bas » ; Jean-François Gilmont : « La Genève du xvie siècle et ses privilèges d’impression » ; John Feather : « Angleterre, privilèges d’impression au début de l’époque moderne ».
– Postface par Nicolas Schapira : « Les privilèges et l’espace de la publication imprimée sous l’Ancien Régime ».
– Bibliographie. Index. Résumés/Abstracts.
Kors, Allan Charles, Naturalism and Unbelief in France, 1650-1729, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 328 p.
« L’athéisme constitua le défi le plus fondamental aux certitudes françaises de la première modernité. Les principaux éducateurs, les théologiens et les philosophes l’ont réputé parfaitement absurde, confiants dans l’idée que ni l’existence, ni le cours de la nature ne pouvaient s’expliquer sans recourir à Dieu. L’alternative était un naturalisme intégral. Ce livre démontre que la vision chrétienne savante du monde a toujours contenu “l’athée” naturaliste comme interlocuteur et clin d’œil polémique, et que l’implication et 312l’utilisation pré-modernes de cet athée hypothétique ont constitué des axes majeurs de sa vie intellectuelle. Dans les réflexions et les polémiques d’une culture orthodoxe toujours plus acrimonieuse, le monde savant français du début des temps modernes donna une voix réelle et finalement la vie à cette présence athée. Sans la prise en compte du contexte réel et de la convergence de l’héritage, de l’érudition, des conflits violents et des habitudes polémiques de la culture orthodoxe, la naissance et la diffusion du naturalisme absolu au début de la modernité sont inexplicables. Ce livre donne vie à la culture savante chrétienne, à ses dilemmes et à ses conséquences inattendues. »
Voir le compte rendu de Gianluca Mori dans le présent volume, et celui d’Antony McKenna à paraître dans Dix-huitième siècle.
Introduction. 1. From Nature to God. 2. Reading the Ancients and Reading Spinoza. 3. Reductio ad Naturalismum. 4. The Passion of Malebranche. 5. Creation and Evil. Conclusion. Bibliography. Index.
Kors, Allan Charles, Epicureans and Atheists in France, 1650-1729, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, IX-242 p.
Ouvrage complétant le précédent.
« L’athéisme représenta le défi le plus fondamental aux certitudes françaises de la première modernité. Théologiens et philosophes le réputèrent absurde, confiants dans l’idée que ni l’existence, ni le cours de la nature n’étaient explicables sans recourir à Dieu. La dynamique du monde savant chrétien, cependant, et c’est que ce livre explique, a permis la large diffusion de l’argument épicurien, de telmle sorte qu’à la fin du xviie siècle, l’athéisme acquiert une voix réelle, et la vie. Ce livre examine l’héritage épicurien et explique ce qui constitue véritablement la pensée athée dans la France du début de la modernité, en distinguant cette incrédulité catégorique des autres défis aux croyances orthodoxes. Sans comprendre le contexte actuel et la convergence des héritages, des érudits, des protocoles et des modes polémiques de la culture orthodoxe, la naissance et la propagation de l’athéisme au début de la modernité sont inexplicables. Ce livre donne vie à la fois à la culture savante chrétienne française du début des temps modernes et aux athées qui naquirent de sa vitalité intellectuelle. »
Introduction. 1. Reading Epicurus. 2. The Epicureans. 3. At the boundaries of unbelief. 4. Historians’ atheists, and historical atheists. Conclusion. Bibliography.
Laursen, John Christian et Pham, Kevin Doan, « Empires for Peace : Denis Veiras’s Borrowings from Garcilaso de la Vega », The European Legacy, XXII-4, 2017, p. 427-442
« En écrivant L’Histoire des Sevarambes dans les années 1670, le Huguenot Denis Veiras a beaucoup emprunté à Garcilaso de la Vega, également connu 313comme El Inca, dont les Commentaires royaux des Incas furent publiés en 1609. Les deux ouvrages décrivent l’histoire d’un empire qu’ils justifient par le fait qu’il apporta la paix et l’unité. Alors que celui de Garcilaso se voulait une Histoire, sa sélection de faits reflétait l’objectif d’améliorer le traitement des Incas par les Espagnols. L’histoire de Veiras se prétendait également une Histoire, mais c’était une fiction transparente, qui allait d’ailleurs jusqu’à plagier de nombreux éléments du livre de Garcilaso. Ce que ces deux livres ont au même titre souligné, c’est que les empires pouvaient viser, et se justifier par les avantages qu’ils procuraient à leurs sujets. Tous deux ont raconté des histoires de dirigeants bienveillants et paternalistes qui fondèrent des sociétés presque idéales dans les pays qu’ils conquirent. Et ces sociétés se posent comme les modèles d’un empire de paix et d’unité, davantage qu’elles ne promeuvent simplement la tolérance des différences ou la concorde des partis adverses. L’utopie de Veiras offre ainsi une instructive étude de cas des effets des emprunts interculturels d’idées littéraires et politiques. »
Lavaert, Sonja et Schröder, Winfried, The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment, Leiden-Boston, Brill, 2017,
« Alors que l’impact de Spinoza sur les premières Lumières a toujours retenu l’attention légitime des historiens de la philosophie, plusieurs penseurs néerlandais du xviie siècle qui furent actifs avant la parution du Tractatus theologico-politicus ont été largement négligés : en paticulier le maître de Spinoza, Franciscus van den Enden (Vrye Politijke Stellingen, 1665), Johan et Pieter de la Court (Consideratien van Staet, 1660 ; Politike discoursen, 1662), Lodewijk Meyer (Philosophia S. Scripturae Interpres, 1666), l’auteur anonyme du De Jure Ecclesiasticorum (1665), et Adriaan Koerbagh (Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd, 1668 ; Een Ligt schynende in duystere plaatsen, 1668). Les articles de ce volume se concentrent sur leur philosophie politique aussi bien que sur leur philosophie de la religion, dans le dessein d’évaluer leur contribution au développement des mouvements radicaux (républicanisme / anti-monarchisme, critique de la religion, athéisme) propres aux Lumières. »
Sonja Lavaert et Winfried Schröder : Introduction. Wiep van Bunge : « “Concordia Res Parvae Crescunt” : The Context of Seventeenth-Century Dutch Radicalism » ; Jonathan Israel : « Dutch Golden Age Politics and the Rise of the Radical Enlightenment. An Overview » ; Frank Mertens : « Van den Enden and Religion » ; Henri Krop : « The Philosophia S. Scripturae Interpres between Humanist Scholarship and Cartesian Science. Lodewijk Meyer and the Emancipatory Power of Philology » ; Roberto Bordoli : « The Monopoly of Social Affluence. The Jus circa sacra around Spinoza » ; Sonja Lavaert : « “Lieutenants” of the Commonwealth. A Political Reading of De jure ecclesiasticorum » ; Sascha Salatowsky : « Socinian Headaches. Adriaan Koerbagh and the Antitrinitarians » ; Michiel Wielema : « Abraham van Berkel’s Translations as Contributions to the Dutch Radical Enlightenment » ; Stefano Visentin : 314« Between Machiavelli and Hobbes. The Republican Ideology of Johan and Pieter de la Court ». Index.
Libertinage et philosophie à l’époque classique (xvie-xviiie siècle), no 14, 2017 : La Pensée de Pierre Bayle, dir. Antony McKenna, Pierre-François Moreau et Sébastien Charles, 280 p.
– Antony McKenna et Pierre-François Moreau : Avant-propos.
– Dossier : La Pensée de Pierre Bayle. Introduction par Sébastien Charles.
Anton Matytsin : « The Many Lives of Bayle’s Dictionnaire historique et critique in the Eighteenth Century » ; Elena Muceni : « Mandeville a-t-il traduit le Dictionnaire de Bayle ? Une hypothèse à l’épreuve » ; Marie-Hélène Quéval : « Bayle et Gottsched. L’édition allemande des Pensées diverses sur la comète » ; Gianni Paganini : « Pierre Bayle interprète de l’hétérodoxie juive à l’aube des Lumières » ; Michael W. Hickson : « Bayle on Évidence as a Criterion of Truth » ; Kristen Irwin : « Les implications du scepticisme modéré académique de Bayle pour la connaissance morale » ; Antony McKenna : « Bayle et le scepticisme. Un écran de fumée » ; Todd Ryan : « Pierre Bayle and the Regress Argument in Hume’s Dialogues Concerning Natural Religion » ; Sébastien Charles : « Bayle au siècle des Lumières. Du pyrrhonisme radical au scepticisme mitigé » ; Peter Balázs : « La tolérance. Conviction philosophique ou produit culturel ».
– Varia. Anna Minerbi Belgrado : « Les Doutes sur le système physique des causes occasionnelles de Fontenelle. Un texte à décrypter ? » ; Sébastien Drouin : « L’Histoire critique de la République des Lettres (1712-1718) et l’impossible mécénat »
– Index. Résumés/Abstracts.
McKenna, Antony [Mélanges], Liberté de conscience et arts de penser (xvie-xviiie s.). Publiés par Christelle Bahier-Porte, Pierre-François Moreau et Delphine Reguig, Paris, Champion, 2017, 880 p.
« Par ses travaux sur Port-Royal et le jansénisme, Pierre Bayle et le protestantisme en France et aux Refuges et sur l’expression et la diffusion de la libre pensée en Europe, Antony Mckenna a marqué la connaissance et la compréhension des débats complexes qui jalonnent l’Âge classique et les Lumières. Les études réunies dans ce volume entendent rendre hommage à ces travaux essentiels qui éclairent la constitution de la modernité et de notre identité intellectuelle. »
– Avant-propos, par Christelle Bahier-Porte, Pierre-François Moreau et Delphine Reguig. Bibliographie d’Antony Mckenna.
– Approches méthodologiques. D. Reguig : « L’augustinisme pour l’histoire des idées » ; D. Antoine-Mahut : « L’historien des idées au travail : un corps à corps avec des dieux et des géants » ; P.-F. Moreau : « Libertinage, clandestinité, 315libertinisme » ; M.S. Seguin : « Quelques réflexions sur les auteurs de littérature philosophique clandestine » ; C. Volpilhac-Auger : « Au-delà de l’édition : les œuvres posthumes » ; M. Viallon : « Scoop au fonds Boullier de Roanne ! Ou des enluminures retrouvent leur auteur ».
– Littérature et philosophie (xvie-xviie siècle). A. Mothu : « La farce divine, Lucien, Des Périers et les dieux d’Épicure » ; M. Clément : « Une utopie “con-vi-viale” en temps de guerre : Les Ordonnances generalles d’Amour d’Étienne Pasquier (1564) » ; L. Simonutti : « “citoyens d’une même cité” : autorité et tolérance chez François de La Noue » ; B. Roche : « “dire sous la rose” : hermétisme rosicrucien et dissimulation libertine, deux modalités du secret au tournant des années 1620 » ; J.-Fr. Lattarico : « Le roman d’un libertin. Notes sur les traductions françaises de Ferrante Pallavicino » ; J.-P. Cavaillé : « L’Italie déniaisée dans les Naudeana de Guy Patin » ; M. Rosellini : « Corneille libertin ? Lecture de quatre vers supprimés » ; N. Gengoux : « Et si l’auteur anonyme du Theophrastus redivivus était… un La Mothe le Vayer ? » ; D. Descotes : « L’égalité chez Pascal » ; H. Bah Ostrowiecki : « Continuité de l’inconstance et irruption de la perpétuité : paradoxes de l’histoire chez Pascal » ; C. Borghero : « L’Art de penser, le pyrrhonisme, la connaissance des faits » ; L. Thirouin : « Tabacologie de Dom Juan » ; I. Moreau : « Guillaume Lamy : l’âme du monde en contexte anatomique » ; A. Del Prete : « De la raison et de la foi chez Malebranche » ; W. Van Bunge : « Spinoza’s friendships » ; J. Israel : « Spinozism and the Erotic : Hadrianus Beverland’s Suppressed Writings » ; L. Bove : « Le “droit” à la “décision” chez Spinoza et la question du “sujet” politique » ; C. Secretan : « Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw : une introduction rêvée au siècle de Spinoza » ; P. Girard : « “philosophie atomiste” et libertas philosophandi dans les premières Lumières à Naples » ; M. Sankey : « L’abbé Jean Paulmier, la terre de Gonneville et le “testament politique” d’Hannibal Sehested, Grand Trésorier du Danemark ».
– Autour de Pierre Bayle. S. Brogi : « Aux origines de la tolérance baylienne : réciprocité, conscience et autonomie du politique dans la Critique générale (1682) » ; G. Mori : « Sur deux écrits secrets de Pierre Bayle » ; H. Bost : « Contrainte théologico-politique et droits de l’âme » ; M. Pécharman : « Le Système de philosophie de Bayle : quelle place pour Descartes ? » ; L. Bianchi : « Entre athéisme et tolérance : Mahomet II dans le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle » ; M. Bokobza Kahan : « De la cause des femmes dans Réponse aux questions d’un provincial de Bayle » ; Ch. Albertan : « Un correspondant de Bayle : l’étrange P. Édouard de Vitry (1666-1730) » ; Ch. Bahier-Porte : « Antoine Houdar de Lamotte et Pierre Bayle » ; J. Sgard : « Prévost et le Dictionnaire de Bayle » ; J. Häseler : « Pierre Bayle lu par Frédéric II de Prusse » ; J.-M. Gros : « Bayle entre Moby Dick et Bartleby ».
– Correspondance et réseaux intellectuels. J. Dybikowski : « Anonymous satire and authorial identity : Pierre des maizeaux and the Lettre d’un gentilhomme de la cour de St. Germain » ; S. Drouin : « Pierre de Joncourt et l’orthodoxie coccéienne » ; M.-C. Pitassi : « La révélation chrétienne en question à Genève dans les années 1720 : autour d’une lettre inédite à Jean Le Clerc » ; P.-Y. Beaurepaire : « “Je 316vous prie très instamment de nous trouver un libraire”. Les relations entre les pasteurs huguenots de Prusse et la librairie hollandaise à travers la correspondance de Jacques Pérard et Prosper Marchand (1736-1746) ».
– Libre pensée et littérature clandestine au xviiie siècle. G. Artigas-menant : « Telliamed : nouvelles données » ; G. Paganini : « Les voies du malebranchisme clandestin : Challe, Dumarsais, Terrasson » ; O. Ferret : « Stratégies du clair-obscur dans la diffusion des Lumières : comment, dans la treizième des Lettres philosophiques, Voltaire a “obscurci” Locke » ; H. Duranton : « Haro sur l’évêque de Soissons Jean-Joseph Languet de Gergy livré aux chiens jansénistes » ; W. Schröder : « Le “fidéisme” réduit à l’absurde. Henry Dodwell et son Christianisme non fondé en preuves » ; P. Balázs : « L’Essai sur la faiblesse des esprits-forts de József Teleki et les difficultés de l’apologétique » ; P. Quintili : « Diderot avec Molière. Une affinité élective » ; F. Salaün : « Diderot et la légende des prêtres de Ternate » ; A. Sandrier : « Priestley lecteur du système de la nature ou comment le matérialisme n’est pas soluble dans l’athéisme » ; S. Albertan-Coppola : « Un “sophiste plus subtil” que tous les autres : Bayle vu par l’abbé Bergier ».
– Index des noms.
McKenna, Antony, Pascal et son libertin, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le xviie siècle », 2017, 131 p.
« L’anthropologie pascalienne de la “misère de l’homme sans Dieu” exprime le point de vue d’un incroyant sur le monde et sur sa propre nature. Le profil intellectuel du libertin apparaît entre les lignes de l’argumentation apologétique. »
Avant-propos. Le statut du libertin dans les Pensées de Pascal. La vanité et la misère : fondement de l’anthropologie pascalienne. La grandeur de l’homme. Le sentiment de pascal. L’imagination. Pascal et les sciences du libertin. La poitique : la force et l’imagination. « L’écriture et Le reste ». L’interlocuteur de Pascal. Conclusion : Pascal et l’apologétique de son temps. Bibliographie des ouvrages cités. Index des noms propres.
McKenna, Antony, « Pierre Bayle historien de la philosophie : un sondage », Lexicon Philosophicum, vol. 5, 2017, p. 21-59.
Article téléchargeable sur le site de la revue : http://lexicon.cnr.it/index.php/LP/issue/current/showToc
« La tradition critique réduit la philosophie de Bayle au pyrrhonisme et fait l’économie de toute analyse de son argumentation pour mieux sauter à la conclusion qu’il tient toutes choses pour douteuses. Cet article vise à démontrer que cette lecture traditionnelle de Bayle est erronée : il n’est pas pyrrhonien en histoire et il est rationaliste dans le domaine de la morale. C’est dans le Dictionnaire qu’il fait figure d’historien de la philosophie ancienne et moderne, mais une lecture attentive des articles révèle qu’il n’a pas le souci d’enchaîner 317une histoire cohérente et systématique de la philosophie. Certes, il signale des problématiques sur lesquelles les systèmes philosophiques échouent (définition de l’espace et du temps, par ex.) mais surtout il pointe avec précision les problèmes où la raison ne peut pas s’accorder avec la doctrine chrétienne. C’est dire que le Dictionnaire n’est pas un étalage des incertitudes pyrrhoniennes mais une attaque en règle contre la théologie rationaliste : il cherche ainsi à démontrer que la foi chrétienne est irrémédiablement irrationnelle. »
Manea, Ioana, « Morale sceptique contre morale païenne ? Le dixième trope sceptique chez le libertin La Mothe Le Vayer », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 159-170.
« Il s’agit d’analyser les contradictions entre la morale chrétienne et la morale païenne qui sous-tendent les œuvres de La Mothe Le Vayer et qui participent de la mise en pratique du dixième trope sceptique. En premier lieu, l’article traite des exemples qui illustrent ces contradictions. En deuxième lieu, il démontre que La Mothe Le Vayer ne se sert pas des contradictions irréconciliables entre les deux types de morale pour inciter à des jugements sur leur valeur. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Marquer, Éric et Rateau, Paul, (dir.), Leibniz lecteur critique de Hobbes, Presses de l’Université de Montréal / Vrin, collection « Analytiques », 2017, 300 p.
« L’influence exercée par la lecture de Hobbes sur la pensée de Leibniz est attestée par le témoignage du philosophe allemand lui-même. Il déclare en effet à son aîné : “Je crois avoir lu la plupart de vos œuvres publiées tantôt séparément, tantôt rassemblées, et je prétends en avoir tiré profit comme peu d’autres en notre siècle.” À notre connaissance, Leibniz n’en dira jamais autant d’un autre de ses contemporains. Et rien ne laisse présumer que cette déclaration de 1670, alors qu’il n’a que 24 ans, ne soit pas sincère. Au contraire, les contributions réunies dans ce volume ne font qu’en confirmer la justesse et la validité au-delà des seules années de jeunesse. Elles montrent que Leibniz connaît bien l’œuvre de Hobbes : qu’il l’a méditée très tôt, qu’il l’a fréquentée assidûment, en y trouvant des ressources théoriques fécondes et en y puisant certains concepts. Qu’il y est même revenu, preuve que l’influence ne s’est pas arrêtée au jeune homme, mais que l’intérêt a perduré tout au long de sa carrière intellectuelle. Hobbes est pour Leibniz un auteur incontournable de la modernité et bien qu’il n’ait pas réussi à entrer directement en contact avec lui, il en a fait dans ses textes un interlocuteur majeur, dont il rencontrait forcément les thèses, en traitant de physique, de théorie de la connaissance, de morale, de religion, de droit ou encore – bien sûr – de politique. »
– Présentation.
I. Le statut des vérités et la question du nominalisme. Martin Schneider : « Le nominalisme chez Leibniz et chez Hobbes » ; Christian Leduc : « L’objection 318leibnizienne au conventionnalisme de Hobbes » ; Marine Picon : « Leibniz, Hobbes et les principes des sciences ».
II. La causalité et la question du nécessitarisme. Jean-Pascal Anfray : « Possibilité, causalité et réquisits chez Hobbes et Leibniz » ; Martine Pécharman : « Leibniz critique du nécessitarisme de Hobbes » ; Arnaud Lalanne : « L’étude du rapport pouvoir-vouloir-savoir dans les Réflexions de Leibniz sur la Controverse entre Hobbes et Bramhall » ; Éric Marquer : « Hobbes et Leibniz sur le hasard ».
III. La philosophie naturelle et la question du matérialisme. José Médina : « La lecture leibnizienne du De Corpore de Hobbes » ; Michel Fichant : « Note sur la philosophie du point chez Leibniz et Hobbes » ; François Duchesneau : « Leibniz et la méthode de Hobbes au fondement de la philosophie naturelle » ; Anne-Lise Rey : « Leibniz et le matérialisme de Hobbes ».
IV. Le droit, la politique et l’histoire. Paul Rateau : « Leibniz, Hobbes et le problème de la justice vindicative » ; Mogens Lærke : « Conciliation avec le Léviathan. La correspondance Leibniz-Hobbes » ; Luca Basso : « Leibniz, critique de Hobbes. La politique moderne entre liberté et souveraineté » ; Philippe Crignon : « Deux rationalités politiques de la modernité. Hobbes et Leibniz sur l’État » ; Nicolas Dubos : « Hobbes et Leibniz, philosophes et historiographes. Un portrait croisé ».
– Annexes. Lettre de G.W. Leibniz à T. Hobbes (13/23 Juil. 1670). Lettre de G.W. Leibniz à T. Hobbes (1674).
– Index des noms.
Mauro, Azzura, « L’abbé Galiani alias le chevalier Zanobi : un philosophe qui “ne croit rien en rien sur rien de rien” » Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 155-168.
« L’œuvre intitulée Dialogues sur le commerce des blés (1770) de l’abbé Galiani a fait l’objet de nombreuses analyses d’un point de vue économique, du fait de l’importance des théories d’économie politique qui y sont développées. Cet article propose une lecture différente, visant à étudier la libre pensée de l’auteur. En utilisant le genre du dialogue, et à travers ses person-nages, l’auteur s’affranchit de tout dogmatisme. En adaptant le langage de la philosophie à la culture mondaine des Lumières, Galiani déploie dans cet ouvrage une critique ravageuse mais également plaisante du principe d’autorité, dont le but ultime est de former un bon philosophe. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
Mazauric, Simone, avec la collaboration de Sylvain Matton, Le Physicien nîmois Claude Guiraud (1612-1657) et la vie savante dans le Midi réformé. Avec ses traités inédits « De la lumière » et « Observations sur un fragment de M. Hobbes sur la lumière ». Textes latins édités et traduit par S. Matton, Paris, Honoré Champion, coll. « La vie des Huguenots », 2017, 406 p.
319« Ami de Sorbière, correspondant de Gassendi, familier des Montpelliérains Bonnel et Saporta, lecteur de Basson, proche de Derodon, le savant protestant nîmois Claude Guiraud, dont le souvenir n’a été longtemps conservé que par quelques rares notices biographiques, a pourtant occupé une place centrale, durant les décennies 1640 et 1650, au sein d’un espace savant languedocien très dynamique. Il est l’auteur d’une œuvre demeurée manuscrite et que l’on a pu croire entièrement perdue, jusqu’à la redécouverte récente de deux de ses manuscrits, conservés à la bibliothèque universitaire de Leipzig, ici édités et traduits pour la première fois. Le contenu de ces manuscrits atteste l’étendue de son information savante ainsi que sa volonté d’œuvrer à la construction d’une nouvelle philosophie naturelle, d’inspiration à la fois mécaniste et atomiste. Ils confirment ainsi la faveur qu’a rencontrée l’atomisme parmi les savants protestants languedociens et invitent à poursuivre l’enquête sur la vie savante dans le Midi réformé. »
– Préface de Patrick Cabanel.
– I. « L’homme de Nismes ». Enquête sur les sources ; un savant protestant ; etc.
– II. Un savant et son réseau. Les savants les plus « remarquables ». Guiraud et Gassendi, Descartes, Mersenne, Sorbière, les savants languedociens. À Montpellier : J. Bonnel et Pierre Saporta. À Toulouse : Pierre de Fermat. Le cercle des nîmois (David Derodon ; Jean Bruguier ; aux origines de l’Académie royale de Nîmes ?). Le réseau élargi (Jacques Pujos à La Rochelle, Théodore Deschamps à Bergerac ; présence de Guiraud en Hollande et à Leipzig).
– III. Guiraud savant (1). Ses sources scientifiques. Sa correspondance avec Sorbière. Les manuscrits de Leipzig. L’Optique et la Catoptrique du père Mersenne. Bilan de son œuvre savante et son horizon théorique anti-aristotélicien et atomiste.
– IV. Guiraud savant (2) : l’optique : le De luce, le Traité sur la réflexion de la lumière les objections à Descartes, l’apport de Gassendi et Hobbes ; etc.
– V. Le traité « Sur les cercles qui se décrivent dans l’eau » et autres productions savantes ; atomisme et protestantisme au xviie siècle dans le Midi languedocien ; etc.
– Conclusion.
– Les écrits de Guiraud. Note sur les manuscrits, par Sylvain Matton. De luce / De la lumière ; Observationes in fragmentum quoddam de luce Domini Hobes / Observations sur un fragment de M. Hobbes sur la lumière ; Epistolæ a Guiraudo aut ad eum scriptæ / Correspondance.
– Index des noms.
Mitsushima, Naoko, « La Lettre sur les aveugles de Diderot et la philosophie de La Mothe Le Vayer », dans [Société Japonaise de Langue et Littérature Française], Études de Langue et de Littérature Françaises, no 108, 2016, p. 21-36.
« Rapprocher Diderot et Le Vayer n’est pas nier l’influence des sciences naturelles sur le premier » ; il s’agit de souligner « l’intérêt de prendre en compte d’autres courants de pensée, liée notamment à la tradition du libertinage 320philosophique, pour examinerv l’originalité de Diderot et la position de ses idées dans le milieu intellectuel de son temps » (Conclusion).
Mori, Gianluca, « Descartes incognito : la “préface” des Passions de l’âme », Dix-septième siècle, no 277, 2017-4, p. 685-700.
« La question des deux lettres qui, avec les réponses de Descartes, constituent la “préface” des Passions de l’âme (1649) hante depuis longtemps la critique cartésienne. S’agit-il d’un échange épistolaire réel ou bien d’une petite supercherie du même Descartes, qui en serait donc l’auteur unique ? La présence dans ces lettres de plusieurs doctrines que le philosophe n’avait jamais proposées dans ses écrits publics constitue, avec d’autres indices historiques, un argument décisif pour soutenir qu’elles ne peuvent venir que de lui. »
Mothu, Alain, « Vicissitudes de la “foi du charbonnier” », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 51-68.
« La fameuse “foi du charbonnier” nous renvoie à l’histoire d’un homme qui, interrogé par le Diable sur ce à quoi il croit, lui répond seulement qu’il croit ce que croit l’Église. Cette histoire n’est pas médiévale mais elle naît et s’épanouit au xvie siècle dans le milieu de la Contre-Réforme catholique, au moment où une certaine idée de la foi (fides) comme fidélité coutumière à la foi de ses pères (donc aussi à Rome) est concurrencée et menacée par l’idée protestante d’une foi intérieure vivante. Le charbonnier devient alors, pour un temps, une sorte de héros de l’Église romaine. Toutefois son heure de gloire sera éphémère, car Rome va à son tour entreprendre de “purifier” la foi. Dans ces conditions, de moins en moins d’hommes pourront se sentir vraiment chrétiens, les liens avec le Ciel vont se déliter, l’incrédulité et le “libertinage” pourront prospérer. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
Mothu, Alain, « La satire de la Révélation dans le Cymbalum mundi », Revue de l’Histoire des Religions, no 235, 2017-3, p. 457-483.
« Publié à la fin de 1537 ou au tout début de 1538, le Cymbalum Mundi, petit livre français contenant “quatre dialogues poétiques, fort antiques, joyeux et facétieux”, fut jugé pernicieux, impie et détestable par tous les contemporains, tant catholiques que protestants, et tôt supprimé par les autorités. Dans cet article, il est montré qu’ils ne se trompaient pas : l’auteur, Bonaventure Des Périers, plantait le glaive au cœur de la Révélation chrétienne, en se moquant notamment de la “Bonne Nouvelle” et du Verbe divin. Le Cymbalum représente donc un indéniable témoignage antichrétien, philosophiquement très mûr, du premier xvie siècle et, comme tel, il se pose sûrement comme un document de première importance pour l’histoire religieuse de l’Europe moderne. »
321Mothu, Alain, « La farce divine », dans Liberté de conscience et arts de pensée (voir à McKenna, Mélanges), 2017, p. 123-143.
« Quand on ne peut dire librement quelque chose, on le tait, ou bien on le dit d’une manière détournée et, par exemple, on le montre. C’est ce que fait Des Périers dans son Cymbalum mundi : il met proprement en scène l’absence de Dieu, sous l’allégorie de Jupiter improvident, impuissant, réduit à l’état de simple rumeur ou à n’être qu’un persona de tragi-comédie. En cela, Des Périers réactualise un philosophème épicurien qu’il hérite, en l’occurrence, du Zeus tragédien de Lucien de Samosate – cette pièce éminemment théocide qui était parfaitement adaptable à l’univers judéo-chrétien. »
Mothu, Alain, « L’érotique épicurienne du Cymbalum mundi », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXIX-3, 2017, p. 529-549.
« L’épisode du troisième dialogue du Cymbalum mundi narrant la rencontre de Cupidon avec une “céleste” jeune femme nommée Celia, a pu être regardé par quelques critiques influents comme la clef d’un ouvrage qui serait, sur le fond, mystico- ou platonico-chrétien. Il n’en est rien : Des Périers prend en réalité l’exact contrepied de toute position idéaliste. La “parabole” de Celia et Cupido illustre ce fait, que les sublimations idéalistes dissimulent des démangeaisons toutes matérielles et que “l’amour n’est en rien un don du ciel”, comme le soutenait Épicure. »
Mothu, Alain, « Mercure magicien : une formule pour faire parler les bêtes », Renaissance, Humanisme, Réforme, no 85, 2017-2, p. 137-154.
« Au troisième dialogue du Cymbalum Mundi, Mercure confère la parole à un cheval de trait. Le dieu utilise à cette fin une formule magique dont on a généralement prétendu qu’elle n’avait aucun sens. C’était peut-être négliger la possibilité que l’auteur, outre le grec et le latin, ait recouru ici à la phonétique, au Portugais et même au jargon paysan de l’Est de la France. Au-delà de cette question linguistique, comme Mercure est un masque du Christ dans le Cymbalum Mundi, il est tentant de regarder cet épisode comme une reprise satirique de la vieille accusation faisant de Jésus un magicien, et notamment une parodie du passage de Marc (Mc. VII, 31-37) où celui-ci emploie la mystérieuse formule Hephathah (“Ouvre-toi !”) pour faire parler un sourd-muet. »
Moureau, François, « L’exercice française de la censure du livre au xviiie siècle », Cahiers d’Histoire des Littératures romanes / Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 40-1 (2016), p. 35-45.
Moureau, François, « Robert Challe et Le Militaire philosophe : histoire d’une 322trahison philosophique ? », Revue d’histoire littéraire en France, CXVI, 2016-2, p. 301-313
Moureau, François, « Publier en secret : jeux et plaisirs de la clandestinité. Le Code de la Librairie et la législation française du livre au xviiie siecle », dans F. Gevrey, A. Levrier et B. Teyssandier (dir.), Éthique, poétique et esthétique du secret de l’Ancien Régime à l’époque contemporaine (« La République des Lettres », 59), Leuven-Paris-Bristol, Peeters, 2015, p. 171-185.
Muller, Marc, Relire “L’homme machine” de Julien de la Mettrie, Paris, Nuvis, coll. « Adverso Flumine », 2017, 136 p.
La thèse « courageuse et avant-gardiste », émise en 1748 par le médecin La Mettrie d’un corps réduit à une mécanique biologique et d’un esprit lui-même tout matériel « avait a priori tout pour séduire les penseurs des Lumières, alors en pleine contestation du magistère spirituel et moral de l’Église et relais philosophiques de la révolution empirique et rationnelle du newtonisme. Ce fut pourtant le rejet, la condamnation et l’ostracisme général, de Voltaire aux Encyclopédistes ; et l’auteur dut s’exiler ! Pourquoi une telle attitude ? De quoi les Lumières ont-elles eu peur ? En quoi la thèse de La Mettrie contrevenaient-elles à un non-dit intime de leurs discours ? En rejetant le Dieu judéo-chrétien omniprésent dans le monde d’antan et législateur de la vie des hommes, les Lumières n’avaient-elles pas, en réalité, effectué un transfert de sacralité et de transcendance vers autre chose ? Vers l’Esprit humain, la Raison cartésienne restant ainsi prisonniers du paradigme idéaliste de la métaphysique platonicienne ? […]. »
Muratori, Cecilia et Paganini, Gianni, (dir.), Early Modern philosophers and the Renaissance legacy, Suisse, Springer International Publishing, coll. « International Archives of the History of Ideas Archives internationales d’histoire des idées », 2016, VI-298 p.
Les essais réunis ici « étudient comment l’héritage des philosophes de la Renaissance a persisté dans les siècles suivants » à travers des dialogues inter-générationnels tels que : Girolamo Cardano et Henry More, Thomas Hobbes et Lorenzo Valla, Bernardino Telesio et Francis Bacon, René Descartes et Tommaso. Campanella, Giulio Cesare Vanini et l’anonyme Theophrastus redivivus.
Cecilia Muratori et Gianni Paganini : « Renaissance and Early Modern Philosophy : Mobile Frontiers and Established Outposts » ; Guido Giglioni : « What’s Wrong with Doing History of Renaissance Philosophy ? Rudolph Goclenius and the Canon of Early Modern Philosophy » ; Stephen Clucas : « Italian Renaissance Love Theory and the General Scholar in the Seventeenth 323Century » ; Lodi Nauta : « The Critique of Scholastic Language in Renaissance Humanism and Early Modern Philosophy » ; Sarah Hutton : « Henry More and Girolamo Cardano » ; Silvia Manzo : « From Attractio and Impulsus to Motion of Liberty : Rarefaction and Condensation, Nature and Violence, in Cardano, Francis Bacon, Glisson and Hale » ; Daniel Garber : « Telesio Among the Novatores : Telesio’s Reception in the Seventeenth Century » ; Natacha Fabbri : « Looking at an Earth-Like Moon and Living on a Moon-Like Earth in Renaissance and Early Modern Thought » ; Emmanuel Faye : « Descartes, the Humanists, and the Perfection of the Human Being » ; Emanuela Scribano : « The Return of Campanella : La Forge versus Cureau de la Chambre » ; Cecilia Muratori : « From Animal Happiness to Human Unhappiness : Cardano, Vanini, Theophrastus Redivivus (1659) » ; Annalisa Ceron : « Ethics, Politics, and Friendship in Bacon’s Essays (1625) : Between Past and Future » ; Gianni Paganini : « Thomas Hobbes Against the Aristotelian Account of the Virtues and His Renaissance Source Lorenzo Valla » ; Sara Miglietti : « Debating “Greatness” from Machiavelli to Burton » ; John Christian Laursen : « John Upton from Political Liberty to Critical Liberty : The Moral and Political Implications of Ancient and Renaissance Studies in the Enlightenment » ; Germana Ernst : « A Story in the History of Scholarship : The Rediscovery of Tommaso Campanella ».
Paganini, Gianni, « Le théâtre, le jeu et le jouet. Métaphores de la condition humaine chez les libertins du xviie siècle », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 69-94.
« Il existe une appropriation libertine de la métaphore du “théâtre du monde” et on en trouve des versions différentes chez Naudé et La Mothe Le Vayer. Surtout ce dernier, retravaillant des passages du pseudo-Aristote (De mundo) et de Platon, a développé la métaphore pour dépeindre la condition de l’homme comme une marionnette entre les mains du Premier Moteur, ou comme un jouet du jeu des dieux. À l’arrière-plan, nous trouvons les lectures très différentes, presque opposées, du texte de Platon par deux auteurs de la Renaissance : Marsile Ficin et Pietro Pomponazzi. Finalement, un texte anonyme, clandestin, “radical” comme le Theophrastus redivivus (1659), donne une exégèse athée et politique du ludus pratiqué par les législateurs religieux. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
Paganini, Gianni, Darmon, Jean-Charles, Desan, Philippe, (dir.), Scepticisme et pensée morale, De Michel de Montaigne à Stanley Cavell, Paris, Hermann, 2017, 274 p.
« Les transformations des philosophies hellénistiques constituent, dans l’histoire de la pensée morale entre Renaissance et Lumières, un phénomène d’une fécondité extraordinaire, capital à beaucoup d’égards pour l’étude des “transferts” entre mondes antiques et Europe de la première modernité. Le 324cas du scepticisme offre de ce point de vue un terrain d’investigation de premier ordre. Or les relations entre scepticisme et pensée morale envisagées dans la longue durée et dans la multiplicité de leurs variations, entre philosophie et littérature, n’ont pas été jusqu’ici étudiées avec l’attention qu’elles méritent. La présente enquête collective a pour ambition de remettre en évidence la finalité essentiellement éthique du scepticisme. »
Parmentier, Bérengère, « Reformuler le christianisme : l’expertise lettrée dans les années 1620. Le cas Jean de Silhon », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 147-158.
« En étudiant une lettre de Jean de Silhon parue en 1627 dans le Recueil de Lettres nouvelles dit Recueil Faret, cet article souligne la nécessité d’une actualisation du christianisme dans la France du premier xviie siècle. Il rappelle que l’ensemble des lettrés est appelé à participer, après les guerres “de religion”, à la recomposition des structures de l’ordre dans le royaume, et suggère que l’avènement d’un nouveau modèle d’expertise lettrée est peut-être aussi déterminant que les oppositions fondées sur l’alternative de la croyance et de l’athéisme. Dans cette perspective, la production des lettrés qui gravitent autour de Richelieu manifeste parfois moins une attitude de défense passive contre une persécution virtuelle qu’une intervention active dans la production d’une nouvelle normativité sociale et politique. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Paschoud, Adrien et Pépin, François, (dir.), La Mettrie. Philosophie, science et art d’écrire, Paris, Éditions Matériologiques, 2017, 308 p.
« Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) est une des figures les plus subversives du siècle des Lumières. Célèbre en son temps pour avoir défendu un monisme radical, qui lui valut nombre de critiques et de condamnations officielles, La Mettrie est l’un des premiers penseurs à se revendiquer matérialiste. Mais il fut aussi et d’abord un médecin, un auteur et un traducteur de nombreux ouvrages médicaux et scientifiques. Ses centres d’intérêt comprennent tous les champs environnant la médecine, notamment la physiologie, l’histoire naturelle, la chimie, les politiques publiques. La Mettrie fut encore un écrivain, sans doute sous-estimé, sachant allier attaques ad hominem, ironie et déplacements subtils dans une volonté toujours réaffirmée d’ébranler toutes les formes d’orthodoxie. C’est à ces divers aspects, dont l’articulation n’est pas toujours aisée, que le présent ouvrage s’est intéressé. Il réunit des spécialistes de La Mettrie, de la philosophie du xviiie siècle, de l’histoire des sciences et de la littérature. »
Adrien Paschoud & François Pépin : « La Mettrie, homme de sciences et de lettres » (Introduction) ; Theo Verbeek : « La Mettrie et Boerhaave » ; François Pépin : « La Mettrie et la chimie » ; François Duchesneau : « La Mettrie et les paradigmes de la physiologie » ; Gilles Barroux : « La Mettrie médecin, envers et 325contre tous » ; Gérard Lambert : « La Mettrie, médecin par-delà le miroir et les simulacres » ; Jean-Christophe Bardout : « Malebranche et sa postérité matérialiste. La Mettrie et l’imagination » ; Claire Fauvergue : « La Mettrie et l’idée de “force innée” » ; Julie Henry : « Des formes substantielles à un principe moteur de la matière. Trajectoire d’une philosophie de (la) vie » ; Stefanie Buchenau : « La Mettrie et l’Allemagne : matérialisme et anthropologie » ; Francine Markovits : « Monsieur Machine » ; Timo Kaitaro : « L’homme comme artefact chez La Mettrie et Diderot » ; Caroline Jacot-Grapa : « Extases lamettriennes : note sur la volupté matérialiste » ; Marta de Mendonça : « La connaissance de la nature : rôle et portée de l’analogie chez La Mettrie » ; Adrien Paschoud : « Le Traité du vertige (1737) de La Mettrie : enjeux et aspects du récit de cas ».
Pelckmans, Paul, compte rendu de Mladen Kozul, Les Lumières imaginaires : Holbach et la traduction (Oxford U.P., 2016) dans Dix-huitième siècle, 49, 2017, p. 769-771.
Pellegrin, Marie-Frédérique (dir.), Poulain de la Barre : égalité, modernité, radicalité, Paris, Vrin, « Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie », 978-2-7116-2761-5, 136 p.
Ce recueil collectif consacré au philosophe cartésien féministe François Poulain de la Barre (1647-1723), résulte d’un colloque organisé par l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (IHPC) en octobre 2012. Il « permet d’éclairer les principaux aspects de sa pensée. Celle-ci est centrée sur la question de l’égalité des sexes mais concerne également l’épistémologie, le droit, l’usage des livres dans la formation de soi et la linguistique. Elle initie une nouvelle approche philosophique des rapports entre hommes et femmes qui irrigue les Lumières en Angleterre et ailleurs, en posant la question de l’égalité d’une manière radicale et toujours d’actualité. »
Introduction de M-F. Pellegrin ; Postface de T. Hoquet. Contributions de D.M. Clarke, G. Conti Odorisio, G. Fraisse, G. Leduc, M. Malinowska, M. Rosellini et S. Stuurman.
Revue Voltaire, no 17, 2017 : L’affaire La Barre, 363 p.
« Dans le prolongement du triste anniversaire de la mort du chevalier de La Barre (1766), ce numéro est très largement consacré aux circonstances qui ont conduit à l’accusation de blasphème retenue contre le jeune homme de dix-neuf ans et ses acolytes du même âge, et au procès qui le condamne à mort après avoir subi la torture. Les études analysent les opuscules écrits par Voltaire en marge de la procédure engagée contre les accusés, la place qu’occupe cette affaire dans son œuvre et sa correspondance, ainsi que ses répercussions sur l’imagerie du “patriarche” de Ferney. Elles examinent le questionnement sur le judiciaire, le 326religieux et le politique que suscite cette résurgence, à la suite des affaires Calas et Sirven, de ce que Voltaire considère comme une barbarie et s’attachent en particulier à apprécier le sens et la portée de l’engagement voltairien.
Dans la section des “Inédits et documents”, d’une ampleur exceptionnelle cette année, il est encore question de l’affaire La Barre à partir de la publication d’éléments, certains d’entre eux inédits, du dossier manuscrit conservé dans les fonds de la Bibliothèque nationale de Russie : un résumé de la procédure, de nombreuses lettres sur les principaux acteurs de l’affaire.
Illustre encore les richesses de la bibliothèque de Voltaire une étude qui examine “l’exemplaire maître” sur lequel Voltaire a consigné des annotations sur ses propres œuvres dans la seconde moitié des années 1760. Comme dans les numéros précédents, la section comporte aussi l’édition de lettres inédites de, à ou relatives à Voltaire. »
Ronzeaud, Pierre, « Voyager dans les récits de voyage imaginaires du xviie siècle », dans Sylvie Requemora-Gros (dir.), Voyages, rencontres, échanges au xviie siècle. Marseille carrefour. Actes du 43e Colloque de la North American Society for Seventeenth-Century French Literature [5-8 juin 2013], Tübingen, Narr / Francke / Attempto Verlag, 2017, p. 17-38 (Biblio 17, vol. 211).
Rovère, Maxime, Le Clan Spinoza. Amsterdam, 1677. L’invention de la liberté, Paris, Flammarion, 2017, 560 p.
L’ouvrage « mobilise toutes les ressources du roman pour faire renaître le monde dans lequel a vécu Bento de Spinoza, entre Amsterdam et La Haye, dans cette Europe du xviie siècle qui a vu l’avènement de la Raison Moderne. Il célèbre les aventures de ceux qui partirent à la conquête de la liberté, hommes et femmes oubliés par l’Histoire et pourtant hauts en couleur. Parmi eux, Saül Levi Morteira, grand rabbin de la communauté juive d’Amsterdam ; Adriaen Koerbagh, encyclopédiste en avance d’un siècle sur son temps ; Franciscus Van den Enden, activiste farouchement opposé à Louis xiv ; Sténon, anatomiste de génie ». Ce livre dessine en somme « la figure inédite d’un Spinoza “en réseau” ».
Seoane, Julio, « Filosofar desde la rabia. Una introducción a la filosofía radical de Jean Meslier », Ingenium. Revista Electrónica de Pensamiento Moderno y Metodología en Historia de la Ideas, 11, 2017, p. 193-209.
Voir http://revistas.ucm.es/index.php/INGE/article/view/58309
Lecture en clef moderne de l’œuvre de Meslier : comment la douleur, la haine et la colère forgent-elles son travail ? Quels mots employer, hier et aujourd’hui, contre l’injustice et l’inégalité ?
327Staquet, Anne, « Comment Hobbes tente de rendre son matérialisme acceptable dans les appendices du Léviathan », Littératures classiques, no 93, 2017-2 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2), p. 95-116.
« Le Léviathan de Hobbes (1651) a subi de nombreuses attaques, au point qu’il est jugé responsable de la grande peste de 1665 et de l’incendie de Londres l’année suivante, et que le parlement ouvre une procédure contre l’ouvrage. Aussi, lorsqu’en 1666 Thomas Hobbes veut publier la traduction latine de ce livre, il y adjoint trois appendices. La version latine de l’œuvre est généralement jugée plus acceptable que le texte original anglais. En étudiant la manière dont Hobbes traite de son matérialisme dans ces appendices, je tente de montrer que les addenda latins ne constituent en aucune manière un retour en arrière du texte, mais que le philosophe enrobe simplement davantage des propos que, par ailleurs, il rend plus radicaux. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-2.htm)
Suitner, Riccarda, Die philosophischen Totengespräche der Frühauf klärung, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2016, 276 p.
Ce livre reconstitue l’histoire d’un ensemble de « dialogues des morts » publiés à bon marché anonymement ou sous pseudonyme en Allemagne entre 1729 et 1734, et actuellement dispersés dans les bibliothèques allemandes. Les protagonistes comprennent des philosophes parmi les plus célèbres du xviie siècle (Descartes, Leibniz, Bekker) et des philosophes ou théologiens allemands du début du xviiie siècle, pour la plupart influencés par le piétisme (Thomasius, Francke, Johann Budde, Gundling, Rüdiger, Mayer, Petersen). Au cours des cinq années où apparaissent ces dialogues, ils ont déclenché un débat houleux à plusieurs strates (philosophique, théologique, économique…). L’autrice montre que ces dialogues forment un corpus cohérent, elle éclaire les controverses d’époque auxquelles ils se rapportent, et montre combien l’étude des groupes sociaux placés en marge des milieux académiques allemands « établis » (étudiants, écrivains à gages, graveurs…) pourrait éclairer bien des aspects et vicissitudes des premières Lumières allemandes.
– Einleitung. 1. Flugschriften, Totengespräche, Pamphlete : die anonyme Welt der deutschen Publizistik des frühen 18. Jahrhunderts. 2. Die philosophischen Totengespräche der Frühaufklärung (1729–1734) : ein unbekanntes Quellenkorpus.
– I. Von der Antike bis zum 18. Jahrhundert. 1. Lukian von Samosata (ca. 120–180/92) : die Νεκρικοί διάλογοι. 2. Fontenelle : die Nouveaux dialogues des morts (1683). 3. David Fassmann : die Gespräche im Reiche der Toten (1718–1739).
– II. Das Examen Rigorosum. 1. Apolls Urteil. 2. Das Business der “Piratenausgaben” : das Totengespräch als Raubdruck. 3. Studentische Rivalitäten.
328– III. Der Krieg der Biographen. 1. Die pietistische Front : Christian Gerber und die Historia derer Wiedergebohrnen in Sachsen. 2. Die ersten literarischen Darstellungen der Leben von Christian Thomasius und August Hermann Francke. 3. Die Welt der Kupferstecher. 4. Die harten Gesetze der Konkurrenz. 5. Trauerreden, Totengespräche, (Auto)biographien : die “Instabilität” der literarischen Gattungen.
– IV. Der Wolffsche Leibniz. 1. S.W. 2. Die Auseinandersetzung mit Johann Franz Budde. 3. Eklektik, mathematische Methode, Atheismus. 4. Wie viele Autoren ?
– V. Das doppelte Gesicht von Leibniz. 1. 1745 : Leibniz wieder Protagonist eines Totengesprächs. 2. Die Unterhaltung mit Ludwig Philipp Thümmig. 3. Gottsched, Mylius, Hagedorn, die “Schweizer” : die Dispute der 40er Jahre.
– Tafelteil. Verzeichnis der Abbildungen.
– VI. Der Streit zwischen Descartes und Rüdiger. 1. Die Ankunft unter den Sternen. 2. Descartes als Wolffscher Philosoph. 3. Pietismus und Materialismus. 4. Der Entstehungskontext des Dialogs. 5. Rollenspiele.
– VII. Die Wiederbringung aller Dinge. 1. Vorworte zu Totengesprächen : der Dialog zwischen. Johann Friedrich Mayer und Johann Wilhelm Petersen. 2. ’Aποκατάστασις πάντων.
– VIII. Die Reue Balthasar Bekkers. 1. Der Exorzismus Peter Ottes. 2. Cartesianismus und Dämonologie im Deutschland des 18. Jahrhunderts : von der ersten Bekker-Rezeption zum Teufelsstreit. 3. Der Pakt mit dem Teufel. 4. Nochmals zu den Kupferstechern : die Identität des “M. B.”. 5. Einige Überlegungen zur Entstehung, Verfasserschaft und Verbreitung des Dialogs. 6. Gespensterbeschwörungen und Unterredungen im Reich der Geister.
– Schluss. 1. Die “Unterwelten” der Totengespräche : welche Ebene von Klandestinität ? 2. Vier Gründe für die Anonymität. 3. Die Rolle der « materiellen‹ Indizien » : Namenszeichnungen, Einbände, Paginierung, Unterschiede zwischen den Exemplaren. 4. Die Frage der Verfasserschaft.
– Abkürzungsverzeichnis.
– Quellen- und Literaturverzeichnis. 1. Ungedruckte Quellen. 2. Gedruckte Quellen. 3. Forschungsliteratur.
– Danksagung. English summary. Personenregister.
Toto, Francesco, Simonetta, Laetitia et Bottini, Giogio (dir.), Entre nature et histoire. Mœurs et coutumes dans la philosophie moderne, Paris, Classiques Garnier, 2017, 366 p.
« Cet ouvrage analyse le rôle des mœurs et des coutumes dans les discours philosophiques modernes et dans l’interrogation des classiques sur la subjectivité, le statut de la morale, la constitution et les limites de la souveraineté. »
– Avant-propos par Giogio Bottini, Laetitia Simonetta et Francesco Toto.
Francesco Toto : « Mœurs et coutumes, raison et histoire. Remarques introductives » ; Giorgio Bottini : « Entre mœurs et corruption. Machiavel, la langue du droit et la politique de la force » ; Antonella Del Prete : « Traduire la culture 329européenne pour les Chinois et vice versa. Universalité et diversité chez Matteo Ricci » ; Élodie Cassan : « Descartes, théoricien des mœurs ? Éléments pour une compréhension renouvelée de l’homme cartésien » ; Arnaud Milanese : « Les mœurs selon Hobbes » ; Alberto Frigo : « Violentia consuetudinis. Pascal et la logique de la coutume » ; Jacques-Louis Lantoine : « Spinoza et la raison des mœurs » ; Raffaele Carbone : « Morale et coutumes chez Malebranche » ; Céline Spector : « L’équivoque du concept de “mœurs”. La lecture althussérienne de Montesquieu » ; Laetitia Simonetta : « Rousseau, de la science des mœurs à l’éveil du goût » ; Andrea Lamberti : « Nature et coutume dans la pensée civile d’Antonio Genovesi » ; Francesco Toto : « Dom Deschamps et les mœurs » ; Valentin D’Agnano : « De l’Angleterre à la France. Métaphysiques des mœurs chez Burke » ; Mariannina Failla : « La dynamique des mœurs chez Kant » ; Jean-Claude Bourdin : « Du gouvernement des mœurs ».
– Index des noms. Résumés.
Van Damme, Stéphane, « La mappemonde sceptique : une géographie des “libertins érudits” », Littératures classiques, no 92, 2017-1 (Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 1), p. 77-112.
« Quelle serait une géographie des libertins érudits ? La plupart des études pionnières sur le libertinage ont privilégié une vision philosophique et doctrinale essentialisante, cherchant à réifier une tradition. Or, pour comprendre ce qui se joue dans les écrits comme dans les pratiques des libertins au xviie siècle, il semble important de revenir sur les contraintes sociales et spatiales qui encadrent la mobilité libertine. En étudiant des contextes spécifiques, il est possible de reconstituer une géographie des savoirs qui propose une nouvelle anthropologie morale et qui s’oppose à un orientalisme catholique mis en place par les ordres missionnaires et en particulier par les jésuites. Les écrivains libertins mettent en garde contre les dangers des récits de voyage qui essentialisent les différences culturelles. Pour ce faire, ils puisent dans une vaste série de savoirs et de genres qui appartiennent à la géographie : traités, récits de voyage, descriptions, cartes, atlas ou encore histoire universelle. En mettant en place un véritable art de lire, ils proposent une économie des savoirs alternative, moins dépendante des autorités religieuses et politiques. » (https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2017-1.htm)
Van Stam, Frans Peter, The Servetus Case : an Appeal for a New Assessment, Genève, Droz, 2017, 341 p.
Ce livre décrit le procès à Genève de Michel Servet, qui se conclut sur le bûcher le 27 octobre 1553, et analyse les causes de la sentence. On accuse souvent Calvin, « parce qu’il contrôlait prétendument Genève à l’époque, cependant dans les sources on voit qu’il a dû se battre comme un Troyen contre les forces combinées d’un féroce esprit de faction, de la xénophobie contre des réfugiés, 330de la ridiculisation du ministère, de la colère populaire et de la peur ». Le conseil de Genève a suivi un cours hésitant, jusqu’à l’impasse. Enfin Servet lui-même s’est compromis dans un groupe de pression…
(Compte rendu par Karin Maag dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXIX-3, 2017, p. 729-730)
Introduction (Tragedy. Timespan and method. Main sources and literature. The heart of the matter).
– I. Rescuing five students. Five prisoners in Lyon (Two new rescue attempts. Bribing the French king. Calvin’s private action. The Inquisitor at work. Calvin deep in trouble).
– II. Harassing Calvin and his adherents (Servetus’ inconvenient arrival. Ridiculing the ministers. The polarization. The Enfants of Geneva. Explosive situation).
– III. Change in Servetus’ behaviour (Politeness in Vienne. New interrogations in Geneva. Initially keen politeness. From a gentleman to a streetfighter. Most hostile against Calvin. Down with Calvin).
– IV. Council’s new way and backlash. Noticeable entry in the Acts. Berthelier’s frontal attack. Combining forces. The consultation. Calvin mobilizes support. The mission of Geneva’s Treasurer).
– V. The basics for the consultation (Calvin’s “Sententiae”. Servetus’ “Responsio”. Calvin’s “Brevis refutatio”. Geneva’s official request. Servetus in dire straits. Servetus’ desperate reply).
– VI. First weeks of Geneva’s trial (Servetus brought to Court. Main points of accusations. First interrogations. In Calvin’s presence. Servetus’ trial a State’s affair. Calvin at a distance. Other implications. The 30 articles. Servetus’ answers).
– VII. Impasse, answers of allies and outcome (Why Rigot’s aggressiveness ? Servetus brought down. 38 new accusations. Requests from Vienne. The outcome of the consultation. Idle waiting and guesswork. Capital punishment).
– VIII. General outlines (Calvin not the mighty potentate. Gradual disclosure of facts. Up-to-date interpretations. Calvin’s book. Zurkinden’s criticism. Whose initiative ? Protestants too burn heretics ? To impress Roman Catholics ?).
– IX. Parts played in the trial (The Council’s trial. Faction-ridden Geneva. Calvin’s close friends. Calvin not his own master. His last talks with Servetus. Servetus. The falsification
– Bibliography. Index of proper names.
Vesperini, Pierre, Lucrèce : archéologie d’un classique européen, Paris, Fayard, coll. « L’épreuve de l’histoire », 2017, 414 p.
« De Lucrèce on croit tout savoir : un éclair, le De rerum natura, qui troua la nuit où sombrait la République romaine, entre guerres civiles et religions à mystères, portant la bonne nouvelle du rationalisme grec et de l’hédonisme épicurien. Puis l’oubli, au Moyen Âge. Oubli délibéré de la part du christianisme triomphant, désireux d’étouffer toute dissidence. La redécouverte enfin, par les humanistes qui, en imposant l’œuvre malgré tous les interdits, 331feront naître le monde moderne. Mais tout cela n’est que mythes. Mythe du poète hors des normes de son temps, mythe d’un Moyen Âge obscur, mythe de l’humaniste éclairé parti seul sur les routes à la redécouverte d’un passé disparu. Pierre Vesperini plonge à même les sources, antiques, médiévales et modernes, et déjoue le filtre de l’historiographie dominante. Dénouant un à un les fils de l’histoire supposée des origines de notre modernité, il éclaire de manière fascinante l’apport de l’héritage antique à notre culture européenne. »
– Voir le c.r. de Pascal Engel, « Lucrèce était-il un philosophe ? », En attendant Nadau. Journal de la littérature, des idées et des arts (https://www.en-attendant-nadeau.fr/2017/11/21/lucrece-philosophe-vesperini/) ; et celui d’Ariel Suhamy publié dans laviedesidees.fr, le 20 novembre 2017.
– Introduction.
– Prologue à Athènes : dans la secte du gourou Épicure.
– Première partie : les savoirs grecs dans la Rome de Lucrèce. I. Le monde de Lucrèce. II. Otium graecum : la Grèce des Romains. III. Rome, ciuitas erudita.
– Deuxième partie : Lucrèce en son monde. IV. Qu’est-ce qu’un poeta ? V. Memmius, le commanditaire du De rerum natura VI. Le monument de Memmius. VII. Les Romains avaient-ils des convictions philosophiques ?
– Intermède. D’étonnements en étonnements ou Le dialogue des pourquoi pas.
– Troisième partie : la pragmatique esthétique et savante du De rerum natura. VIII. Qui parle dans le poème de Lucrèce ? Poésie hellénistique et énonciation fictive. Le « je » fictif. IX. De quoi parle le poème de Lucrèce ? Lucrèce fait partie du savoir partagé. La pragmatique de l’extrait. La varietas.
– Quatrième partie : Lucrèce après Lucrèce. X. Le succès du De rerum natura. XI. Lucrèce au Moyen Âge. XII. Lucrèce et les humanistes (1) : le mythe de Poggio Bracciolini. XIII. Lucrèce et les humanistes (2) : le mythe du retour de l’épicurisme. XIV. Lucrèce, entre Contre-Réforme et Lumières. XV. Lucrèce et les Lumières. XVI. L’invention du mythe
– Conclusion. Abréviations. Notes. Bibliographie. Index. Remerciements.
Winiarczyk, Marek, Diagoras of Melos. A Contribution to the History of Ancient Atheism. Translated from Polish by Witold Zbirohowski-Kościa Berlin, Boston, De Gruyter, ser. « Beiträge zur Altertumskunde », 2016, 242 p.
« Diagoras de Melos (poète lyrique, ve s. av. J.C.) a reçu une attention particulière jusqu’à aujourd’hui parce qu’il était considéré comme un athée radical et l’auteur d’un travail en prose sur l’athéisme dans l’Antiquité. Il fut célèbre pour avoir révélé et ridiculisé les Mystères Eleusiens et fut condamné pour impiété à Athènes. Or ce livre s’attache à reconstituer la biographie de Diagoras et montre qu’il ne peut pas être considéré comme athée dans le sens moderne. »
– Preface. I. Current State of Research. II. Analysis of the more important Sources. III. The Life of Diagoras. IV. The Problem of Diagoras’ Atheism. 332V. Diagoras as the supposed Author of the Commentary on the Derveni Papyrus. VI. Conclusions.
– Appendix I : Diagoras as an Impious Person and Atheist ; II : Contra Deos Testimonium ; III : Gods punish those who stay with an impious Person.
– Bibliography. Indexes (of names ; of geographical and ethnic names ; of subjects ; of Greek and Latin words and expressions ; of passages).
Nouveaux manuscrits
Lettre de Thrasibule à Leucippe : Bibliothèque de l’Université d’État de Nagoya, ms. 62N-903.
Manuscrit signalé par Motoichi Terada (voir ci-dessus G. Artigas-Menant, « Actualités de la recherche sur la littérature clandestine au Japon »).
Pantheisticon : Bibliothèque de l’Université d’État de Nagoya, ms. 62N-1204.
Manuscrit signalé par Motoichi Terada (voir ci-dessus G. Artigas-Menant, « Actualités de la recherche sur la littérature clandestine au Japon »).
Cymbalum mundi : « Copie du Cymbalum mundi, sur l’édition de 1538, faite par Mr Sylvestre, libraire, en mai 1832. 1er dialogue. Auquel j’ai ajouté des notes que Mr Sylvestre a copiées également sur deux cahiers » : Blois, Archive déparementales du Loir-et-Cher, 1 J 321 / 4. (A. Mothu).
Lettre préliminaire et premier dialogue seuls, annotés. Copie réalisée à la demande d’Éloi Johanneau, probablement sur l’imprimé de la BnF (Rés. Z-2442). Pièce du dossier « Travaux d’Éloi Johanneau pour la publication d’une novelle édtion du Cymbalum mundi de Bonaventure Desperiers et correspondance relative à la découverte de la clef de cet ouvrage », entré en 2005 aux Arch. départementales. Nous (A.M.) évoquons ce dossier supra, dans la cinquième note de « Jésus et le bon et autre notes sur le Cymbalum mundi ».
1 Collaborateurs entre 1999 et 2017 : Laurence Bergon (vol. I-IX) ; Hubert Bost (vol. II-XI) ; Hans Bots (vol. IV) ; Annie Leroux (vol. II-IX) ; Jean-Michel Noailly (vol. XIV) ; Maria-Cristina Pitassi (vol. I et II) ; Dominique Taurisson (vol. II-IV) ; Caroline Verdier (vol. II-VIII) ; Ruth Whelan (vol. I et II).