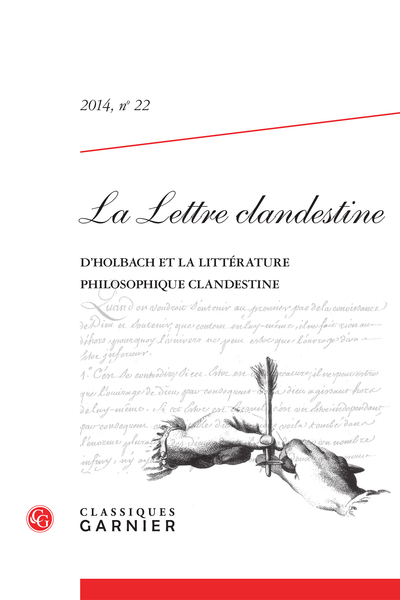
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Lettre clandestine
2014, n° 22. Le baron d’Holbach et la littérature clandestine - Auteurs : Gengoux (Nicole), Seguin (Maria Susana), Lattarico (Jean-François), Artigas-Menant (Geneviève), Quintili (Paolo), Tatin-Gourier (Jean-Jacques), Sandrier (Alain), McKenna (Antony)
- Pages : 291 à 320
- Revue : La Lettre clandestine
- Thème CLIL : 3129 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie moderne
- EAN : 9782812429439
- ISBN : 978-2-8124-2943-9
- ISSN : 2271-720X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2943-9.p.0291
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 31/07/2014
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Hélène Bah-Ostrowiecki, Le Theophrastus redivivus. Érudition et combat antireligieux au xviie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 336 p.
La publication en 2012 chez Honoré Champion de la thèse d’Hélène Bah-Ostrowiecki, sous le titre « Le Theophrastus redivivus, érudition et combat antireligieux au xviie siècle », thèse soutenue en littérature en 1995 sous la direction de Jacques Prévot et remaniée, est bienvenue de nos jours où cet imposant traité anonyme, écrit en latin en 1659 et encore trop peu connu, connaît un regain d’intérêt auprès des commentateurs depuis l’édition italienne du texte en 1981 par Gianni Paganini et Guido Canziani1. La méthode qu’a suivie H. Bah-Ostrowiecki, à savoir « l’étude littérale de la manière dont se construisent le discours et l’argumentation », n’ayant « pas particulièrement retenu l’attention des autres commentateurs » (ceux-ci se sont plus intéressés aux « contenus »), elle a considéré, à juste titre, qu’ils méritaient d’être publiés tels quels, sans le commentaire des travaux postérieurs au sien. En particulier, son approche étant littéraire, elle veut « prendre au sérieux » la forme « doxographique » du texte, c’est-à-dire le fait qu’il soit constitué d’un tissu de citations érudites. L’analyse qu’elle en fait est originale et permet de rendre compte de « tensions théoriques », voire d’« apories » qui seraient le signe d’une position essentiellement polémique de l’auteur du Theophrastus : ce dernier chercherait moins à prouver la vérité de son naturalisme athée qu’à opposer à la position chrétienne une position alternative lui renvoyant ses faiblesses, son caractère relatif et qui surtout permette de défendre la liberté qu’elle étouffe. Le traité répondrait alors à la définition que donne J. Prévot du libertin, celui d’un esprit critique.
Dans un premier chapitre, après un résumé des six traités du Theophrastus, H. Bah-Ostrowiecki s’oppose à une tradition (Henri Busson, René Pintard et John S. Spink) pour qui la forme érudite du Theophrastus disqualifie le fond, qui n’est qu’un « fatras » et, par suite, une « pensée périmée » ; elle rejoint la recherche actuelle (Tullio Gregory) pour qui
les libertins réinterprètent la tradition antique. L’utilisation du latin n’est pas le signe d’une pensée rétrograde car le latin, rappelle-t-elle très justement, était « une langue maîtrisée par tous les hommes de culture » ; c’est seulement le signe d’un élitisme. Une analyse des conditions de réception montre également que le traité n’est pas marginal : son caractère inconnu ne prouve rien et, d’ailleurs, l’auteur ne semble pas avoir fui la censure : une analyse judicieuse de la construction du texte, enveloppé par un préambule et deux péroraisons contradictoires, fait apparaître « l’ambiguïté d’un propos qui n’est pas ouvertement antireligieux », procédé qui n’est pas nouveau (Vanini). L’auteur, dit-elle, a fait le choix de la distance, d’un « jeu ironique ». L’anonymat, enfin, plutôt qu’un signe de prudence, est le signe que l’auteur s’efface derrière l’œuvre au nom d’une démarche revendiquée comme anhistorique : le Theophrastus redivivus est ressuscité, conformément à une conception cyclique du temps.
Dans le deuxième chapitre, H. Bah-Ostrowiecki relie le caractère polémique du texte à son caractère doxographique : ils ne sont pas contradictoires mais permettent, au contraire, d’instaurer un dialogue entre les deux positions, religieuse et antireligieuse. La suite d’opinions (« historia »), annoncée dans le préambule, est en réalité une construction. Mais H. Bah-Ostrowiecki s’attache à montrer que celle-ci n’est pas pour autant un raisonnement démonstratif et qu’elle s’éloigne des constructions traditionnelles de la philosophie. L’auteur, dit-elle, manifeste peu d’intérêt pour les questions théoriques ; l’essentiel est la perspective morale présente à partir de l’avant-dernier traité (sur la mort à ne pas craindre) et développée dans le dernier traité (sur la morale naturelle). Une démarche « analytique » est toutefois dégagée à partir du traité I sur les dieux : les trois chapitres de ce traité annoncent les trois traités suivants (sur le monde, sur la religion et sur l’âme) ; mais ces derniers acquièrent une « autonomie » qui donne à l’ensemble une structure en « étoile » de confirmation et non celle d’une démarche discursive. D’ailleurs tout semble déjà démontré dès le traité I, ce que confirme une certaine « autonomisation » de chaque traité. Enfin, un réseau d’« anaphores » et de « cataphores » introduit une cohérence qui semble plus destinée à convaincre le lecteur qu’à démontrer rationnellement une thèse. Mais cette absence d’ordre déductif en cache un autre, « l’organisation du discours religieux » à laquelle, selon H. Bah-Ostrowiecki, l’anonyme répond par une position antireligieuse qui en
est donc dépendante. C’est essentiellement avec la religion chrétienne qu’il « dialogue », comme le montre le choix de ses références, conforme à leur autorité dans l’apologétique et qu’il retourne contre elle (Aristote, Platon, la Bible exploitée comme un texte ordinaire), ou le fait de traiter à égalité toutes les religions, trait direct porté contre la prétention chrétienne à l’exclusivité.
Ainsi, le problème de Dieu s’efface derrière celui de la religion et le seul but de l’anonyme est de montrer que la thèse antireligieuse n’est « ni moins ni plus absurde » que les autres inventions humaines. Le « choix de la forme doxographique » prend alors « un sens positif », même si l’emploi rare du « je », comme le montre une analyse précise de ses modalités, confirme un « refus de l’engagement personnel » de l’auteur. Son rôle est la « manipulation des sources » : « C’est Aristote contre la Bible et non le libre penseur de 1659 contre le penseur chrétien de la même époque. »
Au chapitre 3, consacré à la méthode, l’athéisme apparaît plus vraisemblable, non en vertu d’arguments démonstratifs, mais parce que les autorités utilisées par les adversaires ne sont pas fiables, les croyants étant souvent de faux athées. Les références ne sont pas examinées ni interprétées pour elles-mêmes ; l’anonyme garde celles qui lui sont utiles et les critères qu’il utilise ne servent qu’à départager les textes, non à dégager « LA vérité ». Autrement dit c’est, tout comme son adversaire, l’argument d’autorité qu’utilise l’anonyme, bien qu’il l’ait rejeté dès le préambule : au dogmatisme religieux il oppose un autre dogmatisme ! Même l’expérience ne serait utilisée que pour mettre les adversaires en contradiction avec eux-mêmes. H. Bah-Ostrowiecki fonde son point de vue que nous appellerons « relativiste » sur la distinction que fait l’anonyme entre la « raison naturelle », seule « véritable » parce qu’elle s’efface devant la réalité en se soumettant entièrement aux sens, et la « raison fausse » que H. Bah-Ostrowiecki nomme la « raison humaine » ; celle-ci donne au sujet de la connaissance un caractère essentiellement « passif », ce qui entraîne à son avis « une impasse théorique » et manifeste le peu d’importance que l’anonyme accorde à la recherche des principes de la connaissance eux-mêmes. Le discours de l’anonyme est considéré comme étant de l’ordre de « l’opinion », si ce n’est de la fable.
Le chapitre 4 traite de la « construction du discours hétérodoxe », discours entièrement médiatisé par l’érudition. H. Bah-Ostrowiecki y
analyse de façon brillante la manipulation des citations : incohérences, rôle des listes, tris, coupures, déplacements internes des personnages, etc. Bref, la doxographie n’est nullement passive mais elle est l’occasion d’un travail de réorientation qui ne peut être dicté que par une logique de persuasion. Pas de « face à face » ni de « confrontation » des points de vue : la position orthodoxe est jugée en fonction de son incompatibilité avec la position hétérodoxe. C’est ce qui explique le recours irrationnel au principe d’autorité, au « consensus », et les contradictions qui s’ensuivent : erreurs de gens très habiles ou jugements droits du vulgaire, par exemple. Telle est la conséquence de la théorie de la connaissance de l’anonyme : la « raison naturelle et vraie » qui est « présente en tout homme […] ne peut parler qu’à travers » les opinions ; la vérité n’existe que « par opposition », comme en témoigne l’usage du principe du tiers exclu : si la proposition de la religion est fausse, celle que défend l’anonyme est vraie. Le discours antireligieux est donc bien, lui aussi, un « dogmatisme ».
Au chapitre 5 est abordé le contenu philosophique lui-même du traité : un naturalisme miné par une contradiction profonde. L’homme fait partie d’une nature totalisante comme tout autre animal, mais il possède une spécificité : il s’écarte de la nature (à cause, surtout, de l’opinion) et on l’invite à y retourner. Comment concilier cette continuité et cet écart ? Quelle est l’articulation entre « l’humain » et le « naturel » ? Des difficultés théoriques surgissent : comment, par exemple, expliquer que le même appétit, l’intempérance, soit naturel chez l’animal et non naturel chez l’homme qui devrait revenir à la sobriété ? Mais sous « l’approche descriptive » se dessine une « perspective axiologique », ce qui confirme que le concept de nature n’est qu’« une machine de guerre » contre la croyance en une « surnature », « l’usage axiologique du concept de nature (étant) incompatible avec une idée descriptive d’une nature omni-compréhensive ». D’ailleurs ce naturalisme est sans contenu « effectif » : la religion, par exemple, bien qu’enracinée dans la nature, sur le plan psychologique (la crainte) et sur le plan cosmologique, est « une invention humaine », une imposture antinaturelle, dont les législateurs et les prêtres sont les médiateurs ; elle ne trouve pas sa place dans un naturalisme et ne peut d’ailleurs, selon H. Bah-Ostrowiecki, en trouver une, n’y ayant en l’homme que la seule raison naturelle.
En conclusion, le seul but de l’anonyme est la démolition de la thèse religieuse. Son athéisme « n’est pour ainsi dire que fonctionnel » : s’il le
défend, c’est parce que « l’existence de Dieu est le pilier de la religion et que la religion est le pire instrument de l’oppression ».
Une telle interprétation n’est pas partagée par l’ensemble des commentateurs actuels, qui accordent le plus souvent à l’anonyme un athéisme assumé. On peut en effet « prendre au sérieux » (pour reprendre l’expression d’H. Bah-Ostrowiecki) la forme doxographique et considérer en même temps que le caractère polémique indéniable qu’elle recèle n’est pas entièrement négatif, mais déploie une pensée rigoureuse qu’il faut alors chercher, non dans ce qui est explicite, mais dans ce que suggère le texte (à travers les allusions, les renvois, la structure du texte), bref, voir une stratégie là où H. Bah-Ostrowiecki perçoit un pur miroir du discours religieux. Ce deuxième type d’interprétation suppose que l’auteur n’est pas toujours « franc », même si son anonymat l’y autorise parfois, et qu’il faut distinguer quand et à qui il s’adresse. Pour notre part (cf. Un Athéisme philosophique à l’âge classique, le Theophrastus redivivus, 1659, à paraître chez Champion), nous pensons qu’il faut « prendre au sérieux » non seulement la « forme » mais aussi le « fond » de la thèse athée de l’anonyme. L’homme n’est pas seulement enclin à penser par opinion, mais aussi à utiliser sa raison naturelle qui, elle aussi, est « humaine » : de ce fait nous accordons une importance à la réflexion théorique de l’anonyme pour qui l’impossibilité pour les sens d’atteindre une réalité absolue découle de son empirisme mais n’entraîne pas nécessairement la « relativisation » de sa position. Une autre conséquence est que ce qui peut passer pour une contradiction chez l’anonyme peut aussi recevoir un sens, comme la présence, parfois, d’un bon jugement chez le vulgaire. Inversement, le caractère naturel de la croyance et de l’opinion elle-même, permet aussi, selon nous, d’intégrer la religion dans le cadre du naturalisme.
Cependant nous avons été très intéressée par la façon dont H. Bah-Ostrowiecki dégage les problèmes principaux, difficultés ou apories, à partir de l’étude fouillée de la forme du texte jusque dans sa littéralité. Elle nous force à nous interroger : par exemple au sujet de la religion, bien que nos interprétations divergent, elle a eu assurément raison de soulever le caractère problématique de son caractère naturel ou non. Un autre intérêt de son livre est qu’elle nous propose une interprétation originale de la pensée de l’anonyme : si elle en fait une sorte de copie inversée de la pensée religieuse, elle a eu tout à fait raison de souligner
la « parenté » de deux courants de pensée en apparence opposés, ce qui remet en question bien des idées préconçues. Enfin, l’ouvrage se lit avec plaisir grâce à la fois à sa cohérence et au style qui est élégant sans être jargonnant.
Nicole Gengoux
Pierre Bayle, Diccionario histórico y crítico. Tomo 1 / A-AFRO. Edición coordinada por Juan Ángel Canal Diez, Oviedo, KRK Ediciones, 2012, 234 p in-folio.
La parution de ce premier volume du Diccionario histórico y crítico est une très heureuse nouvelle, non seulement pour les chercheurs hispanophones, mais aussi pour la communauté scientifique internationale. L’équipe d’enseignants et d’enseignants-chercheurs dirigée par Juan Ángel Canal Diez s’est engagée dans une entreprise aussi ambitieuse que prometteuse, celle d’offrir la première traduction espagnole intégrale du célèbre Dictionnaire de Pierre Bayle, dont seules quelques anthologies avaient été publiées jusque-là, et toutes dans les dernières années seulement2. La présentation générale du projet par laquelle s’ouvre le volume explique les raisons de cette lacune éditoriale : dans un premier temps, l’Espagne du xviiie siècle n’a pas réservé un accueil très favorable à l’œuvre du philosophe français en raison de sa très forte résistance contre le mouvement réformé. Par la suite, l’œuvre de Pierre Bayle a pâti d’une réaction générale de l’Espagne contre toute influence française pour des raisons tout aussi idéologiques que politiques qui conduisaient à rejeter tout ce qui pouvait apparaître comme une forme de « afrancesamiento », terme extrêmement péjoratif désignant le comportement de tous ceux qui manifestaient un intérêt marqué pour la culture ou les idées françaises, notamment celles qui concernent les idées philosophiques du mouvement des Lumières. La critique philologique du xixe siècle, représentée par le célèbre érudit Menéndez Pelayo, n’a fait par la suite qu’enfermer Bayle et son œuvre dans l’histoire d’une « hétérodoxie » aussi disparate que mal connue.
L’objet principal de cette édition est donc de sortir l’œuvre de Bayle d’un injuste oubli et de la replacer dans l’histoire des idées philosophiques de son temps. L’Introduction générale offre une étude d’ensemble du projet baylien pertinente et bien informée par la bibliographie critique la plus récente : analyse de la structure d’ensemble et de la construction des articles, stratégies des entrés, des renvois et des notes, rapport que
le Dictionnaire entretien avec les auteurs et les œuvres de son temps, le Dictionnaire de Moréri, bien sûr, mais les relations complexes entre Bayle et Jurieu également. La présentation montre aussi que la volonté affichée de Bayle de rassembler les erreurs historiques et philosophiques de son temps ne doit pas cacher l’entreprise positive du philosophe, voire les stratégies éditoriales mises en place pour assurer la réussite du Dictionnaire. L’analyse de la réception de l’œuvre, aussi bien en terre catholique que dans les milieux protestants permet aux auteurs de mettre en avant la prise de position « laïque » de Bayle, qui réclame le droit d’être jugé en tant qu’historien et philosophe en dehors de toute considération confessionnelle. Le quatrième chapitre, en particulier, s’attèle à analyser la place qu’occupe l’auteur du Dictionnaire dans l’histoire de la philosophie, en définissant même cette notion de « philosophe » à l’intérieur d’une lignée qui conduit directement aux encyclopédistes et aux Lumières. La pensée de Bayle trouve ainsi sa place à côté de Descartes, Spinoza, Leibniz, Shaftesbury ou Hume. Dans ce contexte, et faute de pouvoir définir un « système philosophique baylien », l’introduction s’intéresse à des notions centrales du Dictionnaire qui permettent de caractériser la pensée de l’auteur : cartésianisme, superstition, scepticisme, tolérance, athéisme et fidéisme, manichéisme et problème du mal, éthique.
Conscients de la difficulté de l’entreprise, l’introduction du projet expose finalement de manière précise les difficultés rencontrées dans le travail de traduction et d’annotation, ainsi que les choix scientifiques et éditoriaux présidant à l’édition. L’équipe scientifique a fait le choix d’une traduction intégrale, fidèle à la langue classique, incluant toutes les entrées, notes et commentaires, reposant sur une réflexion de fond, mais qui a également obligé à des choix ayant des conséquences sur le plan général de l’œuvre : la modernisation de l’orthographe des noms propres, leur traduction en espagnol, a entraîné par exemple le déplacement de certains articles pour respecter l’ordre alphabétique et modifié par endroits le plan général de l’œuvre. Ces déplacements, expliqués et justifiés à chaque fois, n’enlèvent en rien à la qualité de cette très belle édition, richement reliée et illustrée, faisant de ce premier volume non seulement une entreprise scientifique prometteuse mais aussi un beau livre.
Nous ne pouvons donc que saluer le dévouement de la dizaine de spécialistes en philosophie, histoire, philologie française, classique et
hispanique, enseignants et enseignants chercheurs des Asturies, de Madrid et Valladolid qui rendent à Bayle la place qui lui revient dans l’histoire des idées philosophiques du monde hispanophone. Il est enfin à souhaiter que ce premier volume, d’une série de vingt autres à venir, annonce également des collaborations scientifiques avec les différents chercheurs travaillant sur l’œuvre de Pierre Bayle.
Maria Susana Seguin
Libertini italiani. Letteratura e idee tra xvii e xviii secolo, a cura di Alberto Beniscelli, Milano, BUR, 2012.
Cette passionnante anthologie de près de 1 000 pages offre pour la première fois sans doute en Italie, dans un format de poche facilement accessible et maniable, le plus complet panorama de la galaxie libertine de la péninsule. Sous-titrée « Littérature et idées entre xviie et xviiie siècles », l’ouvrage propose de revisiter les principaux courants du « libertinisme » italien à travers une dizaine de chapitres : le rapport entre les Anciens et les Modernes, la question de la censure et de la liberté d’opinion, la polémique contre l’église romaine, la science et l’astrologie, la thématique de l’éros dans la fiction romanesque, le néant, la misogynie et l’homosexualité, la satire et la dérision, l’autobiographie, l’épicurisme, la science nouvelle et la liberté philosophique, la mythographie libertine (le séducteur, l’imposteur). Chaque section est précédée d’une introduction spécifique et à son tour divisée en plusieurs chapitres qui en assurent avec clarté et pertinence la lecture.
Une longue introduction générale fait d’abord le point sur la géographie de la culture anticonformiste, en partant de la célèbre phrase de Gabriel Naudé (« L’Italie est pleine de libertins et d’athées et de gens qui ne croyait rien et néanmoins le nombre de ceux qui ont écrit de l’immortalité de l’âme est presque infini »). Dans des pages denses et dans une langue limpide, Beniscelli revient sur la définition de libertin, sur sa généalogie, depuis l’époque classique (de libertus = « affranchi »), en passant par l’acception « sectaire » théorisée par Calvin, et le relais de Mersenne et Campanella. Il insiste également, et à juste titre, sur l’importance de l’institution académique dans la diffusion, en Italie, des courants libertins, en premier lieu desquels domine la vénitienne académie des Incogniti. Ce n’est pas un des moindres mérites de cet ouvrage de mettre en lumière le rôle essentiel de la littérature, à une époque qui voit l’autonomisation de l’écrivain, sur des œuvres pleinement libertines (La lucerna de Francesco Pona, roman de la métempsychose, les romans et pamphlets de Pallavicino, le dialogue socratique de Rocco – philosophe de l’académie et disciple de Cremonini – qui défend la pédérastie). Beniscelli passe ensuite à une tentative de reconstitution de la « bibliothèque des libertins », rappelant le rôle essentiel des philosophes matérialistes Pomponazzi et Vanini, contempteurs de l’immortalité de
l’âme, et des traités politiques d’un Machiavel. Ces pères fondateurs du mouvement hétérodoxe voyaient dans le paradigme religieux l’instrument politique de l’organisation de la vie collective. En Italie cependant, l’influence de Machiavel sera filtrée par une historiographie prudente, mâtinée de « tacitisme » (ce dont témoignent par exemple les Ragguagli de Boccalini qui offrent une tribune à Machiavel pour se défendre de l’accusation d’impiété, mais finissent par le condamner). Beniscelli souligne ensuite l’importance des phénomènes d’appropriation et de réécriture, illustrés en particulier par le développement considérable du commentaire et de l’exégèse dans les nombreux discours académiques portant tout aussi bien sur le statut de la femme, le néant, le gris, le fromage, et autres bizarreries, héritières des raisonnements paradoxaux d’un Ortensio Landi.
La question des thèmes, des styles et des genres s’appuie sur le paradigme fondateur de la matrice sceptique (à travers les Pensées d’un Paolo Sarpi, figure de l’indépendance institutionnelle à l’égard du pouvoir pontifical), de l’incertitude face aux dogmes religieux (« temps de l’incertitude » est ce qui caractérise le temps baroque, selon Benito Pellegrin), incertitude qui permet aux auteurs libertins de s’appuyer sur un outil épistémologique pour interroger le monde par des chemins de traverse, selon une belle image de Sarpi selon laquelle l’homme traversant une foule, est obligé de biaiser sous peine de la heurter et de tomber. Une longue analyse est ensuite consacrée à la thématique érotique qui nourrit les premiers romans italiens (à partir des années 1625) consacrées à des figures emblématiques de l’érotomanie tératologique (La Messaline de Pona, le Prince hermaphrodite de Pallavicino, le lesbianisme des Amours tragiques de Brusoni, etc.) et qu’on retrouve dans les nombreux recueils de nouvelles amoureuses, dont le recueil des Cent nouvelles amoureuses des Incogniti (1651) constitue l’ultime et exemplaire avatar du Décaméron. La galaxie littéraire libertine privilégie ainsi les genres modernes du roman et du drame en musique, du théâtre aux registres mêlés, réactivent le dialogue et la nouvelle dans une apologie sans complaisance des sens.
Le passage au siècle suivant s’effectue grâce à la reconduction de certaines thématiques (le scepticisme, l’incrédulité, et sa variante cynique) et l’influence emblématique de la culture française. Beniscelli rappelle que la pensée libertine est fondamentalement a-systématique (le refus du système explique, par exemple, la préférence des auteurs anticonformistes
à l’égard de l’atomisme d’un Gassendi contre le systématisme d’un Galilée). Le libertin italien a dû d’ailleurs faire sienne la maxime du philosophe français tirée de son Traité de la philosophie d’Épicure : « Le bonheur consiste entièrement dans le plaisir ». Les textes choisis pour illustrer le libertinage italien au xviiie siècle sont ainsi tout naturellement centrés sur la notion de plaisir. C’est la Volupté triomphante du roman galant Le congrès de Cythère de Francesco Algarotti (1745), dont la notion renvoie au contemporain discours de La Mettrie sur le sujet (1746), c’est le Discours sur l’amour de l’abbé Galiani, illustration théorique de sa correspondance avec Madame d’Épinay, c’est, bien entendu, L’histoire de ma vie de Casanova ou les Mémoires d’un autre libertin célèbre, Lorenzo Da Ponte, en contrepoint des Nouvelles licencieuses de Giambattista Casti. Le parcours de ces deux siècles permet de pointer les accointances qui les relient. Il y a une évidente parenté entre le libertinage érudit du Grand Siècle et les Lumières du siècle du même nom, ou du moins une influence décisive à sa constitution, notamment sur les questions scientifiques et de morale. Mais l’érotisme exacerbé confine à la pulsion de mort. Les dernières années du siècle sont celles d’une mondanité statique (la « fête gelée », selon le bon mot de Starobinski) et préparent le nihilisme d’un Leopardi.
La richesse exceptionnelle de cette anthologie, jusqu’à ce jour inégalée dans le panorama des lettres italiennes, empêche qu’on puisse, dans le cadre restreint du compte-rendu, évoquer la totalité des thèmes et des auteurs abordés. On saura gré à Alberto Beniscelli d’avoir porté à la connaissance du lecteur des textes jusque là difficile d’accès (les discours des Incogniti, notamment, les romans érotiques de Pallavicino, les écrits féministes d’Arcangela Tarabotti, les allégories animalières de Bruno, Giussani ou Frugoni, les écrits scientifiques de Pona, sur le bézoard par exemple, emblème du cabinet de curiosité, ou encore les nouvelles amoureuses, jamais rééditées depuis 1651). Les lettrés de l’âge baroque (Brusoni, Loredano, Ancellotti, Marana) côtoient les auteurs politiques de la fin de la Renaissance (Boccalini), les premiers scientifiques de l’époque moderne (Cardan, Liceti, Ciampoli, di Capua), les alchimistes (di Sangro, Cagliostro, Jerocades) et les libres-penseurs qui ouvrent la voie à la pensée des Lumières (Giannone, Cont, Algarotti, Crudeli). Voilà un outil indispensablen une boussole d’une grande fiabilité pour s’orienter dans le vaste maremagnum du libertinage italien, en même
temps qu’il constitue une réponse exemplaire aux questions soulevées il y a plus d’un demi-siècle par Giorgio Spini dans sa Ricerca dei libertini, dont on espère un jour une traduction française qui ne s’est que trop longtemps fait attendre.
Jean-François Lattarico
Miguel Benítez, Le Foyer clandestin des Lumières. Nouvelles recherches sur les manuscrits clandestins, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2013, 912 p.
Moins de vingt ans après La Face cachée des Lumières, paru en 1996, Miguel Benítez nous offre un nouveau recueil important de ses études sur les manuscrits philosophiques clandestins. Le projet, très judicieux, est le même : réunir dans un ensemble organisé des travaux épars et convergents sur un domaine qu’il a été un des tout premiers dans le monde à explorer et à faire connaître, après Gustave Lanson (1912) et Ira O. Wade (1938). La méthode est différente et il s’en explique dans un bref avant-propos épistémologique. Dans une telle entreprise, il faut choisir entre reproduire les travaux dans leur état originel ou les modifier pour « faire état des progrès les plus récents de la recherche » et « corriger les éventuelles erreurs » (p. [7]). C’est la première option qui l’avait emporté en 1996 à cause de « son indéniable portée historique : les textes compilés sont les enfants de leur temps, et ils le reflètent avec leurs carences et leurs défauts ». Mais c’est la deuxième option qui a prévalu pour le présent ouvrage afin de rendre compte des progrès de la recherche scientifique.
Vingt-neuf études parues entre 1994 et 20103, toutes revues et augmentées « à des degrés différents », sont réparties en cinq parties dont les titres soulignent la cohérence. En ouverture, les six études qui constituent la partie intitulée « Des ouvrages et des hommes » donnent une excellente idée de l’ensemble de l’ouvrage : à la fois précisément centré sur le phénomène clandestin et ouvert sur son contexte historique, philosophique et littéraire. Deux articles fondamentaux y traitent de caractéristiques essentielles de la littérature clandestine, la compilation et la difficile définition du corpus, aussi bien que de la méthodologie appropriée. Les quatre articles suivants en donnent des illustrations. Sources, remaniements, architecture composite, influences, récupération, qui sont des objets récurrents de la recherche sur la littérature clandestine, y sont abordés en détail à propos de l’attribution à Fréret de la Lettre de Thrasybule à Leucippe, des réactions manuscrites au système de La Peyrère, de la diffusion manuscrite du Discours historique sur l’Apocalypse d’Abauzit. Une démonstration complémentaire en est donnée par l’exploitation des documents cités en faveur de la théorie de l’origine marine de l’homme
depuis un Jésuite du xvie siècle jusqu’à Rétif de la Bretonne, en 1781, en passant par le système de Benoît de Maillet.
Consacré aux « Lumières radicales », un second ensemble met en perspective avec des représentants incontestés du corpus manuscrit clandestin des textes rares, voire marginaux, récemment mis au jour. Par exemple, la présentation d’une « rareté bibliophilique » découverte par Sylvain Matton4 intitulée Discours de vraye philosophie démonstrative. Specialement adressé à ceux, qui sans prejugé veulent examiner toutes choses, et sçavent discerner le vray du faux, traduction anonyme publiée en 1628 d’un ouvrage latin du médecin Gabriel Poitevin paru en 1624, conduit Miguel Benítez à une analyse subtile du passage des « discussions philosophiques et théologiques » sur « la corporéité de tout esprit fini, voire, exceptionnellement, de Dieu lui-même » à la « clandestinité, à la multiplication des manuscrits, à la radicalisation des positions » (p. 182). D’où un riche développement sur le « matérialisme chrétien » où sont convoqués les auteurs anonymes de l’Âme matérielle ou de l’Opinion des Anciens sur la nature de l’âme. Et le curé Jean Meslier n’est pas loin, qui « semble attribuer aussi aux Pères cette doctrine qui fait l’âme, les anges et Dieu lui-même corporel » (p. 185). Ainsi, d’après l’auteur, « l’hégémonie du matérialisme, qui se serait imposé aux Pères eux-mêmes » est mise en relief par la littérature clandestine, et c’est « cette voie qui débouchera sur le panthéisme » (p. 186) illustré notamment par le Theophrastus redivivus et par Telliamed.
Un titre explicite, « Les grands philosophes », annonce un troisième groupe de textes révélateur du progrès de la recherche sur les manuscrits philosophiques clandestins. C’est dorénavant un domaine suffisamment reconnu, sinon connu, pour qu’on puisse s’aventurer à y mêler Montesquieu, Voltaire, Diderot, comme on l’a fait dès le début pour d’Holbach. Ses notes de lecture, des extraits de ses Pensées, ses remarques manuscrites sur les Opera de Cicéron5, sa fréquentation des milieux libertins, de Fréret, de Boulainvilliers sont autant d’indices qui conduisent, entre autres, Miguel Benítez à brosser le portrait intellectuel d’un Montesquieu tenté par la
matérialisme des épicuriens. Du libertinage de sa jeunesse à sa lutte contre l’Infâme, s’affirme la constante familiarité de Voltaire avec la pensée clandestine. Des Pensées philosophiques à la Lettre sur les aveugles c’est le scepticisme des Promenades de Cléobule qui fait l’unité de la pensée de Diderot.
Les deux dernières parties, concernant respectivement les « pays de libertés » (Pays-Bas et Angleterre) et les « pays des ténèbres » (Espagne et Portugal), réunissent d’intéressants spécimens de la pensée hétérodoxe qui constituent une sorte de nébuleuse du corpus des manuscrits philosophiques clandestins. On y trouve l’édition synoptique copieusement annotée du manuscrit intitulé « A Madame de… Sur les differentes religions d’Hollande6 » et d’un imprimé de Jean-Baptiste Stouppe, La Religion des Hollandois7, « source de la première importance pour l’histoire des mouvements religieux et des doctrines théologiques et philosophiques aux Pays-Bas dans la deuxième moitié du xviie siècle » (p. 554). Après une présentation des projets d’apologie de la religion de James Tyrrell, des études sur Charles Blount et Anthony Collins sont l’occasion de mises au point ou de discussions sur les notions de spinozisme, de déisme, de panthéisme et d’athéisme. Symétriquement, nous découvrons la façon dont la pensée moderne s’est introduite dans la péninsule ibérique. Miguel Benítez évoque « ces rares auteurs qui ont élaboré, dans un milieu très hostile, une véritable pensée et se sont efforcés de la faire connaître » (p. 681). Parmi d’autres figures pittoresques, et à côté du bien connu marrane Orobio de Castro, on retiendra le médecin Martín Martínez, sceptique plus ou moins inspiré par Gassendi, Nicolas Le Gras alias César Bandier, médecin et prêtre, « vrai libertin érudit », un prêtre franciscain anticlérical et antichrétien Juan Antonio Olavarrieta, alias José Joaquin de Clararrosa.
On le voit, il s’agit d’un très riche ensemble, très varié, qui promet de féconds prolongements, accompagné de deux outils précieux, une bibliographie soigneusement mise à jour et un index qui permet de mesurer l’étendue des connaissances que recèlent ces deux précieux volumes.
Geneviève Artigas-Menant
Colas Duflo, Diderot. Du matérialisme à la politique, Paris, CNRS Éditions, 2013, 232 p.
Ce livre, œuvre de l’un des spécialistes les plus réputés de Diderot et de la philosophie des Lumières, s’articule en trois parties (« 1. Fondements matérialistes » ; « 2. La politique in situ » ; « 3. Le sens des Lumières ») et onze chapitres, dont cinq ont été déjà publiés dans différents recueils et revues, ce qui produit un effet de « décousu » qui n’est cependant pas en contradiction avec le sujet du livre. Le propos de C. Duflo est de prendre au sérieux l’hypothèse centrale de Diderot, à savoir son affirmation du caractère hypothétique de la science moderne (p. 20), associé à l’idée de la plausibilité d’une autre hypothèse : la sensibilité universelle de la matière. Le « postulat » matérialiste de Diderot et le préalable interprétatif de l’auteur se rencontrent donc dans la constatation de la « cohérence sans système » de Diderot (« Introduction. Cohérence de Diderot »). C. Duflo insiste sur ce point, car il s’agit d’une cohérence centrée autour de l’hypothèse aléatoire et matérialiste, permettant de suivre un parcours unitaire dans l’interprétation de la pensée du philosophe, menant du matérialisme (Première partie) à la politique libertaire des Lumières (Troisième partie).
Le propos est excellent et, ainsi bâti, l’édifice interprétatif de C. Duflo tient bien debout, qui part de ce fondement essentiel qu’est la construction du matérialisme biologique (« I. La dynamique matérielle. Qu’appelle-t-on âme ? Pour en finir avec la liberté de la volonté » ; « II. Le moi-multiple : fondements physiologiques, conséquences anthropologiques » ; « III. De la physiologie à l’anthropologie : l’apport des médecins » ; « IV. Diderot, critique de la notion de volonté »), passe par la politique (« V. L’ontologie des Otaïtiens : matérialisme, politique et langage » ; « VI. Philosopher dans l’Histoire des deux Indes » ; « VII. Un moment utopique dans l’Histoire des deux Indes »), pour aboutir au projet émancipateur des Lumières européennes (« VIII. L’Encyclopédie et la publicité des Lumières » ; « IX. Censure et clandestinité » ; « X. La statue du bon despote. L’image disputée de Pierre le Grand » ; « XI. Peut-on lire en philosophe sa propre actualité politique ? »).
Cependant, certaines pièces internes à cet édifice sont mal distribuées ou placées à des endroits où l’on ne s’attendrait pas à les trouver. Par exemple, concernant l’aspect qui nous intéresse ici plus spécialement,
la clandestinité de Diderot, ou plutôt « la fin de la clandestinité » de sa philosophie, qui ouvre à la publicité des Lumières, notamment avec l’Encyclopédie – l’une des thèses de l’auteur – représente un problème qui devrait logiquement précéder l’analyse de l’Encyclopédie et des œuvres politiques de la maturité. Cependant, dans la Troisième partie, le chapitre sur « Censure et clandestinité » (IX) est précédé par l’analyse de « L’Encyclopédie et la publicité des Lumières » (VIII). Toujours dans cette même partie du livre, les deux derniers chapitres ont comme sujet des arguments de politique : « La statue du bon despote. L’image disputée de Pierre le Grand » (X) et « Peut-on lire en philosophe sa propre actualité politique ? » (XI), qui clôt l’ouvrage (sans Conclusions), alors que ces deux textes auraient trouvé une meilleure place dans la Deuxième partie consacrée à « La politique in situ ». Enfin le chapitre v de cette Deuxième partie, sur « L’ontologie des Otaïtiens : matérialisme, politique et langage », nous semblerait mieux placé dans le contexte concernant « le sens des Lumières ».
Tout dépend certes de la conception que l’on se fait de la « cohérence » au sens de Diderot, mais on se heurte avant tout à la difficulté d’unifier un ensemble textuel provenant de contextes de réflexion différents (Colloques, séminaires, etc.). Cela dit – abstraction faite des problèmes d’équilibre architectonique – le livre de C. Duflo contient des analyses très fines et rigoureuses des différents aspects de la pensée de Diderot qui aboutissent à une image d’ensemble très cohérente et convaincante pour le lecteur informé de la critique diderotienne telle qu’elle s’est développée depuis cinquante ans. Cette image se présente, dans toutes ses facettes, comme celle d’un penseur de haut niveau, un Philosophe au sens « noble » du terme, digne d’être placé à côté des grands du xviiie siècle : Hume, Kant, Rousseau et d’autres.
Cependant, ce qui fait la différence, chez Diderot, c’est qu’il participe des « deux mondes », celui de la philosophie « publique », qui diffuse plus ou moins ouvertement ses idées dans les écoles, et celui d’une philosophie plus hétérodoxe et clandestine. Le couple de chapitres viii-ix sur l’Encyclopédie, la publicité des Lumières, la censure et la clandestinité, est en quelque sorte au cœur de la question. C. Duflo soutient que Diderot est l’auteur qui cherche définitivement à sortir de la clandestinité, sans pour autant éliminer, ni condamner tout à fait la censure en tant que telle. Le philosophe voudrait plutôt rendre la
censure publique et ouverte, en termes de critique généralisée des textes : « Il ne milite pas tant pour la fin de la censure que pour la fin de la clandestinité. Il analyse l’échec de la censure, qui contribue à susciter de l’intérêt pour ce qu’elle veut interdire : elle seule produit le clandestin et le succès du clandestin. Il pratique dans son écriture cet usage très particulier de la censure qui consiste à la rendre publique, à l’exhiber pour la contourner : dire la censure pour faire entendre le clandestin. Mais il est bien conscient du brouillage interprétatif qui peut finalement résulter de cette écriture dissimulée, de ce jeu pervers entre censure et clandestinité qui s’engendrent réciproquement. C’est pourquoi il rêve d’un autre usage de la censure : une censure publique qui n’oblige pas à la dissimulation mais qui, à l’inverse, expose tout, une censure en d’autres termes dont la clandestinité ne soit pas le revers » (p. 174-175).
Diderot aurait très bien compris, d’après C. Duflo, comme il le montre notamment dans la fameuse Lettre sur le commerce de la Librairie, que chaque défense redouble ou multiplie indéfiniment le prix de l’ouvrage interdit, indépendamment de la qualité de cet ouvrage, et favorise l’intérêt des libraires étrangers, qui sont libres d’imprimer les textes prohibés en France à un prix dix fois plus important que si le livre avait été autorisé dans son pays d’origine. L’argument en faveur de la liberté de la presse est d’ordre économique et les « paradoxes » de la censure, si bien exposés dans la Lettre et dans l’article « Casuiste » de l’Encyclopédie, aident Diderot à mieux la contourner. C. Duflo observe : « L’Encyclopédie multiplie les manières d’exposer dans un texte par nature non clandestin des éléments qui appartiennent à la pensée clandestine, pour parvenir à montrer au grand jour ce qui ne devrait pas pouvoir l’être. […] nous aimerions souligner à quel point ces stratégies de contournement sont aussi, en même temps, dévoilées dans l’Encyclopédie. L’Encyclopédie tient compte de son horizon de réception, au sens où elle s’adresse à des lecteurs qui savent dans quel contexte l’œuvre est publiée, et qui savent qu’elle est publiée par des gens qui savent que les lecteurs savent dans quel contexte elle est publiée… » (p. 180). Par-delà ce jeu de mots, le jeu de complicité et de dissimulation « ouverte » de l’écriture est librement déclaré dans le célèbre article « Encyclopédie », où Diderot expose sa conception de la fonction historique et politique de l’œuvre littéraire.
S’ouvre, sur ce point, la grande question si chère à Diderot, celle de la Postérité : « C’est, dit-il, parce que des hommes ont plus aimé la
vérité que redouté la persécution que nous sommes sortis de la barbarie. Par analogie, nous pouvons espérer qu’il en ira de même pour nos efforts en vue des Lumières. La postérité nous jugera, et c’est à elle que le philosophe doit s’adresser plus qu’à ses contemporains. On a là le portrait classique, auquel Diderot a beaucoup contribué, du philosophe des Lumières en Socrate en butte à la persécution » (p. 183).
Diderot, selon C. Duflo, plaiderait pour « un bon usage de la censure », mais nous croyons que lui échappe l’ironie sous-jacente à cette plaidoirie. Les conditions de possibilité de l’énonciation concernant la censure, chez Diderot, ne lui permettaient pas de se proclamer « contre » toute forme de censure, mais telle était bien sa position, telle qu’elle ressort des Mélanges pour Catherine II et d’autres écrits. D’ailleurs, l’Encyclopédie n’est-elle pas justement cet ouvrage incensurable qui permit à Diderot de faire sien le « sens des Lumières » et de le diffuser plus largement qu’aucun autre philosophe anti-despotique du xviiie siècle ne l’a fait ni le fera ? Quant à Sartine, lieutenant de police « proche » du philosophe, n’était-il pas aux yeux de Diderot, plutôt qu’un véritable censeur, un ami et conseiller ? Il lui permit en tout cas à la fin de sa vie de devenir « censeur » lui-même (de l’abbé Morellet notamment), c’est-à-dire un lecteur critique, attentif aux idées fausses des autres écrivains, mais se gardant de rien interdire. Le véritable rôle de censure publique, spontanée et non répressive, est joué, ensuite, par le théâtre, à la fois une école de vertu et un lieu de représentation et de discussion publique (visible) des enjeux philosophiques propres à chaque époque de l’histoire intellectuelle, dont l’auteur met bien en valeur l’importance, à la fin de son analyse (p. 186-188).
Voilà la « politique des Lumières » de Diderot, que C. Duflo expose dans ses chapitres viii, x et xi, qui couronnent ce portrait complexe et cohérent d’un philosophe qu’on peut considérer, suivant cette lecture, comme le dernier des clandestins.
Paolo Quintili
Iman Abou El Seoud, Complicité et sédition dans la littérature pamphlétaire de l’Ancien Régime. Images du lecteur et de l’auteur, Paris, Éditions Le Manuscrit, coll. « Réseau Lumières », 2013, 2 vol., 403 et 189 p.
Dans les deux volumes qu’elle consacre à la littérature pamphlétaire des deux dernières décennies de l’Ancien Régime, I. Abou El Seoud développe d’abord un double objectif : elle se propose en effet de dégager les deux images textuelles, symétriques et complémentaires, du lecteur et de l’auteur dans un corpus de pamphlets bien connus des historiens du livre et de la lecture (notamment de Robert Darnton), mais qui n’ont été jusqu’ici qu’exceptionnellement redevables à ce type de questionnement littéraire.
Le corpus retenu comporte en fait quelques-uns des best-sellers de la littérature clandestine qui, dans les deux décennies précédant la Révolution, prennent pour cibles Louis XV, Mme du Barry, le chancelier Maupeou et enfin, dans un deuxième temps, la reine Marie-Antoinette. D’une hybridité générique flagrante et, corrélativement, d’une grande variété formelle (la variété des titres : « Mémoire », « Vie privée », « Portefeuille », « Correspondance », « Conte », « Procès », est à cet égard significative), ces textes ont pour auteurs des pamphlétaires connus : Pidansat de Mairobert, Théveneau de Morande (auteur du fameux Gazetier cuirassé), Coquereau, Ange Goudar et Moufle d’Angerville.
En s’appuyant de manière très pertinente sur les diverses approches théoriques du lecteur et sur l’esthétique de la réception, en prenant en compte le « stéréotypage » des lecteurs (travaux de Ruth Amossy notamment), I. Abou El Seoud souligne une première ambiguïté : le pamphlet implique d’une part un lecteur passif, prêt à se laisser guider dans les méandres secret des élites du pouvoir, mais il exige aussi, d’autre part, un lecteur complice et actif, à l’affût des moindres allusions et insinuations. L’analyse du Portefeuille d’un Talon Rouge décèle toutefois des images de lecteur textuel infiniment plus complexes et ambiguës : les réactions du lecteur naïf et celles du lecteur sceptique, difficile à convaincre de la prétendue innocence de Marie-Antoinette, se chevauchent dans un texte amplement dominé par l’antiphrase.
Iman Abou El Seoud s’attache par ailleurs aux multiples indices dont le pamphlétaire dispose au niveau du paratexte – et particulièrement dans le titre, élément décisif dans l’achat puis la lecture du livre
prohibé. Les exergues, les indications éditoriales (souvent imaginaires mais riches de connotations), les préfaces sont également minutieusement analysées dans la même perspective. Enfin l’intertextualité foisonnante de ces pamphlets implique tout particulièrement l’image d’un lecteur dont la connivence doit être acquise jusque dans la subversion des codes littéraires communément acceptés par les élites cultivées du temps.
L’étude consacrée à l’image de l’auteur met à juste titre l’accent sur le caractère fuyant, évanescent et surtout protéiforme du pamphlétaire qui, développant et croisant de multiples formes génériques, revêt nécessairement de multiples masques : éditeur, épistolier, conteur, dramaturge, historien, moraliste, gazetier, chroniqueur. I. Abou El Seoud s’appuie ici à la fois sur la théorie de la polyphonie et, pour mieux cerner les stratégies que le pamphlétaire emploie à l’égard de son lecteur, sur les trois grands modes d’orientation vers autrui que distingue la rhétorique classique : le logos, le pathos et l’ethos.
L’analyse des modalités de la dégradation et de la disqualification des cibles du pamphlet met en jeu des études proprement stylistiques d’une grande précision, qui mettent en exergue un autre type de polyphonie : la véhémence du discours agressif et le discours biaisé de l’insinuation.
Les analyses d’I. Abou El Seoud, parce qu’elles sont précisément centrées sur l’écriture pamphlétaire, permettent en fait de mieux comprendre comment ces écrits prohibés ont puissamment concouru à rapprocher – et par là même à désacraliser – les élites politiques, à créer un véritable répertoire de personnages nocifs, voire maléfiques, stéréotypés et à cristalliser ainsi les frustrations et les ressentiments d’un ample public à la veille de la Révolution française.
Jean-Jacques Tatin-Gourier
Université François-Rabelais de Tours
Georges Minois, Dictionnaire des athées, agnostiques, sceptiques et autres mécréants, préface d’André Comte-Sponville, Paris, Albin Michel, 2012, 460 p.
Ce dictionnaire prosopographique cite dès les premiers mots de son « Avertissement » quelques lignes du discours préliminaire du Dictionnaire des athées anciens et modernes de Sylvain Maréchal pour en tirer la leçon qu’« [a]ujourd’hui comme en 1800, l’athée n’est toléré qu’à condition qu’il se taise » (p. 11). Que ce jugement entraîne ou non l’assentiment du lecteur, il trahit l’esprit d’une entreprise où, comme chez son devancier, la démarche historique est indissociable d’un diagnostic au présent sur son objet de recherche. Pour le dire autrement, Georges Minois, à l’instar de Sylvain Maréchal, a la compilation militante : la volonté n’est pas tant de recueillir un héritage – d’ailleurs l’auteur renonce sagement à l’exhaustivité – que d’indiquer les jalons d’une mémoire engagée. On ne s’étonnera donc pas de voir le parcours entraîner de l’Antiquité, bien représentée, à l’extrême contemporain des Richard Dawkins, Michel Onfray, Danièle Sallenave, voire André Comte-Sponville, le préfacier, qui peut ainsi saluer cette initiative et commenter sa propre entrée.
En parcourant les quelque quatre cents pages de ce dictionnaire, on découvre le militantisme athée en Inde du temps de Gandhi (Gora) et on redécouvre les tentations athéisantes de la crise moderniste des études bibliques (Loisy), les retombées idéologiques des débats scientifiques (Einstein, Hawking) ou les difficultés de l’engagement (Rushdie). G. Minois propose un « dictionnaire des incroyants au sens large » (p. 13), ce qui lui permet, par exemple, de souligner les potentialités incrédules de Malebranche. Les notices sont de tailles variables et, dans l’ensemble, assez courtes, ce qui pousse au résumé laconique des thèses et des actions des personnages étudiés. Les plus longues ne dépassent pas la demi-douzaine de pages : ce sont, sans grande surprise, les notices consacrées à Spinoza et à Voltaire. La variété des interprétations dont ils ont été l’objet n’est pas oubliée. On vérifie ainsi qu’une place déterminante et même majoritaire est accordée dans ce dictionnaire aux grandes figures classiques : rien que pour le siècle des Lumières, ce sont plus de 115 notices qui sont rédigées, avec les grands noms attendus (d’Holbach, La Mettrie, Collins, Boulanger, Condorcet, Sade, d’Alembert, Rousseau, Diderot, etc.) mais aussi, et cela rend la consultation encore plus intéressante,
les intermédiaires discrets de la littérature manuscrite et clandestine (le prince Eugène de Savoie et le baron Hohendorf, Charles Levier, Rousset de Missy, etc.) ainsi que les figures d’Europe du Nord ou italiennes, souvent minorées (Reimarus, Giannone, Radicati, etc.). On appréciera aussi l’attention portée aux formes littéraires de l’irréligion, que ce soit le roman antireligieux (les Lettres iroquoises de Maubert de Gouvest) ou la poésie matérialiste de Martin de Bussy.
Chaque notice se termine par une succincte bibliographie qui compte rarement plus d’un titre : on soupçonne qu’il s’agit aussi de la source principale de l’article. Et c’est par là que l’entreprise trahit ses faiblesses : quand certaines entrées renvoient, sans plus de précision, à la seule présence dans le Dictionnaire de Maréchal (Baptiste Pio, etc.), d’autres s’en tiennent à des références étonnamment anciennes (Damiron en 1857 pour Naigeon !), ou s’en remettent un peu trop exclusivement aux données fournies par Jonathan Israël (Hakvoort, etc.). C’est dire si la compilation, dont Georges Minois s’est fait depuis plus de vingt ans une spécialité de manière prolixe, s’appuie sur des données qui ne sont pas toujours les plus adaptées ou sur de la littérature qui est déjà elle-même de l’ordre de la compilation (qui peut être, au demeurant, remarquablement informée) : la compilation de compilation révèle ainsi ses limites. On notera cependant des renvois à des publications récentes d’excellent niveau (Boulanger, etc.). Plus donc que leur ancienneté, c’est l’hétérogénéité des sources qui manifeste chez l’auteur une curiosité plus ou moins bien renseignée. Ce constat s’imposait déjà dans l’évaluation de son travail d’historien au long cours de l’athéisme (Histoire de l’athéisme, Paris, Fayard, 1998), il n’est pas surprenant que, pour une entreprise qui se veut encore plus synthétique, vulgarisatrice et engagée, une certaine défiance envers la conduite scientifique de l’ouvrage puisse surgir ponctuellement avec plus de netteté encore. Cela n’ôte rien cependant au plaisir de butiner dans cet ensemble de notices qui, à défaut d’être toujours de référence, réservent bien des découvertes et des surprises.
Alain Sandrier
Ferrante Pallavicino, Libelli antipapali. La Baccinata e il Divorzio celeste, a cura di Alessandro Metlica, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011.
Depuis quelques années, les éditeurs italiens font un effort considérable pour porter à la connaissance du public une série de textes libertins du xviie siècle qui permet d’affiner notre approche de cette période encore insuffisamment étudiée à sa juste valeur (on rappellera pour mémoire L’alcibiade fanciullo a scuola d’Antonio Rocco, philosophe de l’académie des Incogniti, Il puttanismo romano du pamphlétaire Gregorio Leti et le roman érotique de Girolamo Brusoni, Degli amori tragici, tous trois parus chez l’éditeur romain Salerno, respectivement en 2003, 2004 et 2009). Le même éditeur avait également publié, en 2005, de l’auteur qui nous intéresse ici, son bref roman crypto-politique, Il principe ermafrodito (1640), traduction romanesque des idées libertines défendues par le cénacle vénitien, ainsi qu’une intéressante monographie (Raffaele Urbinati, Ferrante Pallavicino. Il flagello dei Barberini, 2004). Plus récemment, en 2009, l’éditeur turinois UTET avait publié une anthologie des œuvres de Pallavicino, comprenant l’un des pamphlets anti-barbériniens, trois romans et la parodie obscène du traité de rhétorique jésuite, La retorica delle puttane, jadis exhumée par Apollinaire, tandis que la publication critique d’un de ses romans bibliques (Il Giuseppe) est annoncée comme imminente. L’écrivain, qui fut surnommé par J. Lucas-Dubreton, « L’Arétin manqué », est issu d’une des plus illustres familles aristocratiques de Plaisance, eut une existence mouvementée tout en ayant été d’une prolixité stupéfiante (onze romans, quatre ouvrages de dévotion, de nombreux panégyriques, des discours académiques, des nouvelles et lettres amoureuses, des pamphlets) en l’espace de quelques années (toute sa production littéraire fut publiée entre 1635 et 1643). Son parcours fulgurant s’arrête net à Avignon en mars 1644, décapité par les sbires du pape, directement mis en cause par les deux pamphlets que l’éditeur italien dell’Orso, publie aujourd’hui dans une excellente édition critique, d’une clarté et d’une probité qui forcent le respect.
Après une introduction bien documentée qui retrace le parcours littéraire et intellectuel de l’auteur, en le plaçant dans le contexte « libertin » de l’époque, Alessandro Metlica montre avec pertinence la cohérence de ce parcours qui aboutit très logiquement vers ces ultimes pamphlets,
symboles d’une certaine « littérature d’opposition » (p. 7), mais qui se démarque de la tradition de la génération précédente (Campanella, Bruno, Galilée) par une recherche effrénée de la nouveauté, y compris sur le plan rhétorique du langage. Est rappelée ici opportunément l’importance du laboratoire expérimental que constitua pendant près de trois décennies, l’activité académique des Incogniti. Les liens étroits que ces académiciens – et Ferrante Pallavicino en tête – entretiennent avec l’actualité, se retrouvent sous la forme cryptée de l’écriture romanesque (dans la fiction épistolaire du Corriere svaligiato par exemple, dont l’influence se fera ressentir au siècle suivant chez un Lesage et sa Valise trouvée) ou encore dans le compte-rendu historico-journalistique (voir les Successi del mondo dell’anno mlcxxxvi, témoignage éloquent des horreurs de la Guerre de Trente ans). La critique virulente contre la corruption des Barberini – qui d’une certaine façon plaçait l’écrivain dans une position délicate vis-à-vis de ses confrères académiciens, parfois plus conciliants avec la curie romaine – était déjà perceptible dans le roman du Courrier dévalisé, dans lequel plusieurs missives s’en prenaient frontalement à la politique belliciste et agressive d’Urbain VIII. La Baccinata, publié en 1642 et traduit en français dès 1644 par Jean Gibaud, est la première réponse du polémiste face à cette politique. À travers l’image du bassin de cuivre que l’on frappe pour rappeler les abeilles (symbole des Barberini) qui se sont échappés de leurs alvéoles avec des intentions belliqueuses (allusion à la guerre du duché de Castro que le pape voulait reprendre aux Farnèse), Pallavicino écrit l’un des textes les plus sulfureux de la littérature pamphlétaire, dont Lucas-Dubreton a pu dire, dans sa monographie de 1923, qu’il était « une satire ménipée en miniature », constituée de « phrases nerveuses, ardentes, qui rappellent les temps héroïques. Depuis longtemps l’Italie n’avait pas entendu pareil langage ».
Les deux textes répondent aux exigences propres du genre pamphlétaire : écriture virulente, parfois obscène, littérature de circonstance (la guerre du duché de Castro qui aboutit à sa destruction et à son annexion par le souverain pontife). Toutefois, Pallavicino n’est pas dans l’invective systématique (la réponse de Tomaso Tomasi, ex-collègue académicien, et partisan acharné du pape, dans son Antibaccinata, est de ce point de vue bien plus « maximaliste », pour reprendre la terminologie de Marc Angenot). Il n’hésite pas à user d’arguments logiques destinés à mettre le pape face à ses contradictions (les références bibliques sont
ainsi nombreuses pour dénoncer les écarts avec les préceptes primitifs de la Chrétienté). Les reproches portent ainsi sur l’illégitimité du pouvoir temporel, en contradiction avec les lois de la Providence divine (la confusion des deux pouvoirs est le signe de l’avidité du pape), sur les erreurs de jugement (le pape se trompe de cible en s’en prenant à un prince chrétien au lieu d’attaquer les infidèles). Autre point intéressant, qui nous ramène aux thèses unitaires de Machiavel : Pallavicino justifie quant à lui l’émiettement politique de l’Italie précisément parce qu’il sert de rempart aux ambitions expansionnistes du pape. Car c’est bien une attaque ad nominem et non une critique de l’institution qui anime la plume acérée de Pallavicino, qui s’en prend à Urbain VIII et non au Pape en tant que tel.
Les thèmes sont repris dans le pamphlet suivant, Il divorzio celeste (1643), également traduit en français (deux traductions anonymes parues en 1644, une troisième fut publiée à Metz en 1696, par un certain Brodeau d’Oiseville, comme l’atteste Bayle dans sa correspondance), dont le titre complet est : Le divorce céleste causé par les dissolutions de l’épouse romaine, et dédié à la simplicité des Chrétiens scrupuleux. Pendant longtemps, la paternité de cet ultime opuscule a été mise en cause, jusqu’à ce que la découverte, à la bibliothèque de Bergame, de la dernière lettre de Pallavicino, écrite en janvier 1644, deux mois seulement avant son exécution, a définitivement confirmé cette paternité, ainsi que le lieu d’édition de la princeps (Venise), qui indique que le manuscrit du Divorce a permis d’arriver en lieu sûr, précisément grâce à l’appui de l’Académie des Incogniti par le biais de son secrétaire, Agostino Fusconi, en contact avec le cousin de l’écrivain, Bartolomeo Albani. C’est à ce dernier que Pallavicino confia le manuscrit de son libelle, sur lequel le fondateur de l’Académie, Giovan Francesco Loredano, dont l’influence dans le milieu éditorial était alors immense, a apporté ses propres corrections. Dans ce texte étonnant, Pallavicino imagine que le Christ descend sur terre ; voyant l’état pitoyable de corruption dans lequel se trouve l’Église chrétienne, il décide de divorcer d’elle. La charge est ici bien plus virulente que dans le précédent pamphlet, même si la dimension allégorique n’exclut pas de nombreuses références à l’actualité politique (encore une fois à la guerre de Castro). Les critiques fusent contre le népotisme et les nombreux manquements du souverain pontife. L’auteur revisite la tradition arétinienne en accusant l’Église chrétienne épouse du Christ,
devenue la prostituée des papes, et singulièrement d’Urbain VIII. Le libelle, qui réactive, en l’inversant, le thème biblique de Babylone corrompue appliquée à la Rome papale, se présente ainsi comme la mise en bonne et due forme d’un procès visant à légitimer le divorce ; Saint Paul est chargé par Dieu de recueillir sur terre les preuves de l’adultère qui aboutira au divorce inéluctable. Au détour de ces critiques à charge, on remarquera la défense non moins acharnée de l’écrivain : « Ah, que la plume de l’écrivain ne se soumette point à cette tyrannie ! Qu’elle écrive en toute liberté ses propres sentiments » (p. 134).
Les thèmes repris de la Bacinata et du Corriere svaligiato, le style incisif, énergique, parfois à la limite de la correction grammaticale et qui révèle l’urgence dans laquelle l’auteur rédigea son libelle, montrent bien que le texte ne pouvait avoir été écrit que par Pallavicino. L’important et précieux apparat de notes qui éclaire avec pertinence le style parfois tortueux de l’écrivain, la qualité de la présentation, le soin avec lequel est reconstruit l’itinéraire complexe de ces deux ouvrages font de cette édition un modèle du genre qu’on espère très prochainement voir renouveler pour les autres textes de cet auteur fascinant.
Jean-François Lattarico
Giovanni Tarantino, Republicanism, Sinophilia and historical writing. Thomas Gordon (c.1691-1750) and his « History of England », Turnhout, Brepols, 2012, 626 p.
Cet ouvrage important – dans tous les sens du terme – se divise en deux parties : la première comporte une biographie intellectuelle de Thomas Gordon, un « athée religieux », une analyse de ses principales œuvres et de la place qu’il occupe dans le paysage intellectuel de l’Angleterre de Walpole, ainsi qu’un commentaire sur sa traduction de Tacite et de Salluste et sur son œuvre inédite Histoire de l’Angleterre ; la seconde partie est constituée d’une édition critique de son Histoire de l’Angleterre, qui va de la conquête normande jusqu’au règne de Jacques Ier.
La première partie est dense et très documentée, car Giovanni Tarantino suit de près l’évolution de la pensée de Gordon et son rôle dans toutes les grandes controverses de l’époque : le « procès » de William Whiston, l’affaire de Benjamin Hoadly, la crise de Sacheverell… Il précise les fréquentations de ce libre penseur : Walter Moyle, Lord Ashley, Robert Molesworth, Charles Montagu, John Toland… Il détaille le rôle de l’imprimeur Edmund Curll dans sa stratégie de contournement des lois qui cherchaient à imposer le silence sur les questions théologiques et sociales délicates (Licensing Act, 1737) et propose une analyse serrée de la pensée de Gordon, dans son association avec John Trenchard et dans l’héritage d’Anthony Collins, de John Locke et de Pierre Bayle sur le plan des idées religieuses et, sur le plan politique, d’Algernon Sidney, de James Harrington et encore de Locke. Gordon réduit la religion à la morale et la morale à un code de comportement socialement utile ; toutes les opinions proprement religieuses sont indifférentes et doivent être tolérées : les Chinois servent de modèle sur ce point. Gordon est l’héritier du Chinois qui figure dans le roman de Tyssot de Patot – dans les prisons de l’Inquisition à Goa – qui est « universaliste », « un dévot de la religion des honnêtes gens ». Les Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde de Jean-Frédéric Bernard, illustrées par Bernard Picart, le marquent également. Nous assistons à l’élaboration d’une pensée républicaine garantissant les droits de la conscience individuelle aussi bien que la solidité des institutions gouvernementales et la fiabilité de la justice. L’anticléricalisme – la dénonciation de « priestianity » (Gordon forge le mot) – et la tolérance sont les devises de
toutes ses batailles, connues par ses œuvres majeures composées en collaboration avec Trenchard, The Independent Whig et Cato’s Letters. Le baron d’Holbach traduit la première sous le titre L’Esprit du clergé, ou le christianisme primitif vengé des entreprises et des excès de nos prêtres modernes (Londres, 1767, 8o), traduction retouchée et « athéisée » par Naigeon, et The Creed of an independent Whig sous le titre Le Symbole d’un laïque, pamphlet qui a circulé sous forme de manuscrit clandestin. Radicati est un de ses lecteurs attentifs. Le choix de Caton (Cato’s letters) implique la vigilance constante dans la défense des libertés contre la tyrannie ; Tacite et Machiavel sont convoqués : l’analyse de cette œuvre permet à G. Tarantino d’entrer dans le débat critique entre Pocock et Skinner sur la « tradition républicaine » et sur le rôle de ces écrits dans la formation de l’esprit révolutionnaire dans les colonies américaines. Cette première partie dense et passionnante sert d’excellente introduction à l’œuvre inédite de Gordon, qui s’appuie sur le récit de Rapin-Thoyras et où est manifeste l’intention d’exploiter les archives historiques afin de promouvoir une certaine conception du rapport contractuel entre le souverain et ses sujets ; on y lit la volonté de résister à la fois à la menace jacobite et à l’alliance entre le gouvernement et le clergé anglican. L’étude de Tarantino est essentielle pour qui s’intéresse à l’évolution des idées religieuses et politiques en Angleterre et l’histoire de la diffusion des écrits de Gordon et Trenchard nous conduit dans le labyrinthe des traductions et des publications clandestines du baron d’Holbach et de Marc-Michel Rey8.
Antony McKenna
1 Theophrastus Redivivus, Edizione prima e critica a cura di Guido Canziani e Gianni Paganini, Firenze, La nuova Italia editrice, 1981, 2 vol. Les 18 et 19 juin 2012 eut lieu à l’ENS-Lyon le colloque « Entre la Renaissance et les Lumières, le Theophrastus redivivus, 1659 », dir. Pierre-François Moreau et Nicole Gengoux, dont les Actes vont paraître chez Honoré Champion.
2 La première anthologie date de 1996. Nous avons rendu compte dans un précédent numéro de La Lettre clandestine de l’une d’entre elles : Pierre Bayle, Diccionario histórico y crítico. Selección, traducción, prólogo, notas y diccionario del editor, por Fernando Bahr, Buenos Aires, El Cuenco de la Plata, 2010, 510 p., La Lettre clandestine, 2012, p. 442-445.
3 Dont six sont traduites de l’espagnol, une de l’italien et une de l’anglais.
4 Sylvain Matton, Le Clangor buccinae de Gabriel Poitevin et la tradition du matérialisme chrétien, Paris, Honoré Champion, 2007, préface de Miguel Benítez.
5 C’est à Catherine Volpilhac-Auger qu’on doit la découverte des remarques manuscrites (Bordeaux, B.M., ms. 2538) et de l’exemplaire de l’édition des Opera de Cicéron sur lequel un copiste anonyme a signalé les passages commentés par Montesquieu (Bordeaux, B.M., B403/1-2).
6 Douai, B.M., ms. 702.
7 La Religion des Hollandois, Representée en plusieurs Lettres écrites par un Officier de l’Armée du Roy, à un Pasteur et Professeur en Theologie de Berne, Cologne, chez Pierre Marteau, 1673, in-12, 142 p.
8 Signalons également la communication d’Eric Gasparini, « Essai sur la réception de l’œuvre de Thomas Gordon dans la France des Lumières », in Le Républicanisme anglais dans la France des Lumières et de la Révolution, http://lrf.revues.org/947