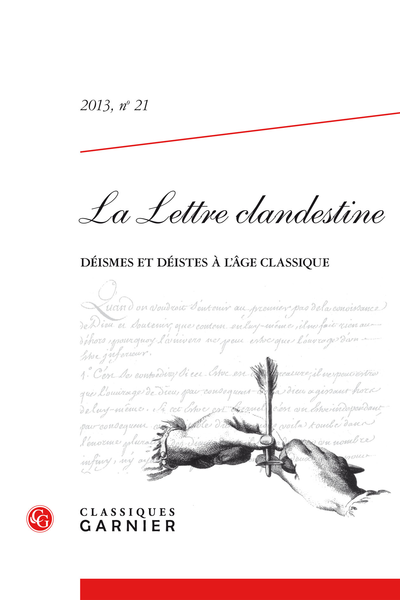
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : La Lettre clandestine
2013, n° 21. Déismes et déistes à l’âge classique - Auteurs : Cavaillé (Jean-Pierre), Mothu (Alain), Paganini (Gianenrico), Pascau (Stéphan), Agnesina (Jacopo), Hatzenberger (Antoine), Bourdin (Jean-Claude), Artigas-Menant (Geneviève), Boussuge (Emmanuel), Brucker (Nicolas), McKenna (Antony)
- Pages : 477 à 539
- Revue : La Lettre clandestine
- Thème CLIL : 3129 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie moderne
- EAN : 9782812412479
- ISBN : 978-2-8124-1247-9
- ISSN : 2271-720X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1247-9.p.0477
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/09/2013
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
Les Aventures satiriques de Florinde, édition de Filippo D’Angelo, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du xviie siècle / Littérature, libertinage et spiritualité », 2012, 182 p.
Je n’écris que pour me complaire,
C’est mon plaisir que de déplaire
Suivant mon caprice rythmeur.
Il suffit, j’estime ma plume
Qui voudra lire ce volume
Se forme selon mon humeur.
Ces quelques vers liminaires donnent le ton des Aventures satiriques de Florinde, habitant de la basse région de la lune, roman comique publié anonymement en 1625, dont Filippo D’Angelo, présente ici l’édition critique1. L’année de parution est celle du procès contre Théophile de Viau. Il est justement question dans le texte, comme le fait remarquer D’Angelo, des persécutions subies par un poète de vers satiriques par les autorités religieuses de son pays. On y trouve d’ailleurs mis en scène le couple du « libertin » poursuivi et de son puissant protecteur, qui apparaît en 1623 dans la Première Journée de Théophile et dans le Francion de Sorel. D’Angelo, tout en précisant que l’auteur, faute de documents supplémentaires, est destiné à rester dans l’ombre, montre qu’il pourrait correspondre à Guillaume Colletet, impliqué dans le scandale du Parnasse satyrique qui avait conduit à l’arrestation de Théophile.
Inspiré du modèle du Satiricon réactivé par John Barclay dans son Euphormion, Florinde est l’un des premiers romans français écrits à la première personne. « Satirique », il l’est au sens latin du mot satura, mélange de genres, des styles et des matières. Ainsi l’œuvre présente-t-elle un mélange serré de prose et de vers et à un enchâssement d’histoires et de péripéties diverses (D’Angelo parle de « collage narratif »), le plus
souvent érotiques mais aussi marquées par la fuite, la poursuite et la peur. L’auteur s’y livre enfin à une pratique intertextuelle de l’emprunt : adaptation de situations narratives préexistantes (Apulée, Boccace, Tasse, Morlini), mais aussi réutilisation de longs extraits tirés de Lucien, de Boèce ou de Barclay.
Dans l’Épître au lecteur, l’auteur anonyme revendique « la liberté d’écrire et de nommer les choses par le nom qui leur est proprement donné » et de « faire paraître les choses telles qu’elles sont sans aucun déguisement ». En effet, l’œuvre offre des scènes d’une verdeur et d’une crudité parfois étonnante ; aussi personne ne peut-il croire, comme il est aussi affirmé dans la même épître, qu’« en mettant devant les yeux » de « honteux spectacles », il s’agit de nous faire « abhorrer les ébats voluptueux ». Le lecteur habitué reconnaît là l’ordinaire rhétorique protective et conjuratoire, qui sert de caution et de viatique aux audaces et aux dévergondages littéraires les plus osés. D’ailleurs, on (n’)ose penser aux lieux suggérés par l’auteur avec sa topographie des « basses régions de la lune ».
La verdeur est celle des audaces du Parnasse satyrique ou des Priapées de Ménard. Un seul exemple :
Si j’avais foutu la beauté
Que soulait adorer mon âme,
Je pourrais dire en vérité
Qu’apaisant l’ardeur de ma flamme
J’aurais mi la gloire à l’envers
Et, pénétrant dedans son centre,
Foulé, non des pieds, mais du ventre,
L’arrogance de l’univers.
Les scènes érotiques décrites sont parfois très… novatrices et nous projettent bien un siècle au-delà, par exemple lorsque le sujet hétérosexuel, en pleine action, devient en même temps, par une sodomie intempestive, passif… dans l’action : « j’embrasse la jeune dame qui n’était encore couchée et, tout ardent sans plus attendre, je la jette sur le lit. Polybe, appris en Italie aux sales ébats défendus, ne tarde point de venir après moi et, me surprenant par derrière, me veut faire agent et patient tout ensemble ».
D’Angelo, dans son introduction, souligne une approche moniste de l’acte érotique, comparable à celle Montaigne : « Florinde, lors d’une
des scènes érotiques les plus puissantes du récit, évoque son bonheur sensuel comme une expérience à la fois de plénitude et de dissolution de son être tout entier. […] dans le domaine érotique, la rébellion libertine est une protestation du corps contre la tyrannie d’une âme conçue, sur le modèle platonicien, comme entité totalement désincarnée […] le message subversif des libertins du xviie siècle consiste à dire que c’est le corps qui est prisonnier d’une âme faussement dominatrice » (p. 18-19). Le curateur nourrit alors son analyse par l’application, au demeurant judicieuse, de concepts deleuziens : machines désirantes, corps sans organes, littérature mineure…
Pour ma part j’insisterai en outre sur la dimension onirique de l’érotisme du texte, à la fois dans la succession des scènes, insensible ou par rupture subite, et par leur composition et dissolution, un long rêve raconté et/ou vécu en première personne. Un seul exemple, pour vous mettre en appétit :
Nous nous serrons de près, nous nous froissons contre elle, et les tenant étroitement embrassées, sans repenser à mes afflictions, m’y portant insensiblement comme les autres, nous les versons par terre, nous baisons, nous exerçons mille blandices ; et, tâchant d’en tirer le souverain délice d’amour, l’ardent désir qui nous presse nous chatouille si vivement qu’empêchés de nous mettre à couvert par la résistance que les jeunes pucelles font en ces premières escarmouches, nous leur barbouillons le ventre d’une liqueur nectarine qui ne se peut longtemps retenir.
Ô doux bruit, doux étonnement,
Ô pluie sur tout désirable,
Ô grêle douce et favorable
Qui cause un tel contentement.
Ô tempête délicieuse
Qui tant de plaisirs gracieux,
Tant de plaisirs délicieux
Nous as moyenné gracieuse !
Jean-Pierre Cavaillé
Denis Sanguin de Saint-Pavin, Poésies, édition de Nicholas Hammond, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du xviie siècle / Voix poétiques », 2012, 235 p.
Il faut saluer la parution de la première édition complète et critique des Poésies de l’abbé de Saint Pavin (1695-1670), dont les manuscrits dorment pour la plupart dans le fond Conrart de la Bibliothèque de l’Arsenal. À l’exception d’une poignée de pièces (moins d’une dizaine), cette production abondante – il nous reste 218 poèmes – ne fut pas publiée à l’époque, et en effet, pour une partie considérable de ces pièces, leur diffusion imprimée était difficilement imaginable. Ainsi furent-elles réservées par l’auteur et ses destinataires à une circulation des plus restreintes.
Saint-Pavin avait en effet la réputation d’être le « roi de Sodome » et une bonne partie de son œuvre est consacrée à soigner cette réputation en chantant les agréments et les mérites des amours contre-nature.
Lui-même aime à se donner dans ses vers l’épithète de « bougre ». La sodomie est chez lui comprise et pratiquée dans le sens que lui donnait l’époque, c’est-à-dire avec l’un et l’autre sexe (tout en affirmant une nette préférence pour les garçons). Beaucoup de vers visent en tout cas à persuader les femmes de se laisser traiter de la sorte : « Ce qui fait que chacun vous aime / N’est pas ce que je prise en vous » (XXXVII). Les arguments, on s’en doute, touchent d’abord au mot d’esprit : « Pour avoir souffert mes caresses, / On ne perdit jamais ses fleurs. » (jeu sur la fleur du pucelage et les fleurs des menstrues, XXXI) ; « J’ai connu cent filles, plus belles, / Qui ne laissent pas, toutefois, / De se vanter d’être pucelles » (XXIX), etc. Souvent, ces dames ne sont guère d’accord : « Vraiment voilà bien la façon / De me guérir du mal de mère. // Un novice dans sa maison / Le pourrait bien souffrir d’un Père ; / Mais avec moi, c’est sans raison / Puisqu’autrement on le peut faire. » (XXXIII). Le fantasme du travesti dont les romans et le théâtre du temps sont remplis, est traité de la manière la plus crue : de celle qui se vêtit en page pour qu’on la laissât entrer chez le bougre invétéré, il écrit : « Je l’ai traité comme une fille / Qui voulait passer pour garçon » (XXXI).
Les conseils ne manquent pas pour engager les amis à en faire autant : « Fous sûrement […] / Galien, Descartes, Bartole /… / Ne t’apprendront point comme on fout / Pour s’exempter de la vérole » (XXIV). Théophile
de Viau, dans le fameux sonnet foutatif qui est un peu à l’origine de tous ses malheurs, invitait à utiliser le même préservatif contre la syphilis : « Je fais vœu désormais de ne foutre qu’en cul ! ». Lorsqu’il est travaillé par ses infirmités, Saint-Pavin se voit pour sa part contraint de revenir à des pratiques plus commodes : « Je ne puis plus foutre qu’en con » (XLV)… avoue-t-il piteusement.
Théophile, qu’il a connu, comme Des Barreaux qu’il semble avoir longtemps fréquenté, sont plus d’une fois évoqués. Du premier il affirme par exemple, qu’il se faisait payer en nature « sur » les amants qui lui demandaient des vers pour leurs maîtresses. Dans une plainte à Des Barreaux, directement inspirée par la Plainte de Théophile à son ami Tircis, il évoque des souvenirs communs, assez édifiants, sur diverses frasques commises « aux eaux » de Bourbon.
Comme le remarque bien Nicholas Hammond, une dimension très importante du personnage qui, comme Théophile et Des Barreaux, construit dans ses vers sa propre figure, est sa difformité, ses infirmités et sa laideur, qu’il met en avant, tout comme sa sodomie, avec esprit et effronterie, en les intégrant à son hédonisme insouciant et de ses paradoxaux succès amoureux : « La Nature, injuste, me fit, / Court, entassé, la panse grosse ; / Au milieu de mon dos se hausse / Certain amas d’os et de chair… » (CCXVIII). Il arbore ainsi son infirmité avec la même aristocratique désinvolture que sa bougrerie. « J’en goûte encore, quoique perclus, / Qui pourraient bien te faire envie, / Mais quand je les prends, en un mot, / Crois-moi, ce n’est pas comme un sot. » (XCI). Et, quel que soit son état, il ne doute point que Madame de Sévigné le préfèrera aux rustres rougeauds de la Bretagne où elle séjourne (CXLIV). Il y a toute une réflexion à poursuivre sur ce travail de la distinction qui passe par une façon toute aristocratique de vivre l’infirmité et la déviance sexuelle, auxquelles la pratique poétique, strictement destinée à une microsociété élitaire, a pour fonction de conférer sa forme propre.
En dehors de quelques pointes anticléricales, Saint-Pavin ne perd guère de temps à évoquer la religion, mais ses idées en la matière sont faciles à déduire, par exemple, de son épitaphe au baron de Blot (« Du présent il a dit merveille / Du futur ce qu’il a pensé, / Ne s’est révélé qu’à l’oreille ; / Mais chacun tient pour vérité / Que jamais il n’en a douté » CLXXXVII) ; de ses vers sarcastiques sur les atermoiements entre créance et mécréance de Des Barreaux (« Qu’il mette son étude / À jouir
du présent : C’est toujours le plus sûr » CXCVI) ; de son autoportrait : « Mon teint est jaune et safrané, / Du coloris d’un vieux damné, / Pour le moins qui le doit bien être, / Ou je ne sais pas m’y connaître […] Enfin, je trouve tout égal, / Et je ne fais ni bien, ni mal » (CCXVIII). Cet indifférentisme moral est associé à la revendication d’un hédonisme exacerbé, comme dans les pièces de Blot ou de Des Barreaux, mais sans aucune exaltation naturaliste ni rébellion misologique. Saint-Pavin écrit simplement : « N’écoute guère la Morale ; / La Nature, plus libérale, / Nous accorde, le plus souvent, / cent choses que l’on nous défend » (CCXVII). Trois petits vers suffisent à dire sa position : « L’indolence fait mon étude. / Je n’ai pas même inquiétude / Pour les choses de l’avenir » (CIX).
On découvre avec Saint-Pavin, jusqu’où pouvait aller la liberté de ton sinon de mœurs dans les cercles aristocratiques auxquels il appartenait, fréquentés par des hommes comme Des Barreaux ou Blot, certes, mais aussi par de très respectables personnes, comme la marquise de Sévigné, auquel il écrit des pièces, ou le très sérieux Valentin Conrart, destinataire d’une étrange lettre amoureuse joco-sérieuse composée par le roi de Sodome et collectionneur avide des écrits de ce roi.
Jean-Pierre Cavaillé
Jean-François Lattarico, Venise incognita. Essai sur l’académie libertine au xviie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 488 p.
Cet ouvrage est le premier en France consacré à l’académie vénitienne des Incogniti (Inconnus ou plutôt Anonymes) mais, surtout, il présente tout un parcours de recherche au contact de sources textuelles remarquables, souvent méconnues en Italie même. Le livre ne fait pas l’histoire de l’institution, sur laquelle il y a encore beaucoup à dire, mais plutôt sur le rôle joué par ses membres dans « l’émergence de nouvelles formes littéraires » et dans la « prise en compte nouvelle des rapports entre le lettré et son public » au cours du procès d’autonomisation du métier d’écrivain, à travers une série d’études approfondies sur les productions d’un ensemble d’auteurs associés à cette prestigieuse académie, fameuse dans toute l’Europe2. Car s’il y a une culture de l’incognito chez les « inconnus », elle est fort ostentatoire ! Ce paradoxe est bien souligné par l’auteur : « l’Académie prône, pour atteindre la prestigieuse renommée littéraire, la plus explicite des publicités » ; ce dont témoigne par exemple les ouvrages collectifs publiés sous le patronage de l’académie, avec les noms des auteurs académiciens bien en évidence (recueils de nouvelles, de vers, de discours académiques et surtout le panégyrique collectif de 1647 intitulé Le Glorie degli Incogniti). Ces auteurs, tous admirateurs de Marino, sont animés par une recherche perpétuelle de la « nouveauté » et de cette nouveauté qui produit l’émerveillement du lecteur (« È del poeta il fin la meraviglia ») ; la délectation, par le rire, l’irrégularité, l’érotisme prenant largement le pas sur l’édification.
Dans la production diversifiée et foisonnante des Incogniti, Jean-François Lattarico s’intéresse d’abord à l’émergence de nouveaux genres promus au sein de l’académie, ceux en particulier qui infusent dans le lecteur les venins de la dérision, de la sensualité et d’une certaine tiédeur (sinon une certaine hostilité) pour les choses de la religion. Gianfrancesco Loredano, prince incontesté et vénéré de l’académie et son comparse Pietro Michiele, dans leur recueil d’épitaphes burlesques intitulé Il Cimitero (Le Cimetière), remarquent d’ailleurs « combien il est
malaisé de faire des plaisanteries sans apparaître le moins du monde impie et obscène ».
Lattarico s’attache d’abord (Première partie) aux genres qui se nourrissent de l’épopée, désormais contestée, avec, en premier lieu sa réécriture burlesque qui donne lieu à l’épopée héroïco-comique et à son « corollaire » : le travestissement parodique. Sont ainsi passées en revue l’Iliade giocosa (L’Iliade plaisante) de Loredano et les grandes œuvres de Giovan Battista Lalli : l’Eneide travestita (1634), bien sûr, qui allait (notamment) inspirer le Virgile travesti de Scarron ; les Rime del Petrarca in stil burlesco, qui joue cette fois avec le modèle de la versification moderne par excellence ; la vaste Franceide, en 6 chants, entièrement consacrée au « mal français » (voir la belle traduction du médecin Le Pileur sur le site Gallica) et, surtout La Moscheide ovvero Domiziano il moschicida (La Moschéïde, ou Domitien le mouchicide), petit divertissement de 3104 vers…
L’auteur envisage ensuite, à partir de la même épopée dégradée, la création du genre romanesque au sens moderne du terme, qui participe aussi de l’histoire, telle qu’elle est théorisée au même moment par Antonio Mascardi dans son Arte Historica (en particulier concernant « les rapports rhétoriques que l’histoire établit avec la poésie et l’art oratoire, dans le but de susciter les passions »). Mais la conscience de forger un nouveau genre est très aiguë : comme l’écrit Girolamo Brusoni, l’un des piliers de l’académie, « cette manière de composer qu’on appelle moderne n’est pas autre chose qu’une écriture conforme à son [propre] génie, sans égards pour les maîtres anciens ou modernes » (La Fuggitiva). Lattarico s’arrête surtout sur la production romanesque de Francesco Pona, auteur de l’incroyable « roman métempsychotique » La Lucerna. Ainsi examine-t-il en particulier l’allégorie romanesque de La Maschera iatropolitica, ovvero cervello e cuore prencipi rivali aspiranti alla monarchia del microcosmo (Le Masque iatropolitique, ou cerveau et cœur princes rivaux aspirant à la monarchie du microcosme ; voir l’édition moderne de F. Biondi, Trento, 2004), l’une des plus grandes étrangetés littéraires du xviie siècle, et La Messalina, sujet choisi pour son caractère on ne peut plus sulfureux (« au simple coup d’œil, les plus vigoureux avaient sa préférence », écrit Pona…), racheté, mais non entièrement, par les commentaires moralisateurs.
Lattarico passe ensuite, dans une deuxième partie, à l’importante production des livrets d’opéra. Le théâtre musical (dramma per musica),
devient en effet à Venise une véritable entreprise commerciale à travers la brève expérience (1641-1645) du Teatro Novissimo, étroitement associé à l’académie, d’abord par la coopération littéraire (tous les librettistes étaient des membres de l’académie), et enfin lorsque l’un des académiciens, Girolamo Bisaccioni, en devient, pour sa ruine financière, à la fois le poète, l’impresario et le gestionnaire.
Sur le modèle romain, les Vénitiens s’emploient dans leurs opéras à la transposition parodique de sujets mythologiques. L’auteur s’attache surtout à l’analyse des principales œuvres de Giulio Strozzi : Il Natal di amore (sous-titré « anacronismo »), mélange de tragédie, de comédie et de pastorale (voir l’édition récente de Marco Arnaudo, 2010) ; Proserpina rapita ; La Delia overo la Sera sposa del Sole, premier dramma per musica (1639), puis la trilogie : La Finta pazza (1641), La Finta savia (1643) et Romolo e Remo (1649). Le théâtre de Strozzi est caractérisé par le triomphe de la sensualité et la multiplication des allusions obscènes, allant jusqu’à vanter, le cas échéant, les délices de l’homo-érotisme.
La condamnation douteuse, qui se retourne si facilement en apologie, du vizio nefando (« vice infame »), apparaît sous de nombreuses plumes, à la suite (entre autres) du fameux « capitolo » de Marino, l’invective « Contro il vizio nefando » publié à titre posthume à Venise, en 1626 (Lattarico lui consacre un chapitres). Mais Marino fut régulièrement accusé de sodomie, et lui-même écrivit des capitoli bernesques restés manuscrits, comme Lo Stivale (La Botte) qui ne font rien d’autres que l’apologie de la relation sexuelle a tergo. Par ailleurs, les figures satiriques du religieux et du pédagogue sodomites s’affirment comme l’un des lieux communs les plus solides et durables de l’anticléricalisme, servant même le cas échéant de couverture à l’expression de l’éloge du vice socratique sur fond de naturalisme déiste (l’Alcibiade enfant à l’école d’Antonio Rocco).
À côté de l’invective, de la satire et de la pornographie, l’homophilie s’exprime aussi et sans doute surtout, dans la littérature des Incogniti, à travers la figure de l’androgyne, déjà au centre de l’Adone, l’œuvre majeure de Marino (l’androgynie de l’Adonis du poème n’échappe à aucun de ses lecteurs). Entre autres œuvres, Lattarico analyse longuement le roman de Ferrante Pallavicino, Il Principe ermafrodito, dont le « héros » est une jeune princesse travestie en garçon par son père au nom de la raison d’État, afin qu’elle puisse lui succéder malgré l’imposition en son pays d’une loi salique. Toute l’intrigue est un jeu complexe de travestis
croisés comme les aime le théâtre « baroque », avec les effets de trouble du désir amoureux qui s’ensuivent, dans un remarquable brouillage des sexes et des genres.
Au-delà des équivoques du désir sexuel, affecté et infecté par les dispositifs de travestissements, là où règne justement la raison politique, la passion amoureuse ne saurait avoir droit de cité. Cette critique de l’amour sublimé, de l’effusion pétrarquiste, est sans appel (voir aussi notre édition récente d’Amour est pur intérêt, discours académique de Rocco). Loredano est sans appel, qui ose bien écrire : « L’amour n’est rien d’autre qu’une sale humeur / Qui se définit par ces deux mots : / Il entre par les yeux et sort par la bite » (Capricci di poesia diversi).
Toute la troisième partie du livre est dédiée à l’omniprésence de l’érotisme dans les écrits des Incogniti : dans la poésie pétrarquisante ou mariniste, dans la nouvelle et le roman « d’invention », dans les discours académiques, ou encore le dramma per musica. L’éros actif dans les nouvelles, genre particulièrement prisé des académiciens vénitiens est, remarque Lattarico, « avant tout pragmatique, charnel, tout entier voué à la jouissance, sans considération morale particulière autre que la satisfaction du plaisir » (p. 337). Ceci est parfaitement illustré par une courte phrase de Pallavicino, tirée de la nouvelle Li amici rivali : « le but de ses pensées amoureuses est finalement un lit, bien qu’elles feignent d’avoir pour idéal une beauté céleste ». La défense et éloge de l’amour charnel possède sans nul doute une dimension philosophique, clairement assumée par certains des académiciens, Rocco en particulier et Pallavicino, dont l’auteur cite un passage important de la « confession de l’auteur », à la fin de La Retorica delle puttane : « Nous devrions également avoir honte de boire et de manger, car je ne vois pas de différence entre se rassasier par la nourriture et satisfaire ses désirs charnels que je juge tout aussi naturels et nécessaires dans leur accomplissement ». Mais cet hédonisme exacerbé n’est nullement solaire ; Lattarico remarque que la plupart des personnages de roman (et de même des figures poétiques, toutes dérivées de Marino) paraissent sous la double pression de l’autoérotisme et de la tentation mortifère.
Trois études sur Giovan Francesco Busenello viennent clore l’ouvrage (Quatrième partie). Presque exclusivement connu pour ses mélodrames – il est l’auteur notamment du Couronnement de Popée mis en musique en 1642 par Monteverdi –, Busenello a laissé une importante production poétique,
romanesque et érudite restée à ce jour inédite. Lattarico procède à l’analyse de ses livrets (surtout celui de Il viaggio d’Enea all’inferno) et d’un roman inachevé que l’on voudrait voir publié : La Floridiana, qui évoque une île où l’on ne vénère que la seule Fortune (on trouve par exemple dans ce texte une belle exposition de l’imposture religieuse : « Ainsi l’esprit humain sut se figurer quelque chose au dessus de lui, pour pouvoir en tirer un profit personnel, en fabriquant des connaissances sur les ruines des ignorants »). Enfin Lattarico se penche sur l’imposant traité manuscrit conservé à la Marciana intitulé Della Retorica, source de première main pour l’analyse rhétorique des œuvres composées par Busenello pour la scène.
La conclusion intéresse essentiellement l’histoire de la littérature. Elle constate, dans les textes étudiés, l’« émergence d’une parole littéraire qui dit tout à la fois la subjectivité de l’écrivain par la singularité de son style, et son relatif effacement derrière une “voix” qui ne cesse de brouiller les pistes, de mêler les différentes instances narratives et finit pas “hypostasier” une écriture qui la fait naître » (p. 436).
Il s’agit sans nul doute d’un ouvrage important sur les productions d’un ensemble d’auteurs remarquables, bien que souvent méconnus, tous liés à l’académie des Incogniti. La seule critique que l’on développerait ici, si l’on en avait le loisir, porterait sur l’usage du terme « libertin », qui d’ailleurs ne désigne pas à proprement parler l’ensemble de l’académie (le titre, remarquons-le, évoque l’académisme libertin en général), dont tous les membres, d’aucune façon, ne pourraient être qualifiés de libertins. Si libertinage il y a (la notion, ici reprise du livre de Giorgio Spini, souffre toujours de manque de précision), il réside dans la production d’une littérature licencieuse et hétérodoxe (de nombreux livres des Incogniti, comme le remarque l’auteur, furent d’ailleurs mis à l’index), appuyée sur des soubassements philosophiques et « idéologiques » qui restent en partie à dégager. Le fait par exemple, qu’une majorité des auteurs dont il est ici traité aient été les disciples de l’aristotélicien Cesare Cremonini, comme le souligne Lattarico, n’est certes pas anodin, mais il reste, sur le plan de l’histoire des idées – et plus encore sur celui d’une histoire sociale des idées – encore beaucoup à découvrir sur les Incogniti.
Jean-Pierre Cavaillé
Jean-Paul Oddos, Isaac de Lapeyrère (1596-1676). Un intellectuel sur les routes du monde, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 312 p.
Isaac de Lapeyrère, Du rappel des juifs, 1643, texte original présenté et édité par Fausto Parente, traduit de l’italien par Mathilde Anquetil-Auletta, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque d’études juives », 2012, 172 p.
C’est à la sympathique et regrettée Élizabeth Quennehen, qui nous a prématurément quittés en avril 2011, qu’aurait dû revenir le soin de parler de ces deux ouvrages. Elle avait soutenu en 1993 à l’université de Paris I une thèse en Histoire sur Le Problème de l’unité du genre humain au xvie siècle : contribution à l’idée polygéniste, comportant une traduction des livres III et IV des Praeadamitae ; elle avait, entre autres publications, donné plusieurs articles sur Lapeyrère dans notre revue et avait offert aux Mélanges Madeleine Alcover (2006) un « Essai biographique » sur le même auteur qui fait aujourd’hui autorité3. Enfin, elle avait transcrit une grande partie des manuscrits de Lapeyrère conservés au château de Chantilly en vue de leur publication aux éditions Honoré Champion. Peut-être cet utile travail verra-t-il tout de même le jour ? C’est ce que nous permet en tout cas d’espérer la récente publication de la thèse en Histoire de Jean-Paul Oddos, Recherches sur la vie et l’œuvre d’Isaac de La Peyrère (1596 ?-1676), soutenue à l’Université de Grenoble II voilà près de quarante ans (1974) et qui paraît maintenant sous le titre, Isaac de Lapeyrère (1596-1676). Un intellectuel sur les routes du monde. Comme Oddos le dit lui-même (p. 297), la thèse de Pintard sur le libertinage érudit (1943) comportait la première étude d’envergure consacrée à Lapeyrère ; sa propre thèse a représenté à coup sûr la seconde, et la première monographie au format livre ; elle enrichissait notablement la documentation apportée par Pintard et conférait à l’auteur des
Préadamites et du Rappel des juifs un esprit sensiblement moins superficiel, léger et entêté, que ne le faisait son prédécesseur. Il devenait un esprit systématique et sérieux, un philosophe à part entière et même une sorte de cousin intellectuel du Spinoza théologico-politique (le « lien avec la pensée de Spinoza », affirmé p. 11, n’est cependant pas développé). Le nouveau titre, Un intellectuel sur les routes du monde, convient bien à l’ouvrage enfin paru, en effet largement consacré à retracer l’itinéraire à la fois géographique et historique de cet intellectuel très mobile que fut Lapeyrère (1re partie, p. 13-110). La deuxième partie, plus courte mais centrale pour Oddos, s’attache à reconstituer son « système théologico-politique » (p. 111-157), l’objet principal de l’auteur étant en effet de montrer que l’œuvre incomplète, fragmentée et en partie raturée de Lapeyrère « n’est en aucune manière une somme de spéculations disparates, mais un système unique, remarquablement ordonné, malgré les fluctuations que lui imprimèrent les circonstances historiques » (p. 11). Les deux dernières parties sont composées de « Documents sur la vie et l’œuvre d’Isaac de Lapeyrère » : lettres, poèmes ou actes notariés retrouvés (p. 159-275), puis d’un « Essai de bibliographie critique » (p. 277-303).
Nous n’avons pas collationné cette édition sur son original tapuscrit, mais le contenu en est apparemment le même, sauf quelques additions dans les notes de bas de page et dans la bibliographie, qui ne sont hélas pas signalées comme telles – à l’exception de deux « notes de 2010 », p. 24 et 97, où l’auteur tempère sa thèse suivant laquelle Lapeyrère n’avait pas d’origines marranes4. Ces quelques additions ne font que
mieux ressortir l’absence de dizaines d’autres qui auraient été possibles si l’auteur avait souhaité nous apporter une édition réellement actualisée, mais ce n’est manifestement pas le cas. Il n’est fait, par exemple, aucun cas des riches travaux, parfois complémentaires et parfois divergents, de Richard Popkin – dont les premières recherches sur Lapeyrère sont à peu près contemporains de celles de Oddos5 –, d’Élizabeth Quennehen, précédemment citée, de Giuliano Gliozzi (Adamo e il nuovo mondo, 1977 ; Adam et le Nouveau Monde, 2000) ou de David N. Livingstone (The Preadamite Theory and the Marriage of Science and Religion, 1992), pour ne citer que ceux-ci. Ainsi la question des « précurseurs » polygénistes du préadamisme (Paracelse, Bruno, etc.) reste-t-elle dans l’ombre, au prétexte douteux que « Lapeyrère ne semble pas avoir connu ses “précurseurs” » (p. 122, n. 29). Le choix de l’auteur était parfaitement compréhensible, son travail original remontant au début des années 1970 ; le lecteur peut cependant regretter l’absence d’un avertissement précisant ce point, tout comme l’absence de marquage précis des additions ponctuellement apportées au texte d’origine.
Pour le reste, cette publication n’est pas vaine, elle est même bien inspirée : elle se lit toujours avec plaisir et profit, restant indispensable à tous ceux qui sont et seront appelés à s’intéresser à Lapeyrère. Car dans la mesure où toute étude approfondie à son sujet doit encore s’appuyer, à un moment où à l’autre, sur un document publié par Oddos ou prendre en compte ses multiples interprétations et suggestions, il est utile de n’avoir plus à faire le détour par la bibliothèque de Grenoble ou de rechercher une reproduction artisanale de ce travail. En même temps, avec cette publication trop longtemps restée dans les limbes, les éditions Champion réparent une vieille injustice.
C’est aussi chez Champion, mais dans une autre collection, que vient de paraître le Rappel des juifs, publié par Fausto Parente, dont le français a été traduit de l’Italien par Mathilde Anquetil-Auletta. Le même auteur a publié en 2007, chez le même éditeur et avec la même traductrice,
Les Juifs et l’Église romaine à l’époque moderne, xve-xviiie siècles. Ici, il nous livre la première réédition de l’ouvrage saisi et interdit dès sa parution en août 1643 – quand le traité sur les préadamites, qui constituait selon Oddos la « clé de voûte de tout le système » eschatologique du Rappel (Oddos, p. 121), n’était alors connu qu’en manuscrit6.
Ce livre commence bien mal. Les vingt premières pages, correspondant aux premières sections de la Préface, qui couvrent globalement la biographie de Lapeyrère, sont truffées de fautes (quelques coquilles, beaucoup d’italianismes) qui en rendent la lecture fort pénible. L’orthographe des personnages y est fort malmenée : nous y croisons par exemple Marin de Mercenne (p. 9 et dans l’Index), Claude Soumaise (p. 11), l’« Archiduc Lepold » et l’« Archivesque de Malines » (p. 13), « le Condé » (p. 14 et ailleurs), « Mr. D’Aliegre » (scil. Aligre, p. 18), l’« Archiveque de Paris » (p. 19), etc., et même des erreurs plus graves, comme la mention d’« un éditeur, Matthieu Molé » (sic !), qui aurait offert en 1666 un privilège à Marolles pour la publication de son Nouveau Testament (p. 19) ! Rappelons qu’à cette date, le Premier président du parlement de Paris était mort depuis dix ans, et que le Nouveau Testament de l’abbé de Marolles était quant à lui paru depuis dix-sept ans (1649). En 1653, Molé avait obtenu pour Marolles un privilège pour une traduction de la Bible entière, à laquelle il déclare travailler avec « grand labeur » en 1666 et recrute Lapeyrère pour participer à l’annotation. Il faut croire que F. Parente a mal lu Oddos (op. cit., p. 108) ou que sa traductrice ne l’a pas compris. En tout cas, nous peinons à croire que ces vingt premières pages aient fait l’objet d’une relecture attentive et informée – non plus d’ailleurs que la quatrième de couverture, même si on la trouve un peu améliorée sur Internet.
Heureusement, ce n’était qu’un mauvais moment de lecture à passer et les choses s’arrangent par la suite. L’intérêt principal de cette réédition réside essentiellement dans les pages 21 et 64 de la Préface (sections IX à XVII), qui correspondent à un résumé assez méticuleux du livre de Lapeyrère (IX-XIII), suivi de quelques remarques à son sujet (XIV-XV) et au sujet de la réélaboration manuscrite inachevée conservée
à Chantilly, probablement destinée aux censeurs ecclésiastiques (XVI), puis de l’examen de la question de savoir pourquoi le Rappel fut supprimé (XVII). Une sorte d’appendice sur « Lapeyrère et la Bible. L’interprétation des miracles » termine cette Préface (p. 53-64). Sans doute toutes ces remarques correspondent-elles aux « notes supplémentaires de Fausto Parente » que nous annonçait maladroitement la quatrième de couverture de l’ouvrage car le Rappel lui-même n’en comportera aucune. On se demande aussi pourquoi les titres de chapitre figurant dans la Table des matières (p. 171) n’ont pas été reproduits – sauf l’appendice sur la Bible et les miracles – en tête des parties concernées de la Préface. Quoiqu’il en soit, si ces remarques sont globalement instructives, on ne peut pas dire qu’elles nous ouvrent de vastes horizons historiques, si ce n’est à propos de la relation faite entre Lapeyrère, Postel et Campanella quant au rôle eschatologique dévolu au roi de France dans le rappel des juifs (p. 45-46).
L’explication que F. Parente donne de la censure du Rappel de juifs peut aussi laisser perplexe. Il déclare, d’une part, que « l’œuvre fut séquestrée et pratiquement détruite, au point qu’il n’en reste que quelques copies qui aient échappé à cette destruction systématique », et parle même d’« acharnement » (p. 51), alors qu’il reconnaît que l’affaire n’est pas documentée. Surtout, il lui aurait été facile d’en repérer près de vingt exemplaires dans les bibliothèques françaises et étrangères7. D’autre part, il soutient que la censure et la suppression du Rappel sont imputables au philosémitisme excessif de l’auteur, soit à son exégèse outrée de la Lettre de Paul aux Romains (chap. xi) où il est dit que « Les juifs n’ont été rejetés que pour être un jour rappelés », c’est-à-dire convertis au christianisme, alors qu’ils forment le peuple déicide (ce thème est surtout traité dans le livre III du Rappel). Cette explication paraît un peu courte. L’apologie du christianisme apostolique des origines, associée à la critique de l’Église actuelle, chicaneuse et intolérante, que l’on trouve au livre V du Rappel, a probablement représenté un motif plus sérieux. Lapeyrère s’élève ainsi « contre cette Multitude innombrable de Canons & d’Articles de Foy
que les Chrestiens de ces derniers temps, & de toutes les Sectes obligent leurs Sectateurs de croire sur peine d’Anathème & de Damnation. Multitude d’Articles qui embarrasse les Consciences, qui accable les Esprits, et leur est un Joug insupportable, contre ce que Jesus Christ mesme nous a declaré de son Évangile : Mon joug, nous a-t-il dit, est leger » (p. 149) ; et il n’hésite pas à réputer « impudique » la foi que propagent ces modernes chrétiens, « abbaissée & precipitée » qu’elle est « de l’intellect aux sens » (150). À coup sûr, « la Foy des Chrestiens s’est corrompue par la depravation des hommes […] elle est devenuë quereleuse & Schismatique […], Sapience d’en-bas » (p. 151). Etc. Pouvait-on laisser passer ces insultes ?
L’appendice qui suit sur Lapeyrère, la Bible et les miracles (p. 53-64) concerne davantage les Préadamites que le Rappel, mais il pourra retenir l’attention des lecteurs de La Lettre clandestine. F. Parente souligne qu’avant Spinoza et Simon, Lapeyrère avait clairement posé le problème de la composition du Pentateuque, et la difficulté à démêler ce qui est inspiré de ce qui fut ajouté. La question particulière des miracles (p. 57 sq.) confirme cependant l’attachement de l’auteur à l’idée que les Écritures ne mentent pas, même quand il se montre simultanément réticent à admettre que le cours de l’univers puisse être bouleversé.
Ensuite vient le texte : une reproduction à l’identique de l’édition de 1643, conservant la distinctions i/j et u/v, la ponctuation souvent baroque8, l’emploi parfois arbitraire des majuscules et les moindres coquilles typographiques de l’original (qui n’en manque pas !), et sans addition d’aucune note lexicale, ni de référence ou de commentaire, ni de variante tirée du manuscrit de Chantilly. On ne trouve pas davantage de justification de ce choix éditorial pour le moins inattendu. D’où cette question : quelle plus-value apporte donc cette édition par rapport à l’original facilement accessible sur Gallica et Google Books ? Si c’est l’édition originale que l’on souhaitait diffuser, il était plus expédient et typographiquement moins risqué de publier un fac-similé9. Mais est-ce
bien de cela qu’ont besoin les rares lecteurs qui pourront s’intéresser aujourd’hui à ce livre compliqué qu’est le Rappel des juifs ?
Alain Mothu
Hélène Bah-Ostrowiecki, Le Theophrastus redivivus, érudition et combat antireligieux au xviie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 336 p.
Le Theophrastus redivivus (TR), cet ouvrage manuscrit daté de 1659, qui représente la première œuvre athée systématique de l’âge moderne et le plus ancien traité philosophique clandestin après le Colloquium heptaplomeres, est resté l’objet de recherches constantes de la part des historiens de la philosophie, de la pensée religieuse et antireligieuse, et des idées. Jusqu’à présent il n’avait jamais été soumis à une analyse sous l’angle de l’art d’écrire, sans doute à cause de deux caractéristiques qui devraient apparemment décourager une lecture de ce type : d’une part, il est rigoureusement anonyme et le secret de son auteur n’a jamais été percé ; d’autre part, il se présente sous l’apparence d’un tissu de citations, comme un ouvrage « ex philosophorum opinionibus constructum ». Ces deux caractéristiques ensemble semblent contredire la notion de personnalité impliquée par le concept moderne d’auteur ; or, sans une instance auctoriale forte, toute analyse littéraire ou rhétorique est mise en péril. Partant, le premier mérite d’Hélène Bah-Ostrowiecki (H.B.) a été de ne pas se laisser décourager par cette situation littéraire faible et de montrer, au contraire, que même une structure et une écriture comme celles du traité anonyme pouvaient se prêter à une analyse stylistique. H.B. aurait pu rappeler d’autres exemples de la même époque, comme celui, assez célèbre, de Robert Burton qui composa son Anatomy of melancholy comme une tapisserie de citations textuelles assez comparable à l’écriture du TR. On pourrait aussi rappeler qu’à peu près dans les mêmes années, Arcimboldo peignit le portrait idéal du bibliothécaire en le représentant comme un homme fait, à la lettre, de livres disposés de telle manière à en composer les traits : ce qui n’empêche pas le tableau de donner au personnage une physionomie très parlante.
Les avantages que peut apporter une analyse attentive autant aux formes expressives qu’aux contenus se révèlent avec évidence quand l’auteure se penche sur des sujets comme la technique de la citation (distinguant entre citations-objets et citations-sujet), sur le statut de l’écrivain en tant que « collecteur » et surtout « organisateur » du matériel érudit, sur la manipulation des sources (analysant les cas exemplaires de Cicéron, Pomponazzi et Bodin), sur l’utilisation des passages cités
en vue non seulement d’une doxographie, mais aussi d’une véritable démonstration, sur l’usage des connecteurs logiques pour organiser un discours qui se fait à travers les propos des auteurs cités, sur la présence, assez rare, en fait, du « je », sur les appels également rares au lecteur (tant à la deuxième personne que par l’englobant « nous »), sur la présence de certains fragments de dialogue avec la tradition religieuse qui subsistent au sein de l’écriture de l’anonyme, etc.
Ces analyses débouchent sur une appréciation positive de l’apport de l’érudition, qui dans le TR est toujours sélective, orientée, souvent astucieuse voire maline, dans le sillon des études italiennes consacrées à cet ouvrage, comme celui de Tullio Gregory, et à l’opposé des évaluations réductrices de René Pintard. Comme l’écrit l’auteure, « l’utilisation d’une forme vieillie [comme celle de la tapisserie érudite de citations] n’est pas nécessairement le signe d’une position passéiste ». En effet, le TR montre qu’une culture humaniste d’un genre nouveau, critique et antichrétienne, pouvait être mobilisée pour produire une coupure majeure par rapport à la tradition de l’humanisme chrétien, anthropocentrée, partisane d’une vision conciliatrice qui était au fond celle de la philosophia perennis et de la prisca sapientia. Pour l’auteur du TR on peut parler au contraire d’une sorte d’athéisme pérenne alternatif au théisme universel de la Renaissance. On pourrait même aller plus loin en disant que le déclin final de la Renaissance fut marqué non seulement par l’avènement de la science nouvelle ou de la métaphysique cartésienne, mais aussi par l’établissement d’une tradition culturelle alternative aux grandes synthèses de la scolastique chrétienne d’abord, ensuite à l’humanisme chrétien.
L’auteure reconnaît donc que l’anonyme du TR est franchement athée. Se référant aux paratextes qui ouvrent et ferment l’ouvrage (le TR se présente comme un recueil de positions athées « doctissimis theologis ad diruendum propositum » ; il se conclut par deux peroraisons, l’une « ad sapientes saeculi », où sont confirmées les thèses athées, l’autre « ad sapientes religionis christianae sectatores » où l’écrivain se proclame chrétien fidèle et prêt à rejeter les positions antireligieuses rapportées dans le texte), elle admet qu’ils sont trop ténus pour piéger les lecteurs, débordés par la masse d’un millier de pages qui les contredisent ouvertement. Par leur exiguïté et transparence presque totale, ces paratextes n’auraient pu servir non plus comme des masques aptes à cacher aux yeux des
censeurs éventuels la nature réelle du texte. Il y a cependant, pour H.B., une « énigme » qui reste à résoudre, concernant la fonction réelle de ces appareils qui ouvrent et clôturent le manuscrit. Tout en faisant quelques hypothèses (s’agirait-il d’un « jeu ironique » ? p. 45 – ou d’une sorte de « rituel » ? p. 318), elle ne prend pas en considération l’explication qui nous semble, quant à nous, la plus vraisemblable, à savoir qu’il s’agirait de la parodie d’un genre, celui de la soumission à l’autorité de la foi et de l’Église – déclarations pratiquées par les auteurs hétérodoxes et qui étaient déjà assez suspectes aux yeux des autorités. Les exemples sont multiples ; il suffira de mentionner un ouvrage que le TR connaissait bien car il le cite maintes fois : le De immortalitate animae, qui se termine par un chapitre, le xv, où Pomponazzi, après avoir établi par des raisons philosophiques très solides la mortalité de l’âme (en dépit du titre), déclare au final qu’il se remet toutefois à la foi et à la révélation, qui seraient plus sûres que la raison et la philosophie. Même la formule dont il se sert retentit dans le TR, qui cite un passage du chapitre xv à la page 622 : « Verum non via incedendum est, qua huius saeculi sapientes incesserunt ». Et le TR parle dans la péroraison de « sapientes saeculi ». On sait que l’Inquisition ne fut pas dupe de cette profession de foi tout à fait contradictoire avec le reste de l’œuvre et que Pomponazzi ne put s’en sortir que grâce au prestige universitaire dont il jouissait et à la protection du gouvernement et des familles importantes de Venise.
Il semble donc très possible que dans l’esprit, souvent dérisoire, de son défi lancé aux théologiens, l’anonyme n’ait pas hésité à parodier des professions de foi que des auteurs hétérodoxes bien connus par lui avaient adoptées comme un subterfuge par ailleurs assez transparent.
Du point de vue des contenus, H.B. a choisi une approche problématique : au lieu de contribuer à la monumentalisation de l’ouvrage (entré récemment dans le panthéon de la Bibliothèque de la Pléiade)10, elle a préféré miser sur les « tensions théoriques » qui le traverseraient, sur les incohérences, les contradictions, les ambivalences, les ambiguïtés, les apories dont il serait parsemé (tous ces mots sont répétés tout au long du livre). À vrai dire, certaines de ces tensions théoriques semblent être plutôt l’effet d’une dramatisation de l’interprète. Par exemple, H.B. met en tension la structure doxographique avec le dessein polémique :
les arguments de la religion sont rejetés au nom de la vera et naturalis ratio, mais la raison ne parlerait qu’à travers les opinions philosophiques rapportées dans le texte. En outre, leur crédibilité devrait reposer sur un principe d’autorité qui est refusé sans appel par l’auteur. S’agit-il d’une véritable contradiction interne ? En réalité, cette impression s’estompe beaucoup si l’on considère que l’auteur anonyme doit faire le tri des opinions philosophiques, en extrayant d’elles la pure doctrine rationnelle. Celle-ci se révèle à l’examen rationnel qui vise à dégager l’évidence de toute opinion fausse (il s’agit d’une évidence qui n’est pas cartésienne, c’est-à-dire purement intellectuelle, car le TR – comme le montre bien H.B. – adopte une épistémologie sensualiste et une ontologie matérialiste). Cette évidence se manifeste en même temps par la convergence des doctrines philosophiques par delà l’échafaudage technique dont elles sont parfois encombrées. Par exemple, l’anonyme se réjouit de montrer que la doctrine de la mortalité intégrale de l’homme peut être démontrée tant par la voie de l’aristotélisme rigoureux (celui de Pomponazzi) que par la voie de l’épicurisme. Il est bien conscient que la doctrine pomponazienne de l’âme en tant qu’elle est l’acte du corps organique se situe aux antipodes de l’atomisme épicurien, mais cela ne l’empêche pas de constater que leur convergence dans la thèse de la mortalité est à elle seule le signe évidente de sa vérité extra-doctrinale.
D’autres apories ou contradictions que l’auteure remarque se rattachent au « naturalisme » qu’elle met en évidence dans un chapitre spécifique. C’est une notion clef pour l’interprétation correcte de l’ouvrage et H.B. y décèle pourtant une faille majeure. Cette faille passerait entre les deux registres différents du traité : celui de la description et celui de l’axiologie. Le premier vise à réabsorber l’humain dans la nature, alors que le second, tout en prenant la nature comme modèle prescriptif, conduit cependant l’homme à se détacher du simple cours naturel. L’auteure souligne combien l’écart entre ces deux registres met en crise le projet d’une éthique naturaliste (les exemples portent sur l’amitié, la nourriture, la crainte et l’espoir, la liberté). Ces apories déboucheraient, selon H.B., sur un échec : « l’opposition fondamentale entre l’humain et le nature met à mal l’idée d’une nature omnicompréhensive et principe unique » (p. 276).
En réalité, cette aporie a une histoire qui remonte beaucoup plus haut et se prolonge plus loin que le TR. Dans le jargon de la philosophie
analytique contemporaine, cette aporie porte le nom de naturalistic fallacy ; elle serait présente dans toutes les éthiques qui prennent la forme du précepte de suivre la nature, ou qui tirent les normes à partir d’énoncés descriptifs sur la nature de l’homme ou des choses. En effet, sequere naturam, répète le TR, qui tombe ainsi dans la fallacy que l’on trouve avant lui chez les épicuriens ou les stoïciens, chez les aristotélicien pour leur téléologisme naturaliste, mais aussi dans les systèmes de droit naturel de l’âge classique. La philosophie ne deviendra consciente de la fallacy qu’à l’époque de Hume, quand le philosophe écossais proclamera qu’on ne peut pas déduire un ought d’un is, le devoir être de l’être (dans notre lexique analytique : une proposition déontique ne peut pas être dérivée de propositions qui seraient toutes descriptives). Et pourtant cette même fallacy survivra encore après Hume dans les déclaration universelles des droits qui sont dits être justement naturels. En définitive, une approche moins interne au texte et plus attentive au contexte historique général aurait aidé H.B. à mieux comprendre et évaluer la place du TR dans la culture de son époque. Notre anonyme est bien sûr autrement plus radical que les autres, mais il partage avec ses contemporains des bases philosophiques générales et de méthode auxquelles il n’échappe pas.
Les conclusions de l’étude méritent aussi quelques considérations. Très correctement, H.B. considère qu’il n’y a pas de place dans le TR pour le concept de religion naturelle compris comme souche positive et authentique de la croyance religieuse ; s’il y a des comparaisons entre une religion et l’autre, entre la religion et la superstition, ces comparaisons ne sont que relatives, et les différences de degré, et l’on ne sort pas de la sphère de l’erreur et de la falsa opinio. Il n’y a pas de religion « pure », car toute religion est fausse pour l’auteur anonyme. Cependant H.B. se prévaut des tensions internes au texte pour soutenir qu’elles révéleraient de la part de l’auteur une « mise en cause réflexive du dogmatisme », y compris le dogmatisme athée. Il faut toutefois remarquer que même dans l’esprit de H.B., ces tensions n’en arrivent pas à faire douter du caractère antireligieux de l’ouvrage. Comme il est dit dans la dernière page de l’étude : « Telle est la physionomie de cet ouvrage, systématique dans l’ampleur de son dessein antireligieux, et marqué cependant par de multiples contradictions dans la mise en œuvre littérale de ses arguments, et par les apories d’une alternative éthique difficile à fonder. Reste qu’avec ces caractéristiques, l’objectif antireligieux de l’anonyme
est atteint » (p. 324). S’agissant de la première étude d’envergure en langue française sur le TR, on doit saluer cette entreprise comme une forme de réparation de l’oubli auquel la culture d’origine de l’ouvrage l’avait injustement condamné.
Gianni Paganini
Patrick Graille, Le Troisième sexe. Être hermaphrodite aux xviie et xviiie siècles, Paris, Éditions Arkhê, 2011, 244 p. dont 52 pl.
« À l’origine du corps hermaphrodite était une dualité réelle ou rêvée, une blessure ou un idéal ». Ainsi commence non pas l’introduction mais le « Préliminaire » d’un ouvrage au thème pour le moins… incommode.
L’histoire (on peut le dire ainsi tant le traitement du sujet vacille entre conte métaphorique et cantique à la tolérance) de ce « sexe paré d’ombre » nous est proposée sans voyeurisme ni déploiement rébarbatif. Il ne sera pas ici question de monstruosité au sens commun, d’exhibitionnisme savant, d’inventaire de clichés médicaux ou de classements sans suites. L’hermaphrodite fraie son chemin au fil de la fable et du fantasme (partie I : Affabulations), de la perplexité ou de l’embarras scientifique (partie II : Médicalisations), et de quêtes morales parfois cruelles (partie III : Inquisitions) pour aboutir, peut-être, à la reconnaissance de son droit d’exister.
À travers la littérature des xviie et xviiie siècles, le lecteur est convié à découvrir ce « jeu de la nature » présenté par rétrospectives, renvois, notes et références dans ses multiples évocations historiques, du mythe antique à la satire, de l’essai naturaliste à l’Encyclopédie, du récit de voyage à l’écriture sadienne (chap. i, A, « passion »).
L’énigme du premier homme, autonome puis fractionné, est retracée depuis la très sérieuse Genèse jusqu’aux saillies de nos célèbres Voltaire, Salgues et Mirabeau en passant par les flammes passionnelles du Moyen Âge ou les illuminations ésotériques d’une Antoinette Bourignon (i, B, « autosuffisance »).
Enfin, une plongée au cœur des utopies ou contre-utopies de Foigny, avec ses trop parfaits androgynes des terres australes (1676), et de Casanova inventeur d’un étonnant peuple lutin vivant au centre de la Terre (1788), parachève dans la fantaisie le parcours sinueux d’une dualité originelle interpellant l’imaginaire lyrique depuis l’invention de la transmission des savoirs (i, C, « Fantaisie »).
De l’observation médicale primitive, on retiendra le cheminement de la logique antique et de l’obscurantisme moral qui cherchèrent d’abord une explication au drame par les mauvaises conjonctures astrologiques, par les conséquences de rapports impurs ou par l’usage répété de la débauche, notamment chez les femmes. « Loin de concilier
les sexes, l’hermaphrodite n’est [alors] qu’une femme, dans le pire des cas une misérable créature asexuée » (p. 62). À la fin du xviiie siècle, la conclusion sera que l’hermaphrodite sublime n’existe pas ; il est avant tout homme ou femme présentant quelques parties de l’autre sexe, atrophiées ou hypertrophiées, à quoi la chirurgie peut remédier, comme judicieusement illustré par le titre du chapitre : « La tranchante clarté » (ii, A).
Le cas de Michel-Anne/Marie Drouart, pour qui les chirurgiens n’ont pu s’accorder dans le choix de l’excoriation, illustre cette « Irréductible ambiguïté » (ii, B) que suscite toute tentative d’affectation d’un genre : ni l’Académie de Dijon, ni les encyclopédistes ne trancheront dans la définition.
À ces matérialistes, vont répondre les plus optimistes spéculateurs. On parlera d’« Oniriques possibilités » (ii, C) qui, pour certaines, précèdent étrangement les théories darwiniennes (Et si la nature, qui a su créer de parfaits spécimens chez les coquillages et autres invertébrés, s’essayait à rendre cette perfection à l’homme ?). Le « monstre » jouerait alors son rôle premier d’annonciateur avant l’aboutissement d’une évolution qu’imagine si joliment Jean-Baptiste Robinet dans ses Considérations philosophiques (1768) : « quand la nature sera parvenue au point d’allier dans un même individu les organes parfaits des deux sexes, ces nouveaux êtres réuniront avec avantage la beauté de Vénus à celle d’Apollon : ce qui est peut-être le plus haut degré de la beauté humaine. » Le marquis de Sade, ombreux et singulier rêveur de l’exploration des corps, donnera, lui, une autre perfection au personnage de l’hermaphrodite impliqué dans l’Histoire de Juliette.
Si les anciens oscillèrent entre le mauvais présage de ces « êtres doubles » et la nécessaire pureté de reproduction, le Moyen Âge fonda ses condamnations sur l’effroi d’un hypothétique commerce avec les démons qui engendrerait de tels monstres. Quant à la Renaissance, elle opta pour une moralisation sélective : l’hermaphrodite devrait choisir son sexe et s’y conformer sous peine de mort. Ainsi, chaque époque a justifié ses répressions par la terreur spirituelle ou spéculative que suscitait l’anomalie, toujours suspecte et condamnable. Ce fut alors au médecin qu’incomba la tâche de sauver, dès le xviie siècle, l’infortuné porteur de trouble lorsque le prêtre et le juriste se déchargeaient d’un tel dilemme.
De quelques célèbres procès, du xvie au xviiie siècle, on retiendra que la sentence de mort pour dépravation n’était évitée que sous condition de célibat définitif au bénéfice du doute, ou bien d’acceptation irréversible d’un sexe déterminé par un collège d’experts. Naturellement, comme à toutes les époques, l’incompétence des experts ne trouva d’égale que la perversité des juges ayant à se prononcer entre calomnies et ambiguïtés, ce qui donna lieu à quelques décisions mémorables.
Il aura fallu le procès d’Anne/Jean-Baptiste Granjean au siècle des Lumières, en parallèle aux réactions du procès Calas, pour susciter l’indignation qui portera le chirurgien George Arnaud de Ronsil, dans sa « Dissertation sur les hermaphrodites » (1768), à poser cette question charnière : « que dirions-nous d’une nation de cyclopes, qui ferait crever un œil à tous ceux de notre espèce qui tomberaient entre leurs mains ? ». C’est enfin par la présentation d’une poésie attribuée à Édouard-Thomas Simon (1765), inspirée de l’affaire Granjean, que se termine la recherche de Patrick Graille dans une troisième partie où ont été développés « L’histoire ancienne dévoilée » (III, A), « Les procès Marcis, d’Apremont, Rafanel et Malavre » (III, B) et « Anne-Jean-Baptiste Granjean » (III, C).
Laissons à l’auteur l’art de conclure, qui prend ici valeur d’encouragement à lire ou consulter son ouvrage : « Rêve d’une dualité accomplie, mais dépossédé de son aléatoire réalité pour la fable, la médecine et la justice, l’hermaphrodite est le monstre le plus troublant, le plus refoulé à l’âge classique. Le monstre “totem et tabou” par excellence : celui qui ne doit pas être monstrueux et qui ne cesse pourtant de l’être, de le paraître, celui qu’on sacralise et qu’on châtie ».
Le plan de l’ouvrage est donc parfaitement raisonné, construit au fil d’une remarquable érudition, guidant le lecteur dans ses interrogations fantasmées, rationnalisées, puis naturellement humaines. De la légende à l’intelligence détrônant les peurs, le sujet évolue vers la compréhension et l’acceptation d’une « monstruosité » au sens large et premier (du latin monstrum qui désigne une « marginalité à valeur d’enseignement »). L’ambition de l’auteur est alors d’opposer à la gêne spontanée une curiosité saine, un esprit ouvert et un regard bienveillant, à quoi l’on peut répondre qu’il a réussi sa gageure.
S’il faut émettre une critique, nous relèverons que le choix de l’image de couverture, quoique tout en symboles, parmi les nombreuses figures
présentées en dossier iconographique, n’est peut-être pas des plus incitatifs à l’exploitation commerciale de l’ouvrage, et que le format des gravures présentées dans ce même dossier aurait gagné à être agrandi. Il n’en reste pas moins que la présentation d’ensemble est parfaitement soignée, finie, avec des notes en fin de texte qui n’alourdissent pas la mise en page et facilitent une lecture sans obligation de recourir aux commentaires, le tout assorti d’un descriptif précis des planches reproduites et d’une bibliographie grandement développée pour un sujet si insolite.
« Curiosité de la nature et fantasme de la culture », l’énigme de ce troisième sexe conserve sans doute une part de ses secrets, mais elle est désormais intelligible à tous et ravira notamment les amateurs de marginalités autour du xviiie siècle.
Il reste à préciser que la parution de cette étude aux Éditions Arkhê est en réalité une réédition améliorée, la parution initiale ayant quasi intégralement brûlé dans un incendie chez le premier éditeur. C’est dire à quel point le sort, la légende et les malédictions frappent et fascineront encore les esprits indiscrets, forts d’approcher, à défaut de connaître, l’essence de la vérité dans ses formes les plus dérangeantes.
Stéphan Pascau
Silvia Berti, Anticristianesimo e Libertà. Studi Sull’Illuminismo Radicale Europeo, Bologna, Il Mulino, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 2012, 404 p.
Anticristianesimo e Libertà rassemble en un volume un certain nombre d’études menées par Silvia Berti autour des Lumières radicales. Écrits et publiés au cours des trois dernières décennies, les articles sont reproduits en version italienne avec la bibliographie originale.
Dans son Introduction à l’ouvrage, l’auteur, donne un aperçu des questions qui sont développées dans les articles reproduits dans le volume. Voici quelques-uns des points clés de l’interprétation de Berti : premièrement, l’existence d’une césure nette entre l’« incrédulité libertine » et l’athéisme des Lumières radicales. Le facteur principal de cette séparation est identifié avec la diffusion de la pensée de Spinoza, qui fournit la base de la pensée athée ultérieure. La publication de La Vie et l’Esprit de Spinosa contenait ainsi la première traduction française de l’un des textes les plus radicaux de Spinoza – l’« Appendice » de la 1re partie de l’Éthique. Un autre thème cher à l’auteur est le rôle du protestantisme et du judaïsme, trop souvent relégués au second plan par les historiens qui se sont posé la question de la formation de la pensée des Lumières. Il ne fait aucun doute qu’un bon nombre d’intellectuels antichrétiens viennent d’un milieu réformé et ont souvent profité de la vaste floraison de la culture juive. Enfin, l’auteur estime que la dernière étape vers les Lumières radicales s’est déroulée en passant de la nécessité de Spinoza à une nouvelle conception de la liberté.
Le premier essai du recueil s’intitule « Les origines de l’incrédulité ». On y soutient, de manière tout à fait convaincante, le rôle de la religion dans le développement des phénomènes du déisme et de l’athéisme. Au contraire, la réfutation de Leo Strauss produite contextuellement par l’Auteur nous paraît moins solide. Selon S. Berti, qui utilise la formule de Quentin Skinner, Strauss tomberait dans une prétendue « mythologie de la cohérence » qui le conduirait à effacer toute ambiguïté dans les textes au nom d’une lecture entre les lignes privilégiant les thèmes les plus hétérodoxes. Pour l’auteur, au contraire, ce sont précisément les ambiguïtés qui doivent être conservées et soulignées par l’historien. Cependant, le risque de cette position se fait remarquer dans les exemples mêmes cités par S. Berti à propos de l’utilisation de textes juifs dans
la polémique antichrétienne. Elle cite Anthony Collins, qui possédait dans sa bibliothèque La Fortification de la fé d’Isaac ben Troki. Selon S. Berti, « l’exemple de Toland et Collins [montre] que les Lumières radicales anglaises, […] pour la force et la vigueur de leur critique du christianisme, ne représentent pas, comme il a souvent été dit, un courant de pensée athée, mais se bornent à utiliser de manière rationnelle et corrosive les ouvrages de controverse de la tradition juive » (p. 26). Or, s’il ne fait pas de doute que Collins fait usage de la littérature juive, il est important de souligner également la manière dont il l’utilise. Ainsi, dans Grounds and Reasons of the Christian Religion (1724), il fait sienne l’herméneutique rabbinique de Willem Surenhusius, mais il est loin de partager une telle interprétation du texte biblique : la seule chose qui compte pour le libre penseur est la force polémique des textes juifs, qu’il peut utiliser contre la religion chrétienne en se masquant, en quelque façon, derrière eux.
Dans les trois essais sur la Vie et l’Esprit de Spinosa. S. Berti reconstitue dans le détail et avec une riche documentation, la gestation de l’œuvre et sa rédaction finale. Composé de deux parties hétérogènes, La Vie de Benoit de Espinosa, écrite probablement en 1678 par Jean Maximilien Lucas, et L’Esprit de Spinosa, écrit entre 1702 et 1711 par Jan Vroese, le texte est réuni et augmenté par Jean Rousset de Missy et Jean de Aymon. Il est publié en 1719 par Jean Levier, après une longue gestation. On y retrouve un mélange de deux philosophies bien différentes : d’une part un spinozisme réinterprété de façon matérialiste grâce à l’identification de la substance avec la matière, et, de l’autre, la réflexion sceptique et libertine de Charron et Naudé, également retravaillée en lui soustrayant toute étincelle de croyance. Le résultat est donc un texte radical, rendu encore plus explosif par la présence, dans le deuxième chapitre, de la première (bien que partielle) traduction française de l’Éthique.
Trois essais de Anticristianesimo e Libertà sont consacrés à Bernard Picart. Né en France d’une famille catholique, après avoir appris l’art de son père et avoir travaillé pendant quelque temps à Paris, Picart se déplace à Amsterdam où il se convertit finalement à la foi calviniste. Les illustrations réalisées par Picart pour les Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1723-1737) sont très intéressantes pour leur valeur artistique mais aussi pour leur épaisseur intellectuelle.
On peut y voir la première esquisse d’un comparatisme religieux destiné à avoir une grande fortune au siècle des Lumières. Les diverses sectes religieuses y sont représentées avec impartialité, sans privilégier aucunement le christianisme. Comme preuve de cette attitude, on peut renvoyer aux images qui illustrent les rites juifs, absolument libres des représentations ordinaires que l’on en donnait à l’époque. Picart a réussi à dépeindre ces rituels en les situant dans la vie de tous les jours, y compris l’important Seder de Pessah : son travail constitue, par conséquent, une preuve importante de la compréhension, par les intellectuels des Lumières, des modes de vie de la nouvelle communauté juive hollandaise d’origine séfarade, en témoignant aussi de leur tolérance et ouverture d’esprit.
Après un article sur Du Marsais qui souligne l’importance de son ouvrage « gallican » de 1715, S. Berti consacre les deux derniers articles de son volume au comte Alberto Radicati di Passerano. Le premier concerne A Philosophical Dissertation Upon Death (1732) et s’interroge sur le scandale provoqué par sa parution. Selon l’auteur, ce scandale naît surtout du mélange de plusieurs facteurs, dont surtout les doctrines d’origine épicurienne avancées par Radicati et le mépris substantiel qu’il affiche pour la mort, considérée comme une simple désintégration d’éléments matériels. L’évêque de Londres, Edmund Gibson, ne pouvait s’empêcher de réagir contre un tel texte, qui pouvait être presque considéré comme une invitation au suicide. Le dernier article est consacré à la prétendue conversion de Radicati au protestantisme, sur son lit de mort. De telles conversions, réelles ou imaginaires, ont toujours été fréquentes parmi les penseurs les plus radicaux de l’époque moderne. Bien qu’appuyée sur des documents et des témoignages, celle de Radicati est souvent remise en question par les historiens. Berti, quant à elle, ne se prononce pas sur son authenticité, préférant souligner que, s’il y eut conversion, celle-ci ne fut pas tout à fait opportuniste. Au contraire, elle marquerait la survivance d’un protestantisme « profond et inébranlable » qui serait la clé de voûte de l’expérience intellectuelle de Radicati : « Ce n’est que sur cette base, poussée à l’extrême et radicalisée sous la forme d’une interprétation autonome de l’Écriture et de la loi de la nature, que Radicati […] finira peut-être par être considéré comme la figure la plus originale, et certainement la plus inquiétante, des Lumières » (p. 352).
Comme toute bonne étude, celle de Berti est loin de se poser comme définitive, mais invite le lecteur critique à une interrogation continuelle, offrant de nombreuses possibilités de discussion.
Jacopo Agnesina
Università del Piemonte Orientale, Vercelli
Claude Gilbert, Histoire de Calejava ou de l’île des hommes raisonnables, édition critique établie par Yvan Nérieux, Paris, Honoré Champion, « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 304 p.
« [Claude Gilbert] fit imprimer à Dijon en 1700 un in-12 de 329 pages, intitulé : Histoire de Calejava ou de l’Isle des hommes raisonnables, avec le parallèle de leur morale & du christianisme. Ce livre ne porte point le nom de l’auteur ni de l’imprimeur. On sait néanmoins qu’il est sorti de la boutique de Jean Ressayre », indiquait l’abbé Philibert Papillon (1666-1738), bibliophile dijonnais, dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne (1742). Il ajoutait dans sa notice qu’« un avocat, qui avait lu quelque chose de cet ouvrage, dit à l’imprimeur que s’il y mettait son nom, il pourrait en être inquiété. Celui-ci remit toute l’édition à l’auteur, qui la brûla entièrement, ainsi qu’il me l’a assuré plusieurs fois, avec serment, à la réserve d’un exemplaire. L’imprimeur avait cependant retranché plusieurs endroits dangereux concernant le christianisme et le judaïsme ». Yvan Nérieux revient, dans la nouvelle édition critique de cette « œuvre anonyme, attribuée à un obscur avocat bourguignon » (p. 8), sur le détail de cette stratégie d’écriture.
Le nom de Claude Gilbert est conservé sur la couverture, même si, en introduction, est reposé le problème de l’attribution et que l’éditeur développe l’hypothèse selon laquelle Philibert Papillon en serait l’auteur. Cette hypothèse est d’abord avancée prudemment (elle est jugée « plausible », p. 24) et plusieurs fois au conditionnel (p. 27), puis de manière de plus en plus affirmative, jusqu’à être validée complètement dans une note de la page 48. À l’appui de cette hypothèse, sont invoqués des passages de la correspondance de Papillon (reproduite en annexe, p. 216-289) présentant des points communs avec la philosophie de l’Histoire de Calejava : des références à Pierre Bayle et au De Tribus Impostoribus, et l’épicurisme que révèle certaines des formules épistolaires de Papillon (relevées par Yvan Nérieux p. 23). De fait, d’autres thèmes abordés dans ces lettres, comme celui du jeûne religieux, évoqué dans une lettre du 18 février 1731 (p. 269), entrent en résonnance avec l’ouvrage attribué à Claude Gilbert (distinction entre jeûne judaïque et jeûne évangélique : XI, p. 189). On pourrait ajouter encore que la Catalogue des ouvrages de M. l’abbé Papillon comprend un titre, Dissertation dans laquelle on montre que l’auteur de la Chronique latine de S. Bénigne de Dijon est un religieux anonyme
(p. 211), qui laisse entendre son intérêt pour les mystères littéraires. Même la présence dans le texte des jeux anagrammatiques à partir du nom de l’auteur présumé – « caludes », conseillers, « glébirs », intendants (III, p. 109), et « lucades y bergli », maîtres d’enfants (V, 4, p. 131) – irait également dans ce sens. Quoi qu’il en soit, le profil de l’avocat Claude Gilbert correspond très bien à celui de l’auteur-type de la République dijonnaise des lettres au xviie siècle, telle qu’Yvan Nérieux la fait revivre dans son introduction. De manière générale, toute la mise en scène prêtée à Philibert Papillon, ainsi qu’une certaine « liberté gauloise si naturelle au seizième siècle et si opposée aux maximes d’aujourd’hui », comme il l’écrit lui-même dans une lettre (17 juin 1729, p. 245), ancrent l’Histoire de Calejava dans la tradition renaissante des parerga de l’Utopia de Thomas More et du style d’un Érasme, cité au livre XI (p. 189), dont l’auteur – avocat ou abbé – défend les principes humanistes.
À l’approche de la révocation de l’Édit de Nantes, le réformé Abraham Christophile, sa fille Eudoxe, qui était « huit jours de la religion de son père, quatre de celle de sa mère [catholique romaine], superstitieuse extraordinairement », accompagnés d’Eugène Alatre, cousin du premier et époux de la seconde, tous conduits par Samieski, « turc d’origine, fort entêté du mahométisme », qui « ne manquait pas pourtant d’esprit et de savoir » (I, 2, p. 91), ont quitté la France pour la Lithuanie, d’où ils sont arrivés, après « deux mois et quelques jours » et des péripéties propres au genre de cet écrit, dans l’île de Calejava, littéralement la terre des hommes raisonnables. Là, ils entrent en dialogue avec le personnage de l’Avaïte, et dans ces échanges, propos croisés dans lesquels se dessinent une thèse d’ensemble, c’est Alatre qui semble faire figure de porte-parole de l’esprit critique : « Alatre était bon philosophe, bon mathématicien, et bon jurisconsulte. Il méprisait extrêmement la théologie scolastique. Il prétendait qu’il avait acquis le droit de le faire par la peine qu’il s’était donnée de l’étudier. Quoiqu’il n’eût pas beaucoup de religion, il avait beaucoup d’honneur et de probité. Il jugeait de tout sainement, et sans prévention » (I, 2, p. 88). C’est lui qui dira que « sans religion on peut vivre moralement bien » (III, 1, p. 114).
L’auteur présente son dialogue philosophique comme un ensemble de « feuilles volantes sans suite et sans ordre », rapportées de l’île de Calejava en France par Christophile et Samieski, auxquelles un ordre a été donné, et dont le contenu a été abrégé puis rendu public. « Je trouve
dans les mémoires qui m’ont été fournis plusieurs aventures très rares qui sont arrivées à ces trois personnes dans leurs voyages », annonçait-il ; « [m]ais je les passerai sous silence, parce qu’elles ne servent de rien à mon dessein principal, qui est d’écrire l’histoire des Avaïtes ». Et il ajoutait, en une prétérition tout à fait typique du genre utopique : « je ne crois pas néanmoins me pouvoir dispenser de parler de celle qui leur donna l’occasion de voir ce peuple » (I, 2, p. 89). Le premier livre relate brièvement le voyage et l’arrivée dans l’île, puis donne une description du pays découvert. Par la suite, le cinquième livre complète le tableau, et, tout au long du texte, de nombreuses indications contextualisantes viennent encadrer les passages dissertatifs.
Le livre second présente les « dispositions requises pour devenir Avaïte » ; c’est un petit traité de la méthode qui traite de l’autorité des savants, des fables, de la vérité et de la raison, « cette heureuse guide qui nous conduit toujours au bien » (I, 4, p. 104). Les livres III et IV traitent de l’existence de Dieu, de l’immortalité de l’âme et de la liberté. Le livre VI est un « Abrégé de la théologie et de la morale des Avaïtes ». Le livre X (« De la fin pour laquelle Dieu nous a créés et de celle pour laquelle il nous a mis au monde ») traite du bonheur et des passions. Le livre XI dresse le « Parallèle du christianisme avec les sentiments des Avaïtes » (sont notamment abordées les question de la polygamie et du divorce). C’est dans ce livre que Christophile énonce un principe théologico-politique de tolérance : « Nous sommes […] obligés en conscience de laisser un chacun libre de ses opinions, pourvu que par ses actions il ne trouble pas le repos de l’état, ou que ses opinions ne permettent des crimes qui renversent l’ordre de la vie civile » (XI, p. 177). Le dernier livre s’intitule « Du départ de Christophile et de Samieski, avec l’application des maximes des Avaïtes aux mœurs des autres peuples ».
Le sous-titre de l’anonyme Histoire de Calejava est capital, puisqu’il annonce bien les thématiques générales : la morale et la religion. Comme Yvan Nérieux en fait le calcul, « sur 34 chapitres que compte l’Histoire de Calejava, 26 traitent plus ou moins explicitement de la question religieuse » (p. 27). Le manuscrit de Dijon comprenait en sus le « Projet d’une religion raisonnable », résumant les grands principes d’un rationalisme évangélique.
Est remarquable l’astuce de l’ellipse des livres VII et VIII permettant d’éviter une critique frontale du judaïsme et du christianisme. L’auteur
prétend que ces livres ont été supprimés, la tactique consistant à faire peser la charge sur le « mahométisme » au livre suivant. Sourates à l’appui, le livre IX traite donc de la crainte, de la superstition, des miracles et de l’imposture des prophètes. Mais, précédemment, Alatre avait prévenu que « si le chrétien, pour trouver de la difficulté à examiner les preuves du mahométisme, a le droit de le rebuter, le turc n’en a pas moins de rejeter le christianisme » (II, 1, p. 96), et Samieski avait dit avoir trouvé dans le Coran « un commandement exprès à suivre la raison » (II, 4, p. 107).
Yvan Nérieux a bien raison de parler dans son introduction d’une « mosaïque philosophique » (p. 38) pour décrire la doctrine des Avaïtes, tant les références, affichées ou suggérées, sont nombreuses. Le Nouveau Testament est relu en parallèle avec le Coran. Lucrèce, Cicéron, Sénèque, Thomas d’Aquin, Érasme, Descartes et Hobbes sont cités. Bayle et Malebranche sont partout sous-jacents, ainsi que, ici et là, Montaigne, Cyrano de Bergerac ou Veiras. À la fin d’une série de citations des Évangiles invitant au bonheur en ce monde, Christophile évoque tout ensemble l’arianisme, le pélagianisme, le déisme et l’épicurisme (XI, p. 194). Comme l’abbé Joly le nota dans son Éloge historique de l’abbé Philibert Papillon : « Il lisait beaucoup, il méditait sur ses lectures, et la mémoire lui fournissait dans la conversation quantité de traits curieux et d’anecdotes intéressantes, qu’il avait puisées dans les bons ouvrages et dans le commerce des savants » (p. 208).
L’introduction de cette édition critique de l’Histoire de Calejava est par endroit très critique quant à la qualité littéraire de cette œuvre mineure de l’âge classique, qui s’en trouve du coup quelque peu minorée par les remarques sur l’indécision générique et sur la construction flottante du récit. Et ce n’est que dans les deux derniers paragraphes de l’introduction qu’est mentionnée la dimension de « réflexion sociétale » de l’Histoire de Calejava (p. 73). Or, comme dans l’œuvre de référence qu’est l’Utopie de Thomas More, et comme chez la plupart de ses épigones par la suite, dont ceux qui ont sans doute servi de modèles à l’auteur de l’Histoire de Calejava, ceux que Jonathan I. Israël considère comme les romanciers spinozistes (dans le chapitre xxxii de Radical Enlightenment : Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, OUP, 2001) – Denis Veiras au premier chef –, la problématique morale est articulée à une réflexion socio-politique. Comme l’écrit
Jonathan I. Israël, la réforme que visaient à accomplir ces auteurs était de grande portée : philosophique, sociale, éthique, en matière de genre et de sexualité, et aussi politique (p. 44).
Dès le premier livre de l’Histoire de Calejava, il est précisé que le législateur Ava (son nom signifie « homme », d’où le nom de l’île et de ses habitants) avait « jeté les fondements d’une république, en établissant de nouvelles lois, et principalement celle de l’égalité des citoyens » (I, 2, p. 86). La question de l’égalité rejoint la référence à l’égalitarisme des premiers Chrétiens, dont s’inspirent les Avaïtes qui « mettent tout en commun » (XI, p. 181). Tous les hommes sont égaux, et ils doivent obéir aux lois (XII, p. 198). Le cinquième livre, qui porte sur « la police générale des Avaïtes », donne des précisions concrètes sur un mode d’organisation sociale conforme au principe d’égalité : priorité donnée à l’agriculture, calcul du temps de travail, système de répartition des denrées, système matrimonial et système éducatif. La question du bonheur, primordiale dans la théologie des hommes raisonnables, est aussi liée à leur régime politique : « après avoir reconnu que les hommes doivent […] être, autant qu’il est possible, également heureux, ils avaient introduit en Calejava les lois fondamentales de la république » (IV, 4, p. 124). Dans le troisième livre est présentée la forme de gouvernement des Avaïtes : le système représentatif des conseillers de la république et leurs procédures législatives. Le dernier livre précise le rapport entre le peuple et le magistrat : « [c]omme toute puissance et toute autorité ne tire son origine que de l’obéissance volontaire du peuple, cette même autorité lui doit être entièrement dévouée » (XII, p. 200).
L’auteur de l’Histoire de Calejava était « désireux de proposer une alternative à la monarchie absolue » (p. 73). La morale des Avaïtes repose sur la loi naturelle, leur théologie sur la raison, sur la critique de l’autorité, de la superstition (la croyance aux miracles), de la crainte et des vaines cérémonies (la prière et le jeûne). Les hommes raisonnables veulent « retrancher tout l’extérieur de la religion » et « chercher à être heureux en ce monde » (XI, p. 188). Malgré peut-être, certes, quelques circonvolutions, cette conception immanentiste du bonheur, ce rationalisme radical combiné à la liberté de conscience et à une spiritualité bien tempérée, ainsi que les réflexions sur la forme républicaine de gouvernement n’en conservent pas moins – regardons autour de nous – toute leur force de frappe. En somme, pour paraphraser l’exergue de l’Histoire
de Calejava pris de Lucrèce, et qui ferme aussi cette mystérieuse utopie métaphysique : n’allons pas rejeter avec mépris ces présents préparés avec un soin fidèle, avant d’en avoir compris toute la valeur.
Antoine Hatzenberger
ENS de Tunis
Miguel Benítez, Les Yeux de la raison. Le matérialisme athée de Jean Meslier, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 842 p.
Sous le beau titre Les Yeux de la raison, titre M. Benítez propose un travail considérable sur la philosophie matérialiste athée du curé d’Etrépigny qui sera utile aux spécialistes de la littérature manuscrite et clandestine et indispensable à tous ceux qui cherchent une reconstruction systématique de sa pensée. Il est indispensable de faire à Meslier toute sa place dans l’histoire du matérialisme, de le sortir de l’ombre dans laquelle la figure des quatre grands (La Mettrie, Helvétius, d’Holbach, Diderot) l’a maintenu. Ce livre y contribue sans aucun doute et conduit à enrichir et compliquer l’histoire de la constitution de la tradition matérialiste.
Les lecteurs de La Lettre clandestine, et au-delà, connaissent les qualités du travail de l’auteur, spécialiste reconnu des manuscrits clandestins : précision sans faille, rigueur, érudition toujours mise au service de la détermination exacte des textes et des phénomènes de diffusion et réception. Sa connaissance de la philosophie « orthodoxe » jointe à celle des pensées hétérodoxes, à quelque titre que ce soit, lui permet de mettre en contexte les thèses de Meslier. Leur originalité est ainsi mise en relief avec beaucoup de netteté.
Comme il se doit l’ouvrage s’ouvre sur une enquête sur « le legs de Jean Meslier » et la composition de son Mémoire, ses états et les moments de sa diffusion immédiate. C’est dans un troisième moment que sera examinée la diffusion manuscrite et ses difficultés dues aux mutilations diverses, au choix des extraits dont l’un a contribué à répandre une image de déiste et plus généralement à une défiguration intéressée : « purger l’écrit du poison de l’athéisme ». Le rôle que ses notes marginales aux Œuvres philosophiques de Fénelon ont joué dans la rédaction du Mémoire est avancé par M. Benítez qui analyse de près sa composition, l’usage de ses sources, en soulignant ce qu’il a d’imparfait compte tenu de la précipitation avec laquelle il fut écrit. Il examine les contradictions d’un curé anticlérical et la mauvaise conscience qui fut la sienne, de sorte qu’est posée la question de la nature des destinataires de l’œuvre : en définitive son écrit ne peut que s’adresser à des prêtres déniaisés comme lui, et non les paysans illettrés dont le sort misérable est le motif de la critique de la société, superstition et tyrannie.
La philosophie est exposée dans trois parties qui regroupent les grandes rubriques de toute philosophie de l’Âge classique aux Lumières : la connaissance de l’être, la nature de l’être, la réalisation de l’être dans la nature, le monde moral et la nature de l’âme. L’exposition donnée par M. Benítez distingue la doctrine du Mémoire et la discussion de Fénelon.
D’abord la critique de la religion, dans la mesure où Meslier considère que, « erreur, illusion, mensonge, imposture », elle est inscrite dans les sociétés comme instrument de pouvoir et de domination. Si la cible de la critique est le christianisme et le catholicisme, elle porte aussi sur toute religion. Sont analysés le thème de l’imposture sacerdotale (et M. Benítez montre comment Meslier interprète les « trois fameux imposteurs ») et le fanatisme. On voit comment les critiques adressées à la religion se regroupent selon des topoï qui organiseront les critiques des Philosophes (la foi, la révélation avec les prophètes, les prodiges et miracles, la théologie, l’interprétation des textes, la doctrine enfin). Puisque les religions sont l’œuvre des hommes, leur fausseté dénoncée témoigne contre l’existence de Dieu. La deuxième partie présente la construction du matérialisme, « aux racines métaphysiques », depuis la question des rapports entre être et connaître, le statut matériel de l’être et les rapports, décisifs pour le matérialisme de la génération à venir, de la matière et du mouvement, que le « sensualisme » de Meslier refuse de poser comme inhérent à la matière, pour finir par la question du panthéisme refoulé. Le matérialisme fonde une représentation de la nature : M. Benítez montre très bien la puissance explicative du mécanisme chez Meslier – raison pour laquelle, peut-être, il a pu apparaître pour la génération venue après 1750, comme appartenant à une phase dépassée du matérialisme. De la nature on passe au monde et à la critique absolument décisive pour tout matérialisme conséquent, comme on ne dit plus, de la finalité, de la Providence. Soutenir la thèse d’une « main aveugle » soulève une série de difficultés où se jouent les rapports entre hasard et nécessité. Enfin, l’âme n’échappe pas à sa matérialité et la liberté apparaît comme la question difficile. L’auteur suit de près les éléments du débat avec Fénelon, Malebranche, la référence à Épicure et montre que Meslier revendique « la capacité qui nous est propre de faire ce que nous voulons », la volonté étant un mode de la matière, quand bien même nous ignorons les mécanismes qui le produisent. La troisième partie a pour objet la critique sociale et politique. Elle est
peut-être la partie la plus originale sous la plume d’un philosophe, en tout cas elle est menée par une violence et une radicalité que l’on peut seulement comparer à celle de Dom Deschamps. Critique de l’alliance du trône et de l’autel, dénonciation des inégalités et du sort des pauvres, reposant sur l’appropriation des richesses par les parasites. Si la famille est le lieu de « reproduction » de l’inégalité, « le pouvoir absolu des puissances souveraines » « est la clé de voûte qui soutient cette société injuste ». Si on connaît mal la philosophie matérialiste de Meslier, on connaît au moins ses propositions visant à établir une « bonne et sage république universelle ». M. Benítez les expose dans le détail et du coup en montre la cohérence dans les limites de la société que connaissait le curé athée. Devant la résistance prévisible des privilégiés, il « invite ouvertement les peuples à la révolte, et au tyrannicide ». Il « prône la révolution » qui doit émaner de la prise de consciences des peuples des raisons de leur misère et de leur oppression voilée, signe d’un « détestable mistère d’iniquité ». Cet accent sur la révolution, explique, selon M. Benítez, que les philosophes n’aient pas manifesté d’intérêt pour la pensée de Meslier.
M. Benítez soulève pour terminer la question débattue du « cartésianisme » de Meslier. Il est vrai que cette image d’un matérialiste athée, à la charnière des xviie et xviiie siècles, ayant écrit à partir de 1718, a souvent été celle d’un philosophe mal dégagé des catégories cartésiennes et, pour cela, mal assuré de son originalité. Il plaide pour une indépendance vis-à-vis du cartésianisme pour ce qui est de sa pensée. Car la formation philosophique de Meslier, faite de scolastique et de cartésianisme instruit par la lecture de Malebranche, peut le conduire à des formulations en effet ambiguës ou embarrassées. La thèse défendue par l’auteur est qu’il y a une claire contradiction entre le cartésianisme et le matérialisme athée de l’auteur du Mémoire.
L’ouvrage comporte une bibliographie dont la première partie (A) décrit avec une extrême précision les manuscrits du Mémoire (manuscrits autographes, copies, copies fragmentaires, copies des extraits), les copies du « Testament du Curé d’Etrépigny », et des « Sentiments de Jean Meslier ». Les éditions des textes de Meslier sont ensuite données depuis celle de Rudolf Charles, en 1864 à Amsterdam, jusqu’à celle des Éditions Société d’Études Ardennaises de 2011, par Yvon Ancelin, Serge Deruette et Marx Genin, en passant, bien entendu, par celle des
Œuvres dans l’édition coordonnée par Roland Desné, avec Jean Deprun et Albert Soboul, de 1970-1972. La rubrique des études comprend les travaux parus après la publication de l’édition de 1970-1972 ainsi que ceux, antérieurs, qui sont cités dans le livre. Avec une remarquable et utile Table analytique des matières et un index des noms, l’ouvrage de M. Benítez représente une somme désormais indispensable pour la connaissance de Meslier et du matérialisme post-cartésien. Il ouvre la voie à de multiples débats et recherches. Cependant son mérité essentiel est d’en avoir fourni les éléments textuels et éditoriaux impeccables, dans une langue claire et précise. Il est dommage que quelques coquilles se soient insinuées dans ce beau livre : p. 762, note 7, ligne 2, il faut lire « Voltaire » et non « Meslier » ; p. 826, dernière ligne, il faut remplacer « l’athéisme » par « le cartésianisme ».
Jean-Claude Bourdin
Claudine Cohen, Science, libertinage et clandestinité à l’aube des Lumières. Le transformisme de Telliamed, Paris, PUF, 2011, 433 p.
« Le Telliamed a souvent été considéré comme l’élucubration d’un amateur, mais il peut être lu aussi comme une œuvre majeure, au carrefour des savoirs scientifiques de son temps sur l’histoire de la Terre, sur la vie et son origine, sur l’homme et son devenir » (avant-propos, p. xii). C’est cette seconde lecture que Claudine Cohen pratique savamment et qu’elle nous entraîne à faire dans son sillage. Tout en reconnaissant que « Maillet affirme, pour la première fois sans doute à l’époque moderne dans un écrit donné pour scientifique, l’idée d’une immense durée de l’histoire du globe », elle se méfie de la tendance à mettre en avant le caractère « prophétique » de son système. À l’encontre des « visions présentistes » qui risqueraient de gauchir le sens du texte, l’auteur choisit de rendre compte de Telliamed « dans sa réalité » et « dans sa spécificité », ce qui est « désormais possible aujourd’hui » en s’appuyant « sur un renouvellement considérable des savoirs et des méthodes ». Ainsi « cette étude vise d’abord à éclairer la genèse de cette œuvre, selon une triple perspective : genèse d’une théorie donnée pour scientifique, et fondée sur la représentation d’une causalité uniforme à l’œuvre dans les processus naturels. Genèse d’un “système” matérialiste du monde, qui contient une vive critique des dogmes religieux tout en se situant dans la mouvance cartésienne ; genèse matérielle du texte, essentiellement constitué comme un collage d’éléments disparates, en une totalité indéfiniment expansive ».
Claudine Cohen part de l’idée que Benoît de Maillet « n’est en rien un naturaliste de profession » et que « son traité est avant tout l’œuvre d’un amateur, tout à la fois isolé et imprégné des modes et des courants du temps ». Parmi ce contexte intellectuel qu’elle analyse en détail, elle attache une importance particulière à la pensée clandestine à laquelle « Telliamed appartient indiscutablement », « tant par les modalités de sa composition et de ses réécritures, de sa circulation et de sa réception, que par ses thèmes philosophiques ». L’auteur montre comment Maillet procède par accumulation de sources et de preuves, créant une « marqueterie », un « texte stratifié », « en expansion », qui emprunte beaucoup aux Anciens. Elle souligne à l’occasion la parenté, tantôt de méthode, tantôt de pensée, de Telliamed avec le Mémoire de Meslier,
L’Âme matérielle, ou la Dissertation sur la formation du monde ou encore les Dissertation et preuves de l’éternité du monde. Elle précise les étapes de la lente élaboration du texte manuscrit et de la préparation de son édition.
Autre élément du contexte, Claudine Cohen relève aussi l’heureuse coïncidence entre la position privilégiée de Maillet, consul au Caire dès 1692, et l’intérêt grandissant en Occident depuis le début du xviie siècle pour les curiosités naturelles de l’Égypte. Ainsi le dialogue fictif entre un philosophe indien et un missionnaire français, qui constitue la forme littéraire du Telliamed, s’ancre dans la réalité autant qu’il est inspiré par la culture très diverse de Maillet qui « se situe au confluent d’une approche rationnelle et d’une attitude empreinte du goût du merveilleux et du bizarre ». La lecture de Strabon, Hérodote, Pline, Sénèque, Plutarque, un cartésianisme diffus, l’héritage des libertins, notamment Sorel et Cyrano, contribuent à transformer un traité « élaboré à partir de “mémoires” accumulés pendant toute une vie » en un « catalogue de curiosités d’un genre particulier », d’autant plus qu’une partie du savoir scientifique de Maillet est empruntée aux comptes rendus de l’Académie des Sciences dont le secrétaire perpétuel depuis 1697 est Fontenelle, modèle et inspirateur de Telliamed. Mais l’influence de Fontenelle pourrait aller plus loin car Claudine Cohen fait l’hypothèse séduisante d’une filiation intellectuelle de Leibniz, « l’immense philosophe », l’auteur de la Protogée, à « l’obscur consul » grâce à l’intervention du secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences qui aurait servi de « passeur clandestin d’idées11 » : « Fontenelle, dont on sait les sympathies pour la pensée libertine et clandestine, que ses fonctions officielles interdisaient d’afficher, a pu jouer le rôle d’intermédiaire. On peut imaginer qu’il a “soufflé” à son ami Maillet un certain nombre des hypothèses que Leibniz lui avait transmises, lui suggérant d’en tirer jusqu’au bout les conséquences ».
Ces influences n’entament en rien l’originalité et la cohérence interne des réponses que la théorie de la diminution de la mer donne aux interrogations « qui s’agitent dans le domaine de l’histoire naturelle » à un « moment d’extraordinaire foisonnement de questions, d’hypothèses, d’observations et de controverses » sur l’histoire de la Terre, l’origine et
le devenir des êtres, la durée de cette histoire. Partant de l’affirmation du caractère exclusivement marin des fossiles, le philosophe indien démontre la formation de tous les terrains du globe au fond de la mer, d’où il déduit l’origine marine de tous les êtres vivants, y compris l’homme. Sa « vision de l’Homme », longuement analysée par Claudine Cohen (p. 181-202), « témoigne d’un nouveau regard porté sur le monde, et participe d’une véritable révolution intellectuelle. […] Elle creuse de toute la profondeur d’une durée immense le temps des êtres et des choses ».
Dans des pages denses, Claudine Cohen analyse la méthode de Maillet, hésitation entre accumulation de preuves et rigueur d’un système de pensée fondé sur une hypothèse unique, confiance tout à la fois dans la raison et dans l’expérience sensible. Elle souligne le caractère fortement polémique de ce « système » qui n’est pas un système philosophique abstrait mais une « élaboration rationnelle, totale, universelle ». Comme beaucoup d’autres manuscrits clandestins, Telliamed s’inscrit nettement contre les dogmes religieux, et spécialement contre le dogme de la création, contre la Providence, contre le déluge universel. Dieu n’est pas indispensable dans le système de Maillet, puisque celui-ci soutient « l’éternité de la matière et de toutes choses, contre le sentiment de leur création ». Tout en présentant la « religion » de Telliamed comme « une sorte de naturalisme panthéiste », Claudine Cohen s’interroge sur la réalité de ce panthéisme.
Ce riche ouvrage constitue d’abord, on le voit, une utile synthèse – qui était difficile à faire – des connaissances sur l’œuvre de Benoît de Maillet, de l’étude des sources de son Telliamed jusqu’à l’influence qu’il a pu exercer aux xviiie et xixe siècles, de la genèse du texte jusqu’à ses éditions successives (étude complétée par la publication, en annexe, de passages manuscrits absents des éditions et d’extraits du manuscrit N.a.f. 22 158 de la BnF, notes et lettres de Benoît de Maillet). Un des intérêts majeurs de l’ouvrage tient à ce qu’il offre, au fil du texte, la présentation très fouillée du contexte scientifique dans lequel le système de la diminution de la mer a été élaboré. Mais l’auteur propose aussi une réflexion approfondie sur la méthode intellectuelle de Maillet dont le système se caractérise par la « tension entre la multiplication de ses preuves et l’unicité de la thèse sur laquelle il repose ». « Le Telliamed, écrit encore l’auteur, se situe au confluent d’une méthode rationnelle et de la démarche d’un “curieux” ». De l’enquête que conduit Claudine
Cohen sur la postérité du texte, on retiendra notamment son rôle dans l’élaboration du vitalisme de Diderot et l’écho que les questions posées par Maillet continuent d’avoir dans les sciences d’aujourd’hui.
Geneviève Artigas-Menant
Jacques-Antoine Grignon des Bureaux, Rêveries métaphysiques d’un Solitaire de Champagne, précédées de son Tintinnabulum Naturæ et suivies de quelques poésies et pièces fugitives, textes édités et présentés par Sylvain Matton, avec des études de Cédric Grimoult et Jean-Marc Mandosio. Postface d’Yves Citton, Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2012, 296 p.
Après une première publication en 2002, déjà agrémentée de plusieurs études12, Sylvain Matton propose une édition augmentée des œuvres du Solitaire de Champagne escortées d’une nouvelle série de textes critiques. La découverte de pièces fugitives ayant permis l’identification de leur auteur justifie à bon droit cette démarche qui achève l’invention, au sens archéologique du terme, d’un nouveau philosophe du xviiie siècle méritant considération – le cas est rare, ne boudons pas notre plaisir – sans négliger d’en assurer la promotion.
Sylvain Matton a revu à cette occasion son introduction, dans laquelle l’analyse du système philosophique de Grignon des Bureaux est complétée par de nouveaux apports, et qui comporte désormais un récit de l’identification de l’auteur, qui ravira les amateurs comme nous d’énigmes érudites. Il a enrôlé cette fois-ci dans son entreprise Jean-Marc Mandosio, Cédric Grimoult et Yves Citton, qui alimentent à leur tour la bibliographie critique de Grignon, de telle sorte qu’après les contributions de Miguel Benítez, Alain Mothu, Alain Niderst et Charles Porset dans la précédente parution, on finira pas trouver exagéré le constat établi d’un « faible écho » (p. 7) rencontré par le vieil auteur si récemment apparu (signalé pour la première fois dans la Lettre clandestine en 1992, publié dix ans plus tard et identifié une autre décade ensuite) et si peu soucieux de publicité.
Jacques-Antoine Grignon des Bureaux (1714-1796), alias le Solitaire de Champagne avait, en effet, pris soin de ne confier ses réflexions philosophiques qu’à un manuscrit resté dans sa famille, copié par un neveu vers 1800 et retrouvé par hasard vers 1975 par André Matton, père du présent éditeur. L’introduction fait état de l’ensemble des recherches (fausses
pistes incluses) qui menèrent ce dernier de la localisation approximative de son milieu géographique d’origine à l’exhumation du nom de l’auteur, en passant par la reconnaissance de la graphie du copiste, la découverte des cahiers encore manquants en 2002, l’identification d’une branche familiale, ce jusqu’à la solution de l’énigme. Le profil biographique qui peut alors se dégager est celui d’un petit noble originaire du Gâtinais, installé en Champagne au moment de son mariage tardif en 1758. Un temps militaire, blessé et décoré à la bataille de Crevelt, en 1758 toujours, il se retira ensuite à Ervy-le-Châtel, où il prit part à la vie sociale locale et aux joutes littéraires qui en faisaient l’animation, avant de subir, dans sa vieillesse, la tourmente révolutionnaire dans la situation délicate de père d’un émigré. Un certain nombre de pièces fugitives (reproduites ici) attribuées à un « Solitaire des environs de Troyes » et dues à Grignon, selon toute vraisemblance, avaient été publiées en 1786 et 1787 dans l’Almanach des Grâces, compilation poétique parisienne largement ouverte aux enthousiasmes provinciaux, mais si notre auteur mérite l’attention réclamée par son éditeur c’est au manuscrit portant la date de 1772 qu’il le doit.
La description de Jean-Marc Mandosio permet de se faire une excellente idée de cet ensemble apparemment des plus disparates. « Le recueil, écrit-il, s’ouvre sur le Tintinnabulum naturæ, c’est-à-dire “le grelot de la nature”, qui est le plus long et le plus ambitieux des textes écrits par le Solitaire. Il est suivi d’une série de Pensées métaphysiques lancées dans le tourbillon, comportant (après un “Epitome métaphysique” servant d’introduction et une série de “Questions proposées”) neuf courts chapitres “Sur la substance”, “Des atomes”, “De la substance épurée”, “Du premier principe”, “De l’amour”, “De l’âme”, “De la faculté méditative”, “De l’universalité”, “De la vie humaine” et un poème intitulé “Système anthithéocratique de Spinoza”. Viennent ensuite des Poésies et pièces fugitives, chansons à boire galantes et licencieuses assaisonnées d’anticléricalisme, parmi lesquels figurent deux courts textes en prose qui relèveraient plutôt de la section précédente étant donné leur caractère philosophique, mais qui ont visiblement été placés ici à cause de leur sujet – “Réflexions sur la génération des mâles et des femelles” et “Sur le cœur des femmes” –, ainsi que le poème sérieux intitulé “Réflexions sur le beau sexe”. On y trouve également, toujours en prose, des “Réflexions sur le crucifiement de Jésus de Nazareth” hautement blasphématoires. Le recueil s’achève
sur l’“Épitaphe de l’auteur” ». Ce dernier texte renvoyant à l’indication « ouvrage posthume » porté sur la page de titre permet au critique de conclure que « L’ensemble forme donc un tout et n’est pas une simple réunion de feuilles éparses agencées tant bien que mal après coup » (p. 114-115).
L’intérêt des pages philosophique des Rêveries métaphysiques d’un solitaire de Champagne réside dans la grande originalité du système de pensée qui y est exposé. Celui-ci repose sur une conception qui identifie « le premier principe au temps » (Matton, p. 68) d’où dérive « la première formulation de l’hypothèse transformiste évolutionniste, ou à tout le moins sa première formulation non ambiguë » (Matton, p. 61). Dans la grande confidentialité de son domicile champenois, Grignon aurait donc été en mesure d’effectuer rien moins qu’une « révolution philosophique » dont Sylvain Matton et Jean-Marc Mandosio s’attachent à déployer les principaux aspects en deux études très substantielles (reprises ici respectivement p. 61-100 et 113-136). Comme plusieurs des études déjà parues, celle de Cédric Grimoult situe les idées évolutionnistes de Grignon par rapport à celles d’un de ses contemporains plus célèbres, en l’occurrence Maupertuis (p. 137-142), tandis que Matton et Mandosio se sont intéressés en particulier à sa position par rapport à Diderot (développements antérieurs d’un article de Matton intégrés ici dans l’introduction, étude originale de Mandosio, p. 143-152). Yves Citton propose, enfin, en guise de postface, une lecture actualisante de Grignon assez subtile pour pouvoir intégrer en illustrations quelques-uns des « grelots de la nature » les plus spectaculaires du Musée archéologique national de Naples (mais sans faire référence curieusement aux « sonnettes » analogues, mais chronologiquement bien plus proches de Grignon, du roman de Guillard de Servigné).
Une des questions les plus intéressantes que pose pour nous la publication des Rêveries métaphysiques est celle du statut du texte édité. S’agit-il bien d’un manuscrit clandestin ? Jean-Marc Mandosio s’interroge à ce propos en concluant, de manière restrictive, qu’on pourrait le considérer en un certain sens comme clandestin dans la mesure où l’auteur est conscient qu’il contient des « pensées non autorisées », cependant la limite qu’il a apportée en conséquence à sa circulation a été si radicale que jamais le manuscrit n’a connu « cette forme de publicité qu’est la clandestinité ». De fait, plus qu’à un manuscrit clandestin, « nous avons
plutôt affaire ici à un écrit privé », dit-il fort justement (p. 115). Resterait à s’interroger sur la raison de sa non-diffusion. La transgression manifestes des dogmes religieux, dont les conséquences (« l’honorable distinction d’un bucher public », p. 158) sont évoquées par Grignon même, vient évidemment à l’esprit et parait indiquer la prudence comme motif principal. Ses stratégies de présentation semblent d’ailleurs mimer le jeu courant des ouvrages clandestins pour égarer la censure (ouvrage présenté comme posthume, adresse parodique). Une autre explication de la retenue radicale de Grignon pourrait cependant être aussi évoquée : la formalisation que l’on peut juger inaboutie de son texte.
Plusieurs éléments font penser que Grignon a été tenté de donner une autre forme à son « ouvrage posthume ». L’adresse africaine d’Ardra13, par exemple, pouvait ménager des développements fictifs laissant grande latitude pour intégrer les réflexions métaphysiques de Grignon dans un canevas susceptible d’intéresser le lecteur. Elle situe en effet le texte champenois dans une tradition narrative où le déplacement exotique est souvent propice à communiquer dans une grande liberté des idées illicites (que la transgression soit satirique, érotique ou philosophique). Mais dans notre cas, la référence est particulièrement abstraite, rien ne venant justifier cette géographie africaine, si ce n’est le fait de déléguer la parole à un « individu semi homme, semi bête, engendré d’une négresse et d’un Orang-Outang14 », le continent dit noir pouvant paraître un cadre vraisemblable pour la rencontre de ses parents supposés. Encore
faut-il ajouter que cette généalogie est elle-même un élément tout à fait abstrait : rien dans les propos du narrateur ne rappelle cette origine hybride et africaine. Confier l’énoncé des Rêveries à un tel « métaphysicien des bois » ne manquait pas d’intérêt et correspond notamment à une position stratégique dans le système évolutionniste de Grignon, qui pouvait être largement exploitée dans un cadre fictif. Là encore, les possibilités étaient riches et nombreuses. On imagine ce qu’un Dulaurens aurait pu en tirer, pour prendre l’exemple d’un auteur anticlérical livrant généreusement ses rêveries métaphysiques au public sous les apparences les plus variées15. Or si l’élément de mise en scène fictionnée est suffisamment fort chez Grignon des Bureaux pour être mis au centre de la page de titre de son manuscrit, sa mise en œuvre reste minimale. Elle est cantonnée dans deux petits paragraphes encadrant le Tintinnabulum, qui présentent le raisonnement au cœur de ce texte comme occasionné par une controverse entre l’Orang-Outang et « certain Théologien » parfaitement anonyme, dont les vains arguments sont exposés en six lignes. Les deux paragraphes sont du reste absolument détachables de l’ensemble, que toute autre situation d’énonciation permettant à un avatar philosophe de Grignon d’exposer ses théories pourrait introduire aussi judicieusement. On note que, plus loin, le chapitre intitulé « De l’âme » (p. 178-179), absolument théorique par ailleurs, se présente aussi comme un exposé des croyances des Orangs-Outangs. Avant-propos (p. 159) et Avis (p. 166) contiennent encore deux autres dispositifs narratifs restés en germe et réduits ici à l’expression excessivement laconique d’un sarcasme. Une hypothèse vient alors à l’esprit. Tout ne se passe-t-il pas comme si le Tintinnabulum et les Pensées métaphisiques représentaient les éléments philosophiques d’un ensemble que Grignon des Bureaux avait été tenté de mettre en œuvre dans un cadre fictif dont il n’a fait qu’esquisser les traits ? Ne pas mettre en circulation un tel texte relèverait alors de réticences d’une toute autre nature que celles avancées jusque-là. Grignon pouvait garder son manuscrit par devers lui tout simplement parce qu’il le jugeait inachevé, comme le dossier d’un livre projeté mais non réalisé. Cette hypothèse rendrait compte à la fois de sa cohérence et de son aspect morcelé. Grignon des Bureaux n’en a heureusement
pas moins conservé avec soin les fragments métaphysiques quelquefois fulgurants que Sylvain Matton livre à notre lecture.
Le grand mérite de cette édition est de traiter avec un scrupule exemplaire un texte au statut difficilement définissable, œuvre d’une « sorte de philosophe autodidacte » (Mandosio, p. 143) détaché des réseaux savants de son temps et susceptible de cogitations très originales par le fait de cette distance-même. Cette position, que Mandosio rapproche de celle d’un « fou philosophique » par analogie avec les « fous littéraires », ou d’un « génie visionnaire » (p. 151), le rend aussi très difficile à situer dans l’histoire des idées16. La portée des réflexions du Solitaire de Champagne avec « la première formulation véritable de l’idée moderne d’évolution » (Matton, p. 100) justifie amplement le remarquable effort réalisé ici dans ce but. Il permet de mesurer, enjeu considérable, l’ampleur de ce qui était pensable à une époque donnée et bouscule ainsi les simplifications abusives17.
Emmanuel Boussuge
Le Théâtre de l’incrédulité. Trois pièces manuscrites des Lumières irréligieuses, édition d’Alain Sandrier, Paris, Classiques Garnier, 2012, 337 p. Préface de Pierre Frantz.
Alain Sandrier rassemble ici une tragédie en un acte et en vers de Charles Duclos, écrite en 1737, et deux tragi-comédies anonymes en cinq actes et en prose, l’une des années 1740 et l’autre de 1764. Les trois pièces sont inédites, irréligieuses, parodiques. Toutes les trois, malgré les genres annoncés – tragédie et tragi-comédie – sont écrites pour déchaîner le rire. Ce sont leurs quatre points communs.
Dans une introduction aussi savante qu’alerte (p. 11-34), l’éditeur présente leur découverte et leur contenu. La bibliothèque Mazarine conserve, dans un recueil manuscrit de sept pièces de théâtre, l’unique exemplaire connu de la « petite comédie », donnée malicieusement par Duclos pour une « tragédie » sous un titre évocateur de cette double nature : La Mort de Mardi-Gras18. Elle était destinée, parmi d’autres « badinages impies », à divertir de jeunes seigneurs le vendredi-saint de l’année 1737. Mais la représentation en fut interdite et le manuscrit original brûlé par son auteur. C’est dans un recueil conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève que L’Embrasement de Sodome et La Religion voisinent avec plus de cinq textes divers – dont trois manuscrits philosophiques clandestins – suivis d’un florilège de « Pièces satiriques et érotiques19 ». Deux recueils conservés à l’Arsenal contiennent chacun une de ces deux tragi-comédies.
La Mort de Mardi-Gras est une tragédie « badine » où la parodie est très réussie. Le lecteur prend plaisir, comme à la Foire, à reconnaître travestis les alexandrins des grands classiques, et même plus largement « de Cyrano à Voltaire ». Il jouit des deux monologues grandiloquents, des stances écrites pour le chanoine Bombance, le plus truculent des bouffons personnages de la farce. Il imagine que si la représentation avait eu lieu, elle aurait vraiment diverti son public libertin. L’ensemble est irrespectueux selon les conventions du genre et l’irréligion se borne à
mettre en scène « l’affreux Fanatisme » sous le nom de « La Dévotion », à proclamer que Rome est « un sûr asile » pour les assassins et le crime, à railler le jeûne, la sainteté, l’Église et la résurrection. C’est une belle illustration du goût pour la parodie subversive dans le théâtre de société.
La subversion dans L’Embrasement de Sodome et dans La Religion est d’un tout autre ordre et plusieurs différences importantes creusent l’écart entre la pièce de Duclos d’un côté et les deux pièces anonymes de l’autre. D’abord la prose des deux tragi-comédies nuit considérablement à l’effet parodique qu’amplifient au contraire les vers. Puis, deuxième différence, comme le dit très bien Alain Sandrier, les deux pièces en prose « semblent davantage relever d’un “théâtre” à lire ». Troisième différence, les dialogues « sont souvent chargés de développements ralentissant l’action » (p. 19), ce qui affadit beaucoup le caractère polémique affiché par les deux pièces, qui, loin de la verve irréligieuse de La Mort de Mardi-Gras, délivrent un message laborieux et répétitif. La quatrième différence importante qui empêche de mettre sur le même plan les trois pièces est la place que la sexualité, absente de la première, tient dans les deux autres. Dans L’Embrasement de Sodome, « la légende biblique est mise en images, souvent salaces, et littéralement incarnée par des personnages, qui font sentir leur poids de chair » (p. 11-12) ce qui veut dire en clair que « les questions sexuelles sont au premier plan, la référence à Sodome y invite » (p. 15). On peut dire en effet avec Alain Sandrier que « la “révélation” sexuelle de Sara avec [l’ange] Zuphta » est « le centre » du « premier tableau », que l’épisode de Sodome est « entièrement centré sur la séduction brutale des filles de Lot par les anges », que « l’assaut se fait sur scène » et qu’« on verse alors dans le théâtre pornographique ». Peut-on vraiment dire que « La Religion n’a pas creusé le sillon de l’érotisme avec la même intensité » ? En tout cas, on reconnaît avec l’éditeur que la scène 3 de l’acte III où « Le Fanatisme devance quelque peu les licences du mariage » avec la Crédulité – « action […] brève et sans équivoque » – est « le seul moment de la pièce où la sexualité affleure si nettement ». Cette précision même suggère une tendance latente. Dans les deux pièces, il est difficile de parler d’érotisme, mais le registre bas, envahissant dans L’Embrasement de Sodome, sporadique dans La Religion, parasite le « travail de sape des fondements religieux de la société ».
Le rapprochement s’impose de ces deux tragi-comédies en prose avec Saül, la parodie de tragédie biblique de Voltaire, en prose elle
aussi, dont une copie se trouve mêlée à des manuscrits philosophiques clandestins dans le recueil manuscrit 1192 de la Bibliothèque Mazarine. Après avoir circulé en manuscrit en 1762, Saül est éditée en 1763, puis publiée dans L’Évangile de la raison en 1764. Le rapprochement s’impose d’autant plus que, des écrits iconoclastes voltairiens, ce n’est pas le plus efficace. Alain Sandrier s’y attache dans un intéressant développement intitulé : « Des “Manuscrits philosophiques clandestins” ? » (p. 19-23). La question posée relève de la définition du corpus des manuscrits philosophiques clandestins20. Elle mérite en effet qu’on s’y arrête. On peut rapidement exclure de cette hypothèse La Mort de Mardi-Gras qui fait partie d’un recueil entièrement constitué de sept pièces du théâtre de société apprécié par les cercles mondains, dont, on l’a vu, elle a toutes les caractéristiques. Le cas de La Religion et de L’Embrasement de Sodome n’est pas si facile à régler. Cinq éléments justifient la question : leur nature exclusivement manuscrite, leur anonymat, leur idéologie antireligieuse, leur association, dans le recueil de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, avec trois manuscrits philosophiques clandestins parmi d’autres textes, la preuve de leur circulation manuscrite, surtout pour L’Embrasement de Sodome, dont on connaît quatre copies alors qu’on n’en connaît que deux pour La Religion. Mais est-ce suffisant pour appartenir au corpus découvert par Lanson, confirmé par Ira O. Wade et par cent années de recherche ? Si on élargit « encore le périmètre de cette catégorie de “manuscrit philosophique clandestin”, au demeurant toute empirique » (p. 23), ne risque-t-on pas de brouiller les repères en détruisant l’unité même du corpus en question qui, comme le dit si bien Alain Sandrier, « relève des formes coutumières du débat d’idées » ? Qu’y a-t-il de commun entre les deux pièces en question et le Mémoire des pensées et sentiments de Jean Meslier, l’Examen de la religion, les Difficultés sur la religion, et plus précisément avec les Méditations philosophiques sur Dieu, le monde et l’homme, les Essais de quelques idées sur Dieu et sur la Trinité, la Lettre de Thrasibule à Leucippe, manuscrits tous les trois réunis sous la même couverture dans le recueil manuscrit 4436 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève ? L’anonymat, la circulation manuscrite, la critique violemment antireligieuse. L’anonymat et la circulation manuscrite
sont des usages courants au xviiie siècle qui, on le sait, ne suffisent pas à classer un texte. Quant à la critique violemment antireligieuse, caractéristique des Lumières, elle n’est certes pas l’exclusivité des manuscrits philosophiques clandestins, mais on peut y constater partout à l’œuvre, à partir des années 1740, l’influence de ces mêmes manuscrits philosophiques clandestins. Le recueil 4436 qui ne peut être antérieur à 1764, date de La Religion, n’est pas un recueil factice21. Il est constitué selon une logique d’idéologie critique autour de trois fleurons clandestins, comme le recueil 1192 de la Mazarine qui contient Saül, est constitué autour du Système de religion purement naturelle, des Doutes sur la religion et de Parité de la vie et de la mort, selon le procédé des recueils imprimés militants que Voltaire a inauguré en 1764 avec L’Évangile de la raison, dans la « lutte contre l’Infâme ». En se développant et s’approfondissant, la recherche sur les manuscrits philosophiques clandestins conduit à en découvrir les marges. Il est utile et nécessaire de les explorer, sans pour cela prendre le risque de diluer l’identité du corpus.
En tout cas, dans une édition très soignée, très bien informée, annotée avec beaucoup de précision, et enrichie de variantes et d’annexes22, Alain Sandrier rouvre ici un débat qui n’a pas fini de passionner les esprits.
Geneviève Artigas-Menant
Mark Curran, Atheism, religion and Enlightenment in pre-revolutionary Europe, The Royal Historical Society, New York, The Boydell Press, 2012, 226 p.
Partant du constat de la place limitée concédée au baron d’Holbach dans les études dix-huitiémistes, l’auteur se propose de réévaluer son œuvre envisagée en termes de rayonnement dans la culture et la société de l’Europe pré-révolutionnaire. La méthodologie choisie revendique l’héritage de l’histoire de l’imprimé telle que Robert Darnton l’a mise en œuvre, et plus particulièrement appliquée au fonds des archives de la Société Typographique de Neuchâtel. L’étude bénéficie plus généralement de l’approche sociologique adoptée par de nombreuses monographies depuis vingt ans, en renouvelant notre vision des Lumières et en déplaçant les frontières entre philosophie et antiphilosophie. Aux perspectives intellectuelles et esthétiques, longtemps dominantes, s’est ajoutée une vision culturelle, par nature synthétique, qui a permis d’appréhender les phénomènes liés à la circulation des idées : le commerce du livre, sa diffusion, clandestine ou publique, ses usages variés ont fait l’objet de travaux remarquables. Si les essais et articles de R. Darnton ont pu aborder l’œuvre du baron, ce ne fut que de façon sporadique. L’étude d’Alain Sandrier (Le Style philosophique du baron d’Holbach, 2004), d’une grande finesse, répondait à un questionnement de type littéraire : il lui manquait son pendant historique. C’est ce manque que vient combler le travail de Mark Curran, qui s’appuie sur une connaissance extensive de l’œuvre du baron, et plus encore sur les réponses, philosophiques, et surtout antiphilosophiques, qui lui ont été faites de 1752 à 1789, mais aussi sur les enseignements de la base de données constituée à partir des archives de la STN. Les données quantitatives, matérialisées par des visuels, corroborent ou infirment les hypothèses avancées jusque-là. Le patient dépouillement des journaux des années 1770 et 1780 complète la documentation dont profite l’étude : les cent vingt imprimés, traités, réquisitoires, mandements, mais aussi poèmes ou romans, qui, principalement ou de manière furtive, ont cherché à réfuter l’une ou l’autre des œuvres phares du baron trouvent leur écho dans la presse. Au long de son enquête, l’auteur poursuit une même interrogation : dans quelle mesure la sphère publique tient-elle un rôle déterminant dans le débat d’idées ? La priorité a longtemps été mise sur les auteurs, leur œuvre singulière, leur pensée originale, au détriment
d’une approche inclusive, de type holistique, qui seule garantit, par la saisie simultanée de nombreux paramètres, une compréhension de cette réalité complexe qu’on appelle les Lumières.
Dans le chapitre 1, « L’athée vertueux », l’auteur donne l’envergure de l’œuvre holbachienne, en termes de production, depuis les traductions puis les éditions des manuscrits de Boulanger jusqu’aux ouvrages originaux, et en termes de diffusion, notamment à partir des données de la STN. C’est l’occasion de souligner les talents de propagandiste que manifeste cet aristocrate raffiné, talents qui lui attireront en retour des réactions proportionnées dans le public lettré. Le chapitre 2, « La sphère orale et écrite », met précisément l’accent sur la dimension communicationnelle de la réalité littéraire. L’auteur part de l’image employée par l’abbé Galiani, le jet de dés, utilisée pour récuser la pensée matérialiste. Il montre la fortune de cette métaphore qui en est venue à figurer le matérialisme dans l’esprit du public, alors même qu’elle est explicitement récusée par d’Holbach, qui s’en sert pour réfuter la thèse du hasard, et affirmer, contre les « déicoles », un strict nécessitarisme. Ce débat se prolongera pendant les dix années à venir. Cet exemple montre aussi de quelle façon le baron teste ses idées sur ses hôtes dans l’espace confiné du salon de la rue Royale Saint-Roch, avant de leur donner une existence dans la sphère publique. La conversation se déploie aussi dans les réseaux des correspondants, comme le montrent les 25.000 lettres de la STN, la plus grosse correspondance de librairie de l’époque jamais conservée. Par les lettres, la presse clandestine, la conversation de salon, les sermons, les discussions publiques, beaucoup de gens sont entrés en contact avec l’œuvre de d’Holbach sans pour autant toucher un imprimé. L’oral reste donc prédominant dans la circulation des idées et la formation de l’opinion. Le chapitre 3, « Livres et brochures », porte plus classiquement sur les réponses données aux œuvres de d’Holbach, mais en adoptant un point de vue plus quantitatif que qualitatif. Les données bibliométriques, figurées sous forme de graphiques, permettent de juger de l’importance de cette production, et de son étalement dans le temps. L’auteur s’intéresse aux réfutations majeures, telles que celles de l’abbé Bergier, mais ne néglige pas pour autant les répliques moins systématiquement étudiées, les romans ou les poèmes, et les réfutations partielles. Il y est principalement question du Système de la nature, et de la campagne antiphilosophique qui sévit dans les années qui suivent sa parution. Le marché du livre religieux
connaît alors un regain, qui profite à toute l’édition européenne de langue française, tous partis ou clans confondus. L’affaire du Système est d’abord une très bonne affaire commerciale. Le chapitre 4 est consacré aux périodiques, dans une période où les titres se multiplient, où le public s’élargit et se diversifie, où le rôle de la critique se montre déterminant du succès ou de la chute d’un livre. L’auteur s’est livré au dépouillement des principaux journaux, de façon à répertorier les articles parus où il est question de l’œuvre du baron. En augmentation de 1770 à 1781, avec un pic en 1774, ces articles prouvent l’implication de la presse dans la campagne, et de son action qui tend à durcir les antagonismes. Le chapitre 5 donne la parole aux philosophes, puisqu’y sont examinées les réactions qui furent les leurs lors de la parution du Système. La réponse de Frédéric II est plus celle d’un roi que d’un philosophe. Quant à Voltaire, son revirement, une fois passé l’enthousiasme de la découverte, n’est pas exempt d’arrière-pensées ni de calculs personnels. De son étrange réponse, intitulée Dieu, il inonde toute l’Europe, et mène campagne dans sa correspondance contre un livre que désormais il honnit. Rares sont en définitive les réactions de philosophes. Avec Jacques le Fataliste, Diderot apporte son soutien au fatalisme, en défendant l’utilité et la moralité de cette doctrine, mais sans donner à sa pensée un tour aussi systématique que le maître du Grandval. Le chapitre 6, qui rend compte des « réactions institutionnelles », est plus convenu. L’auteur, en rappelant les faits, remarque cependant que les institutions – roi, parlements, hiérarchie catholique, Sorbonne, académies – réagissent de façon non concertée, donnant une impression d’incohérence et de confusion. Le réquisitoire de Séguier indispose le roi, qui le fait interdire. L’Assemblée du clergé tente de même de faire pression sur l’exécutif sans plus de succès. La Sorbonne achève dans cette affaire son irréversible déclin. L’absence de stratégie commune, qui condamne l’action à sa plus totale inefficacité, fait apparaître d’autant plus injustifiées les craintes des philosophes. Les chapitres 7 et 8, qui traitent des « Lumières chrétiennes », passent en revue les formes d’accommodation de la pensée et de l’expression au goût du jour, non selon une approche poétique, comme cela a déjà été tenté ailleurs, mais pour contribuer à une histoire des représentations. Les romans antiphilosophiques des années 1770 et 1780, en donnant à l’athéisme une existence littéraire, traduisent l’effort de penser la différence, de lui conférer un statut, forcément marginal, et de l’articuler ainsi au
christianisme. Ils sont la faction avancée du discours religieux, la plus apte à intégrer par le jeu dialectique l’altérité philosophique ; la plus apte aussi à revendiquer la raison comme son bien propre. Le « christianisme éclairé » doit faire concurrence à la philosophie sur son propre terrain. Il porte une ambition : par la confrontation de leur dogmatique avec la frange radicale du philosophisme moderne, les apologistes entendent mettre le christianisme à l’épreuve, et montrer qu’il demeure la seule métaphysique valide. Leurs stratégies discursives, loin de n’être qu’une copie symétriquement inverse de leurs adversaires, se révèlent être un effet de la sphère publique avec laquelle elles interagissent. Ils savent profiter du choc généré par la diffusion des œuvres de d’Holbach pour s’imposer sur le marché de l’édition, au point d’éclipser des classiques de la littérature séditieuse.
De copieux appendices terminent le livre. La liste des réfutations de d’Holbach, d’une grande utilité, notamment par le bref résumé qui accompagne chaque référence, pâtit cependant de l’arbitraire des catégories employées : la distinction entre important, partiel, implicite et mineur ne saute pas aux yeux, et dans le détail pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Plus claire est la liste des articles des principaux périodiques écrits en réaction à d’Holbach, annonces ou comptes rendus des réfutations des ouvrages de ce dernier.
Qu’on n’attende pas de ce livre une analyse pointue des textes évoqués, ni même un regard neuf sur ceux-ci. L’érudition s’y trouve très limitée. En revanche l’effort de synthèse est impressionnant ; la démarche, toujours explicite, progresse pas à pas vers une élucidation plus complète de la place du matérialisme athée, de sa diffusion, de ses échos nombreux et contradictoires. Mais il est en définitive majoritairement question d’antiphilosophie dans cette étude, considérée non seulement comme réaction, mais comme participant d’un même espace d’échanges, intellectuels, culturels, économiques. C’est l’ambition, et l’honneur, de ce livre d’avoir cherché à saisir, au-delà des clivages faciles, la complexité des Lumières chrétiennes.
Nicolas Brucker
Université de Lorraine
Colas Duflo, Les Aventures de Sophie. La philosophie dans le roman au xviiie siècle, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », 2013, 287 p.
Colas Duflo est un philosophe engagé dans les voies de la littérature, s’intéressant non seulement aux grands systèmes mais aussi à la manière dont ceux-ci se traduisent en vie, en passions, en récits. Il publie aujourd’hui deux ouvrages sur ces questions : un recueil d’actes de colloque international : Fictions de la pensée, pensées de la fiction aux xviie et xviiie siècles, dans la collection « République des Lettres », Québec-Paris, CIERL-Hermann, 2013, et le livre de poche qui fait plus particulièrement l’objet de notre attention : Les Aventures de Sophie.
L’auteur adopte une approche philosophique, formelle, de la question des régimes du récit et de la réflexion philosophique en ce sens qu’il se demande comment les auteurs se sont ingéniés à surmonter et à dépasser l’opposition entre la narration et l’analyse, entre l’action et la réflexion. Ce sont des régimes antagonistes, explique-t-il, et leur rencontre exige des distorsions de la vraisemblance ou des déguisements de la pensée, des manœuvres narratives et une discrétion quant aux fondements de la représentation et de l’analyse qui sont proposées. C’est cette « tension entre deux discours hétéronomes » qui l’intéresse.
C’est donc un livre instructif, pédagogique, qui aborde la rencontre entre roman et philosophie sur le plan de la méthode, pour ainsi dire. Il ne traque pas le vocabulaire de Malebranche, de Bayle ou de Pascal dans les romans de Prévost, ni celui de Fréret ou de tel autre philosophe clandestin dans ceux du marquis de Sade. Il n’interprète pas l’action des Liaisons dangereuses comme une mise en scène de la bataille entre le mécanisme de l’Encyclopédie et la philosophie du sentiment de Rousseau. Mais il réfléchit sur des cas exemplaires où le registre de la narration intègre celui de la philosophie et où l’écrivain traduit en termes romanesques – par ex. en une anthropologie des passions – une conception philosophique de l’homme et du monde.
Après une réflexion méthodologique, où sont intégrées les phrases gnomiques et les métalepses analysées par Gérard Genette, nous sommes invités à guetter toutes les marques d’une réflexion qui vise une « vérité » au-delà du monde fictif du roman : autrement dit, Colas Duflo propose des contre-exemples à ce que Genette appelle « l’intransitivité du texte de fiction » qui le constitue en « objet autonome et sa relation au
lecteur en relation esthétique ». Rousseau, par exemple, veut conduire son lecteur, au moyen de dissertations abondantes au sein de la fiction vers la considération de vérités extratextuelles. « Un tel texte n’est donc ni intransitif, ni autonome, et demande plus et autre chose que la seule appréciation esthétique : c’est peut-être le seul moyen de sauver le roman. » (p. 64). Le roman du xviiie siècle ne se contente pas de raconter que « la marquise sortit à cinq heures » : il la fait accompagner par un honnête homme qui réfléchit avec elle sur le monde et qui tire les leçons de leurs observations. C’est Cleveland, le narrateur philosophe, Jacques, le valet philosophe, Pangloss, le maître en philosophie, la femme philosophe…, dont les leçons sont mises à l’épreuve de l’expérience. De cette façon la philosophie est poussée à donner sa réponse à la « seule question qui vaille » : « La philosophie vaut-elle quelque chose ? Aide-t-elle à vivre ? ». L’ambition du roman de l’époque classique est en ce sens parfaitement conforme à l’ambition philosophique : il s’agit « “d’apprendre à distinguer le vrai d’avec le faux, pour voir clair en [nos] actions, et marcher avec assurance en cette vie”. Les romans du personnage du philosophe interrogent la validité d’un tel projet et posent, de façon narrative, la question philosophique par excellence. »
Cette façon d’inscrire la philosophie dans le roman a des effets à la fois sur la narration et sur la philosophie : on pense au statut des « philosophèmes » dans le théâtre de Molière. Le propos du romancier peut être de dénoncer l’échec de la philosophie à l’épreuve de l’expérience (Prévost), le propos philosophique peut dépasser la vraisemblance du cadre romanesque (La Religieuse) ; les épisodes du roman peuvent parfaitement refléter une vision anthropologique explicitée ailleurs (Bernardin de Saint-Pierre dans ses Études). Le roman antiphilosophique peut aussi constituer un genre « hypertextuel », doublement hypertextuel même, dans le cas de Candide, dont l’hypotexte est à la fois la philosophie de Leibniz et le modèle romanesque de Prévost : c’est la réfutation narrative d’une philosophie au moyen d’une parodie romanesque. Enfin, Jacques le fataliste fait l’objet d’une analyse éclairante en tant qu’« antiroman dont vous êtes le héros » : « l’essai de philosophie narrative passe ici par l’antiroman du lecteur. Il a pour objet de nous délivrer de cette illusion philosophique alimentée par la lecture des romans : l’illusion des possibles, en tant qu’elle favorise la croyance en la liberté métaphysique. Tout n’est pas également possible ; le lecteur l’apprendra à ses dépens :
c’est l’objet même du texte, le point où le contenu idéologique rejoint la forme narrative et où la philosophie de Jacques, dans une nouvelle forme de métalepse, s’applique à la discussion sur le récit qui raconte ses aventures : “quoique tout cela vous paraisse également possible, Jacques n’était pas de cet avis ; il n’y avait de réellement possible que la chose qui était écrite en haut” » (p. 265).
Certes, Colas Duflo n’identifie pas le manuscrit philosophique clandestin que Prévost met entre les mains du cardinal Dubois, intitulé Deus, an sit ? Cependant, bien documentée, méthodique, pédagogique, intégrée dans le débat critique sur le roman philosophique et sur la philosophie romanesque, très pertinente dans les analyses proposées d’un choix de romans exemplaires, cette étude est précieuse, également utile aux enseignants et aux étudiants.
Antony McKenna
1 Filippo D’Angelo est l’auteur d’une thèse remarquable à paraître (Le Moi dissocié. Libertinage et fiction dans le roman à la première personne au xviie siècle, Université Stendhal-Grenoble, 2008). Il est aussi l’auteur d’un magnifique « roman libertin » contemporain composé en Italien, où Cyrano de Bergerac joue un rôle non négligeable : La Fine dell’altro mondo, Minimum fax, 2012.
2 Voir l’ouvrage collectif récent Gli Incogniti e l’Europa, a cura di D. Conrieri, Bologna, libri di Emil, 2011 (art. de D. Conrieri, F. Bondi, C. Carminati, L. Grassi, N. Michelassi, V. Nider, S. Villani, S. Vuelta García).
3 Voir, d’une part, É. Quennehen, « À Propos des Préadamites : deux manuscrits des Archives Nationales », La Lettre clandestine, no 3 (1994), rééd. 1999, p. 305-310 ; « Un Nouveau Manuscrit des Préadamites », ibid., no 4 (1995), rééd. 1999, p. 545-551 ; « Lapeyrère, la Chine et la chronologie biblique », ibid., no 9, 2000, p. 243-255. Voir d’autre part : « L’auteur des Préadamites, Isaac Lapeyrère. Essai biographique », dans Dissidents, excentriques et marginaux de l’Âge classique. Autour de Cyrano de Bergerac. Bouquet offert à Madeleine Alcover, éd. Patricia Harry, Alain Mothu et Philippe Sellier, Paris, Honoré, Champion, 2006, p. 349-373.
4 À propos de l’affaire célèbre des thèses soutenues en 1624 par Villon et de Claves, Oddos renvoie ainsi judicieusement (p. 28) aux travaux récents et références fournies par Didier Kahn – nom manquant à l’Index. À propos des origines marranes de Lapeyrère, Oddos tempère au fil de deux notes (p. 24, n. 61 et p. 97, n. 21) ce qu’il avait dit en 1974, où il excluait cette hypothèse généalogique (défendue en revanche par Popkin). Son exégèse de la lettre à Ismaël Boulliau où Lapeyrère accepte d’être qualifié de « juif » tout en précisant ne l’être pas « de la manière qu’il l’entend » mais « comme saint Paul l’a entendu et l’a escrit », s’ouvre désormais à la possibilité d’un aveu d’ascendance juive, n’excluant pas une « fière conversion » et la priorité donnée à la foi calviniste dans laquelle il a été élevé. Signalons par ailleurs ces retouches : Blaise Pascal est désormais cité d’après l’édition donnée en 2000 par Philippe Sellier (p. 44) ; au sujet du docteur de Sorbonne Blaise Le Féron, il est renvoyé au Dictionnaire de Port-Royal (2004) (p. 107) ; à propos d’une lettre de Christophe Dupuis, référence est faite à sa correspondance récemment éditée à Tübingen (p. 132). Dans la bibliographie sont signalées (p. 297) la monographie de Richard Popkin (1987) et la thèse d’Élizabeth Quennehen (1993), et un peu plus loin (p. 303), visiblement à la dernière minute puisqu’il n’est pas correctement classé, un article de 2004 de W. Poole.
5 Voir « The Marrano Theology of Isaac La Peyrère », Studi internazionali di filosofia, 5 (1973), p. 98-126 ; « The Pre-Adamite Theory in the Renaissance”, dans Edward P. Mahoney (dir.), Philosophy and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller, Leiden, Brill, 1976, p. 50-69.
6 Les premières attestations de ce manuscrit remontent à 1642 ; les Praeadamitae paraîtront en Hollande en 1655. Richelieu avait interdit leur parution, mais la mort du ministre, en décembre 1642, semble avoir incliné Lapeyrère à faire paraître en France une version (inachevée, dit-il) de son Rappel.
7 F. Parente renvoie On en trouve au moins quatre exemplaires sur Paris, mais aussi à Poitiers, Toulouse, Chantilly, Rouen, Besançon, etc. (cf. le CCfr), ainsi qu’à l’Étranger (cf. le Karlsruhe Virtual Catalog). Sait-on d’ailleurs si son éditeur, Morel, en fit un énorme tirage ?
8 Le découpage des phrases est souvent singulier (ex. : « Pour le second. Ie respons. Qu’il se peut dire qu’Abraham… » [p. 118] ; « Ce n’est pas que nostre Foy estant purament Intellectuelle ; & nostre Intellect […]. Que la Foy ne soit de la Raison » [p. 149] ; etc.) et l’on n’a aucune garantie que l’auteur en soit responsable. Pourquoi infliger tant de difficultés à son lecteur ?
9 F. Parente a souhaité respecter scrupuleusement l’original, mais c’était une gageure impossible. Quelques minutes nous ont suffi pour dénicher des inexactitudes : ainsi, p. 77 (e.o. p. 33), on lit « dedant son sein », mais la finale n’est pas un « t » dans l’original, c’est un « 1 » minuscule ; ailleurs (p. 94, e.o. p. 96), un « l’vn » est transcrit à tort « I’vn » et « Roys » est placé ensuite à tort en petite capitales ; on lit p. 150 que la foi est « abbaissé & precipitée », alors que l’accord est correct dans l’original (p. 311). Etc.
10 H.B. a traduit et présenté le livre VI du TR dans Libertins du xviie siècle, éd. J. Prévot et alii, t. II, Paris, Gallimard, 2004, p. 217-404 et [Notice et notes] 1490-1553.
11 Voir pour plus de précision notre compte rendu de Corpus, revue de philosophie, no 59, « Telliamed », mis en œuvre par Francine Markovits, dans La Lettre clandestine, no 20, 2012, p. 450-451.
12 Tintinnabulum Naturæ ou Rêveries d’un individu semi homme semi bête engendré d’une négresse et d’un orang-outang. Suivi de Pensées métaphisiques lancées dans le tourbillon et de quelques poésies et piéces fugitives. Par un solitaire de Champagne, avec des études de Miguel Benítez, Alain Mothu, Alain Niderst et Charles Porset, Paris-Milan, Séha-Arché, 2002.
13 Le lieu d’« édition » attribué fictivement au manuscrit, correspond à la capitale d’un royaume côtier du golfe du Bénin du même nom. Par souci de précision géographique, ajoutons aux indications fournies (p. 9-11) que ce toponyme était dédoublé en Grand et Petit-Ardra, villes jumelles, la capitale proprement dite, à l’intérieur des terres, et son port, sur la côte. La première localisation de ce doublon urbain avait correspondu aux actuelles villes béninoises d’Allada et Offra, avant que le premier royaume d’Ardra battu en 1724 par le puissant Dahomey ne se réfugie au sud-est répétant le dédoublement de ses villes principales à l’emplacement des actuelles Porto Novo et Ekpé (voir Pierre Verger, « Les côtes d’Afrique occidentale entre “Rio Volta” et “Rio Lagos” (1535-1773) », Journal de la Société des Africanistes, 1968, t. 38, fasc. 1, p. 35-58). Il est évidemment vain de chercher à quelle Ardra Grignon des Bureaux se référait. Comme le Congo des Bijoux indiscrets ou Madrogan, la capitale supposée de l’Abyssinie, dans le roman perdu de Melotta Ossompi écrit par Louis-Joseph de La Rochegérault vers 1750, Ardra est un point de localisation de pure fantaisie.
14 Il convient de noter que ce que l’on désigne comme « ourang outang » au xviiie siècle est beaucoup plus large que la définition courante aujourd’hui renvoyant exclusivement à l’espèce répandue en Asie méridionale. Voir à ce sujet le remarquable article d’Alain Mothu, « Rêves de singe au xviiie siècle », dans Tintinnabulum Naturæ, etc., op. cit., p. 79-156.
15 L’ourang outang d’Ardra avait tout pour inspirer un tel romancier capable de donner la parole, par exemple, à une momie morte et vivante à la fois et fort métaphysicienne, elle aussi, dans Imirce en 1765.
16 Les lecteurs de la somme d’André Blavier sur le sujet n’ignorent pas à quel point la pente philosophique est répandue chez les fous littéraires. Grignon des Bureaux aurait pu être classé dans la copieuse section des « Cosmogones, philosophes de la “Nature” » (Les Fous littéraires, Édition des Cendres, 2001 [1re édition 1982], p. 271-364).
17 Dans son introduction, Sylvain Matton insiste bien sur la portée polémique de la découverte et de sa prise en compte dans l’histoire des idées, notamment contre Michel Foucault et les critiques prolongeant sa pensée (p. 85-87).
18 Bibliothèque Mazarine, recueil manuscrit 4004. Alain Sandrier rend hommage à Dominique Quéro qui a exhumé ce recueil. Voir D. Quéro, « La Mort de Mardi-Gras : “résurrection littéraire” d’un inédit de Duclos », R.H.L.F., 2000, no 2, p. 237-253.
19 Bibliothèque Sainte-Geneviève, recueil manuscrit 4336. Voir Alain Mothu et Alain Sandrier, « Un nouveau recueil de manuscrits à la bibliothèque Sainte-Geneviève », La Lettre clandestine, no 15, Paris, PUPS, 2007, p. 476-490.
20 La Lettre clandestine a toujours été le lieu de débats utiles sur cette question à laquelle elle a consacré en 1998 le dossier du numéro sept intitulé L’Identification du texte clandestin aux xviie et xviiie siècles.
21 D’après des clichés, François Moureau date la reliure du recueil de « vers 1770 », voir A. Mothu et A. Sandrier, art. cit., La Lettre clandestine no 15, p. 478.
22 On connaît quatre copies manuscrites de L’Embrasement de Sodome. Le texte de base choisi est la version de l’Arsenal (ms 9405) et les variantes sont celles du manuscrit 4336 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Le texte de base choisi pour La Religion est la version de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et donc, pour cette pièce, l’édition fournit les variantes du manuscrit 9523 de l’Arsenal, seul autre exemplaire connu. L’Embrasement de Sodome est suivie de trois annexes : la totalité de la scène 1 de l’Acte V dans la version très différente de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, une note sur les autres textes du manuscrit Arsenal 9405, le texte des chapitres 18 et 19 de la Genèse dans la traduction de Lemaître de Sacy.