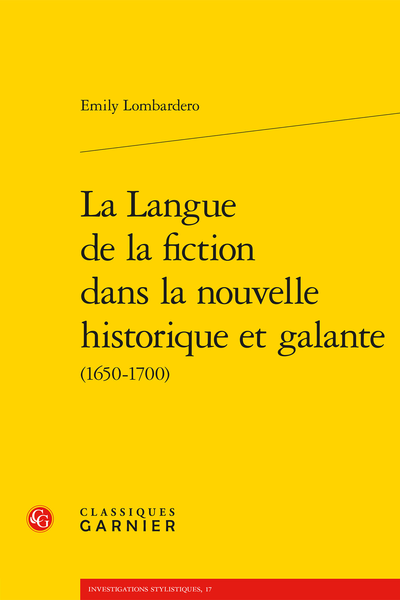
Introduction à la troisième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)
- Pages : 233 à 234
- Collection : Investigations stylistiques, n° 17
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782406167020
- ISBN : 978-2-406-16702-0
- ISSN : 2271-7013
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16702-0.p.0233
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/06/2024
- Langue : Français
Introduction à la troisième partie
La fin du xviie siècle marque un tournant majeur aussi bien dans les pratiques que dans les théories de la fiction narrative, au sens où celle-ci s’émancipe de l’imaginaire de la parole, entendue comme production orale du discours1. En effet, dans la nouvelle, l’écriture de la fiction cesse progressivement de renvoyer à une mythique oralité première, et l’on voit diminuer non seulement les dispositifs de mise en scène de la narration – comme l’enchâssement d’histoires secondaires, si fréquent dans le roman – mais encore tout un ensemble de stylèmes caractéristiques d’un « écrit oralisé2 ». Cause, ou conséquence : les discours critiques repensent la nature de la fiction, de moins en moins envisagée comme le prolongement de l’activité orale du contage. C’est alors l’Histoire qui semble s’imposer comme nouveau modèle du récit : la chronique comme les mémoires relèvent d’un mode de narration qui prend acte du medium du livre. L’évolution des formes de l’énonciation narrative dans la fiction sérieuse, cependant, n’est pas réductible à l’imitation d’une voix 234historienne : certains auteurs et autrices de nouvelles expérimentent en effet la possibilité d’un récit sans narrateur ou presque, et consomment la rupture entre récit et imaginaire de la voix d’une manière qui demeure, à la fin du xviie siècle, le propre de la fiction.
En nous attachant à décrire précisément l’évolution de l’énonciation narrative dans la fiction de la fin du xviie siècle, nous tenterons de montrer que, si les récits factuels contribuent au bouleversement énonciatif de la fiction en concurrençant le modèle traditionnel du contage, ils proposent un modèle de récit encore largement tributaire de l’art oratoire, notamment pour ce qui concerne l’Histoire à la troisième personne. Son imitation dans la veine historique de la nouvelle implique donc un fort marquage de la présence auctoriale, qui contraste avec les stratégies du récit « montré » et font de ce dernier une spécificité de la fiction (chapitre 5). En outre, l’idéal du récit sans narrateur engage les auteurs à concevoir de nouvelles stratégies de guidage pour les lecteurs, qui exploitent les potentialités de l’écrit et les adaptent aux besoins de la fiction. L’évolution des pratiques et des théories de la fiction informe donc profondément la mise en texte du récit : de la phrase au livre, le texte narratif semble prendre en charge une partie des fonctions autrefois dévolues au narrateur fictionnel (chapitre 6). Enfin, l’idéal de l’effacement énonciatif informe la pensée du style, l’époque valorisant, en même temps que la disparition de la voix narrative, une forme de neutralité stylistique. On verra que le genre de la nouvelle est traversé par une tension entre uniformisation et individuation linguistique, à l’origine d’un déplacement du travail stylistique vers de nouveaux territoires, peut-être propres à l’écrit (chapitre 7).
1 Nous renvoyons à Badiou-Monferran, Claire et Denis, Delphine, Le narrateur en question(s) dans les fictions d’ancien régime, ouvr. cité, ainsi qu’à Lallemand, Marie-Gabrielle et Mounier, Pascale, Elseneur, no 32, L’oralité dans le roman (xvie et xviie siècles), 2017. Voir également la thèse d’Adrienne Petit qui, à travers le prisme de la représentation des passions, retrace finement l’histoire de ce « passage d’une rhétorique – art de parler – à une poétique – art d’écrire » (Petit, Adrienne, Le Discours romanesque des passions, ouvr. cité, p. 8). Précisons toutefois que ce propos ne concerne que la fiction narrative sérieuse : les genres comiques sont en effet le lieu d’un travail d’oralisation du récit écrit sur lequel nous nous attarderons infra, p. 237 sq.
2 Claire Badiou-Monferran emprunte la notion d’« écrit oralisé » à Peter Koch et Wulf Œsterreicher, pour l’inscrire dans un rapport d’opposition avec celle d’« oral scripturalisé » (Jean-Michel Adam). Ces expressions en miroir lui permettent de décrire le changement qui s’opère dans la prose narrative classique au tournant des années 1650, grâce auquel un marqueur d’oralité comme le « et » de relance peut se voir réinvesti en « “effet de clôture”, emblème d’une prose écrite » (Badiou-Monferran, Claire, « De l’écrit oralisé à l’oral scripturalisé. L’évolution des emplois de Et, jonctif de phrases et de propositions, dans les fictions narratives en prose des xvie et xviie siècles », Elseneur, no 32, L’oralité dans le roman (xvie et xviie siècles), 2017, p. 74).