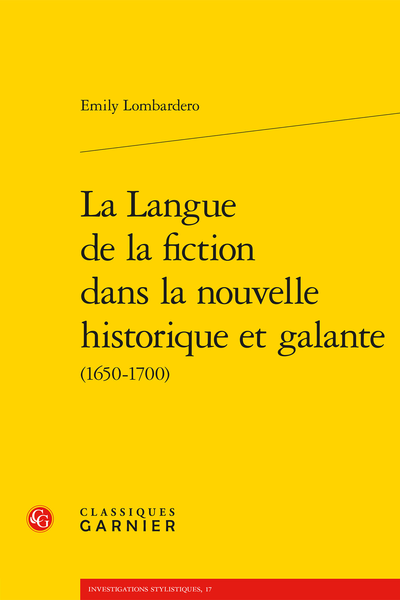
Introduction à la quatrième partie
- Publication type: Book chapter
- Book: La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)
- Pages: 457 to 459
- Collection: Stylistic Investigations, n° 17
- CLIL theme: 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN: 9782406167020
- ISBN: 978-2-406-16702-0
- ISSN: 2271-7013
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16702-0.p.0457
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-05-2024
- Language: French
Introduction à la quatrième partie
On peut reconnaître, assez intuitivement, l’existence d’un lien privilégié entre le récit de fiction et le personnage, au regard duquel les essais formalistes du « Nouveau Roman » – personnages sans noms, romans sans personnages – constituent des expériences limites. Pour les auteurs et les critiques de l’âge classique, il ne fait aucun doute que l’art du romancier consiste à « faire intéresser les lecteurs pour les héros1 ». Mais ces héros changent de visage au fil de l’histoire littéraire : dans la seconde moitié du xviie siècle, le régime de la vraisemblance historique fait disparaître les amants parfaits du roman baroque, au profit d’hommes et des femmes qui, sans être véritablement du commun, se distinguent de leurs prédécesseurs par d’humaines faiblesses2. Or, en renonçant à l’idéalisme, et en prétendant restituer à travers ses personnages une forme d’expérience du réel, la fiction redéfinit son objet d’une manière qui déplace une frontière ancienne entre Histoire et fiction. La tradition aristotélicienne confiait en effet à l’Histoire la représentation du particulier, et à la fiction, celle d’« actions générales3 » dont les lecteurs et lectrices devaient tirer une instruction morale. Dans la poétique de la nouvelle, cependant, la dimension universalisable de l’histoire est moins conçue comme l’instrument d’un apprentissage moral, que comme la condition d’un sentiment d’identification qui aurait fait défaut au roman baroque :
458Nous ne nous appliquons point ces prodiges et ces grands excès ; la pensée que l’on est à couvert de semblables malheurs, fait qu’on est médiocrement touché de leur lecture. Au contraire, ces peintures naturelles et familières conviennent à tout le monde ; on s’y retrouve, on se les applique, et parce que tout ce qui nous est propre nous est précieux, on ne peut douter que les incidents ne nous attachent d’autant plus qu’ils ont quelque rapport avec nous4.
Les auteurs de nouvelles semblent ainsi renoncer à la mission traditionnelle du Poète – celle de peindre à travers le personnage de fiction un idéal moral – pour donner plutôt au lecteur le plaisir de se reconnaître dans les héros de l’histoire. La métamorphose du personnage est indissociable, en somme, d’un bouleversement profond de la réception : il ne s’agit plus d’éblouir les lecteurs par des exemples de vertu parfaite, mais de susciter un sentiment d’empathie, voire d’identification avec le personnage. On pourrait dire, dans la terminologie de Vincent Jouve, que la réception herméneutique fait place à la réception empathique, l’« effet personnel » comptant désormais moins que l’« effet personne5 ». Valincour, tout en blâmant l’auteur de La Princesse de Clèves pour certains artifices narratifs, salue ses peintures de sentiments « si délicats et si naturels, qu’on les sent presque dans son cœur, à mesure qu’on les découvre dans les personnages6 », si bien qu’en lisant la nouvelle « l’on entre dans les sentiments de Mme de Clèves ; l’on souffre avec 459elle7 ». Chez les auteurs et les critiques, l’idée s’impose peu à peu que les œuvres fictionnelles sont destinées à une lecture empathique, au cours de laquelle « nous devenons les amis intimes de[s] personnages au point de saisir l’essence même de leur âme8 ».
La nouvelle historique et galante est donc le lieu d’un bouleversement de la pensée du personnage, qui engage un travail visible de la langue. Nous nous pencherons ici sur deux systèmes qui jouent un rôle essentiel dans la représentation fictionnelle de l’être humain, à commencer par celui du discours représenté. Contrairement aux mémoires, qui se donnent pour ambition de restituer la langue singulière des hommes et des femmes qu’elle représente, on verra que la fiction ne se préoccupe guère de doter chaque personnage d’une langue propre ; au contraire, les discours et les pensées représentées sont le lieu d’un travail d’unification stylistique où se dessine une continuité formelle entre le domaine de la voix et celui de la pensée (chapitre 8). On se penchera ensuite sur les chaînes de référence liées aux personnages de fiction : les relations de coréférence sont exploitées par les auteurs, non seulement pour effectuer des opérations de rappel, susceptibles de faire évoluer notre représentation du personnage, mais également pour mettre en concurrence différentes expressions désignant la même personne. Ces tensions invitent les lecteurs à prêter attention aux noms du personnage, et à s’interroger sur l’inaptitude de certaines expressions à saisir pleinement et uniquement l’individu (chapitre 9). Au fil de ce parcours, nous essaierons de montrer que dans la nouvelle historique et galante s’élabore une pensée fictionnelle de l’individu, distincte de la représentation particularisante de l’Histoire, car elle est destinée à créer chez le lecteur un sentiment de reconnaissance, et sans doute de réflexion sur sa propre condition individuelle.
1 Du Plaisir, Sentiments sur les lettres et sur l’histoire, ouvr. cité, p. 51.
2 Voir Pavel, Thomas, La pensée du roman, ouvr. cité.
3 Le Bossu, René, Traité du poème épique, Paris, Le Petit, 1675, p. 36. Parce que le poète doit toujours « feindre une action générale » (ibid., p. 36), Le Bossu recommandait même aux auteurs de poèmes épiques de commencer par imaginer « un plan général, universel, & sans Noms », car « commencer par chercher un Héros dans l’Histoire, & entreprendre de raconter une action qu’il aura faite », c’est « s’éloigner des préceptes d’Aristote […], et corrompre la nature de la Fable Epique » (ibid., p. 96). « Un Poëte », dit encore Le Bossu, « n’écrit pas comme un Historien, quel a été Alcibiade, ce qu’il a dit, ou ce qu’il a fait en telle rencontre ; mais ce que vrai-semblablement il a du dire ou faire » (ibid., p. 335). Le but de cette peinture générale est d’éduquer le lecteur, l’épopée n’étant qu’une « instruction morale, déguisée sous les allégories d’une Action » (ibid., p. 83).
4 Du Plaisir, Sentiments sur les lettres et sur l’histoire, ouvr. cité, p. 50. Au sujet de la théorie du personnage formulée par Du Plaisir dans ses Sentiments, voir Toma, Dolores, « Du Plaisir, un théoricien de la nouvelle au xviie siècle », dans V. Engel et M. Guissard (dir.), La nouvelle de langue française aux frontières des autres genres, du Moyen Âge à nos jours, Actes des colloques de Metz et de Louvain-la-neuve, Louvain la Neuve, Bruylant-Academia, 2001, vol. 2, p. 132-137. Concernant la place prise par l’idée d’identification dans les théories classiques de la réception, voir l’anthologie de Camille Esmein-Sarrazin, qui commente l’une des premières expressions de cette théorie dans la préface de Clorinde, roman anonyme paru en 1654 (Poétiques du roman, ouvr. cité, p. 241 sq.).
5 Dans sa théorie de l’« effet personnage », Vincent Jouve distingue la perception du personnage de sa réception. Ni simplement un actant, ni véritablement une personne, le personnage est en effet « le produit d’une représentation » fondée sur notre compréhension du texte, et des savoirs qui concernent le hors-texte – c’est la perception du personnage (Jouve, Vincent, L’effet-personnage dans le roman, Paris, PUF, 1998, p. 40 sq.). La réception du personnage, en revanche, est moins déterminée textuellement que culturellement : elle concerne la manière dont le lecteur établit des liens avec le héros, liens qui peuvent être de nature herméneutique (c’est « l’effet personnel », le personnage étant perçu comme un élément de sens), empathique (c’est « l’effet personne », le personnage devenant objet de sympathie ou d’antipathie), ou encore fantasmatique (c’est « l’effet prétexte », le personnage servant de support à des investissements inconscients) (ibid., p. 70 sq.).
6 Valincour, Jean-Baptiste de, Lettres sur le sujet de La Princesse de Clèves, ouvr. cité, p. 558.
7 Ibid., p. 543.
8 Chapelain, Jean, Opuscules critiques, Paris, 1936, p. 221, cité par Ginzburg, Carlo, « Paris 1647 : un dialogue sur fiction et histoire », art. cité.