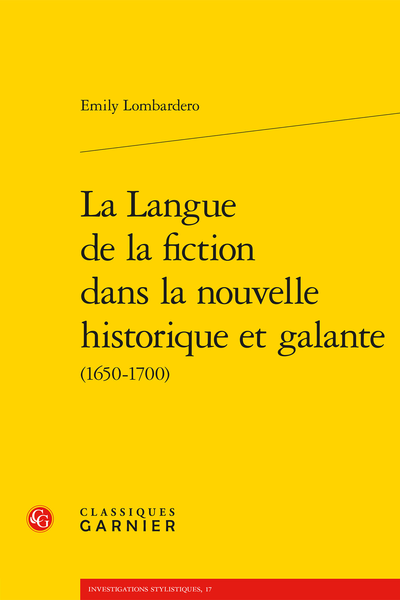
Introduction à la deuxième partie
- Publication type: Book chapter
- Book: La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)
- Pages: 131 to 132
- Collection: Stylistic Investigations, n° 17
- CLIL theme: 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN: 9782406167020
- ISBN: 978-2-406-16702-0
- ISSN: 2271-7013
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16702-0.p.0131
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-05-2024
- Language: French
Introduction à la deuxième partie
Contrairement à la philosophie du langage, qui définit la fiction à partir de l’étude des « énoncés fictionnels1 », la théorie littéraire des mondes possibles envisage la fiction à l’échelle de l’œuvre. Comme le souligne Jean-Marie Schaeffer, ce changement de perspective est adossé à une réflexion sur la réception des œuvres fictionnelles :
la notion de « monde fictionnel » a l’avantage d’attirer l’attention sur le fait indéniable que le dispositif fictionnel ne se borne pas à une addition de propositions fictionnelles […], mais donne naissance à un univers qui est « comme » l’univers actuel et dans lequel nous sommes plongés « comme » nous le sommes dans cet univers actuel2.
Jean-Marie Schaeffer appelle « immersion fictionnelle » le processus mental au terme duquel le lecteur se trouve comme « plongé » dans le monde de la fiction, et qui repose sur « une inversion des relations hiérarchiques entre perception (et plus généralement attention) intramondaine et activité imaginative3 ».
Alors qu’en situation « normale » l’activité imaginative accompagne l’attention intramondaine comme une sorte de bruit de fond, la relation s’inverse en situation d’immersion fictionnelle4.
Parce que l’activité imaginative, dans l’immersion fictionnelle, occupe le premier plan de la conscience, nous avons le sentiment d’être « dans » l’histoire que nous lisons. La notion d’« immersion fictionnelle », au cœur de la définition de la fiction proposée par Jean-Marie Schaeffer, peut être rapprochée de ce que les théoriciens cognitivistes du récit de fiction appellent le « déplacement déictique » (deictic shift). Les théoriciens du déplacement déictique considèrent en effet que
132the metaphor of the reader getting inside of a story is cognitively valid. The reader often takes a cognitive stance within the world of the narrative and interprets the text from that perspective 5 .
« la métaphore du lecteur entrant dans l’histoire est, d’un point de vue cognitif, valide. Le lecteur se place cognitivement à l’intérieur du récit et interprète le texte depuis cette perspective. »
Fondée sur des résultats d’expériences menées sur des lecteurs, la théorie du déplacement déictique montre que l’interprétation de certaines formes linguistiques, au cours de la lecture d’un récit de fiction, s’effectue depuis un « centre déictique » situé dans le monde fictionnel et non dans le monde physique du lecteur6.
Dans cette partie, nous nous proposons de mettre au jour les outils linguistiques responsables, dans la nouvelle historique et galante, de ces effets d’« immersion » et de « déplacement déictique ». Nous examinerons dans un premier temps les seuils de la fiction. En effet, discours préfaciels, récits cadres et incipitsont des lieux d’expérimentation pour les auteurs et autrices de la seconde moitié du xviie siècle ; à travers la métamorphose de ces seuils s’observe la permanence de dispositifs rhétoriques et stylistiques anciens dans la fiction, destinés à programmer chez les lecteurs une attitude particulière de réception (chapitre 3). Dans un second temps, nous aborderons la question de la récupération du matériau historique par la fiction, au cœur de nombreuses théories de l’hybridité entre récits factuels et récits fictionnels. Nous nous attacherons à montrer que les références à des événements et des individus réels font l’objet, dans la fiction, d’un traitement linguistique spécifique, destiné à donner aux lecteurs le sentiment d’une Histoire moins racontée que représentée – au sens étymologique de « rendue présente » (chapitre 4).
1 Voir supra, p. 40 sq.
2 Schaeffer, Jean-Marie, Pourquoi la fiction ?, ouvr. cité, p. 206.
3 Ibid., p. 180.
4 Ibid.
5 Segal, Erwing M., « Narrative Comprehension and the Role of Deictic Shift Theory », art. cité, p. 15.
6 « The deictic center contains all the elements of the here and now, or the phenomenal present for the user of the deictic terms » [le centre déictique contient tous les éléments du ici et du maintenant, autrement dit, le présent phénoménologique de celui qui emploie les expressions déictiques] (ibid.). Les expériences en question consistent à soumettre le même court texte fictionnel à un ensemble de lecteurs et lectrices, à qui sont posées plusieurs questions d’interprétation. Les réponses aux questions attestent que la lecture du texte fictionnel active une interprétation particulière des expressions déictiques comme here, now, tocome, etc.