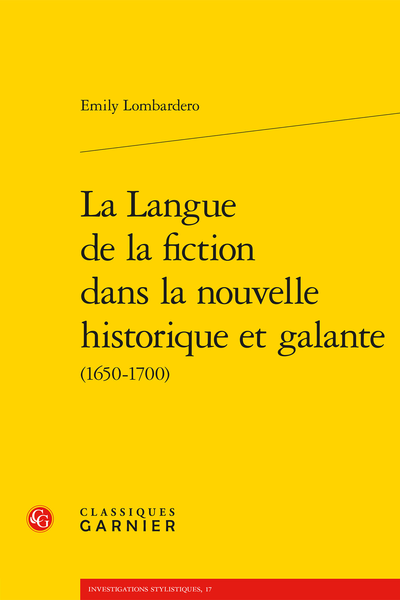
Conclusion de la troisième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)
- Pages : 453 à 453
- Collection : Investigations stylistiques, n° 17
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782406167020
- ISBN : 978-2-406-16702-0
- ISSN : 2271-7013
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16702-0.p.0453
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/06/2024
- Langue : Français
Conclusion de la troisième partie
La nouvelle historique et galante marque l’aboutissement d’un long processus de minoration des voix narratives dans la fiction, qui culmine dans le récit « sans parole » à la manière de Lafayette. Nous avons proposé de voir dans cette disparition des voix la cause d’une certaine « grammaticalisation des interrogations littéraires1 », sensible à la lecture des œuvres et des commentaires qu’en ont laissés les critiques du temps, et qui est à l’œuvre aussi bien dans le domaine de la structuration textuelle, que dans celui du travail stylistique.
Ces métamorphoses de la fiction ne sont pas sans conséquence sur la manière dont les œuvres font exister des personnages. On va voir en effet que la discrétion ou l’absence de la voix narrative fait du récit un lieu d’accueil pour des formes linguistiques que les lecteurs rattachent à la subjectivité du personnage. Des mots et des tours de phrases, des figures et des effets de rythme attirent l’attention à la lecture, et donnent le sentiment d’entendre la voix du héros ou de l’héroïne, d’accéder à sa pensée, d’adopter son point de vue. Les outils engagés dans la représentation du personnage évoluent dans la nouvelle historique et galante, et ces inventions formelles révèlent de nouvelles manières, pour la littérature, de penser la personne.
1 Philippe, Gilles, Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française, 1890-1940, Paris, Gallimard, 2002, p. 17. Gilles Philippe montre dans cet ouvrage comment, à la fin du xixe siècle, la grammaire devient centrale dans la manière dont se produit et se pense la littérature. Sans contester sa thèse, nous émettons l’hypothèse que d’autres « moments grammaticaux » ont pu avoir lieu au cours de l’histoire littéraire, et notamment dans les théories et les pratiques de la fiction à la fin du xviie siècle.