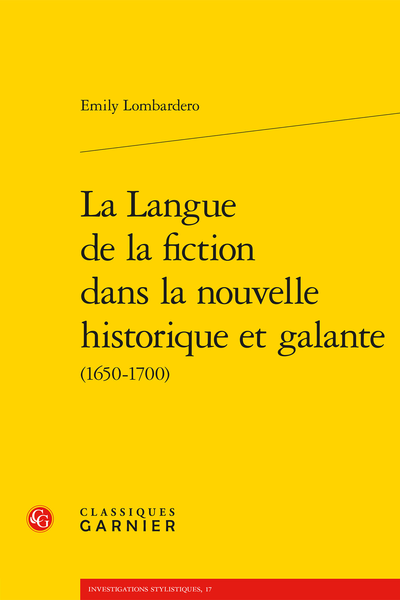
Conclusion de la quatrième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)
- Pages : 599 à 601
- Collection : Investigations stylistiques, n° 17
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782406167020
- ISBN : 978-2-406-16702-0
- ISSN : 2271-7013
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16702-0.p.0599
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/06/2024
- Langue : Français
Conclusion de la quatrième partie
La représentation du personnage est un lieu de différenciation stylistique pour la fiction, au sens où s’y inventent des manières singulières de faire parler et penser le personnage, de le nommer et de le (re)désigner. Dans la nouvelle historique et galante, ces outils nous semblent engagés dans une pensée de l’individu, que nous avons proposé d’analyser, après Stéphane Chauvier, à l’aide du couple notionnel de l’unité et de l’unicité. Pour Stéphane Chauvier,
Il existe, sinon en fait, du moins en droit, deux manières très différentes d’accéder cognitivement à un individu […]. L’une de ces deux manières de penser à un individu, la manière dominante, conduit à concevoir l’individu comme une unité numérique d’une espèce ou d’une sorte données, ce que nous appellerons une hénade. L’autre manière de penser à un individu conduit à concevoir l’individu comme un absolu singulier, fermé sur le reste du monde, ce que nous appellerons une monade. […] nous disposons de deux chemins d’accès cognitifs complémentaires à tout individu, deux chemins qui ne peuvent pas être empruntés en même temps et qui, lorsqu’ils sont empruntés, conduisent à voir n’importe quel individu, tantôt comme une hénade, tantôt comme une monade1.
Ces notions peuvent éclairer la complémentarité de deux systèmes linguistiques au cœur de la représentation du personnage : celui du discours représenté, et celui de la référence. D’une part, le travail d’unification stylistique à l’œuvre dans la représentation des paroles et des pensées peut s’interpréter comme la figuration littéraire d’une unité intime, sans que les personnages se distinguent linguistiquement les uns des autres, comme ils peuvent le faire dans les mémoires, et comme ils le feront dans les romans plus tardifs. D’autre part, les tensions à l’œuvre dans le système de la désignation permettent de penser l’unicité d’un personnage qui ne se reconnaît ni dans le nom de sa famille, ni dans 600celui de son type ; loin d’apparaître alors comme une unité, le personnage se voit fractionné entre différentes instances – privée et publique, physique et psychologique, passée et présente – que saisissent ses différents noms. En empruntant à Ann Banfield les mots avec lesquels elle mettait en rapport les notions de la philosophie russellienne et les modes de représentation de l’esprit dans le roman, on pourrait dire que « la langue contient déjà – parmi les choses dont on peut dire que la langue les sait – la distinction même que la philosophie s’efforce de rendre explicite2 » entre deux manières de penser l’individu : l’individu comme monade, « sujet […] qui occupe toute la scène et qu’on regarde moins, lui, qu’on ne regarde en lui », et l’individu comme hénade, « sujet […] qui se détache parmi d’autres3 ».
Le double processus d’individuation et d’individualisation du personnage à l’œuvre dans la nouvelle historique et galante nous amène à nous interroger sur le rôle joué par la fiction littéraire dans l’émergence, à l’âge classique, d’une pensée moderne de l’individu – « idée forcément un peu schématique, mais à laquelle les séries d’autoportraits de Rembrandt ou l’émergence d’un projet comme les Confessions donnent une sorte de sens malgré tout4 ». Au sujet de la représentation de la vie intérieure dans la fiction de l’âge classique, Marc Hersant invitait ainsi à se demander « si la vie intérieure des personnages de fiction ne crée pas, d’une certaine manière, celle des hommes réels5 ». On peut envisager que les hommes et les femmes du passé aient appris à se concevoir comme des individus d’une manière qu’ont modelée leurs expériences esthétiques, et notamment la lecture des récits de fiction. Au xviie siècle, ceux-ci s’orientent en effet vers une expérience de lecture empathique, destinée à créer un sentiment d’identification : nous adoptons le point de vue des personnages, et nous assistons aux expériences intérieures des héros. Dans l’expérience de l’oralisation, nous pouvons faire nôtre la voix intérieure de personnage, cette scansion saccadée de la pensée 601en « je ». Nous pouvons faire nôtre, également, le trajet psychologique de ces héros qui s’individualisent : lisant l’histoire de personnages qui réfléchissent en lecteurs à leur condition individuelle, les lecteurs et lectrices réels sont peut-être amenés à s’évaluer eux-mêmes à l’aune des ensembles préconstruits de la culture littéraire, et à se saisir narrativement, en se racontant sous la forme d’une histoire6. S’il est vrai que « la fonction fabulatrice […] est à la racine de notre identité personnelle7 », sans doute la réception des récits de fiction détermine-t-elle aussi, au moins en partie, la manière dont nous nous racontons.
1 Chauvier, Stéphane, « L’unique en son genre », art. cité, p. 3.
2 Banfield, Ann, Phrases sans parole, ouvr. cité, p. 312-313.
3 Chauvier, Stéphane, « L’unique en son genre », art. cité, p. 19.
4 Hersant, Marc et Ramond, Catherine (dir.), La représentation de la vie psychique dans les récits factuels et fictionnels de l’époque classique, ouvr. cité, p. 13. À ce sujet, on pourra consulter les actes d’un colloque franco-italien réunissant philosophes et historiens des idées, Cazzaniga, Gian Mario et Zarka, Yves-Charles (dir.), L’individu dans la pensée moderne, xvie-xviiie siècles, Pisa, ETS, 1995.
5 Hersant, Marc et Ramond, Catherine (dir.), La représentation de la vie psychique dans les récits factuels et fictionnels de l’époque classique, ouvr. cité, p. 14.
6 Cette réflexion excède sans doute la portée de notre étude. On peut évoquer cependant la notion d’« identité narrative », proposée par Paul Ricœur à la fin de Temps et récit, et développée ensuite dans une conférence (Ricœur, Paul, « L’identité narrative », Anthropologie philosophique. Écrits et conférences, t. III, Seuil, 2014 [1986]). Pour Paul Ricœur, « la compréhension de soi est médiatisée par la réception conjointe – dans la lecture en particulier – des récits historiques et des récits de fiction » (ibid., p. 355). Ces deux types de récits jouent chacun un rôle : « la composante historique du récit sur soi-même tire celui-ci du côté d’une chronique soumise aux mêmes vérifications documentaires que toute autre narration historique, tandis que la composante fictionnelle le tire du côté des variations imaginatives qui déstabilisent l’identité narrative » (Ricœur, Paul, Temps et récit, t. III, Le temps raconté, ouvr. cité, p. 258). Le concept d’identité narrative s’est largement diffusé dans les sciences de l’homme à la fin du xxe siècle, « l’idée qu’il n’y a pas d’identité personnelle sans la narration [étant] devenue un topos de l’herméneutique et de la sémiotique » (Ferry, Jean-Marc, Les puissances de l’expérience. Essai sur l’identité contemporaine, t. I, Le sujet et le verbe, Paris, Cerf, 1991, p. 103).
7 Molino, Jean et Lafhail-Molino, Raphaël, Homo fabulator, ouvr. cité, p. 48.