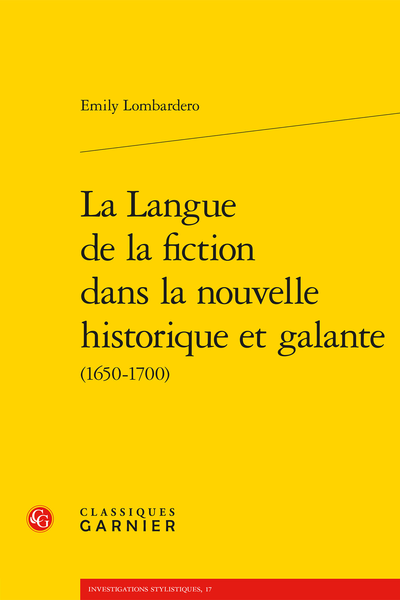
Conclusion de la deuxième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)
- Pages : 229 à 230
- Collection : Investigations stylistiques, n° 17
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782406167020
- ISBN : 978-2-406-16702-0
- ISSN : 2271-7013
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16702-0.p.0229
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/06/2024
- Langue : Français
Conclusion de la deuxième partie
En philosophie du langage et en narratologie, la fiction est souvent envisagée comme le résultat d’une feinte énonciative : écrire une fiction ne serait rien d’autre que feindre d’écrire la vérité, en utilisant une langue qui est celle de l’Histoire. La bonne réception de la fiction serait programmée par l’appareil péritextuel de l’œuvre – informations éditoriales, titres, sous-titres et préfaces invitant les lecteurs à une expérience de lecture non sérieuse. Cette description coïncide mal, cependant, avec la manière dont s’invente au xviie siècle la fiction vraisemblable. Dans les seuils de la nouvelle, c’est l’appareil péritextuel et en particulier la préface qui apparaît souvent comme le lieu d’une feinte énonciative, le libraire ou l’auteur prétendant se porter garant de la vérité de l’histoire. Au-delà du seuil, en revanche, on constate aisément que la langue de la fiction n’est pas celle des récits historiques. Quand bien même les auteurs de nouvelles historiques et galantes tirent leur matériau narratif du récit non fictionnel, ils repensent les formes linguistiques qui permettent d’évoquer le temps passé, et les personnes qui l’ont habité. Si feinte il y a, sa place est moins dans le récit fictionnel en lui-même, que dans les péritextes qui l’entourent. Nous avons proposé d’expliquer ce phénomène à partir de la notion d’immersion : nous croyons que les indices linguistiques de fictionnalité n’ont pas vocation – ou n’ont que secondairement vocation – à jouer un rôle de balise. L’enjeu de la langue de la fiction n’est pas d’avertir les lecteurs que les événements racontés et les personnages représentés sont fictifs – de fait, ils ne le sont pas toujours –, mais de créer un effet d’immersion dans le monde représenté.
Si tout récit de fiction est sans doute destiné à créer, à des degrés divers, cet effet d’immersion, la question des moyens employés peut se poser de multiples façons. Au xviie siècle, la pensée de la fiction évolue de telle sorte que la manifestation énonciative de l’auteur dans son œuvre est perçue comme incompatible avec l’adhésion des lecteurs à l’histoire. 230La nouvelle historique et galante constitue l’aboutissement d’un long processus de minoration de la voix narrative, qui, nous allons le voir, modifie en profondeur le texte de fiction.