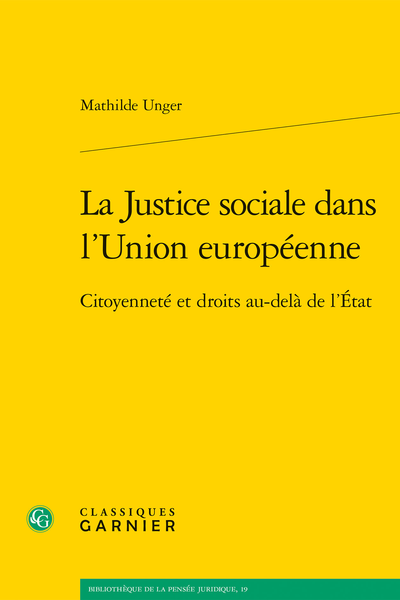
Table des matières
- Publication type: Book chapter
- Book: La Justice sociale dans l’Union européenne. Citoyenneté et droits au-delà de l’État
- Pages: 301 to 308
- Collection: Library of Legal Thought, n° 19
- CLIL theme: 3126 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie
- EAN: 9782406130352
- ISBN: 978-2-406-13035-2
- ISSN: 2261-0731
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13035-2.p.0301
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 05-18-2022
- Language: French
Table des matières
Préface
« Une philosophe-juriste au secours de l’Europe » 7
Introduction 13
Les insuffisances d’une approche fondée sur la coopération 14
Le sens politique de la justice sociale 17
La question sociale dans l’Union européenne 22
Méthode 25
Le corpus théorique 27
Plan du livre 29
PREMIÈRE PARTIE
LES LIMITES
DE LA CITOYENNETÉ SOCIALE EUROPÉENNE
Deux lectures de la citoyenneté européenne 35
Les ressorts nationaux de la solidarité 37
Le nationalisme libéral
contre l’européanisation de la justice 37
La critique d’une solidarité « désincarnée » 37
La force de l’imaginaire national pour fonder la justice 40
Conserver la souveraineté des États
en matière de justice sociale 41
La valeur des choix démocratiques 41
La différence entre justice et assistance 43
302L’Union européenne, laboratoire
d’une citoyenneté postnationale 44
Les limites de la citoyenneté nationale
dans un marché ouvert 44
La nation, forme historiquement contingente
de la solidarité 44
Les promesses du marché 47
La voie postnationale de la citoyenneté 49
La voie post kantienne de Jean-Marc Ferry 50
La constitution de l’Europe de Jürgen Habermas 54
Justice nationale, postnationale ou transnationale ? 58
Les promesses d’une « citoyenneté
sociale européenne » 61
L’avènement d’une « citoyenneté sociale européenne » 62
Des travailleurs aux citoyens 63
Décloisonner les marchés nationaux 63
–Les droits du travailleur 63
–Trois catégories connexes 66
L’introduction de la citoyenneté européenne 68
–Vers une approche « désectorisée » 68
–La citoyenneté, « statut fondamental »
des ressortissants d’un État membre de l’Union 70
Fondements et limites de la citoyenneté sociale 72
Le droit de circuler et de séjourner
est le droit du citoyen : la Directive 2004/38 72
L’égalité de traitement et ses limites 74
La citoyenneté européenne
a-t-elle fait triompher l’égalité libérale ? 77
De nouvelles opportunités garanties
par le principe de non-discrimination 77
De l’éclatement de la société d’ordre
au dépassement de l’État-nation 78
–Du droit des pauvres aux droits des citoyens 78
–L’égalité libérale 79
–Le travailleur,
pivot de l’émancipation transnationale 82
Des opportunités transnationales 83
La citoyenneté sociale européenne
peut-elle s’affranchir du marché ? 87
La structure du droit, un vice de forme ? 88
–La « citoyenneté de marché » :
aux origines d’une expression surprenante 88
–Une citoyenneté inachevée ? 91
L’atomisme à l’œuvre dans l’Union européenne 94
–La citoyenneté de marché est un « oxymore » 94
–Vers un lien réel ? 96
Le « lien réel »,
à la recherche d’une solidarité européenne 97
L’intégration sociale redéfinie
par le droit de l’Union européenne 99
L’affirmation du critère du lien réel
dans la jurisprudence 100
L’exigence d’un lien réel entre le citoyen européen
et le marché de l’emploi 100
Un critère minimal 101
La résidence ininterrompue,
meilleur indicateur de l’intégration sociale ? 103
L’utilité du critère de la résidence pour les inactifs 103
La diversité des critères de rattachement
à l’État et la citoyenneté sociale 107
Forces et limites
d’une citoyenneté sociale dénationalisée 110
Démocratiser les critères d’inclusion
à une société démocratique 110
Dépasser le privilège de la naissance 110
Les degrés d’appartenance
à la « coopération sociale » 113
Le retour du refoulé national ? 116
Des discriminations déguisées ? 116
Une solidarité factice ? 121
304Le conflit entre la solidarité nationale
et la solidarité européenne 125
Les États-providence
à l’épreuve du droit de l’Union européenne 125
La contestation des politiques sociales
par l’invocation des libertés économiques 126
La double asymétrie au cœur du droit
de l’Union européenne 126
Un pouvoir de dérégulation 129
La dénationalisation des droits sociaux
contre les États-providence ? 133
De la (seule) liberté des modernes 133
La promotion des droits individuels corrompt-elle
le principe de répartition des ressources ? 135
–L’enseignement supérieur 135
–Les soins de santé 141
Une théorie de justice pour l’Union européenne ? 147
Une théorie de la justice à plusieurs niveaux 147
Une philosophie du droit
de l’Union européenne 149
Les trois niveaux 151
–Le niveau national 151
–Le niveau interétatique 151
–La solidarité transnationale 153
L’irréductibilité du contexte
de légitimation national 154
Une répartition du « surplus » constitue-t-elle
une juste distribution des biens
dans le marché intérieur ? 154
Le contexte de justification politique 157
305DEUXIÈME PARTIE
LA FORCE DES DROITS
Le principe de non-discrimination
est-il un principe de justice sociale ? 163
Le principe de non-discrimination
en raison de la nationalité consolide l’égalité formelle 164
Le principe de non-discrimination
en raison de la nationalité permet le déploiement
des libertés de circulation 164
Le principe de non-discrimination
est l’envers du principe d’égalité de traitement 164
Le principe de non-discrimination
concrétise l’égalité des chances 165
Les inégalités sociales,
envers de l’égalité des chances libérale ? 170
Le principe de non-discrimination fondé
sur la nationalité autorise les autres différences
de traitement 170
Le principe de non-discrimination
réaffirme le marché comme principe distributif 172
Le principe de non-discrimination
peut-il servir la justice sociale ? 175
Le principe de non-discrimination,
pilier de l’Europe sociale ? 176
L’égalité entre les hommes et les femmes
dans le monde du travail 177
La diversification des motifs proscrits 179
La non-discrimination œuvre-t-elle en faveur
de la justice sociale ? Distribution et reconnaissance 181
Le principe de non-discrimination n’a pas pour objectif
la reconnaissance des identités méprisées 181
Une approche distributive du principe
de non-discrimination est-elle pertinente ? 185
La force et la légitimité des droits sociaux 191
Splendeur et misère des droits sociaux
dans l’ordre juridique de l’Union 192
Les promesses d’un titre de la Charte
consacré à la solidarité 192
Le critère de l’« autosuffisance »
limite la portée des droits sociaux 196
Le déficit démocratique
d’une protection européenne des droits sociaux 202
Pas de droits sans représentation nationale 203
Les droits ne peuvent être soustraits
à la délibération publique 203
La légitimité de la Charte des droits fondamentaux
dans une logique néo-républicaine 205
La séparation des pouvoirs mise en péril
par une protection européenne des droits sociaux 208
Les droits sociaux peuvent faire l’objet
d’un contrôle juridictionnel classique 208
Le sens démocratique des droits sociaux 211
Concilier les libertés économiques
et les droits sociaux ? 217
Libertés économiques contre droits sociaux,
le déséquilibre des forces 218
La formulation du conflit
entre les libertés économiques et les droits sociaux 218
Les décisions Viking, Laval et Rüffert
à la fin des années 2000 218
Le droit de mener des actions collectives
peut-il justifier une entrave aux libertés ? 220
Un équilibre factice 222
Le test de proportionnalité peut-il s’appliquer
au droit de grève ? 222
Un équilibre est-il possible ? 225
Les droits sociaux sont-ils un instrument
de domination culturelle et économique ? 230
La réversibilité entre les libertés et les droits 230
Dépasser la distinction faussement universelle
entre « économique » et « social » 230
Les limites
de cette « nouvelle conceptualisation du social » 231
Répondre à l’objection « culturelle »
et clarifier les enjeux démocratiques 233
L’argument de la diversité des cultures juridiques 233
Distinguer l’argument du pluralisme culturel
et le sens politique de la justice 237
La force des droits
dans les contextes de justice transnationaux 241
Les contextes de justice transnationaux
dans l’Union européenne 242
Définition des contextes de justice transnationaux 243
Les injustices « transnationales »
sont de second ordre 243
Les formes de domination « externe » 247
La thèse du fédéralisme concurrentiel
dans l’Union européenne 251
Le tropisme libéral d’une fédération économique 251
Le fédéralisme économique comme mode de production
des normes optimales 253
Encadrer les contextes de justice transnationaux 258
Les nouvelles arènes démocratiques 259
Une conception néo-républicaine
des droits fondamentaux 263
La fonction des droits fondamentaux
dans une fédération économique 263
La légitimité dérivée des droits fondamentaux 265
Conclusion 271
Jurisprudence 275
308Bibliographie 281
Index des noms 295
Index des notions 299