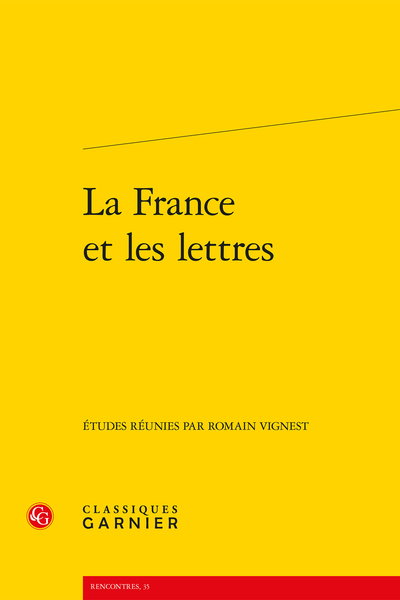
Présentation
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La France et les lettres
- Auteur : Vignest (Romain)
- Pages : 25 à 27
- Collection : Rencontres, n° 35
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812444869
- ISBN : 978-2-8124-4486-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4486-9.p.0025
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 09/10/2012
- Langue : Français
Présentation
Il était tout naturel qu’à l’occasion de son centenaire l’association des professeurs de lettres (APL), dont la vocation est de rassembler les professeurs de lettres en France, s’interrogeât sur ce qui lie la France aux lettres. Cette interrogation était d’autant plus légitime que l’enseignement de la langue nationale est, en France, confié à des professeurs de lettres et qu’en outre cette appellation cheville chez nous le français au latin et au grec.
Certes, et bienheureusement, notre pays n’est pas le seul où l’on enseigne la littérature aux enfants et aux adolescents. Il n’en reste pas moins que la Troisième République lui assigna une double fonction, éminemment politique, celle d’éclairer les futurs citoyens, de leur apprendre à penser et à s’exprimer – c’est tout un – grâce à la fréquentation des grands textes, celle de souder une nation extrêmement diverse autour d’un patrimoine commun.
Ce faisant, la République adaptait à l’enseignement primaire et généralisait à l’ensemble de sa population l’œuvre qui avait été celui des rois de France. Dès le xiiie siècle en effet, c’est à travers la littérature que la France se saisit et se construisit : le mythe des origines troyennes de la monarchie française manifeste le besoin de se légitimer à travers une double ascendance proprement littéraire, celle de la guerre de Troie et celle de Virgile. Ce mythe manifeste aussi cette singularité française d’une nation qui se choisit elle-même ses origines, l’enracinement paradoxalement délibéré dans les auteurs de l’Antiquité plutôt que dans les traditions locales, et revendique une translatio studii qui la détourna des substrats celtique ou germanique ; les humanistes, puis les classiques, la langue travaillée par la Pléiade, légiférée par les académiciens nous ont maintenus dans cette voie, sous l’égide de monarques statufiés en empereurs romains et jusqu’à la singularité d’un romantisme français que signale, deux siècles et demi après la Deffence & illustration, sa profonde fidélité à la culture classique. Et de fait, qu’elle ait servi le pouvoir, comme
Boileau, ou qu’elle l’ait frondé, comme Beaumarchais, la république des lettres est si étroitement liée à l’État que son actualité est également celle du pays, non seulement parce que Ronsard, d’Aubigné, Voltaire, Hugo, Zola, Péguy, Aragon, Sartre, Malraux ont engagé leur plume dans des luttes qu’ils ont marquées et transcendées, qu’à rebours Mirabeau, Napoléon, Jaurès, De Gaulle se soient, dans l’exercice même de leurs charges, illustrés par le verbe, mais parce qu’aussi, de la Querelle des femmes à celle de la Nouvelle critique en passant par toutes les autres, celles du Cid, du Tartuffe, des Anciens et des Modernes, ou par la Bataille d’Hernani, les événements proprement littéraires ont dans l’hitoire de France rang d’événements historiques.
Aussi n’est-il pas excessif d’affirmer qu’en France la littérature a contribué au premier chef à constituer la nation au point que c’est d’abord son enseignement qui fabrique, comme aurait dit Claude Nicolet, les jeunes Français et qu’aux yeux du monde elle se confond pour une large part avec sa littérature même, qu’avant même d’être et pour pouvoir être une puissance elle est une pensée. On pourrait dire, paraphrasant Hugo : « La France n’est qu’un pays ; mais par Montaigne, Molière, Diderot, Balzac et Marcel Proust, ce pays emplit le monde1. » Il y a un lien originel et à double sens entre le littéraire et le politique, tous deux marqués du sceau de l’élection plus que de l’atavisme. En France, la nation n’est pas non plus ethnique, mais civique ; forgée par l’État, elle consiste en une communauté de citoyens. Cela ne signifie pas bien sûr que la France se réduise aridement au contrat social : elle est aussi une terre, un art de vivre, un patrimoine, toute une chair en somme, que d’ailleurs arts et lettres célèbrent, mais qui composent une personne, offerte à quiconque veut l’aimer. Patrie civique et littéraire, peuple amené là par les quatre vents, la France est une vocation à l’universel, dont sa littérature tout à la fois résonne et participe. Combien de révolutionnaires et de résistants, et encore tout récemment de l’autre côté de la Méditerranée, se sont récité les Châtiments ? Combien de voyageurs immobiles ont arpenté les rues de Paris ou respiré la « douceur angevine » ? Combien sont devenus, ici comme Samuel Beckett ou François Cheng, au loin comme Emmanuel
Dongala ou Abdellatif Laâbi, des écrivains français et, en français, comme dit Senghor, « se réveillent à leur chaleur complémentaire » ?
C’est que le philosophe, à la raison parfois mordante, éclaire et émancipe ; le moraliste, le romancier, sous l’influx sublime des femmes, et le génie, en vers ou prose, dont l’imaginaire est fécond, sondent des vertiges à tous communs ; le gastronome, le naturaliste chantent la joie radieuse d’être au monde. Ils ont noms Descartes et Montesquieu, La Bruyère et Racine, Flaubert et Bernanos, Rabelais et Claudel, La Varenne et Buffon. Et quand les identités meurtrières aliènent l’individu, quand l’infâme, ressuscité, écrase à nouveau les consciences, quand la finance aveugle et triomphante piège et digère les peuples, il est bon que les élèves de nos écoles sustentent leur avenir de grands textes et il est bon que la France, la France des lettres, très au-delà de l’Hexagone, éblouisse à nouveau les ténèbres.
Romain Vignest
Président de l’APL
Nous tenons à remercier Monsieur le Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et l’Institut français de Tunis, le ministère de la Culture et de la communication, notamment Monsieur le Délégué aux commémorations nationales, le personnel du lycée Henri-IV, nos collègues Delphine Hassan, Michèle Vignest, Jean-Nicolas Corvisier, Jean-Noël Laurenti, Alain Vauchelles et, surtout, Michel Serceau.
1 Actes et paroles, III, 1878, III, Discours d’ouverture du Congrès littéraire international (17 juin 1878) : « Rome n’est qu’une ville ; mais par Tacite, Lucrèce, Virgile, Horace et Juvénal, cette ville emplit le monde. »