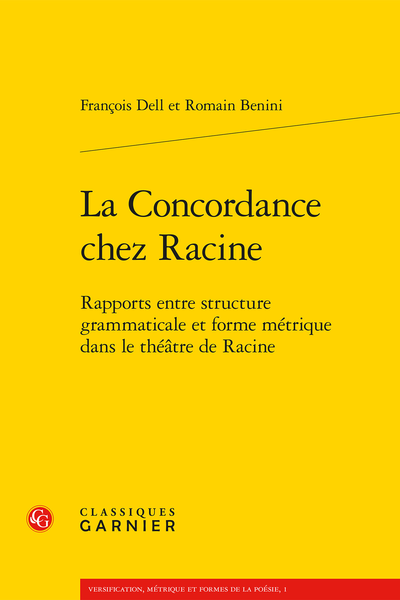
Glossaire
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : La Concordance chez Racine. Rapports entre structure grammaticale et forme métrique dans le théâtre de Racine
- Pages : 215 à 217
- Collection : Versification, métrique et formes de la poésie, n° 1
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782406096177
- ISBN : 978-2-406-09617-7
- ISSN : 2743-4362
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09617-7.p.0215
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 28/12/2020
- Langue : Français
Glossaire
Pour permettre aux lecteurs de les retrouver plus facilement, ici sont rassemblées diverses définitions, conditions/règles auquel il est fréquemment fait référence au cours de la discussion. Cette liste commence par des définitions qui ne sont pas précédées d’un numéro entre crochets dans le corps du texte.
Mots légers et mots lourds (p. 106) : les mots légers sont tous les mot-outils ainsi que les mots pleins suivants : les prépositions (polysyllabiques), les adverbes pas et point, et enfin les verbes suivants : être et avoir, les auxiliaires, les semi-auxiliaires et le verbe des locutions de la forme V+N telles que prendre soin ou tenir compte. Les autres mots pleins sont des mots lourds.
Mots pleins et mot-outils (p. 55) : les mots pleins sont les noms et les formes pleines des pronoms, les verbes, les adjectifs et les adverbes. Les mot-outils sont les mots restants.
Noyaux et satellites (p. 56) : un satellite est un mot-outil monosyllabique. Les noyaux sont les mots restants, i.e. les mots mot-outils polysyllabiques et les mots pleins.
Syllabe en fin de charnière (p. 95) : tonique située le plus à droite au sein de la charnière minimale de la syllabe précédente.
|
[ 12 ] (p. 23) |
borne métrique |
position non finale d’hémistiche |
position finale de h1 (césure) |
position finale du premier vers d’un distique |
position finale de distique |
|
saillance |
0 |
1 |
2 |
3 |
[14] Saillance d’un constituant grammatical (définition p. 23) : La saillance d’un constituant grammatical est la saillance de sa borne métrique finale.
216[17] Charnière minimale (définition p. 24) : La charnière minimale d’une borne métrique B est le plus petit des constituants grammaticaux qui chevauchent B. Un constituant chevauche B s’il contient la voyelle associée à B ainsi que celle associée à la position métrique qui suit immédiatement B.
[18] Discongruence (définition p. 25) : Soit B une borne métrique et C sa charnière minimale. On dit que B est discongruente, ou encore, de façon équivalente, que le constituant C est discongruent, quand la saillance de B est supérieure à celle de C.
[19] Congruence (p. 25) : Une borne métrique ne doit pas être discongruente.
[44]CongRac (p. 36) : La discongruence est interdite si la borne se trouve à l’intérieur d’un GI et qu’en outre sa charnière minimale est un SN, un SA, un SAdv ou un SP.
[61]D2Dist (p. 46) : Deux bornes métriques dont les charnières minimales sont contenues tout entières dans un même distique ne peuvent pas être discongruentes toutes les deux.
|
[71] |
Hiérarchie Prosodique (p. 54) : |
Mot |
GC |
GPh |
GI |
[75]Formation des GC (p. 56) :
a Tout mot fait partie d’un GC.
b Un GC contient un noyau et un seul.
c Dans une suite A…S…B où S est un satellite et où A et B sont les deux noyaux les plus proches, S appartient au même GC que celui des deux noyaux avec lequel il entretient le rapport syntaxique le plus étroit.
[93] Alignement (définition p. 64) : Soit G un constituant grammatical et soit M un constituant métrique dont la dernière position est P. On dit que la fin de M est alignée avec celle de G si la voyelle associée à P est contenue dans G et si G ne chevauche pas P. (Sur « chevauche », voir [17].)
[81]Tonique (p. 60) : La voyelle associée à la dernière position d’un hémistiche est la tonique d’un GC (première approximation finalement remplacée par DisRac [197]).
[82]Align (p. 60) : La fin d’un hémistiche est alignée avec celle d’un GC (première approximation finalement remplacée par [128]).
217[119] La fin d’un vers n’est pas alignée avec celle d’un opérateur non saturé (p. 72).
[122]Hiérarchie métrique (p. 74) :
|
position |
hémistiche |
vers |
distique |
[128]Align (p. 49) : La fin d’un hémistiche est alignée avec celle d’un GPh.
[129]Formation des GPh (p. 77) :
a tout GC fait partie d’un GPh ;
b A et B étant deux GC contigus et α et β étant deux mots respectivement contenus dans A et B, A et B appartiennent au même GPh si et seulement si il existe un constituant K qui contient α et β et qui remplit les conditions suivantes :
i K est un SX où X = N, A ou Adv,
ii α et β ne sont pas contenus dans des SX différents,
iii ni α ni β ne se trouve à droite de la tête de K.
[162](p. 92)
a De deux syllabes contiguës dont l’une est tonique de GC et l’autre non, c’est la tonique de GC qui est la plus accentuée ;
b de deux syllabes contiguës dont l’une est tonique de GI et l’autre non, c’est la tonique de GI qui est la plus accentuée.
[164]Règle de l’accent final (p. 93) : L’accent le plus fort au sein d’un constituant est porté par la dernière tonique du constituant.
[168]Désaccentuation (p. 95) : Si deux syllabes contiguës A et B prises dans cet ordre sont telles que B est en fin de charnière, B est plus accentuée que A.
[170]Discordance de proéminence (définition p. 97) : Soit deux positions métriques contiguës A et B (leur ordre est indifférent) telles que A est plus saillante que B. On dit que la suite AB est une DSP (discordance de proéminence) si la voyelle associée à B est plus accentuée que celle associée à A.
[197]DisRac (p. 109) :
a Les DSP à gauche sont exclues (inviolable) ;
b les DSP à droite sont exclues (violable).