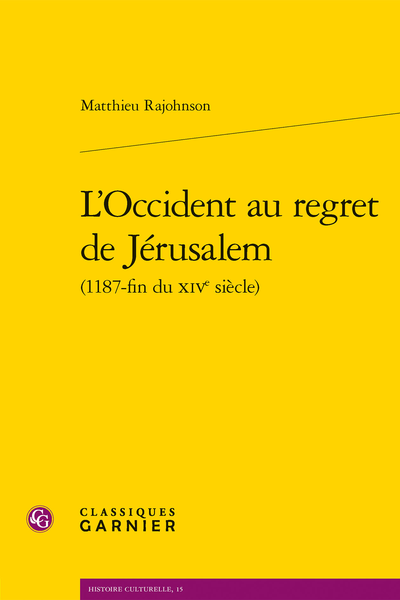
Préface
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : L’Occident au regret de Jérusalem (1187-fin du xive siècle)
- Pages : 9 à 14
- Collection : Histoire culturelle, n° 15
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406106685
- ISBN : 978-2-406-10668-5
- ISSN : 2430-8250
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10668-5.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 29/04/2021
- Langue : Français
Préface
En 1033, si l’on en croit le moine Raoul Glaber,
une foule innombrable se mit à converger du monde entier vers le Sépulcre du Sauveur à Jérusalem ; personne auparavant n’aurait pu prévoir une telle affluence. Ce furent d’abord les gens des classes inférieures, puis ceux du moyen peuple, puis tous les plus grands, rois, comtes, marquis, prélats ; enfin, ce qui n’était jamais arrivé, beaucoup de femmes, les plus nobles avec les plus pauvres, se rendirent là-bas1.
Moins d’un siècle plus tard, en 1099, l’appel au « pèlerinage en armes » lancé par le pape Urbain II quatre ans auparavant lors du concile de Clermont aboutissait à la prise de Jérusalem par les Latins. Puis, en 1187, Saladin conquiert à son tour la ville et confronte l’Occident au « choc de la perte », suivi d’un long travail de deuil. Le chroniqueur du xie siècle amplifie sans doute le propos, porté par l’enthousiasme ; mais sa voix n’est pas isolée. Comment la société occidentale a-t-elle réagi à la perte de Jérusalem, alors qu’elle s’était trouvé entraînée dans un tel mouvement ? Comment un fait, qui n’est pas anodin mais pouvait être considéré comme accidentel, devint un événement de portée considérable ? Il est sans doute moins attrayant de s’interroger sur un repli que sur une dynamique. Pourtant force est de constater que ce repli fut paradoxal. L’esprit de croisade, cher à Paul Alphandéry et Alphonse Dupront demeure présent en Occident pour des siècles encore après 11872 ; le nom de Jérusalem continua d’y retentir et les images, voire les imitations de la Cité sainte, d’y fleurir. Complexe alchimie, sur laquelle ce livre se penche avec brio, pour une période bien circonscrite mais ouvrant à la réflexion dans une très longue durée.
10L’affaire n’était pas simple à mener : rien de moins que de saisir, en historien, la force d’une émotion, ses variations, son cheminement ; prendre le pouls d’une société dans toutes ses composantes, du sommet – papauté et princes – aux plus humbles, dans ses genres auxquels le chroniqueur se montre attentif mais aussi dans ses générations successives, une fois passé le choc. Pour ce faire, il convenait d’ausculter aussi bien les initiatives militaires que leur absence, les discours politiques que les œuvres spirituelles et les témoignages iconographiques ou monumentaux. Enfin, le plus complexe, d’en dégager l’alchimie, les dissonances ou les harmonies et leurs fluctuations au fil de deux siècles et demi. Le lecteur a sous les yeux le livre qui résulte de la thèse entreprise par Matthieu Rajohnson sur cet ambitieux sujet, poursuivie avec une grande détermination jusqu’à sa soutenance en 2017 devant l’université Paris Nanterre. Il fallut le talent, le courage et l’inventivité de ce jeune chercheur pour accepter de donner à la thématique toute son ampleur et, in fine, faire suivre à son lecteur, en trois actes, le lent cheminement qui conduisit du « temps du désir et du regret » à celui du « deuil », en passant par celui de la « nostalgie ».
Dans un style élégant qui instille dans la rigueur de l’écriture scientifique de belles touches poétiques, l’auteur entraîne dans les replis de la conscience occidentale, pour le meilleur d’une histoire des émotions, cultivée dans toute sa profondeur, scrutant les réactions officielles aussi bien que les « mouvements paniques », le discours des gens d’Église aussi bien que celui des laïcs. Les témoignages mobilisés associent, comme il est rare de le lire, des objets de nature variée, ce qui permet de multiplier les angles d’approche : les chroniques côtoient l’exégèse biblique ou la liturgie (on composa des messes afin de prier pour la reprise de Jérusalem) ; aux actes pontificaux répondent les chansons, épopées et poèmes de croisade ; les traités de reconquête rejoignent les sermons, anecdotes édifiantes (exempla) ou œuvres hagiographiques ; aux plans et schémas de Jérusalem, qui s’approprient l’espace de la cité dans un propos dont les évolutions sont restituées, font écho les enluminures des Bibles, livres liturgiques, récits de pèlerinage et autres textes dévots ou profanes. Chaque dossier de sources a fait l’objet d’un examen de première main, appuyé sur la bibliographie afférente dont le nombre de titres dit, mieux que tout, la richesse de l’information. Matthieu Rajohnson n’est, en effet, pas le premier historien à se pencher sur Jérusalem ni le 11premier médiéviste à aborder le vaste champ de l’histoire des croisades. Mais aucune recherche n’avait jusqu’alors uni à ce point l’Orient, la ville de David et du Christ, et l’Occident, dans son rapport à ce centre des origines chrétiennes. Aucune recherche n’avait tenté de saisir ce qui apparaît avec le recul comme un tournant : plus jamais, après 1187, l’Occident ne domina pleinement Jérusalem. Passé le choc, il fallut accepter l’entrée dans la durée d’un fait qui perdit progressivement sa dimension conjoncturelle et provoqua la redéfinition des relations entre ce haut lieu et ceux qui s’en réclamaient en Occident : la ville allait-elle devenir avant tout un nom, un mythe ?
Le livre invite à suivre la lente mutation des réactions à travers des témoins méconnus ou inattendus. Se révèle ainsi au lecteur l’engouement pour le petit Livre des lamentations encore attribué à l’époque au prophète Jérémie. Sorti de l’ombre dans un tel contexte, celui-ci fait l’objet de commentaires textuels ou imagés comme jamais auparavant, en une exégèse dont la tonalité permet de suivre, au cours des deux siècles envisagés, l’expression du regret puis celle de son apaisement. On ne lira pas non plus sans un certain étonnement que la réaction de la papauté n’est pas allée sans « ambiguïtés » (je cite Matthieu Rajohnson) : il est curieux – suggestif ? – d’observer que les sources pontificales peinent à nomme Jérusalem. L’ombre de la ville du martyre de Pierre plane sur celle de David, à l’heure où l’Église d’Occident connaît la réforme que l’on appelait autrefois grégorienne, dans laquelle on s’accorde à voir l’application au monde latin d’une ecclésiologie centralisée autour du siège romain. Comment résoudre la tension qui s’installa ainsi entre deux têtes du christianisme ? On constate également que les revendications occidentales sur Jérusalem ne furent pas emportées par les armées de Saladin. Le titre de « roi de Jérusalem » resta longtemps convoité par les puissants, faisant de la cité de David un « espace de compétition » : Frédéric II lui-même n’a-t-il pas souhaité l’ajouter à son titre impérial ? De même, l’espoir d’une reconquête demeura vivace. Aux yeux de l’Occident, Jérusalem est bien « la plus sainte des villes », celle où s’est déployée l’action de ce Jésus dont la vie terrestre retient de plus en plus l’attention dans la dévotion, à partir des xie et xiie siècles. Le temps fit cependant son œuvre, là comme ailleurs ; la ténacité des faits aussi : quelles que soient les voies employées, les armes ou la négociation, elles ne parvinrent pas à endiguer l’abandon qui s’imposa, abandon d’une 12domination sublimée dans la force du nom, retrouvant en cela des accents proprement bibliques.
On découvre enfin que, contrairement aux apparences, le temps du deuil n’ouvrit pas la porte à celui de l’oubli ; bien au contraire, il fit éclore une véritable transmutation de la relation. L’ouvrage montre en effet que, loin de renoncer à Jérusalem, les Latins ont continué d’en vivre, en se l’appropriant autrement. En dépit de la fin des royaumes latins d’Orient, la cité sainte ne quitta pas les esprits en Occident. Les récits de pèlerins et les descriptions de la Terre sainte témoignent d’un intérêt renouvelé pour ce voyage, l’iter hierosolomytanum, auquel ne s’attache aucune obligation en christianisme, rappelons-le, pas plus que pour toute autre destination pèlerine. Au moment où cette étude s’achève, les Franciscains viennent d’entrer en charge de l’accueil des pèlerins dans le cadre de la Custodie de Terre sainte. Comme Maurice Halbwachs l’a montré en son temps3, s’élabore alors un vaste réseau de lieux de mémoire entre lesquels les pieux visiteurs sont invités à cheminer. Mais pour qui ne peut ou ne veut partir, pour qui entend dépasser le rêve oriental, pour qui veut surmonter les lamentations, c’est Jérusalem qui vient à eux sur le mode d’une « réappropriation symbolique » où s’entendent les affirmations de certains Pères de l’Église : « le vrai temple, c’est l’assemblée des chrétiens », écrivait déjà Clément d’Alexandrie († v. 215)4. Sur cette voie, Rome tenta de s’affirmer comme la « nouvelle Jérusalem », en devenant le réceptacle des plus éminentes reliques de la cité de David et en faisant de sa cathédrale, l’église Saint-Jean du Latran, un sanctuaire « typologique » du Temple de Jérusalem5. Mais le phénomène prit un tour plus complexe, plus diffus, par la multiplication de lieux de dévotion érigés ad instar Hierosolymæ. Reconnaissons que pour cette voie originale du deuil le terrain était préparé. Avant même la conquête de la ville par les Latins, puis sa reprise par les musulmans, l’Occident avait vu s’ériger des églises qui se voulaient des reproductions du Saint-Sépulcre par leur forme imitant la rotonde 13de l’Anastasis, par leurs dimensions calculées en relation avec celles de l’édifice originel, par leur titulature, il va de soi, restée pour certains cas dans la toponymie : ainsi Neuvy-Saint-Sépulcre6. L’enracinement de la perte de Jérusalem dans le temps long accéléra sans nul doute le mouvement, comme on peut le constater dans le chapitre final de l’ouvrage ; elle l’amplifia aussi au-delà de la seule référence au tombeau et l’ouvrit aux dimensions de tout l’espace parcouru par Jésus, tel que le décrivent les Écritures chrétiennes : pensons aux Monti Sacri d’Italie du Nord où le fidèle-visiteur est invité à suivre pas à pas les étapes de la vie terrestre du Christ. Au moment où se clôt l’ouvrage de Matthieu Rajohnson, le temps n’est pas encore venu de lire au-dessus d’un simple groupe sculpté figurant le tombeau du Christ, cette inscription rapportée dans un manuscrit des débuts du xvie siècle, qui invite à une prière indulgenciée :
Anyone who will read these little prayers that are written below, with devotion and while in the state of grace, every day for one year, in front of the Holy Sepulchre in any church of his choice –since in every church there is normally a Sepulchre constructed in the praise of God– will be able to earn all of the indulgences and graces that he would earn if he had visited the Holy Sepulchre in Jerusalem, because our Lord is better here with us than in Jerusalem7.
Les derniers mots en disent long sur cet étrange rapport au lieu des origines chrétiennes, puissante force d’évocation et référence récurrente, espace susceptible plus que d’une transposition, d’une démultiplication infinie qui, par nature même, ne saurait se limiter au seul Occident latin.
Si je t’oublie, Jérusalem
Que ma droite se dessèche !
Que ma langue s’attache à mon palais
Si je perds ton souvenir,
Si je ne mets Jérusalem
Au plus haut de ma joie8 !
14Ces versets du psaume 136 ont retenti durant de longs siècles sous les voûtes des plus grands sanctuaires comme dans les plus modestes églises : n’oublions pas que tout jeune clerc apprenait le latin dans les poèmes de David. L’engagement, celui du peuple d’Israël repris à leur compte par les fidèles du Christ, fut tenu par des voies singulières, on le voit.
Alliant une érudition très sûre à une remarquable finesse d’analyse, Matthieu Rajohnson montre dans ces pages denses et lumineuses comment un fait d’armes survenu en Terre sainte en 1187 devint un événement majeur dans l’histoire de la sensibilité occidentale, dont la perception est ici déployée à de multiples échelles. Mais après avoir compris par quelles voies l’Occident, entraîné dans la dynamique d’une phase d’engouement pour Jérusalem, en vint à faire son deuil de la cité, dès lors qu’il fallut prendre acte de l’installation dans la durée de la perte de 1187, on butte sur une nouvelle question, qui renvoie à un événement évoqué allusivement au début de cette préface. Pourquoi, au seuil du second millénaire, et pas avant, après plusieurs siècles de christianisme, l’Occident fut-il travaillé par ce grand élan vers Jérusalem ? Scruter la portée de 1187 invite donc à s’interroger sur le surgissement de 1095-1099, alors que la présence musulmane auprès du Saint-Sépulcre était entrée dans les faits depuis la première moitié du viie siècle (638) sans provoquer de réaction comparable. Ce serait l’objet d’un autre livre. Il est temps de laisser le lecteur apprécier à sa pleine valeur celui qu’il a entre les mains.
Catherine Vincent
Université Paris Nanterre
Membre senior honoraire de l’IUF
MéMo
1 Cité dans Georges Duby, L’An mil, Paris, Julliard, 1967, p. 177.
2 Paul Alphandéry & Alphonse Dupront, La chrétienté et l’idée de croisade, Paris, Albin Michel, 1954-1959 et Alphonse Dupront, Le mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997.
3 Maurice Halbwachs, La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte : étude de mémoire collective, Paris, PUF, 1941.
4 Cité par Pierre Maraval, « Comment s’est constituée une identité pèlerine chez les chrétiens des premiers siècles ? », Identités pèlerines, actes du colloque de Rouen, 15-16 mai 2002, dir. Catherine Vincent, Rouen, PUR, 2004, p. 21.
5 Umberto Longo, « Dimensione locale e aspirazioni universali a Roma nel XII secolo : San Giovanni in Laterano come santuario nell’eredità dell “Antica alleanza“ », Expériences religieuses et chemins de perfection dans l’Occident médiéval, éd. Dominique Rigaux, Daniel Russo & Catherine Vincent, Paris, AIBL, 2012, p. 121-138.
6 Geneviève Bresc-Bautier, « Les imitations du Saint-Sépulcre de Jérusalem (ixe-xve siècle), archéologie d’une dévotion », Revue d’histoire de la spiritualité, 50/1974, p. 319-342 ; plus récemment : Laura Gaffuri & Ludovic Viallet (dir.), Politique et dévotion autour du souvenir de la Passion en Occident (Moyen Âge-époque moderne), Reti Medievali Rivista, 17-1/2016.
7 Traduction anglaise du texte original en moyen allemand dans Kathryn Rudy, Virtual Pilgrimages in the convent : imagining Jerusalem in the late Middle Ages, Turnhout, Brepols, 2011, p. 396 (p. 395-398 pour l’ensemble du texte ; manuscrit daté autour de 1520).
8 Ps 136 (137),5-6.