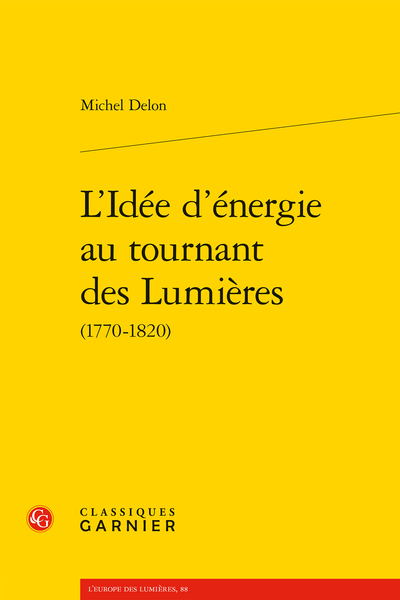
Table des matières
- Publication type: Book chapter
- Book: L’Idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820)
- Pages: 443 to 448
- Collection: Enlightenment Europe, n° 88
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406148708
- ISBN: 978-2-406-14870-8
- ISSN: 2258-1464
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14870-8.p.0443
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-05-2023
- Language: French
Table des matières
Introduction 7
Tâche et fondements de l’histoire des idées. L’idée d’énergie. État des recherches.
Problèmes de périodisation. Unité et scansion des Lumières.
Les générations de la Révolution et de l’Empire.
Des Lumières au Romantisme, de la Nature à l’Histoire.
Introduction à la nouvelle édition 25
L’histoire des idées, un demi-siècle plus tard. Nouvelles perspectives sur l’idée d’énergie.
Les métaphores de l’époque. Un imaginaire de la thermodynamique. Paradoxe, contradiction, oxymore.
PREMIÈRE PARTIE
LES MOTS ET LE MONDE
L’histoire d’un mot 45
De l’Antiquité au classicisme.
Aristote. La patristique et le Moyen Âge. Rabelais et l’humanisme. Théologie, philosophie et rhétorique.
Perspectives lexicales.
Le Dictionnaire de l’Académie, Trévoux, l’Encyclopédie. Travaux de lexicologie. Interférences des vocabulaires scientifique et psychologique. Influences anglaise et allemande.
L’énergie de la langue 63
L’héritage classique.
Le refus de l’énergie, de Frain du Tremblay à Rivarol. Un autre classicisme : le je ne sais quoi, de Bouhours au Salon de 1765, le sublime, de Boileau au Salon de 1767.
444Le sensualisme.
Condillac. Diderot : de la Lettre sur les aveugles à la Lettre sur les sourds et muets. L’Article « Langue » de l’Encyclopédie. Le néo-classicisme selon Diderot et selon l’abbé Arnaud.
Du sensualisme au spiritualisme.
Rousseau et l’Essai sur l’origine des langues. L’illuminisme : étymologie et allégorie, Court de Gébelin, Saint-Martin, Fabre d’Olivet.
Du sensualisme à l’Idéologie.
Destutt de Tracy, De Gérando.
L’énergie dans les Beaux-Arts 99
L’apport leibnizien.
Johann Georg Sulzer, son exposé de 1765 et sa diffusion en France.
Energeia et ergon.
James Harris, Lessing. Le sublime chez Burke et Kant et le néo-classicisme : une même libération de l’énergie.
Spécificité de chaque art.
La peinture, de la représentation à la suggestion. La musique, langage de charge, les réticences de Grétry. Les arts du geste et du corps : Cahusac, Noverre, Engel. L’architecture et les jardins.
L’idée de littérature 119
La mise en cause des codes classiques.
La poésie et la prose. L’archaïsme et la néologie. Réhabilitation du corps et du peuple. Contagion sensible, contagion érotique. L’authenticité du fait divers, l’exemple de Baculard d’Arnaud.
Pour ou contre l’énergie.
Théories de la littérature : Mercie et Mme de Staël. Le refus de l’énergie chez les fidèles des Belles-Lettres. La Harpe, Mme Du Deffand, Mme Riccoboni, Joubert, Mme de Genlis.
Totalité et densité.
La condamnation de la littérature fugitive et l’idéal du « tout dire ». La condamnation du bavardage et l’énergie de la concision. Graphomanes et hydromélanophobes.
Énergie ou inertie de la matière 139
Matérialisme clandestin et militantisme militant.
Meslier, les manuscrits clandestins, Deslandes, La Mettrie. Souvenirs antiques et gassendisme. Influence de Toland.
445Débats et polémiques.
D’Holbach et Diderot. Lamétherie et Peyrard. Les arguments spiritualistes. Le débat dans la fiction : Dorat et Maréchal, Potocki et Sade. Chassés-croisés : Voltaire, Delisle de Sales, Daon.
Énergie matérielle, énergie spirituelle.
Attraction, affinité élective, magnétisme, électricité. Vers le concept scientifique.
La puissance de la nature 159
La nature comme force créatrice.
Buffon. Un panthéisme matérialiste : Diderot, Dupuis, Cabanis. Un panthéisme spiritualiste : Bernardin de Saint-Pierre et Mme de Staël. Werther, Mercier et Beaumarchais. L’image de l’océan.
Forces telluriques, forces cosmiques.
La descente au centre de la terre, la mine et le volcan. « La poésie est matérialiste ». Les orages désirés.
Du poème de la nature au paysage romantique.
Les Saisons et Les Mois. Le poème de la nature condamné au fragment ou à la perte d’énergie. Récits de voyage et prose romanesque. La nature comme métaphore de la négativité humaine.
De la nature à l’histoire 179
Modèles cycliques et modèles linéaires.
Azaïs et Condorcet. Une double ambivalence, perte ou exaltation de l’énergie : le système des compensations, Buffon et Bernardin de Saint-Pierre, et le système du progrès, l’Encyclopédie et Volney.
Une dialectisation de la violence.
Énergie et nostalgie. L’appel aux grandes catastrophes. L’éloge maistrien de la guerre, l’éloge sadien du crime. Fermentation et crise, révolution et régénération. Énergie primitive et progrès. La Révolution comme réveil. Positivité et négativité de l’énergie : Saint-Martin, Ancillon, Maistre, Bonald. Le groupe de Coppet.
Partition de la nature, partitions historiques.
Le Nord et le Midi. L’Ancien et le Nouveau Monde. L’aristocratie et la bourgeoisie.
446DEUXIÈME PARTIE
LE MOI
L’énergie humaine 209
La fibre ou l’âme.
La tradition vitaliste et l’École de Montpellier. Stahl, Barthez, De Sèze. Diderot, Cabanis, Bichat, Lamarck. L’énergie tragique chez Senancour. Du Je pense cartésien au j’existe sensualiste. Le dynamisme leibnizien : Sulzer et l’école berlinoise. Delisle de Sales et Mercier. Le groupe de Coppet. L’école française : Maine de Biran, Laromiguière. L’homme sans Dieu et l’homme de foi, l’indifférence.
Les conditions de l’énergie.
Le tempérament. L’âge, Chérubin et René, « Le Printemps de Botticelli », 1789 et les âmes neuves. Le sexe, médecins et rousseauistes. Thomas, Diderot, Laclos. Travestissement. L’énergie de la haine : la femme au poignard. Héroïnes sadiennes. Zingha et Frédégonde. Héroïnes révolutionnaires. Charles Fourier et les amazones.
Le sentiment de l’existence 239
Énergie maximale, énergie minimale.
Du pur sentiment de l’existence à la vie intense. Refus de l’énergie et existence minimale. Option philosophique et sentiment de l’existence. Accroître l’existence. Équilibre et cyclothymie. Existence maximale : de la douleur à la mort.
Témoignages romanesques.
Existence sensible, existence scélérate chez Sade. Dramatisation du débat dans L’Émigré. Roman d’amour et scènes fortes. Vie intense et imminence de la mort dans les fictions de Mme de Staël. Perspectives autour de 1820.
Expansion et repliement 269
La leçon de Rousseau.
Matérialistes et illuministes. Solitaire, solidaire.
Diastole et systole.
Un double risque : la dispersion, l’évaporation et l’égoïsme, l’isolisme. Les figures du mouvement centripète : le repli, la jouissance de soi, la réflexion, la concentration. Les figures du sentiment centrifuge : la bienfaisance, la gloire, l’immortalité, la querelle de la postérité.
447Mémoire et imagination.
La mémoire affective. La réhabilitation de l’imagination. L’image du foyer.
Passions et paroxysmes 291
Le débat sur les passions.
Diderot, Helvétius et leurs réfutateurs. La morale encyclopédique et la bonne gestion des passions. Le discours médical. Bonstetten et Mme de Staël. L’orthodoxie religieuse. La mise en scène romanesque. Le vague des passions. L’image de la tempête. Une nouvelle apologie des passions : Sade, Fourier et Stendhal.
L’enthousiasme.
La condamnation voltairienne et encyclopédique. Un Sturm-und-Drang français. L’expérience révolutionnaire. Un thème poétique : Lebrun et Lamartine. La théorisation de Mme de Staël. Fanatisme et extrémisme, maximum et paroxysme.
Le crime.
La réflexion diderotienne. De Diderot à Sade. La violence révolutionnaire. La violence romantique : Nodier, Ballanche, Stendhal.
La folie.
Folle par amour, folle par révolution. Charles VI chez Sade et Népomucène Lemercier. La médecine aliéniste.
La volonté 331
L’énergie de résistance.
Le goût de l’obstacle. La résistance aux passions. Le paradoxe du libertin.
Le caractère.
L’homme sans caractère. La morale de Beaumarchais.
Théories et pratiques.
Deux théories de la volonté : Destutt de Tracy et Maine de Biran. Le magnétisme comme théorie et pratique de la volonté. Le champ politique, de la Révolution à l’Empire.
La perte de volonté.
L’aboulie selon Maine de Biran, Senancour, Constant, Nodier.
D’un élitisme à l’autre 351
Les repoussoirs de l’énergie.
Le mondain : l’occasion et le moment, l’inconstance. Le bourgeois : la médiocrité, penseurs et poètes de la modération. Élitisme et mépris.
Le libertin et l’âme sensible.
Critique intramondaine et extramondaine de la mondanité. Continuité et discontinuité temporelle. Continuité et discontinuité sociale.
Le rêveur et le révolutionnaire.
Un nouveau monde. Le possible et l’impossible.
448Le méchant 379
Traditions théâtrales et romanesques.
Le sillage du Méchant de Gresset. Intrigue et vertu. Figaro et Gaudet. Les épreuves de la vertu. Le Crime de Lesuire. La gloire de l’échafaud.
Les séductions du brigand.
Brigands et scélérats chez Diderot et chez Sade. Modèles étrangers : Lillo, Milton, Schiller.
Complots et conspirations.
La compilation de Duport du Tertre. Polémiques de la Révolution. Le Vieux de la Montagne. Réflexion historique, imaginaire romanesque. De Nodier à Balzac.
Le génie 403
Topologie de la génialité.
Une mutation lexicale. Le sommet des Alpes. Le Descartes de Thomas. Une continuité poétique : Lebrun, Mercier, Lamartine. Mercier et Raynal. Le vocabulaire du génie : vaste, planer. L’identification à Dieu.
Formes et modalité du génie.
Le savant et le législateur. La multiplication des points de vue, le sens de l’universel. La concentration, le miroir d’Archimède.
Génie et négativité.
Le génie du mal. Le génie maudit. Promotion et perte du moi.
Conclusion 423
Idée d’énergie et concept scientifique. Sturm-und-Drang, crise ou tournant des Lumières, secondes Lumières. Un slogan : osez, un lieu symbolique : le Panthéon.
Index 429