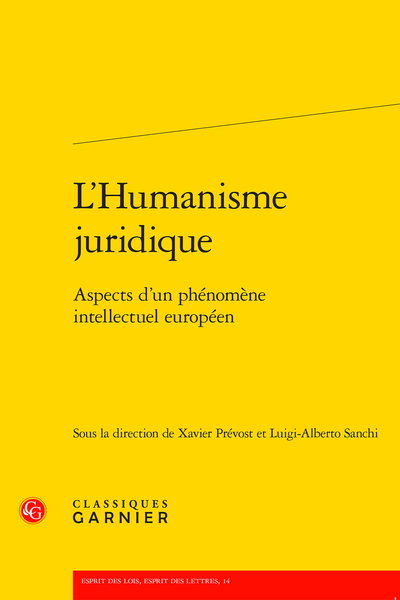
Résumés des contributions
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen
- Pages : 421 à 425
- Collection : Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n° 14
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406118015
- ISBN : 978-2-406-11801-5
- ISSN : 2264-4148
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11801-5.p.0421
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 09/02/2022
- Langue : Français
Résumés des contributions
Bruno Méniel, Xavier Prévost, Luigi-Alberto Sanchi, « Introduction »
Comment définir l’humanisme juridique ? Les différentes approches sont d’abord prises en considération, pour ensuite présenter le panorama des principaux juristes humanistes et de leur contribution à l’histoire de ce courant érudit. Est enfin abordée la production scientifique qui en a récemment renouvelé la connaissance.
Jean-Louis Ferrary, « Ouverture. Les collections de textes juridiques antérieurs au corpus de Justinien, de Sichard à Schulting (xvie-xviiie siècles) »
À partir de la première tentative, par J. Sichard en 1528, de percer la barrière chronologique du règne de Justinien pour cerner l’état du droit romain précédent, sont étudiées les apports de la Renaissance et du xviie siècle à la connaissance de la jurisprudence antérieure aux Compilations, en particulier ceux d’Alciat, de Cujas, des frères Pithou et de Godefroy, pour aboutir, en 1717 à l’édition de la Jurisprudentia vetus ante-justinianea d’Anton Schulting.
Diego Quaglioni, « L’Epistola contra Bartolum de Laurent Valla (1433), fondation de l’humanisme juridique ? »
Cet article vise à reconsidérer de manière critique un épisode que l’on juge classiquement comme relevant de la genèse de l’humanisme juridique, c’est-à-dire la parution, en 1433, de la célèbre Epistola contra Bartolum de Lorenzo Valla (1433). L’édition critique du texte de Valla et celle du traité De insigniis et armis, objet de sa polémique, nous permettent de mettre en évidence l’opposition de l’humaniste à l’idée bartolienne de la primauté du droit civil sur toutes les autres sciences.
422Dario Mantovani, « L’éloge des juristes romains dans le prologue du livre III des Elegantiae de Laurent Valla »
L’éloge des juristes romains contenu dans les Elegantiae répond au programme de Valla de retrouver la précision de la langue latine comme un outil indispensable pour élaborer et communiquer avec exactitude toute discipline. Il récupère des évaluations que les anciens eux-mêmes ont données des juristes romains. L’article démêle la trame de l’éloge et ses modèles, pour mieux saisir la pensée de Valla, et suit ses échos (et déformations) dans la culture européenne jusqu’au xxe siècle.
Xavier Prévost, « L’Encomium historiae (1517) d’André Alciat. De l’éloge de l’histoire à l’étude historique du droit »
À travers l’étude d’un de ses premiers écrits, il s’agit de s’interroger sur le projet intellectuel d’Alciat, souvent présenté comme un fondateur de l’humanisme juridique. L’Encomium historiae, épître dédicatoire de ses annotations sur Tacite, a connu seul une grande fortune éditoriale, mais doit être étudié dans son contexte d’origine afin de comprendre l’ambition de son auteur. Alciat y fait l’éloge de l’histoire tacitéenne, qui constitue alors une référence pour l’étude des textes juridiques.
Annalisa Belloni, « De l’interprétation des épigraphes milanaises anciennes à la reconstitution des bureaux municipaux à Milan à l’époque romaine »
Œuvre de la maturité d’Alciat, les Rerum Patriae libri se fondent surtout sur les épigraphes milanaises, rassemblées dans ses Collectanea epigrafica. Par leur interprétation, Alciat tira les éléments pour reconstruire les magistratures à Milan à l’époque romaine. Il les envisagea dans le cadre de l’administration centrale, en particulier judiciaire. Ses hypothèses parfois erronées sont toujours le fruit d’une acribie d’investigation et de nature à provoquer des progrès dans la recherche.
Géraldine Cazals, « Avignon, mos Italicus, mos Gallicus ou mos Tholosanus ? Un lieu majeur du développement et de la diffusion de l’humanisme juridique (premier tiers du xvie siècle) ? »
Nourri par l’idée sous-jacente de questionner les géographies de l’humanisme juridique, l’article interroge le rôle qu’a pu jouer sous cet angle la ville d’Avignon 423dans le premier tiers du xvie siècle. S’attachant à découvrir les préoccupations et activités des maîtres du studium et les témoignages laissés au cours de cette période par ses écoliers, il révèle quelle émulation intellectuelle a pu alors caractériser la ville, au sein de l’université comme auprès des communautés hébraïques locales.
Luigi-Alberto Sanchi, « À l’origine du Mos Gallicus. Les Annotations aux Pandectes de Guillaume Budé »
Parues en 1508 puis enrichies au cours des décennies suivantes, les Annotations aux Pandectes de Guillaume Budé constituent l’un des premiers essais philologiques humanistes consacrés au Digeste : l’attention pour la langue, le texte et l’exégèse des fragments de la jurisprudence romaine épouse ici une approche large du fait antique, mêlant un horizon encyclopédique gréco-romain et des questionnements politiques et philosophiques.
Giovanni Rossi, « Un manifeste de l’humanisme juridique naissant. L’épître Studiosis (1524) en préface du De legibus connubialibus et iure maritali d’André Tiraqueau »
L’œuvre très originale d’André Tiraqueau aborde le thème anthropologique non moins que juridique du mariage et des rapports conjugaux. L’humanisme de Tiraqueau se traduit à la fois par une méthode juridique renouvelée par les études classiques des grands savants de l’époque et par l’ambition de mettre à jour la formation traditionnelle en droit.
Bruno Méniel, « L’humanisme juridique est-il un humanisme ? Le cas du Catalogus gloriae mundi de Barthélemy de Chasseneuz »
Dans le Catalogusgloriae mundi de Chasseneuz, qui développe une réflexion sur les hiérarchies fondée sur des présupposés théologiques, les nouvelles autorités de l’humanisme juridique n’évincent pas les autorités anciennes de l’école bartoliste. L’ouvrage se rattache pourtant au mouvement humaniste par sa visée universelle, par la place essentielle qu’il accorde au savoir, et par son intention de donner aux hommes, quelle que soit leur condition, un sentiment de dignité.
424Raffaele Ruggiero, « François Baudouin, la “iurisprudentia muciana” et l’édit provincial de Cicéron »
Le parcours intellectuel de François Baudoin (1520-1573) invite à approfondir le lien entre ses travaux philologiques et l’analyse historique du droit, jusqu’à sa conception d’une coniunctio entre histoire universelle et jurisprudence et à la formulation de propositions politiques qui s’enracinent dans son interprétation du passé. Cas d’étude, sa monographie Jurisprudentia Muciana concerne le lien entre l’édit provincial de Quintus Mucius Scaevola et le proconsulat de Cicéron en Cilicie.
Stéphan Geonget, « Prolégomènes à l’édition critique de l’Antitribonian de François Hotman »
Cet article entreprend d’examiner – dans la perspective d’une édition – comment l’Antitribonian de François Hotman, s’inscrivant dans un projet de réforme des études de droit de vaste ampleur, nécessite un travail à plusieurs mains. Des compétences historiques, philosophiques, juridiques et littéraires sont nécessaires pour entreprendre de l’interpréter pleinement. C’est ainsi notamment dans la langue de Rabelais et par le prisme de ses œuvres que se disent certains des enjeux juridico-politiques du moment.
Marco Penzi, « Le schisme des parlements “royalistes” en 1591. Théorie et application des thèses gallicanes »
Entre 1589 et 1595, les partisans d’Henri IV eurent affaire à la Ligue, à l’Espagne et à la Papauté. En 1591, pour défendre les droits du roi au royaume, les gens de sa cour n’hésitèrent pas à proclamer le schisme. Ces catholiques défendaient une thèse dépassant les droits et libertez de l’Eglise Gallicane dont ils étaient les gardiens. Or le clergé qui suivait le Béarnais n’adopta pas les positions des parlementaires, créant ainsi une scission dans cette alliance de catholiques navarristes.
Mathias Schmoeckel, « L’Humanisme juridique en Allemagne. Depuis la Réforme jusqu’à l’“Usus modernus Pandectarum” »
Il faut préciser le rôle de l’humanisme allemand à côté de la Réforme protestante, qui assume un rôle dominant dans la vie, la politique et la science 425au Saint-Empire. La nouvelle théologie inspira une nouvelle approche méthodologique et épistémologique. Même la jurisprudence de ce siècle, dans son fondement scientifique, comprit et propagea les convictions confessionnelles de ses auteurs. Ces traditions différentes se laissent saisir à travers quelques biographies de juristes du xvie siècle.
Gaëlle Demelemestre, « L’humanisme rationaliste de Diego de Covarrubias »
Cette contribution présente les apports méthodologiques d’un juriste majeur du siècle d’or espagnol, Diego de Covarrubias, dont la spécificité est d’opérer la synthèse entre la tradition du mos italicus et la nouvelle méthode du mos gallicus forgée par les juristes français. À partir d’une lecture discursive de son œuvre, on se propose d’expliciter la méthode inédite inventée par ce dernier, que l’on peut appeler « humanisme juridique », pour concilier la théorie et la pratique du droit.