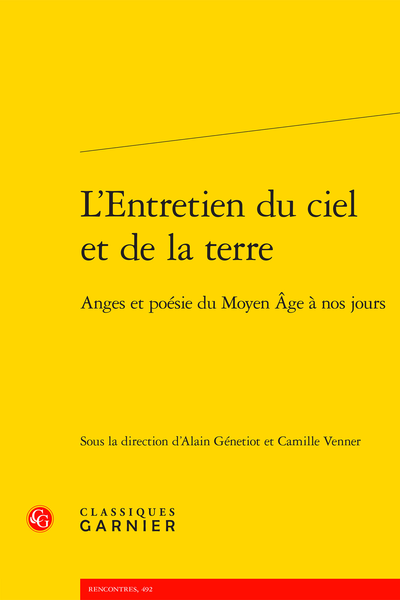
Résumés
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: L’Entretien du ciel et de la terre. Anges et poésie du Moyen Âge à nos jours
- Pages: 367 to 372
- Collection: Encounters, n° 492
- Series: Convergences in literature, n° 5
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406112518
- ISBN: 978-2-406-11251-8
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-11251-8.p.0367
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 03-29-2021
- Language: French
RÉSUMÉS
Camille Venner, « Les ailes et la lyre. Aspects et enjeux de la présence des anges en poésie »
Dès la Bible, l’ange, médiateur entre le ciel et la terre, est associé au langage artistique ; il convient donc d’envisager l’intérêt d’une étude de la figure angélique pour favoriser une réflexion sur l’essence et les pouvoirs de la poésie. Les relations entre la poésie et les anges constitueraient alors un lieu révélateur de la relation que le poète entretient avec son propre langage, et avec ce qui excède son langage humain, tout en l’attirant.
Thibaut Radomme, « Gautier de Coinci, le chant des anges et l’Ave Maria dans les Miracles de Nostre Dame »
Il est montré comment, à travers l’étude de ses occurrences dans les prologues (I Pr 2, II Pr 1) et chansons (I Ch 3, II Ch 6, II Ch 8), le motif de l’imitation du chant des anges est exploité par Gautier de Coinci pour justifier sa pratique d’écriture et ériger l’évêque Bon (I Mir 36) en modèle auctorial. L’examen des Salus Nostre Dame (II Sal 35) conduit finalement à suggérer que, plutôt que d’imiter l’ange Gabriel, Gautier tente de se substituer à lui pour devenir à son tour un auctor.
Élisabeth Pinto-Mathieu, « La Cornerie des Anges de Paradis que chascun doit noter »
Poème méconnu, La Cornerie des Anges de Vaillant de Tours (xve siècle) soulève de complexes problèmes génériques. Jonglerie en rimes équivoques, elle se lit a priori comme un poème religieux, menaçant une humanité frivole du Jugement Dernier, que sonnent les quatre anges de l’Apocalypse. En recourant aux manuscrits d’époque, à la lexicographie et au contexte social, l’article démontre la possibilité d’une interprétation triple, qui fait passer des anges aux femmes coquettes ou aux maris trompés.
368Marie-Laurentine Caëtano, « Les anges dans la poésie spirituelle d’Anne de Marquets et de Gabrielle de Coignard »
Le présent article souhaite étudier la présence, discrète mais constante, des anges dans les œuvres de la religieuse dominicaine Anne de Marquets (1533 ?-1588) et dans celle de Gabrielle de Coignard (1550-1586), laïque. Parmi les anges cités, on remarque notamment des anges messagers et un « chœur angélique », qui apparaît comme un modèle de louange. Cette étude montre également à quelles fêtes religieuses et/ou à quels rôles les anges sont associés et dans quelle mesure.
Josiane Rieu, « Les anges dans La Sepmaine de Du Bartas (1581-1584) »
Du Bartas propose un discours conforme à la théologie catholique et réformée sur les anges, dont la louange est un exemple pour le poète, même si son langage imparfait vaut surtout comme preuve d’amour de Dieu. L’homme peut mieux comprendre sa position étonnante dans la Création : si dans le néoplatonisme il est inférieur aux anges sur l’échelle des êtres, le poète renverse la perspective, en montrant le choix de Dieu pour l’homme, à qui la Rédemption apporte une Grâce unique parmi les créatures.
Catherine Déglise, « Claude Hopil et le modèle angélique »
La figure de l’ange est omniprésente les Divins Eslancemens d’amour de Claude Hopil (1629). Dans ces poésies très abstraites marquées par la tradition dionysienne, l’ange apparaît comme un modèle théorique qui permet au poète de penser la relation à Dieu et l’ordre du monde, mais aussi comme un modèle poétique permettant d’envisager une issue aux impasses de la parole poétique qui ne cesse de se heurter au caractère indicible des mystères divins.
Clément Duyck, « De l’énonciation à l’esthétique. Les anges du Parnasse séraphique de Martial de Brive »
L’objet de cette étude est de rendre compte de la variété des usages et des statuts de l’ange dans Le Parnasse séraphique de Martial de Brive (1660). Cette variété révèle une tension entre deux projets poétiques. Le premier projet, théocentrique, assigne à l’ange une fonction énonciative qui fait de la louange angélique un idéal poétique. Le second projet, christocentrique, se traduit par une mise à distance des anges, qui se voient cantonnés à un rôle essentiellement esthétique.
369Lucien Wagner, « Le dialogue des anges et du roi dans le Saint Louys du père Le Moyne »
Pierre Le Moyne dans son poème héroïque Saint Louis met en scène des anges, dont les fonctions répondent largement aux stéréotypes du merveilleux chrétien. Mais un véritable dialogue s’établit entre le roi héros chrétien et le messager angélique, nouant contact entre ciel et terre. La parole angélique insuffle au héros épique un élan visionnaire. L’ange épique apparaît dès lors comme une figure allégorique de l’enthousiasme poétique conçu comme feu spirituel.
Sylvain Menant, « Anges poétiques des Lumières »
La présence des anges dans la grande poésie religieuse du xviiie s., celle de Jean-Baptiste Rousseau, de Louis Racine ou de Lefranc de Pompignan, est limitée à cause de la vulgate philosophique du temps et de priorités apologétiques. Mais les cantiques spirituels les associent volontiers au thème lyrique de l’exil dans un monde de misère et de tentations, notamment chez Pellegrin, Grignion de Montfort ou les auteurs de Saint-Sulpice. La figure de l’ange exprime alors mélancolie et confiance.
Olivier Beneteau, « Renouvellement et transformation de l’épopée dans La Chute d’un ange de Lamartine »
Au sein de La Chute d’un ange de Lamartine, l’ange, loin d’être réduit à son rôle de médiateur, parvient non seulement à faire progresser la diégèse mais surtout à renouveler les fondements de la poésie épique. Devenue mystique, celle-ci n’est plus cantonnée aux fonctions de l’épopée héroïque afin de légitimer les valeurs axiologiques d’une nation. La figure de l’ange, miroir de la condition humaine, l’ouvre aux visions surnaturelles en envisageant l’expiation du monde appelé à la rédemption.
Esther Pinon, « Les anges dans la poésie romantique, une poétique de l’unisson ? »
Motif récurrent dans la poésie romantique, l’ange ne s’y manifeste pourtant bien souvent que dans des apparitions fugitives, sur fond d’esthétique fragmentaire, alors même qu’il représente l’idéal d’une parole éternelle et unanime. Plus que jamais inaccessible en un temps de bouleversements idéologiques et 370de doutes spirituels, cet idéal est mis en question et, à travers l’unisson des anges, la poésie romantique interroge la puissance des voix humaines, dans leur solitude et leur singularité.
Henri Scepi, « Baudelaire et les “mauvais anges” »
Lié au divin, l’ange questionne les chances du poème, et son aptitude à favoriser l’essor d’une pureté, par laquelle seraient préservées les ressources du cœur et de l’âme. Mais Baudelaire sait que l’ange s’enracine dans l’immanence de la vie et l’épreuve du négatif. Les « mauvais anges » rêvés par lui s’offrent comme la manifestation d’un moment de la poésie, à la faveur duquel celle-ci prend la mesure de la finitude qui la hante.
Laure Darcq, « Le chant de l’ange sur scène. Le Verbe incarné dans quelques mystères symbolistes »
À la fin du xixe siècle, et pendant plusieurs décennies, les poètes dramatiques souhaitent rendre visible le sacré. Ils composent à cet effet des livrets d’opéras (Charles Grandmougin, Maurice Maeterlinck), des oratorios pour marionnettes (Maurice Bouchor) et des drames (Émile Pouvillon, Paul Claudel). L’ange occupe une place centrale dans ces compositions, où dominent poésie et musique. En incarnant la parole lyrique, il s’impose comme le nouveau coryphée, chef d’orchestre et double du poète.
Bérengère Avril-Chapuis, « De la musique des sphères comme idéal »
Synonyme d’idéal et d’harmonie aussi bien dans la Bible que dans les théories antiques puis les cosmogonies médiévales qui en découlent, au cœur de l’harmonia mundi, la musique des sphères semble à nouveau désigner un idéal esthétique chez les Symbolistes et leurs héritiers. Nous nous intéresserons à quelques exemples marquants chez quelques auteurs et artistes issus de ce mouvement.
Dominique Millet-Gérard, « Poétique des anges chez Paul Claudel »
Dès les premières années du xxe siècle, Paul Claudel s’intéresse à la question théologique des Anges, à travers saint Thomas d’Aquin, saint Augustin et Denys l’Aréopagite. Il en tire des « Propositions sur les Anges », et la 371« Seconde Note sur les Anges ». Outre la théorie, il met l’Ange en scène dans Le Soulier de Satin puis dans « Le Livre de Tobie ». Enfin l’Ange est l’objet d’une réflexion de haut vol sur le mot et la formule poétiques, articulée à la méditation sur le langage eschatologique.
Serge Linarès, « Les métamorphoses de l’ange dans l’œuvre de Jean Cocteau »
Figure cardinale de l’œuvre de Cocteau, l’ange en détermine les causes et les modalités. Il est à l’origine de la mue spirituelle et esthétique du poète, conditionnant la refonte de son inspiration et le déploiement de ses névroses. Il vit de ses fantasmes de filiation, de sexualité et de rébellion, empruntant à la Bible comme à l’art romantique. Il s’incarne dans des formes linguistiques et iconiques dont il perturbe les capacités de représentation au point d’être lui-même menacé par la négation.
Caroline Narracci, « Vers une terre angélique. Figures et fonctions de l’ange dans la poésie d’Yves Bonnefoy »
Poète athée, Yves Bonnefoy a néanmoins été attentif aux mots et aux figures religieuses. Nous nous intéressons dans cet article à la façon dont il déplace les attributs et fonctions traditionnels de l’ange du plan religieux au plan poétique. Nous montrons ainsi comment il renouvelle notre vision de la figure angélique à travers une étude des rôles et des sens qu’il lui attribue.
Patrick Labarthe, « L’ange dans la “pensée figurale” de Bonnefoy »
Comment restaurer l’expérience d’un sens par-delà le constat du néant, telle est l’une des interrogations majeures de Bonnefoy. Or l’ange est l’une des figures de cette restauration. Il traverse l’œuvre tant sous ses formes historiques (les anges de la peinture du Quattrocento notamment) que sous ses vêtures les plus hétérodoxes. C’est dans son humanisation que réside l’une des inflexions majeures de sa poétique.
Alain Génetiot, « Modèle angélique et parole poétique »
Entre le Moyen Âge et nos jours, on a mis en évidence les évolutions de la figure de l’ange comme métaphore du poète et de l’inspiration. La poésie 372angélique, qu’elle soit proprement dévotionnelle ou simplement métaphorique, engage une médiation entre ciel et terre qui se joue dans la langue poétique même : sublimation qui fait signe vers l’Absolu, poésie apocalyptique d’illumination, purification par le feu, poésie de déchiffrement qui permet de nommer le monde dans sa complétude harmonieuse.