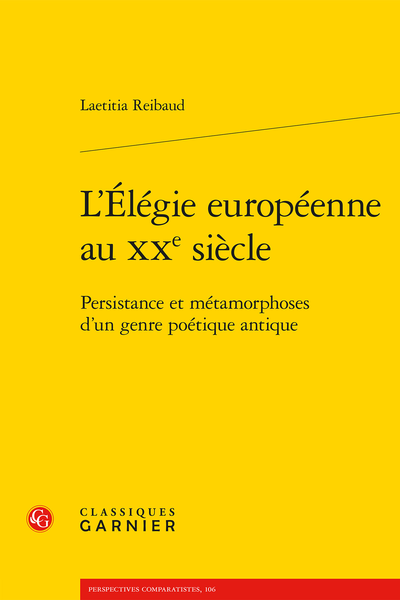
Table des matières
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : L’Élégie européenne au xxe siècle. Persistance et métamorphoses d’un genre poétique antique
- Pages : 1185 à 1193
- Collection : Perspectives comparatistes, n° 106
- Série : Classique/Moderne, n° 12
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782406119333
- ISBN : 978-2-406-11933-3
- ISSN : 2261-5709
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11933-3.p.1185
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 26/01/2022
- Langue : Français
Table des matières
Abréviations 9
Avertissement
Note sur l’accentuation des mots grecs modernes 11
Introduction 13
Permanence et longévité de l’élégie 13
Un problème d’identité et de définition 16
La nécessité d’une perspective diachronique.
L’élégie contre l’élégiaque 17
Deux axes de comparaison 20
S’intéresser à la forme de l’élégie moderne 21
Traditions et modernités dans l’élégie du xxe siècle 26
Le renouveau du lyrisme élégiaque au xxe siècle 28
Critères d’établissement du corpus 30
PREMIÈRE PARTIE
L’ÉLÉGIE, UN PROBLÈME DE DÉFINITION
Présences de l’élégie au xxe siècle
Enquête et panorama 37
Panorama de l’élégie au xxe siècle. Vers une disparition ? 46
Fréquence du titre Élégie(s) au xxe siècle 47
Les « vies secrètes » de l’élégie au xxe siècle 63
Bilan et problématique 110
1186D’une prétendue disparition de l’élégie au xxe siècle 110
L’identité de l’élégie au xxe siècle 113
La question des héritages 117
Elégie ou élégiaque :
genre ou « éclatement des genres » ? 118
Un « nouveau lyrisme » pour une nouvelle élégie ? 123
Méthode 132
Définitions 137
Portrait-Robot de l’élégie.
La langue courante comme témoin 139
Une définition par le « contenu » 141
Tonalité mineure 143
Lyrisme 144
Sentimentalité : jusqu’à la mièvrerie ? 151
Un portrait double 155
Ce qu’en pensent les théoriciens du xxe siècle 156
Faut-il restreindre l’élégie au chant de deuil ? 157
Sur quels exemples se fonde la définition
par le deuil et la mélancolie ? 166
Le thème amoureux : problèmes de cohérence thématique
et historique de l’élégie 175
Questions de forme 182
Quelques exemples pris au xxe siècle 185
Conclusion 193
DEUXIÈME PARTIE
FONDEMENTS ANTIQUES ET MODERNES
Elegos, Elegeion, Elegia 201
Introduction. « Quel sujet n’est pas élégiaque ? » 202
Étymologies 211
Élégie dérivée d’Élegos 211
1187É é légein et autres étymologies populaires :
pleurer, s’apitoyer, célébrer 213
Hypothèses scientifiques et modernes
pour l’étymologie d’élegos : la flûte ? 218
Élegos et elegeîon 225
Élegos, góos, thrênos : question de vocabulaire 230
Un ensemble de critères peut-il définir l’élégie ? 237
L’élégie gnomique et méditative :
Grèce archaïque et xxe siècle 238
L’élégie narrative : élégie archaïque,
élégie hellénistique, élégie du xxe siècle 251
L’élégie « érotico-subjective » à la romaine :
les origines de l’élégie d’expression personnelle
et sa postérité au xxe siècle 267
De la « légèreté » et de la « tendresse » dans l’élégie :
un héritage hellénistique 283
La double polarité
de l’élégie romaine et de l’élégie moderne :
mise en évidence de la « tension élégiaque » 285
La conjonction des thèmes de la mort et de l’amour
et l’élaboration de la définition de l’élégie
comme plainte amoureuse 296
Conclusion. Vers une définition de l’élégie comme genre 304
Mythologies élégiaques 315
La Pleureuse, la flûte et le rossignol.
Une rhapsodie aérienne et solitaire 322
La monodie plaintive, aiguë et virtuose du thrène 322
L’élegos et le chant de l’oiseau 326
De l’Antiquité au xxe siècle 329
D’autres flûtes et d’autres cris de deuil.
Linos et Pan ; Daphnis et Orphée 338
Linos et le cri originel du deuil 338
Pan et la plainte funèbre de la flûte bucolique 343
Orphée et Daphnis :
deuil universel pour la mort d’un poète 353
Le chant du manque et de l’absence : Orphée 362
Allégories de l’élégie en pleureuse. La tradition tragique 368
Euripide et Boileau : l’Élégie, petite sœur de la Tragédie 368
Aragon et la constellation de l’Élégie 375
Les « Nuits tourmentées », les « Plaintes »
et les « monts de la Douleur première » :
la mythologie élégiaque de Rilke 378
Allégories de l’élégie en amoureuse. La tradition ovidienne 389
Des éléments issus de la tradition amoureuse
dans l’allégorie rilkéenne : perméabilité des frontières
entre élégie de deuil et élégie d’amour 390
Des malicieux renversements d’Ovide, … 394
… de l’embarras de Boileau,… 400
… à l’imposture de Chénier 403
Les « cheveux épars » de l’Élégie française :
deuil tragique ou tendre et douce séduction ? 409
Allégories jouant des deux thèmes.
Puissance érotique et morbide de l’élégie au xxe siècle 418
La Dame aux Camélias, l’Élégie et la Mort :
Ouránis et Baudelaire 420
L’« Élégie terrible » au Tombeau d’Orphée :
moissonneuse du souvenir 427
Conclusion 436
Sensibilités élégiaques modernes
Des conceptions complexes et ambiguës de l’élégie 441
Coexistence et métissage des deux conceptions de l’élégie 443
Deux modes clairement distincts à la Renaissance
et à l’époque classique 444
Le métissage de l’amour et de la perte :
une nouvelle voie pour l’élégie amoureuse 451
L’élégie et le romantisme.
La passion mystique de la mélancolie et de la mort 468
Le règne de la mélancolie et de la poésie sépulcrale 470
Élégie et Mélancolie : deux sœurs jumelles ? 480
1189Élargissements romantiques :
vague et mélancolique rêverie
ou grande méditation métaphysique ? 493
Élégies (romaines), 1795-1996.
Légère élégie érotique ou mélancolique élégie amoureuse ? 505
Les Élégies romaines contre l’Élégie de Marienbad 505
Elegie romane (1892) :
l’acte de décès de la légère élégie érotique ? 510
Élégies érotiques françaises (1893, 1996) :
persistance de l’élégie légère « à la romaine » 514
La modernité baudelairienne contre l’élégie.
Quelle place occupe l’élégie
dans le « procès fait par la modernité au lyrisme » ? 527
Le divorce de la poésie et du lyrisme élégiaco-romantique
aux abords du xxe siècle 530
Baudelaire et Leconte de Lisle :
les féminines et impudiques « fibres du cœur » 537
Le rejet du lyrisme élégiaque :
du xixe siècle au xxe siècle 553
Conclusion 559
TROISIÈME PARTIE
DE L’IDENTITÉ FORMELLE DE L’ÉLÉGIE
AU XXe SIÈCLE
Boiterie ou fluidité ?
Formes anciennes et modernes 567
Quelques mots sur la forme antique de l’élégie 571
Le pied bot de l’élégie : un rythme « mixte » et heurté 571
L’envol du rossignol :
fluidité et liberté de l’improvisation 575
Bref panorama des tendances formelles modernes
avant le xxe siècle 580
Réinventer un rythme inégal
en jouant sur la longueur des vers 581
Adaptation du distique élégiaque antique
en allemand et en italien 584
Vers l’abandon du distique :
pour un « style coulant, & non scabreux » 588
Reconnaître une élégie à sa forme au xxe siècle
Permanence, retour, transformations du distique 599
Permanence et opposabilité du distique comme indice formel d’identification de l’élégie au xxe siècle 603
Existence et variété du distique « élégiaque » au xxe siècle 612
L’héritage des métriques « barbares » italienne
et allemande : créer de nouveaux distiques,
rester fidèle aux rythmes antiques 612
Le distique isosyllabique :
les vers longs au service du lyrisme élégiaque 625
Autres distiques : alternances régulières,
vers irréguliers, ambigus et libres 648
D’autres alternances
pour évoquer l’antique disposition des vers 661
Élégies strophiques hétérométriques
à alternances régulières 661
Des alternances pour l’œil seulement 676
Conclusion 680
Silences et « outrances », discontinuités et fluidités
dans la longue élégie de forme libre 685
Reconnaître une élégie sans l’aide du distique
ni des alternances métriques ? 688
Une autre identité formellement marquée de l’élégie :
l’élégie funèbre et strophique « à l’anglaise » 689
La longue élégie en vers isométriques auxxe siècle :
mesures et démesures 697
Élargissement du souffle et fluidité
dans l’élégie du xxe siècle 704
Le « mouvement escaladant de la parole » 705
Élargissement de l’unité métrico-sémantique élégiaque :
la « continuité du lyrisme » dans une élégie
de plus en plus ample et libre 715
L’identité formelle de l’élégie s’est-elle perdue
ou diluée dans la prose ? 722
« L’air entre dans le poème ». Discontinuités et silences
dans la longue élégie de forme libre 734
L’élégie trouée d’air : distiques, amplifications et silences 735
L’élégie « extrême contemporaine » :
ni vers ni prose, mais l’éclatement de la parole élégiaque
chez Dominique Fourcade et Emmanuel Hocquard 746
Caractères et modernité
de la forme de l’élégie au xxe siècle 773
Conclusion. Des œuvres appartenant à d’autres genres
et obéissant à d’autres règles formelles
peuvent-elles être considérées comme élégies ? 779
Limites et relativité de l’identité formelle élégiaque 785
L’élégie brève et concise. Hors des traditions formelles ? 787
Des épigrammes élégiaques parmi les élégies :
elegidia amoureux et funèbres 787
Des vers longs dans l’élégie brève et de forme « fixe » 794
Des recueils d’elegidia sous le titre Élégies :
Bertolt Brecht et Eugène Guillevic,
deux façons d’écrire l’élégie brève en vers brefs 802
Opposabilité de la forme élégiaque au sein d’une œuvre 814
Unité formelle au sein du recueil d’Élégies ? 814
Opposabilité des formes élégiaques
au sein de l’œuvre d’un même poète 819
L’Élégie singulière composée hors du cadre du recueil 830
Le livre de poèmes intitulé Élégie au singulier 839
Conclusion 851
1192QUATRIÈME PARTIE
POSTURES ÉLÉGIAQUES AU XXe SIÈCLE
Vers quels inaccessibles l’élégie
tend-elle au xxe siècle ? 857
L’« Ailleurs » et l’« Autre ». Expérimenter, mesurer,
formuler l’impossible et l’infranchissable distance 861
Le « Tu » infiniment désiré de l’élégie au xxe siècle.
Amour et deuil 867
Différents « tu » dans l’élégie 867
Le « Tu » aimé et manquant de l’élégie de deuil,
ou élégie du noir 880
Quand « tu » désiré est promesse d’une plénitude future 912
« Changer en hymne l’élégie » :
Senghor et Jouve, élégiaques « majeurs » 925
Élégies sans « tu ».
Élégies métaphysiques et élégies des objets 938
Élégies métaphysiques : trouver un passage vers la vérité,
s’engouffrer dans l’ouverture infinie de la mort –
les Élégies de Duino et les Élégies d’Oxópetra 939
Élégies des objets : portrait du poète élégiaque
en « enquêteur » dans les Élégies d’Emmanuel Hocquard 972
Conclusion 986
Les « Je » de l’élégie au xxe siècle
Pudeur, évanescence, réaffirmation 991
Pudeur.
Contenir le besoin d’écrire « je », contenir l’épanchement 993
L’effacement des marques grammaticales
de la première personne 994
Les masques du « je » élégiaque et la division du « moi » 1001
Évanescence et réaffirmation.
Le « moi suspendu » mais présent 1013
1193Refus puis adhésion
chez Rilke, Esteban, Elýtis et Grosjean 1014
La tentation de la disparition de « je » au sein du monde :
Grosjean et Montale contre Jammes 1019
Pleine réaffirmation du « je » élégiaque
et francs épanchements dans l’élégie du xxe siècle :
les Élégies majeures de Senghor 1036
Intimité, singularité du discours élégiaque.
Du thrène et de l’élégie au xxe siècle 1042
Conclusion 1053
Conclusion 1055
L’élégie ne se confond ni avec l’élégiaque
ni avec l’élégie romantique 1056
La variété et la complexité irréductibles de l’élégie 1058
Pour une définition de l’élégie 1059
Les particularités de l’élégie du xxe siècle 1061
La portée méditative et philosophique
de l’élégie du xxe siècle 1067
Annexe 1071
Titre Élégie au singulier 1071
Titre Élégies au pluriel 1102
Bibliographie 1131
Index des noms d’auteurs et d’artistes 1169