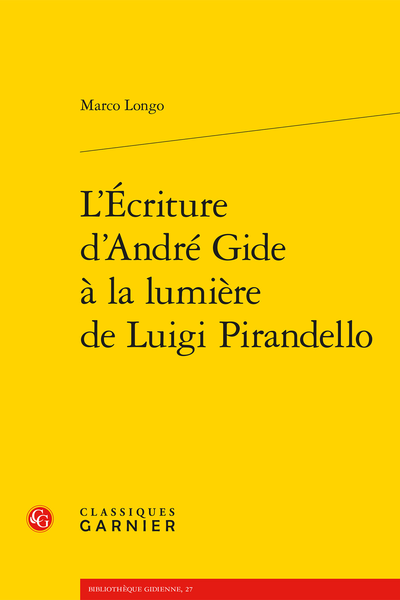
Table des matières
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : L’Écriture d’André Gide à la lumière de Luigi Pirandello
- Pages : 577 à 581
- Collection : Bibliothèque gidienne, n° 27
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406159124
- ISBN : 978-2-406-15912-4
- ISSN : 2494-4890
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15912-4.p.0577
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 28/02/2024
- Langue : Français
Table des matières
Abréviations 9
Avertissement 11
Introduction 13
Première partie
Les différents points de rencontre
entre Gide et Pirandello
L’Italie, terre d’élection et banc d’essai pour Gide 33
Points de rencontre, moments d’échanges ? 33
Sur les traces des deux écrivains 41
Les premiers indices d’une « connaissance » 43
Milieux culturels italiens en commun 46
Les revues florentines 47
Florence et les Italiens, D’Annunzio,
Papini, Vannicola, Ferrero 53
Gide en Italie… 68
… jusqu’à la Première Guerre mondiale 69
… pendant les années vingt 71
… les années trente et après 76
La France, terre d’accueil
et de succès pour Pirandello 81
Pirandello en France 81
578Les premières étapes de la réception française 83
… à travers des articles et des amis :
Orvieto, Cena, Aleramo, Mortier 83
… à travers les romans 93
… à travers les premières traductions des nouvelles 94
La renommée et le déclin 96
… à travers les traductions et la promotion
de Crémieux et Comnène 96
… à travers les différentes mises en scène :
Dullin, Pitoëff et les autres 100
… à travers les œuvres de critique et de réflexion
sur la littérature italienne : Dornis et Crémieux 109
Le rôle de LaNRF 116
France-Italie : une diplomatie mondaine
et intellectuelle 119
De quelques autres amitiés
et connaissances en commun 119
De la diplomatie aux planches :
Philippe et Hélène Berthelot, Marie Kalff
et Henri-René Lenormand 121
Le beau monde parisien au féminin :
Colette, Madame Aurel, Lucie Delarue-Mardrus 124
Les amis « ennemis » : Régnier et Du Bos 126
Chaumeix, Jaloux et les maisons d’édition 129
Les admirateurs : Maurois, Prezzolini,
Romains, Ghéon 131
Les historiens : Gillet, Nolhac et l’ombre de Dante 134
Quelques liens supplémentaires
entre Gide et Pirandello 144
L’ami romain de Larbaud : Puccini 144
Le Tout-Paris : l’abbé Mugnier et les salons parisiens 146
Le belliqueux : Ungaretti 149
La révélation : Masino 151
Quelques conclusions au sujet de ces points
de rencontre et de convergence 155
Deuxième partie
L’humorisme et ses sources
Lectures et influences communes
Une même perception de la comédie de la vie 169
L’humorisme, les passeurs 169
Don Quichotte entre Cervantès et Unamuno :
du sentiment tragique de la vie à la folie 171
Dostoïevski, Bourget et Barrès,
en quête d’une nouvelle idée de roman :
entre esthétique et politique 177
Ombres et pantins 191
Lasca et Chamisso, médiateurs
de l’inconséquence et du saugrenu 191
La passion des marionnettes. Le monde allemand :
de la farce transcendantale à la sotie 196
Des réflexions sur la comédie de la vie 213
Dramaturges, moralistes, humoristes.
De la comédie de la vie à la mise en abyme 213
La sagesse des Anciens : Montaigne et Pascal.
L’essence, le masque, le temps 220
Jeu de fantoches et seconde réalité.
Sources de la farce et de la sotie 225
Le bouleversement carnavalesque.
Stratégies et expérimentations de l’écrivain humoriste 231
Une preuve théâtrale : sur une scène de Saül 234
L’accoutrement des sots et la nudité des personnages 236
Le monde belge et la farce tragique de la jalousie 241
Nordau, Séailles, Binet, Lombroso, Tarde, Durkheim.
De la dégénérescence à l’éloge de la « maladie » 249
La maladie comme condition humaine 249
Le scandaleux criminel économique 252
580La maladie comme action hors de la norme 255
Criminologues, criminels et boucs émissaires 259
Le « théâtre » de l’acte gratuit 264
Defouqueblize (pirandellien) meneur de jeu 267
La folie au foyer 272
Anatole France et Henri Bergson.
La forme et le rire 277
Quelques réflexions sur la comédie de la vie
chez Pirandello et chez Gide 288
Troisième partie
L’écriture gidienne
à la loupe pirandellienne
Pistes de lectures intertextuelles
L’humorisme gidien 295
À l’origine… la perception d’une dysharmonie 295
La décomposition et le « sentiment du contraire ».
Les « vieillesses déshonorantes »
dans Ainsi soit-il ou Les Jeux sont faits 304
L’ « engrenage infernal » du cadre bien fait.
L ’ Art bitraire 311
Le lucide raisonneur désillusionné. Le Grincheux 315
Conversation avec un Allemand
comme « entretien avec un personnage » 328
La « mise en scène » au fil des œuvres gidiennes
Personnages et valeurs 333
Les personnages « décentralisés » 333
Le carnaval névrotique de la mise en abyme 336
La Pérouse, figure éminemment « pirandellienne » 344
Les personnages martyrisés
devant la cour d’assises gidienne 358
La quête d’un auteur et l’évolution
des héros et des héroïnes gidiens 360
Une hantise : « l’homme entre deux femmes » 365
La famille, le couple et le contrat social :
le chantage du « nœud coulant » 372
Figures de femmes : sœurs, mères… 387
… saintes et adultères… 402
… suicidées et immolées… 406
… hystériques et émancipées 410
La bonne et la mauvaise foi.
Les antidotes au mensonge 427
Armand, ou la conscience d’être personnage 430
Les trompeuses bonnes raisons 434
Le masque et le travestissement des « crustacés » :
barbiers, défauts physiques et intervention divine 437
Lafcadio et Mathias Pascal, frères meurtriers.
Michel, un prototype ? 445
La « mise en scène » au fil des œuvres gidiennes
Décors et significations 457
Les lieux de l’action 457
Les bibliothèques 459
Les « chambres de torture » 462
De l’enclos au dehors : jardins, gares et trains 464
La ville de Rome : vices et vertus de la sainteté 469
Réflexions finales sur la dimension
pirandellienne de l’œuvre gidienne 493
Conclusion 495
Remerciements 511
Bibliographie 513
Index des noms 561