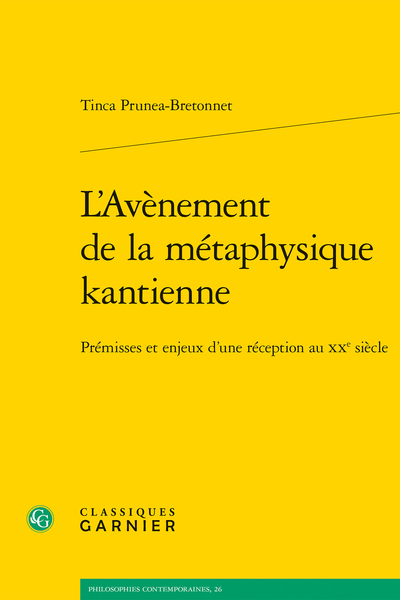
Pourquoi 1924 ?
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : L’Avènement de la métaphysique kantienne. Prémisses et enjeux d’une réception au xxe siècle
- Pages : 27 à 29
- Collection : Philosophies contemporaines, n° 26
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406148180
- ISBN : 978-2-406-14818-0
- ISSN : 2427-8092
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14818-0.p.0027
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 09/08/2023
- Langue : Français
Pourquoi 1924 ?
Les représentants de l’interprétation métaphysique de Kant annoncent en 1924 une rupture radicale avec la lecture positiviste, qui proposait une compréhension de la pensée critique comme épistémologie scientiste, à l’exclusion de – ou au moins en ignorant – toute dimension métaphysique et historique. Il s’agira désormais de « revisiter » les exégèses kantiennes reçues, ainsi que d’opérer un retour aux écrits de Kant lui-même, manuscrits ou publiés de son vivant, au sein d’une « renaissance de la métaphysique1 ». Cette renaissance, non seulement rendra possible une nouvelle lecture de la philosophie critique et, plus généralement, des Lumières allemandes, mais se verra nourrie et éclairée en retour par le texte kantien – comme en témoignent, entre autres, les œuvres consacrées à l’ontologie par N. Hartmann et à la métaphysique par M. Heidegger. Cette renaissance de la métaphysique passe donc par une redécouverte de Kant.
La question que l’on pourrait légitimement se poser est : pourquoi 1924 ? Qu’est-ce qui a rendu possible à ce moment précis la naissance d’un tel mouvement – nous parlons bien d’un mouvement de pensée, car des lectures métaphysiques de Kant ont existé auparavant –, sa force de conviction, son succès dans le monde kantien et, finalement, cette unité de perspective dont il a joui pendant plus d’un demi-siècle ? Certains interprètes en parlent comme d’une sorte d’« avènement », d’un changement brusque et inexplicable survenu après la Première Guerre mondiale. Ainsi, de Vleeschauwer décrit en 1954 ce qu’il nomme « la grande césure dans la réception de Kant par la postérité » en des termes qui dévoilent autant l’admiration que l’étonnement :
Vers la fin de la première guerre mondiale et pour des raisons qui sont encore insuffisamment établies, le climat spirituel se retourna complètement. La renaissance de la métaphysique, voire même de l’ontologie s’annonça avec 28fracas. […][Plusieurs articles] ont créé instantanément dans les milieux les plus différents un climat sympathique pour une conception plus nuancée et plus complète du criticisme (De Vleeschauwer, 1954, p. 355-356).
Quelles sont en effet ces raisons encore « insuffisamment établies » ? Dans ce qui suit, nous nous proposons d’offrir des éléments de réponse.
L’on a avancé2 différentes hypothèses pour expliquer ce « revirement » des années 1920, dont trois méritent d’être mentionnées. Il s’agit d’abord de la crise, et de la prise de conscience conséquente, engendrées par la Première Guerre mondiale. La confiance dans la raison s’en sort profondément ébranlée et la question du sens – de la vie, de la pensée, de l’homme – se pose avec une nouvelle et douloureuse acuité. Kant est désormais interrogé à partir de ces deux problèmes essentiels, les exégètes tentant de parcourir le domaine de la raison à sa suite, pour en tracer à nouveau les frontières, en assurer les principes et retrouver ainsi la confiance perdue. Leur lecture de Kant porte l’empreinte de cette approche : un des textes fondateurs a justement le titre emblématique de « Persönlichkeitsbewusstsein und Ding an sich in der Kantischen Philosophie » (« Conscience de la personnalité et chose en soi dans la philosophie kantienne »)3.
Ensuite, la force inouïe avec laquelle ressurgit la question de la théorie de l’être chez Kant est sans doute aussi une réaction à l’indifférence souveraine dont le néokantisme a fait preuve à son égard. Si l’on définit l’être comme être-pensé, alors les principes de la connaissance deviennent aussi – et peut-être en premier lieu – des principes ontologiques de l’objet et de l’objectité. Ce qui ouvre la possibilité d’une relecture métaphysique.
Enfin, les exégètes acquièrent une conscience de plus en plus aiguë du fait que Kant n’est pas seulement le penseur de la « révolution copernicienne », mais appartient à un contexte philosophique précis et à une histoire de la pensée ; voire, que sa philosophie n’est pas un « bloc » critique donné comme tel mais, au contraire, parcourt un cheminement, se cherche, évolue, subit des influences. L’on commence ainsi à s’intéresser aux prédécesseurs et contemporains de Kant et à se pencher avec une curiosité croissante sur les débats de l’époque, en découvrant que Kant y est profondément impliqué. Et l’on se rend compte que nombre de 29concepts-clés et de problèmes critiques ne peuvent être compris d’une manière satisfaisante que si l’on intègre Kant dans une continuité de pensée. Nous verrons cette hypothèse se vérifier dans les recherches sur le concept de transcendantal, chez H. Pichler par exemple. En effet, l’approche historisante se confirmera dans les années 1920 et se retrouvera renforcée dans les interprétations métaphysiques.
Bien que valables, ces trois arguments ne sauraient pourtant, à notre avis, rendre compte à eux seuls, ni même en premier lieu, de cette nouvelle orientation de l’exégèse vers une perspective métaphysique. Plus décisif et plus fondamental encore nous paraît le rôle joué par la recherche philologique qui, dans les années 1880-1890, apporta une contribution cruciale aux études kantiennes, dont l’influence se fera sentir pendant plusieurs décennies. Ce rôle est intimement lié à des controverses engendrées par l’étude du Nachlaß kantien et qui, en retour, ont encouragé l’analyse approfondie des manuscrits. C’est la thèse que nous souhaitons avancer et argumenter dans la première partie de notre ouvrage. Ce sont d’ailleurs ces débats qui ont, entre autres, attiré l’attention sur le contexte historique de l’élaboration de la philosophie de Kant, ainsi que sur son inscription dans les Lumières allemandes. En effet, les dernières décennies du xixe siècle se caractérisent par un intense travail philologique, sans équivalent jusqu’alors. Nous nous pencherons sur deux éditions des manuscrits kantiens, l’une très solide et académique, les Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie par Benno Erdmann (Leipzig, 1882-1884), et l’autre plus controversée, mais très influente, Immanuel Kants Vorlesungen über Psychologie par Carl du Prel (Leipzig, 1889).