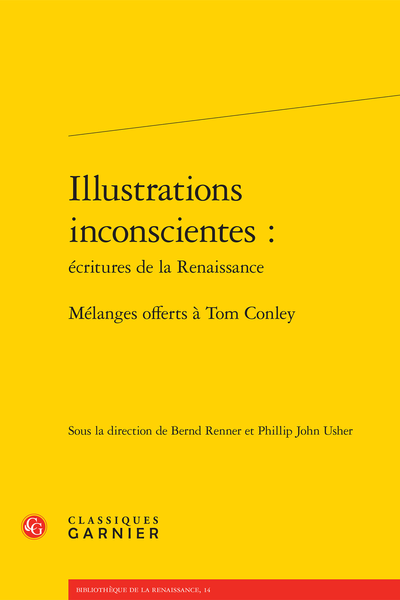
Avant-propos
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Illustrations inconscientes : écritures de la Renaissance. Mélanges offerts à Tom Conley
- Auteurs : Renner (Bernd), Usher (Phillip John)
- Pages : 9 à 11
- Collection : Bibliothèque de la Renaissance, n° 14
- Série : 2
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782812425974
- ISBN : 978-2-8124-2597-4
- ISSN : 2114-1223
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2597-4.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 31/07/2014
- Langue : Français
AVANT-PROPOS
Les travaux qu’a consacrés Tom Conley à la littérature française du xvie siècle ont profondément marqué les études seiziémistes en nous rappelant la nécessité de lire autrement, de lire un peu à la manière du narrateur du Songe de Poliphile dont les « bras feissent l’office de [ses] yeux » et qui avance en « tastonnant atrauers ces destours aueglez1 ». Autant que Michel de Certeau, qu’il a traduit, Conley est à cheval sur deux continents. Son parcours professoral a été jalonné de périodes d’enseignement dans les institutions les plus prestigieuses d’Amérique du Nord et d’Europe, inter alia l’Université de Minnesota, l’Université de Californie à Berkeley, Miami University (Ohio), le Graduate Center à l’Université de la Ville de New York (CUNY), l’Université de Californie à Los Angeles, l’Université Harvard, l’EHESS, l’Ecole des Chartes… Promu chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en 2001 et en plus de s’être vu titulaire des bourses de recherche les plus importantes (John Simon Guggenheim Fellowship), Conley a reçu des distinctions trop nombreuses à énumérer : la ville de Tours lui a décerné la Médaille d’honneur en 1990, l’Université Blaise-Pascal l’a nommé, en 2011, docteur honoris causa, etc. Ce voyage sans fin entre les deux continents est au cœur des travaux de ce chercheur au « profil inhabituel » et la modernité de ceux-ci viendrait, suggère Marie-Claire Ropars dans la préface qu’elle a écrite pour l’édition française de L’Inconscient graphique : Essai sur l’écriture de la Renaissance2, « sans aucun doute de France ».
En effet, les articles et les livres de Conley se sont écrits – et se lisent – dans un va-et-vient entre les méthodologies des deux continents. Ils se sont nourris de films américains et de théoriciens français, de Raoul Walsh et de Ronsard, de cinéma et de cartographie. Il s’agit là d’une « vue oblique », extrêmement fructueuse, qui renouvelle
l’étude des lettres françaises du seizième siècle, mot à comprendre dans son acception la plus large, car Conley s’intéresse à toutes les formes d’expression artistique (la littérature, l’architecture, la typographie, la cartographie, etc.) et aussi à la forme même des signes sur la page ou sur la carte. Cette approche novatrice se manifeste dans la combinaison d’une érudition étonnante, d’une fine connaissance de la culture renaissante ainsi que d’une maîtrise de l’appareil critique moderne et postmoderne auquel il a lui-même fortement contribué. Le tout, sans succomber aux dangers de l’anachronisme. La modernité de Conley ne trahit ainsi jamais « l’essence » du seizième siècle, n’en déplaise à certains critiques traditionnalistes, mais la révèle sous un jour nouveau grâce à de multiples rencontres et métissages. L’approche conleyenne nous semble être une approche prometteuse pour mieux cerner les enjeux d’une période qui prisait justement la bigarrure, où les distinctions entre formes et genres littéraires ou bien, plus généralement, entre catégories du savoir humain étaient loin d’être aussi nettes qu’aujourd’hui. C’est bien un véritable « abysme de science », concept tant prisé par Rabelais, et caractérisé par des avances, voire des bouleversements radicaux dans tous les domaines, et c’est sans doute là où la Renaissance semble bien plus proche de notre ère qu’elle n’en a l’air au premier abord, rapprochement qui se reflète de manière exemplaire dans des études novatrices telles The Graphic Unconscious, The Self-Made Map et An Errant Eye.
Tom Conley occupe une place unique dans le monde universitaire et ce des deux côtés de l’Atlantique. Étant donné le profil inhabituel du dédicataire de ces Mélanges, dont les chapitres se veulent autant d’« illustrations » et de témoignages d’amitiés, il n’est guère surprenant que les travaux de Conley dépassent de loin les études seiziémistes pour inclure notamment des études importantes sur le cinéma et la théorie littéraire ainsi que des traductions anglaises de différents penseurs et auteurs (Gilles Deleuze, Réda Bensmaia, Christian Jacob, Marc Augé, Louis Marin, etc.). Ce volume aurait donc pu compter beaucoup plus de chapitres traitant de nombreux autres sujets. Nous avons néanmoins choisi de nous concentrer sur le seizième siècle parce que la Renaissance constitue pour Conley une sorte de « premier amour » depuis les années estudiantines passées aux universités de Columbia et de Wisconsin, passion qui préside d’une manière ou d’une autre à toutes les autres. Que ce soit dans les contributions d’anciens étudiants, dont nous avons réuni une bonne demi-douzaine, ou bien
dans celles d’illustres collègues, « l’école conleyenne » se fait ressentir, consciemment ou inconsciemment, tout au long de ces pages que nous sommes honorés de lui offrir.
Bernd Renner
et Phillip John Usher