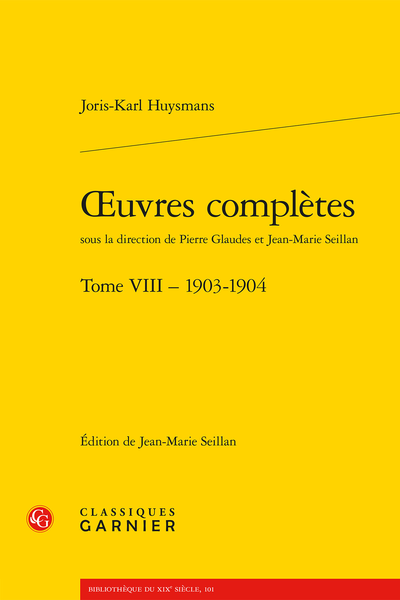
Préface aux Poésies religieuses de Paul Verlaine
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome VIII – 1903-1904
- Pages : 829 à 841
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 101
- Série : Huysmans, n° 7
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782406132738
- ISBN : 978-2-406-13273-8
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13273-8.p.0829
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/11/2022
- Langue : Français
Préface aux Poésies religieuses
de Paul Verlaine
Notice
GENÈSE
La mort de Verlaine, survenue le 8 janvier 1896, touche profondément Huysmans. Attristé par l’indifférence de la presse religieuse envers le poète, il remercie l’abbé Moeller d’avoir fait dire une messe, à Bruxelles, pour le repos de l’âme du poète : « C’était vraiment très bien votre service pour Verlaine et c’est une bonne leçon pour les catholiques si peu charitables, d’habitude. Dans ce monde-là, ici ç’a été une douce stupeur. Au fait, que peuvent comprendre des journaux comme l’Univers et la Vérité. Ils détiennent la Religion, et hors d’eux, il n’est pas de salut. » (Ms Lambert 65, fo 71). Pour autant, l’idée de rendre hommage au poète disparu en publiant une anthologie de ses poésies religieuses ne revient pas à Huysmans. C’est le père Jules Pacheu, de la Compagnie de Jésus, qui la lui a soufflée. Il lui répond, moins d’un mois après la mort du poète :
Je trouve votre idée d’un Selectæ mystique de Verlaine très bonne. Je suis en excellents termes avec Vanier, et ferai de ce côté ce qui vous plaira ; si vous désirez que je vous abouche avec lui, rien ne sera plus facile.
Que vous avez raison de défendre Verlaine ! Sagesse est le seul volume d’art catholique qui existe réellement ; il faudrait le magnifier, sans toujours jeter à la tête de ce pauvre homme les malpropretés de sa vie. Puis, qui sait s’il n’y aura pas pour le bon chantre de Notre Seigneur des miséricordes infinies, Là-Haut ? Qui sait aussi si, après Sagesse, alors qu’il vivait encore en Dieu, les catholiques, ravis d’une telle aubaine, lui avaient ouvert les bras, s’il aurait sombré dans la basse crapule des gens qui l’entouraient ?
830Il reste, en tout cas, à le plaindre et à prier pour lui. (Lettre du 5 février 1896, Ms Lambert 65, fo 186).
Peu après, Huysmans fait le récit de sa rencontre avec le poète, dans une longue lettre adressée au peintre Frédéric-Auguste Cazals, qui en fera la préface du volume intitulé Paul Verlaine, ses portraits, publié la même année chez Clerget :
Il était, autant que je puis me rappeler, rentré depuis peu en France. Un ami commun, le bon Robert Caze, nous avait réuni[s] dans son logement de la rue Rodier. Bien peu d’écrivains connaissaient alors Sagesse, qui avait été si soigneusement enfouie dans le placard d’une librairie catholique. Ce fut, je crois bien, pour son auteur, un peu de légitime joie lorsqu’il nous entendit, tous les deux, lui en parler avec une admiration qu’il sentait n’être point feinte, et il se débrida, sortit tout cet affectueux côté d’enfant et de brave homme qui était en lui. (Lettre du 29 février 1896, Ms Lambert 45, fo 247).
Mais Huysmans n’éprouve pas seulement de l’amitié pour le poète : il a de sa poésie une haute idée et l’exprime dans une autre lettre au père Pacheu, lorsque ce dernier projette de publier des Études d’idéalistes et de mystiques sous le titre De Dante à Huysmans. Il lui suggère de préférer De Dante à Verlaine : « Le titre que vous annoncez ne me semble pas bon ; puis, sans modestie fausse, en mon âme et conscience, je pense que Verlaine a été, dans ses vers, très supérieur à ce que je puis être en prose ». (Lettre du 26 décembre 1896, Ms Lambert 65, fo 188).
Avec l’installation à Ligugé, le projet d’anthologie entre en sommeil. Il ne renaît qu’en 1903, lorsque Huysmans le présente, sur un ton à la fois apitoyé et élogieux, dans une longue interview publiée dans La Presse, le 22 décembre 1903 :
Ce pauvre Verlaine, je l’ai beaucoup connu et très peu fréquenté. Dans les derniers temps de sa vie, vous vous souvenez, il s’était mis à boire ; il était dénué de toutes ressources.
La poésie a rarement enrichi son homme : il vivait en garnis et buvait. Et il a fallu qu’il fût mis en prison pour qu’il se convertisse et qu’il publie ces poèmes admirables : Sagesse, Bonheur, Amour, Liturgie intime[sic], les plus beaux vers, à coup sûr, que l’on trouve dans toute son œuvre. Ce sont ces poèmes que l’éditeur de Verlaine a réunis et pour lesquels il m’a parlé de faire une préface.
Je n’ai pas cherché à nier la vie dissolue de Verlaine, mais comme ce recueil est surtout destiné à un public sérieux que le nom de Verlaine éloignait, j’ai cherché à excuser sa vie, voulant abattre la barrière qui sépare le “pauvre 831Lélian” à la vie heurtée et si mouvementée, des gens aux mœurs régulières qui doivent le lire et qui l’admireront, j’en suis sûr.
Il n’y a rien de semblable dans toute la littérature française, depuis les poèmes de Villon, aux pièces incomparables que renferment Sagesse, Amour. Car on ne peut juger littéraires ces “salopailleries”, ces sous-cantiques, que l’on publie de nos jours comme poèmes religieux. (Interviews, op. cit., p. 405-406).
Cette déclaration invite les lecteurs à croire que l’initiative de la publication et la sélection des poèmes sont le fait de l’éditeur Messein, ce qui n’est pas le cas, et que Huysmans, à en juger par la sérénité de son propos, n’appréhende aucune réaction hostile de la part des catholiques « aux mœurs régulières ». Il n’en est rien, évidemment. Une lettre adressée la semaine précédente à Léon Leclaire confirme qu’il a sélectionné lui-même les poèmes de Verlaine et obéi à des arrière-pensées polémiques :
Je suis en train de faire un travail qui me plaît fort. Je fais un volume de toutes les poésies religieuses de Verlaine – le plus bel eucologe de prières rimées qui aura paru depuis le Moyen Âge – et je les précède d’une préface aux catholiques. Ils y auront quelques idées à rebrousse-poil, amusantes. / Je pense que ça paraîtra dans les débuts de l’année prochaine ; chez l’éditeur de Verlaine, Vanier, qui me l’a demandé. (Lettre du 15 décembre 1903, Ms Lambert 60, fo 289).
Car l’oblature n’a pas changé Huysmans. Le plaisir qu’il a toujours pris à la provocation, il l’avoue sans ambages dans une lettre à Adolphe Berthet en date du 30 décembre 1903 : « J’essaie d’y défendre la vie du pauvre homme et d’expliquer qu’elle ne pouvait être autre. Il y aura, je crois, quelques idées sur le talent, fruit du péché, qui feront un brin gueuler les catholiques – mais il est juste, il est salutaire que de temps en temps, je les fasse braire. » (Ms Lambert 67, fo 102). La presse religieuse ne le décevra pas.
Réception
Sans susciter pléthore d’articles, cette préface, qui paraît au mois d’avril 1904, ne passe pas inaperçue. D’abord parce que la critique, qui vient à peine d’en finir avec L’Oblat, l’associe à celle d’À rebours ; ensuite parce qu’elle bénéficie de la controverse politico-littéraire provoquée par 832le refus opposé par la ville de Metz – ville allemande depuis 1871 – à l’apposition d’une plaque commémorative sur la maison de naissance du poète. « L’affaire de Metz pour Verlaine – confie Huysmans à l’éditeur Messein, le 15 avril 1904 – est bonne pour le lancement du livre. Ça fait des articles ! » (Ms Lambert 50, fo 201). De fait, ce refus déclenche une polémique, qu’illustrent, par exemple, l’article « Pour Verlaine », publié le 7 avril 1904 par le poète Fernand Gregh à la une du Figaro et la réplique du professeur de rhétorique Charles Formentin contre ceux qu’il appelle les « Verlainiens » et qui admirent, prétend-il, le poète « à plat-ventre ». Mais si ce débat bénéficie à Huysmans, il reste étranger à l’accueil réservé à sa préface par la presse catholique.
Les comptes rendus qu’il recueille confirment pour une part ses prévisions. « Le volume Verlaine – écrit-il à Leclaire le 20 avril – déchaîne d’aimables fureurs ; ah ! mais non, les catholiques n’en veulent pas du tout de Verlaine ; le fait est qu’en tant que poésie les cantiques leur suffisent ! » (Ms Lambert 60, fo 302). Avant d’ajouter le 29 : « J’ai pour l’instant, la presse sur le dos. La préface d’À rebours jointe à celle du Verlaine, a eu l’heur d’exaspérer les catholiques et ils recommencent la scie de la destruction de mes anciens livres. […] / Ah ! l’imbécillité, le bouchage d’esprit de ce monde-là. C’est le Correspondant et le Gaulois qui ont mis le feu aux poudres. / L’idée d’ailleurs que Verlaine était un grand poète, le seul poète catholique, les met hors d’eux. Ils en reviennent toujours d’ailleurs à ce qu’il était ivrogne et sodomite ! – Ils sont donc bien purs, ces gens si pris toujours à condamner les autres. » (ibid.) À l’abbé Moeller, il résume la situation, le 10 mai :
Il n’y a rien à faire. Cette dernière tentative le prouve. Les librairies catholiques ont refusé de prendre le livre ! ! Elles ont répondu à l’éditeur : On nous a prescrit de ne pas le vendre. Qui : On ? (Ms Lambert 65, fo 168).
Le livre a-t-il été victime d’une censure inavouée ? Nous l’ignorons. Ce qui paraît sûr, c’est que, parmi les recensions défavorables à Verlaine et à son préfacier, l’article décisif a été celui qu’a publié Édouard Trogan dans sa chronique « Les Œuvres et les hommes » du Correspondant, le 25 avril 1904, aux p. 366-370. Liant les deux préfaces, Trogan met d’abord en cause celle d’À rebours, en se demandant « si l’utilité psychologique ou mystique de contempler la marche de la grâce dans une âme […] vaut le danger que de tels livres peuvent faire courir à d’autres 833âmes très nombreuses ». Après quoi, il s’en prend au préfacier des Poésies religieuses. « De ce que Verlaine a écrit des vers de dévotion simple, de frais mysticisme, d’émotion balbutiante, d’amour repentant, cela ne suffit peut-être pas à nous obliger, en conscience, à reconnaître en lui “une âme prédestinée, une âme d’élection”, à qui Jésus “avait départi le don superbe de la poésie” ; et pas davantage “le plus grand poète dont puisse s’enorgueillir l’église depuis le Moyen Âge”. Ce sont là des hyperboles excessives où, dans son zèle de défenseur, Huysmans a mis plus d’esprit de revanche que d’esprit de justice. Mais que nous ayons à “profiter de ses péchés, car s’il ne les avait pas commis, il n’aurait point écrit dans les larmes les plus beaux poèmes de repentir et les plus belles suppliques rimées qui existent”, c’est à quoi nous ne saurions souscrire. » Et repassant à l’étamine la sélection faite par Huysmans, il conclut que, « sur 250 pages on en conserve à peu près une centaine : alors nous aurons vraiment un volume tout à fait exquis. » Sur ce sujet, Trogan rejoint La Croix du 7 avril 1904, qui avait signalé dans un entrefilet la parution du livre, avec pour seule appréciation : « M. Huysmans dit que en Verlaine “l’Église a eu le plus grand poète dont elle puisse s’enorgueillir, depuis le Moyen Âge.”. C’est au moins fort exagéré. » Avis docilement partagé, le 23 avril, par La Semaine religieuse de Paris, qui trouve que « c’est peut-être un peu exagéré tout de même », et par Démocratie chrétienne, qui explique que, « malgré la meilleure bonne volonté, il est difficile de croire, comme le prétend Huijmans dans son originale Préface, que “l’Église a eu en Verlaine le plus grand poète dont elle se puisse enorgueillir, depuis le Moyen Âge” ».
Dans une autre revue catholique, Le Mois littéraire et pittoresque, Gabriel Aubray, professeur de rhétorique au collège Stanislas, s’y prend à deux fois pour juger le poète et son préfacier. Intitulée « Les Nouveaux Livres » et parue dans le Supplément à la livraison de janvier 1904, une première recension se contente « d’y trouver parfois des idées trop hardies (p. 143), ou des rythmes trop “bistournés” », et, au lieu de citer la préface de Huysmans, préfère citer celle… de François Coppée, qui avait publié son propre florilège des poésies de Verlaine. Mais G. Aubray revient sur le sujet au mois de juillet en intitulant sa « Causerie littéraire » mensuelle « De la correctionnelle à l’Académie. Toute la lyre ». Sans doute ce catholique militant reconnaît-il in fine la sincérité de Verlaine en admettant que « ce truand, ce dépravé, cet ivrogne, s’est confessé tout 834entier dans ses vers et a exhalé des gémissements qui touchent », mais c’est après avoir réprouvé « les jurons, les saletés, les bégaiements et les vomissements d’ivrogne, […] les incohérences d’un cerveau noyé » qui caractérisaient ce poète « loué à contresens et aux pires endroits », que prônaient « les chienlits de nos saturnales littéraires » (p. 108).
L’accueil de la presse catholique n’a cependant pas toujours la rudesse prévue par Huysmans. Sous le titre « Verlaine, poète chrétien »,l’abbé Ph. Ponsard publie, dans La Quinzaine (16 décembre 1904, p. 536-550), une longue analyse de l’œuvre du poète et, cédant aux arguments du préfacier, finit par écrire : « En sincérité, après avoir lu les Poésies religieuses, le mot de M. Huysmans que nous avons en Verlaine le plus grand poète chrétien ne nous semble plus un paradoxe. Personne n’a mieux senti que Verlaine ce que Chateaubriand appelait le génie du christianisme. » La Revue du clergé français, bimensuel à tendance moderniste destiné aux prêtres, adhère aussi, dans sa livraison du mois d’août, aux convictions de Huysmans sur la sincérité et le génie du poète : elle passe patiemment en revue la littérature française depuis l’âge classique et reconnaît avec lui « que nous n’avons pas à proprement parler de poète catholique français – ou si peu. » (« La Religion de Verlaine », p. 488). Le 25 septembre 1904, Le Sillon, organe d’un catholicisme auquel Huysmans n’a jamais été favorable, lui reconnaît le courage « d’avoir pris soin d’extraire de ses livres [Verlaine] un volume de “Poésies religieuses”, irréprochable de tous points. » Dans Le Bloc catholique de Toulouse, en août 1904, l’historien Édouard Pontal, surmontant ses préventions morales, loue l’œuvre de Verlaine et salue Huysmans pour « sa préface très réussie, pleine de franchise et de finesse, pleine aussi d’indulgence et de pitié pour ce grand pécheur ». C’est aussi l’avis de l’historien de l’art Alphonse Germain qui associe la défense de son ami Huysmans à celle de Verlaine : dans le numéro de Pâques 1904 de la « revue catholique d’avant-garde » Résurrection, il rappelle que « le pauvre Lélian ne fut pas l’impénitent pécheur, le faux converti que l’on a dit dans les milieux catholiques où […] on se défie toujours des artistes » et affirme que sa préface « judicieuse et lumineuse » est une œuvre de justice. Telle est aussi l’opinion d’Oscar Havard qui, prenant la défense du préfacier, écrit, dans Le Nouvelliste de Bordeaux du 14 avril, que Huysmans « venge le barde des reproches injustes que lui adressent d’ignorants détracteurs », et d’un certain Jacques Varages qui fait paraître, dans le Mémorial d’Aix, « journal politique, artistique et littéraire », du 19 mai, un article 835aussi admiratif sur l’œuvre de Verlaine que sur la « préface superbe » que Huysmans lui a dédiée avec « un beau courage ».
En dehors du monde religieux, il est cependant des critiques favorables à l’œuvre de Verlaine qui blâment l’agressivité de son préfacier.C’est ainsi que la revue Le Mouvement scientifique du 10 juillet 1904 applaudit à la publication de cette anthologie et à la volonté de réhabiliter le poète, mais réprimande les « excès de langage » de ce converti qui ose « définir M. Doumic “une atrabilaire ganache” et qualifier de “médicastre” et “d’acariâtre mazette” le Dr Nordau […] qui méritent d’être traités avec plus de lénité et de respect. » Dans le même esprit, Edward Coremans concède, dans la Revue bibliographique belge datée du 30 août, que « la préface […] est intéressante », mais ajoute aussitôt : « nous ne l’aimons cependant pas à raison du ton qui y règne à certains endroits – mélange de négligence et de préciosité d’une part et besoin d’être désagréable de l’autre – et qui semble être la caractéristique de la dernière manière de J.-K. Huysmans. »
Inversement, il en est d’autres qui décrient l’œuvre de Verlaine mais louent son préfacier. Ainsi du Mémorial de la Loire, publié à Saint-Étienne, qui publie le 16 avril une appréciation contrastée sous le titre d’« Eucologe moderne » : il juge que l’anthologie contient « du médiocre, du mauvais, de l’incompréhensible et, qui pis est, de l’insignifiant », mais encense la préface de Huysmans, qui a su mettre en évidence la foi du poète, et rappeler aux catholiques oublieux que « tout est pardonné à la faiblesse qui s’accuse et s’humilie, à l’amour qui se lave dans les larmes de la pénitence et s’épure dans la souffrance. »
Rares sont donc les comptes rendus qui approuvent les deux parties du volume. C’est le cas du recenseur anonyme de L’Action littéraire et artistique qui, après avoir rappelé que le titre du recueil de Huysmans peut passer pour une ironie aux yeux des connaisseurs du poète, avoue, après quelques citations, que ce titre est justifié (mars 1904, p. 87). Ou encore de Léon Daudet qui approuve sans réserve le texte de Huysmans, dont il offre une pesante paraphrase dans un article de Une du Gaulois daté du 7 avril, intitulé « Poésie et religion » : passant en revue les écrivains chrétiens du xixe siècle, il admet que, sans exclure ni Chateaubriand ni Lamartine, « chez aucun comme chez ce vieil étudiant de la fin du siècle, lamentable et honni, pèlerin égaré par l’absinthe, la foi toute pure et toute simple n’eut un langage si impressionnant ». Quant à mesurer l’influence que pourrait exercer sur le public le plaidoyer de 836Huysmans en faveur de l’œuvre de Verlaine, Eugène Ledrain se montre dubitatif dans sa chronique « Le Mouvement littéraire » qui paraît dans L’Illustration du 16 avril 1904 : « Le fort et superbe artiste de : En route réussira-t-il dans son dessein ? Fera-t-il accepter des catholiques le rare poète qui s’est ému devant les autels fleuris de mai et devant les cires pascales allumées ? » (p. 254).
Du côté de la libre pensée, on rejette évidemment l’ensemble du livre. Dans sa livraison de juillet 1904, La Chronique de l’hygiène y voit l’occasion d’engager les parents à surveiller les lectures prématurées de leurs enfants : « Méfiez-vous, quand vous voyez entre les mains de vos enfants, par exemple, du Verlaine, du Huysmans, du Remy de Gourmont, du Willy ; qu’ils attendent 30 ans pour comprendre l’esprit morbide de ces écrivains. Poussez-les aux sciences pratiques (mathématique, mécanique, physique, physique, chimie, sciences naturelles, géographie, hygiène.) ». Quant au quotidien anticlérical L’Action, il laisse la parole à Laurent Tailhade qui signe, le 13 avril, une longue étude intitulée « Le cas Verlaine ». Il y fait un bel éloge, non de ses poésies religieuses mais de ses premiers recueils, en tirant, suivant son usage, une bordée d’invectives contre « les renâclements du hideux Léon Bloy », « les épilogues scurriles de Joris Karl Huysmans », le « si pédant, si lourd, si emphatique José Maria de Heredia », le « gâtisme clérico-militaire de M. Coppée », le « quadrumane de L’Autorité, Paul de Cassagnac » – mais ignore tout de la préface de Huysmans.
Notes
P. 473
1 Préface aux Poésies Religieuses de Paul Verlaine, 1 vol. in-18, Paris, Messein, successeur de Vanier, 1904.
P. 475
1 Après deux années passées dans les prisons de Bruxelles puis de Mons, suivies de longs séjours en Angleterre et en province, Verlaine s’est réinstallé à Paris en 1885, date à laquelle il était en effet oublié des éditeurs et des lecteurs.
2 Les 500 exemplaires de Sagesse parurent à compte d’auteur début décembre 1880 chez Victor Palmé, directeur de la Société générale de Librairie catholique. Palmé n’ayant pas diffusé le recueil, Léon Vanier racheta les invendus stockés dans sa cave en 1888. Amour parut en mars 1888, Bonheur fin avril ou début mai 1891 chez Léon Vanier. Liturgies 837intimes fut publié en souscription dans la Bibliothèque du Saint-Graal en mars 1892, puis repris, grossi de sept pièces nouvelles, chez Vanier en avril 1893.
3 La dénonciation de la Renaissance comme paganisation de la société médiévale est un lieu commun du catholicisme conservateur du xixe siècle.
4 Admiration confirmée dans une lettre de Verlaine à Émile Blémont en date du 25 juin 1873, qui cite une pièce de « Dormeuse », parue dans Pauvres Fleurs en 1839 : « Est-ce assez une chambre d’enfant au berceau, en été ? Tous les vers de cette femme sont pareils, larges, subtils aussi, – mais si vraiment touchants – et un art inouï. » (Correspondance générale de Verlaine, éd. M. Packenham, Paris, Fayard, t. I, p. 329).
P. 476
1 Huysmans se rappelle le chapitre xiv d’À rebours, où il écrivait : « il avait pu exprimer de vagues et délicieuses confidences, à mi-voix, au crépuscule. Seul, il avait pu laisser deviner certains au-delà troublants d’âme, des chuchotements si bas de pensées, des aveux si murmurés, si interrompus, que l’oreille qui les percevait, demeurait hésitante, coulant à l’âme des langueurs avivées par le mystère de ce souffle plus deviné que senti. » Revenant sur la place qu’il lui avait accordée dans À rebours, il écrira en préfaçant la réédition de son roman en 1903 : l’« admiration […] que je professais pour Verlaine s’est même accrue » (voir supra, p. 455).
2 Troisième strophe du poème « Les Ingénues » : « Le soir tombait, un soir équivoque d’automne, / Les belles se pendant rêveuses à nos bras, / Dirent alors des mots si spécieux tout bas, / Que notre âme depuis ce temps tremble et s’étonne. » Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes, éd. Y.-G. Le Dantec, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1962, p. 110.
3 Sagesse, III, 9, « Le son du cor s’afflige… », v. 12-14, ibid., p. 282.
4 Sagesse, I, 10, « Non. Il fut gallican… », v. 2-4, ibid., p. 249.
5 Conviction déjà exprimée dans la lettre à Marcel Bartilliat du 3 septembre 1891 : « Je crois que les transpositions d’un art dans un autre sont possibles. […] Je crois que la plume peut lutter avec le pinceau et même donner mieux, et je crois aussi que ces tentatives ont élargi la littérature actuelle. » (Ms Lambert 45, fo 141).
P. 477
1 Huysmans aime à citer l’image empruntée aux épitres de saint Paul du « vieil homme » que le chrétien doit apprendre à dépouiller. Il y recourt dans Sainte Lydwine de Schiedam : « Au fond, rien n’est plus malaisé que tuer ce que saint Paul nomme “le vieil homme”. On l’engourdit, mais, la plupart du temps, il ne meurt pas. Un rien le sort de sa léthargie, et le réveille » (Œuvres complètes, Classiques Garnier, 2022, t. VII, chap. xii, p. 315), dans L’Oblat : « on ne tue pas le vieil homme, on l’engourdit à peine et, à la moindre occasion, ce qu’il s’éveille ! […] pour le commun des mortels, […] rien n’est plus difficile que de se muer en saint. » (supra, p. 210), et dans Les Foules de Lourdes : « Rien n’est plus difficile que de tuer son vieil homme » (éd. citée, p. 223).
2 Gaston Phébus (1331-1391). Huysmans, qui possédait le Livre de prières, par Gaston Phébus, comte de Foix [1385], publié par L. de La Brière, Paris, E. Kolb, 1893, résume ici l’analyse développée au chapitre xi de La Cathédrale. Durtal, qui possède cette édition, retourne le poète du xive siècle contre ses contemporains, « déplor[ant] qu’il fût si parfaitement inconnu des catholiques. Ils en étaient tous à remâcher le vieux foin déposé en tête ou en queue des journées du chrétien ou des eucologes, à laper des oraisons solennelles, issues de la lourde phraséologie du dix-septième siècle, des suppliques où l’on ne percevait aucun accent sincère, rien, ni un appel qui partît du cœur, ni un cri pieux ! » (Œuvres complètes, éd. Classiques Garnier, 2021, t. VI, p. 308).
8383 Huysmans cite le chapitre 12 de Mes prisons, éd. Jacques Borel, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. 346.
4 Ibid.
P. 478
1 Paris / Bruxelles, Société générale de librairie catholique, 1881.
2 René Doumic, le type même de l’universitaire normalien que détestait Huysmans, entrera à l’Académie française en 1909 et prendra la direction de la Revue des Deux Mondes en 1916. Auteur en 1895 des Décadents du christianisme, où il voyait dans l’auteur d’En route un « esprit biscornu » et dans sa « nostalgie du christianisme, […] le regret d’une possibilité de jouissance perdue », il avait publié une étude sur « Les Œuvres complètes de Paul Verlaine » (Vanier, 5 vol.) dans la livraison du 15 janvier 1901 de la Revue des Deux Mondes, aux p. 445 à 456. Refusant de voir dans son œuvre plus qu’une « plaisanterie énorme » et une « insolente mystification », il dénonçait dans le parallèle entre Verlaine et Villon une « rengaine […] qui a le défaut de ne rien signifier », accusait le poète de « s’install[er] paisiblement dans son abjection », de « l’étal[er] avec un cynisme tranquille et gai », d’avoir le cœur habité par « la vanité et la haine », bref d’être un « pornographe » qui a abusé les catholiques et « un « très mauvais écrivain ». À la lecture de cet article, Huysmans avait écrit à Descaves, le 4 mars 1901 : « Je viens de lire des fragments d’un fameux salaud doublé d’un imbécile sinistre un article sur Verlaine de Doumic. Quel [sic] gens que ces normaliens ! Celui-là reproche entre autres choses à Verlaine d’avoir été pauvre ! ! ! » (Ms Lambert 64, fo 283). – Gustave Kahn s’était également élevé contre cet éreintement aveugle dans Symbolistes et décadents (« Doumic contre Verlaine », Paris, Léon Vanier, 1902, p. 394-400), ainsi que Remy de Gourmont dans le Mercure de France du mois de juillet 1903 (Voir Olivier Bivort, Verlaine, coll. Mémoire de la critique, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1997).
3 La dipsomanie désigne l’impulsion morbide poussant à boire de grandes quantités d’alcool.
4 Citation extraite de Dégénérescence, Paris, Alcan, 1895, trad. A. Dietrich, t. I, p. 227-228. Huysmans règle simultanément un compte personnel avec Nordau, qui avait fait de Des Esseintes le parfait exemple du dégénéré et de son auteur « le type classique de l’hystérique » (ibid., t. II, p. 107 à 119). Sur cette question, on lira Per Buvik, « Fin de siècle et dégénérescence : Max Nordau lecteur de Huysmans », Huysmans à côté et au-delà, J.-P. Bertrand, S. Duran et F. Grauby éd., Peeters-Vrin, 2001, p. 105-120.
5 Citation tirée de la conclusion de Nordau : « Les mystiques, mais surtout les égotistes et les orduriers pseudo-réalistes, sont des ennemis de la société de la pire espèce. Celle-ci a le strict devoir de se défendre contre eux » et d’« écraser du pied la vermine anti-sociale. » (ibid., t. II, p. 560).
6 Évangile de saint Jean, viii, 7.
P. 479
1 La Bonne Souffrance avait paru chez Lemerre en 1898. Ami de Huysmans depuis le milieu des années 1870, François Coppée y racontait la « révolution morale » accomplie en lui à la suite de deux opérations chirurgicales périlleuses, dans l’espoir de « ramene[r] vers la Croix quelques âmes qui s’en étaient depuis longtemps éloignées » (préface, p. 18). Il avait soutenu Huysmans contre les membres du clergé qui dénonçaient dans La Cathédrale un livre injurieux pour la Vierge et la religion et préfacé d’un sonnet l’Esquisse biographique sur Don Bosco publiée par Huysmans en 1902.
2 Né en 1844, Verlaine avait trente ans lors de sa conversion, début mai 1874.
3 Lieu commun partagé par les proches et les admirateurs de Verlaine, Coppée en particulier dans les paroles prononcées sur sa tombe (« inclinons-nous sur le cercueil d’un enfant »). 839Dans sa lettre à Cazals du 29 février 1896, Huysmans évoquait déjà « tout cet affectueux côté d’enfant et de brave homme qui était en lui ». « On a trop dit […] que Verlaine fut un immortel enfant », dira Charles Morice au Banquet des Amis de Paul Verlaine pour le quinzième anniversaire de la mort du poète (Paris, Vanier, 1911, p. 15).
4 Double allusion à la séparation de corps demandée et obtenue le 24 avril 1874 par sa femme Mathilde, sur qui Verlaine avait exercé des violences répétées, et à sa condamnation, prononcée le 8 août et confirmée en appel le 27, à deux années de prison pour les coups de pistolet tirés sur Rimbaud, le 10 juillet 1873. Sa peine purgée, Verlaine avait été libéré le 16 janvier 1875.
5 Confessions, IIe partie, III, Paul Verlaine, Œuvres en prose complètes, éd. citée, p. 500.
6 À titre d’exemple, ce récit rapporté par Goncourt dans son Journal le 4 avril 1898. « Huysmans nous conte la mort de la mère de Verlaine. La mère et le fils demeuraient chez un marchand de vin : le fils au-dessous, les jambes malades et ne pouvant se lever de son lit, la mère au-dessus et gardée après sa mort par des amis de Verlaine ivres-morts. Et toutes les difficultés avec les amis et les croque-morts, soûls les uns comme les autres, pour faire passer la bière dans l’étroit escalier : descente pendant laquelle s’ouvre un instant la porte du fils, auquel on passe un goupillon pour jeter de l’eau bénite de son lit. » (éd. citée, t. II, p. 1236).
P. 480
1 Sans les nommer, Huysmans évoque les deux prostituées, Philomène Boudin et Eugénie Krantz, avec qui Verlaine partagea, de façon parfois conflictuelle, ses dernières années. Sans que l’on sache précisément pourquoi, Huysmans met l’abbé Mugnier en garde contre l’une d’elles, le 12 janvier 1897 : « Se défier absolument de la Krantz. / […] Ne vous mêlez pas de ses affaires qui ont toute chance d’être malpropres. C’est un dromadaire qui a des cals aux genoux, comme les hermites [sic] de la Thébaïde, mais pas pour les mêmes motifs. » (Copie conservée au Centre de recherche sur la littérature française du xixe siècle, UMR CELLF 16-21 de l’Université Paris-Sorbonne.) – Sur ces relations, on lira Alain Buisine, Verlaine. Histoire d’un corps, Paris, Tallandier, 1995, chap. xix, p. 432-448.
2 Huysmans est du nombre. Il écrit à Verlaine le 12 mars 1888 : « il me semble que dans ce colossal Empire du Panmuflisme où nous vivons, nous sommes quelques-uns d’égarés, croyant à l’art, et que nous devrions nous serrer un peu les coudes, car sans cela, nous ne sommes faits pour vivre avec personne. » (Ms Lambert 53, fo 104). Mais les efforts qu’il fait pour l’aider aboutissent si peu qu’il écrit à Prins, le 23 novembre : « Verlaine, il ne désaoule plus en compagnie de jeunes voyous si particulièrement ignobles que je l’ai lâché et ne veux plus m’occuper de lui. » (éd. citée, p. 148).
3 Être dans les brindes : être ivre.
P. 481
1 Huysmans citait déjà cette phrase de Pascal dans une lettre à Zola datée du 12 novembre 1885 : « Au fond, Pascal a raison, il faut rester dans sa chambre » (Lettres inédites à Émile Zola, éd. P. Lambert et P. Cogny, Genève-Lille, Droz-Giard, 1353, p. 116).
2 Paul Verlaine, Le Diable, Œuvres en prose complètes, éd. citée, p. 307.
P. 482
1 Sagesse, II, 2, « Je ne veux plus aimer… », v. 17-18 et 21-24, Œuvres poétiques complètes, éd. citée, p. 266. Huysmans a écarté les vers 19-20, en raison peut-être de leur tonalité politique : « Mère de France aussi, de qui nous attendons / Inébranlablement l’honneur de la patrie. »
8402 Amour, « Angélus de midi ». Huysmans cite le v. 17 et les v. 43-46 qui ferment le poème (ibid., p. 432).
3 L’ordre adopté par Huysmans pour présenter les dix noms réunis dans cette liste obéit à des critères multiples : générationnel, idéologique et générique. Chateaubriand dit avoir retrouvé la foi après avoir appris, par une lettre de sa sœur, la mort de leur mère alors qu’il était en exil en Angleterre. La section du livre XI des Mémoires d’outre-tombe intitulée « Mort de ma mère. – Retour à la religion. » précède celle qui présente le Génie du Christianisme. – Louis Veuillot (1813-1883), rédacteur en chef de L’Univers, quotidien traditionnaliste et ultramontain, s’est converti lors d’un séjour à Rome en 1838 ; il en a fait le récit dans Rome et Lorette (Paris, O. Fulgence, 1841) ; Huysmans a vanté son talent de polémiste dans À rebours
P. 483
1 Conviction développée depuis En route et rappelée dans la préface d’À rebours : « Je n’ai pas été élevé dans les écoles congréganistes, mais bien dans un lycée » (voir supra, p. 458).
2 Déjà énumérés dans le chapitre xii d’À rebours, les noms qui suivent sont ceux des catholiques monarchistes libéraux qui ont milité pour ouvrir la religion sur le monde ; opposants au Second Empire et à l’ultramontanisme de Veuillot, ils écrivaient dans Le Correspondant dans une optique plus politique que littéraire. – Avant de se convertir en 1824 et de devenir prêtre, Henri Lacordaire (1802-1861) a fait ses études au lycée de Dijon, puis a étudié le droit en vue de mener une carrière d’avocat. – Charles de Montalembert (1810-1870) a été élevé jusqu’en 1819 par son grand-père maternel en Angleterre ; rentré en France, il a poursuivi ses études à Paris, d’abord au lycée Bourbon (actuel lycée Condorcet), puis, à partir de 1826, à l’institution Sainte-Barbe. – Le comte Alfred de Falloux (1811-1886), qui fit voter en 1850 la loi favorable à l’enseignement des congrégations religieuses portant son nom, a fait ses classes au collège Bourbon, à Paris. – Le duc Albert de Broglie (1821-1920), autre figure du catholicisme libéral, est issu d’une lignée aristocratique.
3 Dans la génération de ses contemporains, Huysmans retient le nom de quatre militants catholiques, d’esprit fort différent. Ernest Hello (1828-1885), auteur de L’Homme, essai que Huysmans tient en haute estime, a étudié le droit à Rennes, puis à Paris au collège Sainte-Barbe et au lycée Louis-le-Grand. – François Coppée (1842-1908) a été, comme Huysmans lui-même, élève du lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel ; sa conversion, dont il a fait le récit dans La Bonne Souffrance (Paris, Lemerre, 1898) date de la fin des années 1890. – Édouard Drumont, auteur de La France juive et fondateur de La Libre Parole, a été élève des lycées Bonaparte et Charlemagne ; il s’est tourné vers l’Église au début des années 1880, sous l’influence du père Du Lac. – Ferdinand Brunetière, élève au lycée Thiers de Marseille, a rallié l’Église après une rencontre avec le pape Léon XIII ; il laissera un récit tardif de sa conversion dans Sur les chemins de la croyance (Paris, Perrin, 1905). – On notera sans surprise que Léon Bloy, qui aurait pu figurer sur cette liste, s’en trouve exclu.
4 Allusion au débat sur la fréquence de la communion soulevé dans Les Rêveries d’un croyant grincheux, infra, p. 509-510.
5 La réédition de la préface par les éditions Crès a restauré le genre masculin du mot bulbe.
6 L’hostilité tenace de Huysmans à la littérature de l’âge classique a pris avec la conversion une forme nouvelle, stylistique pour l’essentiel. La Cathédrale a rejeté les « oraisons solennelles, issues de la lourde phraséologie du xviie siècle, des suppliques où l’on ne percevait aucun accent sincère, rien, ni un appel qui partît du cœur, ni un cri pieux ! » (éd. citée, p. 309).
7 Cette thèse est en partie un plaidoyer pro domo. Dès le chapitre xii d’À rebours, Huysmans avait défini Barbey d’Aurevilly « ainsi qu’un étalon, parmi ces hongres qui peuplent les écuries ultramontaines ».
8418 Huysmans en est convaincu comme en témoignent les propos qu’il tient à l’abbé Mugnier. En 1904-1905, il affirme devant lui la consubstantialité de la perversion sexuelle et de la création artistique, dont il avait fait quinze ans plus tôt la théorie dans le préambule du « Rops » de Certains. Perplexe, l’abbé en prend note dans son Journal : « Huysmans de redire que l’art est le commencement du péché, que n’ont du talent que ceux qui ont beaucoup péché. / Huysmans a redit qu’il n’y a pas de talent sans péché, que pour avoir du talent il faut avoir couché avec des femmes. Il va même plus loin. Baiser, dit-il, une femme, dessus, ne suffit pas. Il faut du vice pour avoir du talent. Voilà une thèse curieuse. » (Journal de l’abbé Mugnier (1879-1939), Mercure de France, 1985, respectivement le 7 mars 1904 et le 19 mai 1905.) Dans le même esprit, Huysmans avait expliqué à l’abbé Broussolle, « l’impossibilité qu’il y a pour un prêtre, pour un homme qui n’a pas fait la noce de comprendre ce que renferment l’œil et la bouche d’une madone du Pérugin ou de Botticelli » (lettre du 24 novembre 1900, Ms Lambert 66, fo 12).
P. 484
1 Huysmans n’a jamais apprécié son œuvre, dont il écrivait dans La République des lettres du 14 janvier 1877 : « les imitations de Lamartine, poète que d’aucuns prisent fort, ont généralement pour résultat d’être mortellement ennuyeuses » (Œuvres complètes, éd. Classiques Garnier, 2017, t. I, p. 365).
2 Huysmans pourrait citer le nom du poète Le Cardonnel, novice à l’abbaye de Ligugé. Le 2 juin 1900, il écrivait à l’abbé Mugnier : « Quand le Père [Besse], qui est un vrai père, me donne pour un après-midi mon copain [Le Cardonnel], nous nous grisons de Verlaine et prenons une telle cuite de littérature que la vieille tentation nous fiche la paix pendant des mois. » (Ms Lambert 51, fo 54). Ou à Georges Landry, le surlendemain : « vous pensez la liesse de Le Cardonnel, s’emparant du Verlaine et se gargarisant, dans le jardin, de vers. » (Ms Lambert 58, fo 39).
3 Allusion à la querelle du « modernisme » liée à la publication de L’Évangile et l’Église, d’Alfred Loisy (Paris, A. Picard et fils, novembre 1902). L’ouvrage, qui entendait « déterminer historiquement l’essence de l’Évangile », avait été condamné le 17 janvier 1903 par le cardinal Richard, mais la soumission pour le moins réticente faite par son auteur, l’année suivante, dans Autour d’un petit livre (Picard, 1903), faute d’aller jusqu’à la « rétractation immédiate, sans aucune réserve » exigée par Rome, entraînera son excommunication en mars 1908. Huysmans s’était montré hésitant sur la meilleure façon d’enrayer l’influence de cette approche rationaliste des textes sacrés dans le clergé.
4 De Dante à Verlaine (études d’idéalistes et mystiques), Paris, Plon-Nourrit, 1897.
5 C’est le cas, par exemple, du poète Armand Praviel dans un article intitulé « Poètes d’aujourd’hui » publié dans L’Univers du 24 avril 1892. Après avoir encensé les bretons Brizeux et Le Mouël, il s’environnait de précautions pour réhabiliter l’œuvre catholique de Verlaine : « Pourquoi faut-il que la joie de goûter un plaisir d’art ne soit presque jamais sans mélange ? Pourquoi quelque tache dépare-t-elle toujours les plus nobles manifestations de l’intelligence ? La mythologie païenne avait inventé des êtres hybrides, figure humaine sur un corps de bête, dont elle peuplait la mer et les forêts. L’œuvre de Verlaine rappelle ces générations monstrueuses. »
6 Métaphore en désaccord avec l’imaginaire de Huysmans, hostile aux hygiénistes qui dégageaient les vieilles églises de leur milieu urbain sordide, dans En route par exemple : « Dire que d’ignares architectes et d’ineptes archéologues voudraient dégager Saint-Séverin de ses loques […] ! Mais elle a toujours vécu dans son lacis de rues noires ! elle est volontairement humble, en accord avec le misérable quartier qu’elle assiste […] ; aussi serait-ce le contre-sens le plus absolu que de la sortir de son milieu » (En route, éd. Crès, t. XIII, I, chap. ii, p. 56).