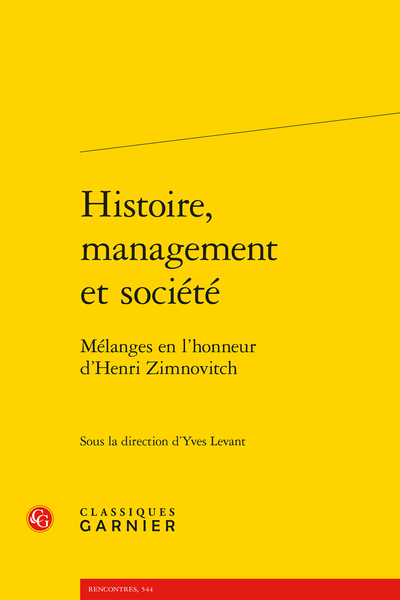
Préface
- Ouvrage labellisé par le collège de labellisation de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE)
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Histoire, management et société. Mélanges en l’honneur d'Henri Zimnovitch
- Auteur : Comte-Sponville (André)
- Résumé : Henri Zimnovitch, dès ses études à la Sorbonne vers le milieu des années 1980, a montré que son goût pour la philosophie tenait à quelque chose de plus profond, de plus grave, de plus douloureux peut-être que la simple curiosité intellectuelle. Il concilie toujours passion et rigueur, amour de la pensée et respect du réel, enfin liberté du chercheur et responsabilité du citoyen.
- Pages : 9 à 12
- Collection : Rencontres, n° 544
- Thème CLIL : 3341 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique -- Histoire de la pensée économique
- EAN : 9782406129899
- ISBN : 978-2-406-12989-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12989-9.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 31/08/2022
- Langue : Français
- Mots-clés : Gestion, entreprises, histoire, philosophie, science
Préface
J’ai connu Henri Zimnovitch à la Sorbonne, où j’enseignais, vers le milieu des années 1980. C’était un étudiant parmi d’autres, juste un peu plus vieux et plus attentif que la moyenne. On sentait que son goût pour la philosophie tenait à quelque chose de plus profond, de plus grave, de plus douloureux peut-être que la simple curiosité intellectuelle, pourtant vive chez lui, ou que les contraintes d’un cursus universitaire, fût-il suivi assidûment. Lorsqu’il m’apprit en aparté, à la fin d’un de mes cours, qu’il était chef d’entreprise, en l’occurrence dans le recyclage des textiles, cela ne me surprit qu’à moitié. Je viens d’apprendre, lisant le témoignage de Serge Sztarkman dans l’avant-propos de ce livre, qu’il y avait là comme un tropisme familial : que son grand-père, puis son père, juifs émigrés d’Europe centrale, avaient été « fripiers » ou, comme il dit de lui-même, « chiffonniers ». À l’époque, j’y vis plutôt un choix idéologique, d’autant plus estimable que les soucis environnementaux, dont j’imaginais qu’ils étaient à l’origine de cette orientation, n’avaient pas encore pris, dans la vie économique, la place qu’ils occupent aujourd’hui.
Je fus davantage étonné lorsque j’appris, quelques années plus tard, qu’il était devenu assez riche – ayant vendu ses entreprises – pour décider librement d’une éventuelle activité professionnelle, et qu’il choisissait… la recherche et l’enseignement, en l’occurrence dans la comptabilité, la finance, le management et autres sciences de la gestion ! Rétrospectivement, je me dis à présent que j’avais tort d’être surpris : c’était le même goût pour la pensée, et le même sérieux un peu triste, qu’il manifestait, quinze ans plus tôt, dans mes cours ou dans nos discussions. Ce que cela doit à l’histoire de sa famille ou à la sienne, à son tempérament ou à l’époque, ce n’est pas à moi de le dire. Mais j’admire comme il sut, sur des sujets si austères et si importants, concilier passion et rigueur, amour de la pensée et respect du réel, enfin la liberté du chercheur et la responsabilité du citoyen. Ce beau volume lui rend légitimement hommage, et j’ai plaisir à m’y associer.
10Sur les sciences de la gestion, dont j’ignore à peu près tout, je me garderai bien de me prononcer, sauf sur un point. Mon idée, parfois saluée ou critiquée dans les pages qui suivent, est qu’aucune science n’est morale ni immorale : parce que toutes ne se soucient que du possiblement vrai et du certainement faux, qui n’ont que faire du bien et du mal. J’en conclus que les sciences de la gestion, dans la mesure où elles méritent ce nom de sciences, ne sauraient tenir lieu de gestion, qui n’est pas une science mais un art, au sens où l’on en parle en médecine.
Quelle différence fais-je entre ces deux notions ? Celle-ci : une science, au sens où je prends le mot, exclut toute visée normative ou téléologique, dont un art, au contraire, ne peut se passer, puisque sa finalité interne (son but, sa visée) fait partie de son essence ou de sa définition. Les questions « Faut-il faire de la biologie ? », « À quoi sert la biologie ? » ou « La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? » ne relèvent pas de la biologie, laquelle, de fait, est incapable d’y répondre et même de les poser (ce qui n’empêche pas les biologistes de le faire, ou plutôt ce qui impose, mais d’un autre point de vue, qu’ils le fassent). On remarquera que les techniques, de ce point de vue, sont du côté des sciences (dont elles résultent de plus en plus : c’est ce qu’on appelle les technosciences) bien davantage que des arts. C’est qu’elles n’ont que faire, elles non plus, de quelque finalité que ce soit. Un marteau peut servir à briser un crâne aussi bien qu’à planter un clou. La physique n’est pas moins technoscientifique dans une bombe atomique que dans une centrale nucléaire, ni dans celle-ci que dans une éolienne. Ni la biologie, selon qu’elle sert à tuer ou à sauver. Un biologiste qui chercherait à fabriquer une arme bactériologique tendant à supprimer toute vie sur terre ne cesserait pas pour cela de faire de la biologie. Alors qu’un médecin, même compétent, qui se sert de son savoir médical pour conseiller des tortionnaires ou pour faire des expérimentations aux dépens de ses victimes, comme le sinistre Mengele, peut bien faire, à ce moment-là, de la biologie, mais assurément pas de la médecine ! Pourquoi ? Parce que la médecine est un art, qui inclut comme tel sa finalité (en l’occurrence la santé ou le bien-être du patient) dans sa définition, ce qu’une science ne saurait faire.
Si l’on m’autorise cette analogie, ou plutôt ce modèle théorique, je dirai volontiers que la gestion, comme art, a évidemment besoin des sciences qui l’étudient ou la renforcent (un peu comme la médecine a besoin de la biologie), mais ne saurait s’y réduire. Sa finalité (l’efficacité ? 11la rentabilité ? la pérennité ? la croissance ? l’utilité sociale ? la satisfaction des « parties prenantes » ?) est sans doute moins consensuelle ou plus diversifiée que celle de la médecine (tout le monde désire la santé, tout le monde ne désire pas la croissance), mais elle ne saurait pas davantage se déduire de la seule connaissance, ni donc de quelque science que ce soit. C’est où échoue le scientisme, qui n’est pas une science mais une idéologie et une illusion. De ce qui est, montre Hume, on ne saurait déduire ce qui doit être. Nul ne peut démontrer scientifiquement que la vie vaut mieux que la mort, ni la richesse mieux que la pauvreté. Simplement, les désirs, là-dessus, communément s’accordent. C’est le point décisif : il n’y a de but que pour et par un désir qui le vise. Mais comment l’atteindre sans connaître – si possible scientifiquement – les moyens qui le permettent ? C’est où sciences et techniques interviennent : pour proposer non des fins mais des moyens. Et où les arts (au sens où médecine et gestion en sont, qu’on ne confondra pas avec les beaux-arts) retrouvent leur nécessité propre : pour mettre ces moyens, que les sciences nous offrent, au service de certaines fins, qui sont les nôtres.
J’en tire une leçon importante, qui est que la gestion, comme la médecine, ne sera jamais trop scientifique, mais qu’il arrive, comme en médecine, qu’elle ne soit pas assez humaine ou humaniste (notamment quand on la réduit à une technique, ou quand on croit que la science pourrait suffire à son exercice). Je le dis souvent aux médecins, surtout hospitaliers : « Ne laissez pas aux “médecines douces” le monopole de la douceur ! » Je dis volontiers de même aux manageurs, comme aux chercheurs ou aux enseignants : « Ne comptez pas sur votre entreprise, ni sur le marché, ni sur les sciences de la gestion, pour être humanistes à votre place ! » C’est où les responsabilités respectives et des gestionnaires (qui pratiquent l’art de la gestion) et des enseignants-chercheurs (qui en transmettent ou en développent les sciences) s’enracinent sans se confondre (aucune théorie ne tient lieu de pratique, aucune pratique, de théorie) et s’articulent l’une à l’autre : dans l’incapacité du vrai à dire le bien, donc aussi à empêcher le pire. C’est une figure de ce que j’appelle le tragique, et j’aime qu’Henri Zimnovitch, dans les travaux si savants que nous lui devons, nous laisse, en tant qu’individus et fût-ce au sein des organisations, la responsabilité de l’affronter.
Où je retrouve quelque chose de la gravité que j’évoquais en commençant. Je l’ai dit souvent, là encore, aux chefs d’entreprise comme 12aux médecins : il n’y a pas de responsabilité heureuse, mais pas de bonheur humain sans responsabilité. Là-dessus, lisez l’Ecclésiaste : « En beaucoup de sagesse, beaucoup de tourments ; qui augmente son savoir augmente ses douleurs… » Ce qui n’empêche pas, précise le même auteur, que « la sagesse l’emporte sur la folie, comme le jour sur l’obscurité », comme la joie sur la tristesse ! Les sciences, même compliquées, sont toujours plus simples que nos existences, et valent toujours mieux (pour qui aime la vérité) que l’ignorance. Il reste que c’est l’action – donc aussi l’inaction – qui engage notre responsabilité. Méfiez-vous de la bonne conscience, plus encore que de la mauvaise !
André Comte-Sponville