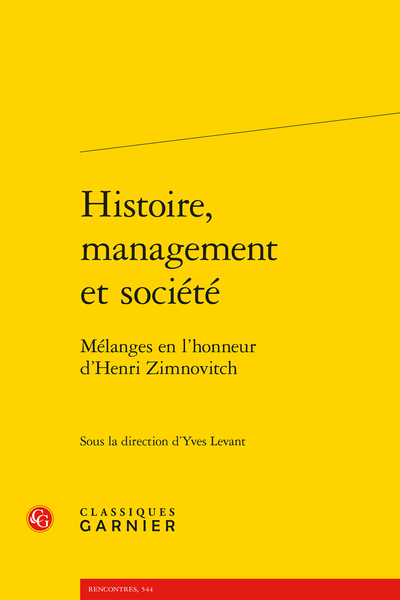
Avant-propos Le patron et le professeur
- Ouvrage labellisé par le collège de labellisation de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE)
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Histoire, management et société. Mélanges en l’honneur d'Henri Zimnovitch
- Auteur : Sztarkman (Serge)
- Résumé : Le respect qu’Henri Zimnovitch portait à son grand-père, juif émigré d’Europe centrale arrivé en France au tournant du xxe siècle, menant une activité de fripier, et à son père, son successeur dans cette entreprise, explique en bonne partie son choix de reprendre l’entreprise familiale et de suivre les études qui l’y ont préparé. Dans son activité académique, il a tiré profit de son expérience d’entrepreneur au sein d’une corporation connue pour son âpreté.
- Pages : 13 à 16
- Collection : Rencontres, n° 544
- Thème CLIL : 3341 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique -- Histoire de la pensée économique
- EAN : 9782406129899
- ISBN : 978-2-406-12989-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12989-9.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 31/08/2022
- Langue : Français
- Mots-clés : Gestion, entrepreneuriat, histoire, famille, expérience
Avant-propos
Le patron et le professeur
Le grand-père paternel d’Henri Zimnovitch1 a fait partie de cette génération de Juifs émigrés qui, fuyant les pogroms et la misère du Yiddishland, sont arrivés en France au tournant du xxe siècle. Pour gagner leur vie, ils parcouraient les rues de Paris, en tirant une charrette, et rachetaient des vieux vêtements qu’ils revendaient après les avoir rafraîchis ; une activité de fripier que la plupart devaient sans doute déjà occuper dans le shtetl d’où ils venaient2. Le respect qu’Henri portait à son grand-père et son père3 explique en bonne partie son choix de reprendre l’entreprise familiale et de suivre les études qui l’y ont préparé. Peu de temps après qu’il ait obtenu ses diplômes, son père, qui avait spécialisé l’entreprise dans le chiffon d’essuyage, lui laissa la direction de la société. Il la développa pendant quinze ans, notamment avec de nouvelles fabrications, sur de nouveaux marchés, ce qui lui permit de se retirer à moins de 40 ans des affaires, une fois qu’il eût vendu ses différentes activités à des repreneurs qui ont continué après lui à les faire prospérer.
Une partie de ces activités ont concerné la récupération textile et c’est par ce que j’ai perçu de l’apport d’Henri à cette corporation que je peux témoigner. Au début des années 1970, quand il commença à s’intéresser au métier, il était encore étudiant et il a participé au renouveau de la profession. Après la Seconde Guerre mondiale, les petits métiers, comme celui du chiffonnier traditionnel, avaient disparu. Il 14était plus intéressant d’acheter les chiffons à l’étranger, essentiellement aux États-Unis. Début 1970, le niveau de consommation en France ayant bien progressé et les questions écologiques émergeant, la question de collecter des vêtements usagés pour leur recyclage de façon industrielle fut posée à la profession, notamment au niveau syndical par mes prédécesseurs à la tête de la Fédération de la récupération, Claude Beaumont, et de son département textile, Jean-Claude Badel. Henri a fait partie de cette équipe qui a créé en 1976 la société Recollect, dont il fut administrateur jusqu’en 1990, qui réussit à collecter en France, tant au profit des entreprises que des associations caritatives qui étaient associées aux opérations, 20 000 tonnes/an4. Dans cette aventure collective, l’apport d’Henri se manifesta dans le souci de l’organisation de l’entreprise, le suivi des finances, la réflexion sur son développement. Sur ce dernier point, je veux relever son inclination à procéder à des études : ce fut, entre autres, une enquête Sofres sur « La motivation et les freins chez les Français à l’acte de donner leurs vêtements » ; une étude Cegos pour que la profession adopte une méthode de calcul des coûts par section homogènes, etc. Je dois dire que tous ses confrères et moi-même n’avons pas été toujours convaincus de la pertinence de ces dépenses.
Par contre, lorsque je me suis associé à Henri pour fonder la Compagnie française de recyclage textile, en 1983, je m’en suis remis en toute sécurité à lui pour les aspects administratifs, juridiques, comptables, ce qui m’a permis d’assurer la présidence de l’entreprise en me focalisant sur les questions liées à la production et au commercial. J’ai également apprécié ses conseils en matière de stratégie, même si je n’ai pas été toujours d’accord avec ses analyses, que je trouvais souvent excessivement pessimistes et laissant trop de part au rationnel, au point de décourager la nécessaire prise de risque.
Malgré les réussites qu’il a connues dans ses entreprises, je ne crois pas qu’Henri ait été pleinement heureux dans son métier d’alors ; aussi, lorsqu’il m’a informé de son désir de prendre de nouvelles orientations professionnelles, je n’ai pas cherché à l’en dissuader, et je l’ai même accompagné pour lui faciliter ce changement.
15Je suis sûr que, dans son activité académique, il a tiré profit de son expérience d’entrepreneur au sein d’une corporation connue pour son âpreté. Je peux dire aussi que celle-ci s’enorgueillit qu’un de ses membres soit devenu Professeur des universités.
Serge Sztarkman
Fondateur de la société Hersand
Ancien président
de la filière textiles de Federec
Bibliographie
Compagnon, Antoine, Les Chiffonniers de Paris, Paris, Gallimard, 2017.
1 Dans la profession, on disait Zimno.
2 Antoine Compagnon dit : « Le chiffonnier et le fripier sont deux personnages distincts. C’est le fripier que la tradition associe depuis le Moyen Âge a la judéité […]. Après la grande époque du chiffonnage [au xixe siècle], le xxe siècle a confondu le chiffonnier et le fripier. » (Compagnon, p. 296.)
3 Il faut dire qu’en plus de leur parcours professionnel, ils connurent les épreuves des guerres mondiales pour lesquelles ils furent décorés (Légion d’honneur, médaille des évadés…).
4 La collecte se faisait alors par sacs plastiques. Aujourd’hui, c’est essentiellement par conteneurs que se font les opérations, et les quantités ont décuplé, notamment grâce à l’écotaxe pour la récupération des textiles mise en place en 2006 et l’action du Relais.