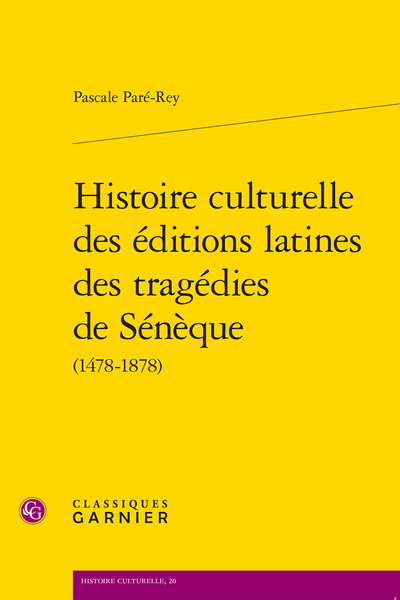
Introduction Présentation des principales éditions des tragédies de Sénèque parues entre 1478 et 1878
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Histoire culturelle des éditions latines des tragédies de Sénèque (1478-1878)
- Pages : 41 à 43
- Collection : Histoire culturelle, n° 20
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406142553
- ISBN : 978-2-406-14255-3
- ISSN : 2430-8250
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14255-3.p.0041
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/02/2023
- Langue : Français
Introduction
Présentation des principales éditions des tragédies
de Sénèque parues entre 1478 et 1878
Cette première partie du travail présente le corpus dans son ensemble, la manière dont il a été constitué et ses principales caractéristiques (premier chapitre).
Vient ensuite un catalogue raisonné des éditions retenues, qui les présente dans un ordre chronologique, et s’organise en trois chapitres, couvrant toute la période. Comme mentionné dans l’introduction générale (voir la section « Organisation de l’étude »), un chapitre ne recouvre pas un siècle, ce qui aurait morcelé la présentation et n’aurait pas rendu compte des articulations et césures que nous avons repérées. Mais la composition adoptée permet d’aboutir à des ensembles cohérents et comparables.
Le deuxième chapitre rassemble les premières éditions de la fin du xve et du tout début du xvie s., proches dans le temps, dans l’espace, et pour les problématiques. Huit éditions paraissent en moins de quarante ans, en Italie et en France. Ce sont des incunables et post-incunables qui cherchent à établir le texte correctement, à l’expliquer et à le commenter, en essayant de définir ces poèmes d’un nouveau genre récemment redécouverts. Ces éditions consacrent l’éclosion des paratextes où sont développés les thèmes de l’identité de l’auteur, de l’histoire de la tragédie, de sa composition, de sa forme métrique. On voit également les premiers arguments et les premières planches illustrées venir guider la découverte des pièces.
Le troisième chapitre comprend le reste des éditions du xvie s. et du début du xviie s., période faste pour les tragédies sénéquiennes. Huit éditions paraissent en un siècle (de 1517 à 1613), au cœur de l’Europe (Venise et Londres) et en Europe du Nord (Leipzig, Heidelberg, Anvers, Leyde)1. 42On distinguera dans ce corpus l’édition de l’imprimeur J. Commelin qui en est aussi l’éditeur scientifique, des éditions de grands humanistes comme Fabricius, Delrio, Fr. Rapheleng et J. Lipse. À partir de cette période, les éditeurs scientifiques commencent à reproduire certaines parties d’ouvrage de leurs prédécesseurs mais éditent aussi à nouveaux frais de copieux commentaires : ils s’attachent à l’interprétation et à la théorisation.
Le quatrième chapitre réunit toutes les éditions restantes, du xviie s. au xixe s. pour un total de treize éditions2. Elles paraissent également plutôt en Europe du Nord, à Leyde pour trois d’entre elles (Schrijver, Thys, Gronov), à Leipzig pour trois également (Bothe, Baden, Peiper-Richter), à Delphes (Schröder), à Berlin (Leo), à Deux Ponts (Fabricius-Ernesti), et à Paris pour quatre d’entre elles (de Marolles, Levée, Pierrot, Greslou). Mais la production n’est pas linéaire : alors que paraissent trois éditions au milieu du xviie s., il faut attendre soixante-dix ans environ pour que la suivante arrive, au début du xviiie s. Voient ainsi le jour cinq éditions Variorum (Schrijver, Thys, Gronov, Schröder, Pierrot) et les premières traductions (de Marolles, puis Levée et Greslou). L’heure est donc aux grosses sommes et à des éditions dont les paratextes enflent considérablement, avec beaucoup de pièces honorifiques, d’outils de consultation et de lecture, mais aussi des textes critiques abordant les problèmes de tradition manuscrite, de poétique, de valeur littéraire et philosophique des tragédies. Parmi les éditions allemandes, figurent celles de grands philologues comme Fabricius et Ernesti – qui ouvrent une nouvelle ère de la critique avec leur édition bipontine –, comme Bothe, Baden, Peiper et Richter, Leo. Cette époque voit le retour des travaux d’établissement du texte avec des méthodes de collation des manuscrits et des éditions systématiques, et ouvre la voie aux éditions critiques modernes, avec les premiers apparats (dans les deux dernières éditions du corpus, de Peiper-Richter et de Leo). On voit se dessiner une dichotomie entre les approches littéraires et les approches philologiques, les premières visant, par leurs dissertations générales et leurs traductions, un public de lecteurs élargi (par exemple des scolaires, des gens de théâtre), tandis que les secondes sont plutôt destinées à l’étude du texte 43sous des angles de vue techniques (codicologique, critique, métrique, stylistique). S’ouvre également le débat, avec la dernière édition de Leo, de la lecture des tragédies comme des morceaux déclamatoires destinés à la recitatio et non au pulpitum, débat qui occupera tout le xxe s.
1 Voir E. Rombauts « Sénèque et le théâtre flamand » dans (Jacquot et al., 1964, p. 211-219).
2 Nous justifierons le choix de ce groupement, qui peut paraître trop large dans le temps, par le fait qu’elles appartiennent toutes au troisième et dernier groupe d’édition que nous avons repéré : « Des éditions en réseau. Des familles d’édition » p. 72-75.