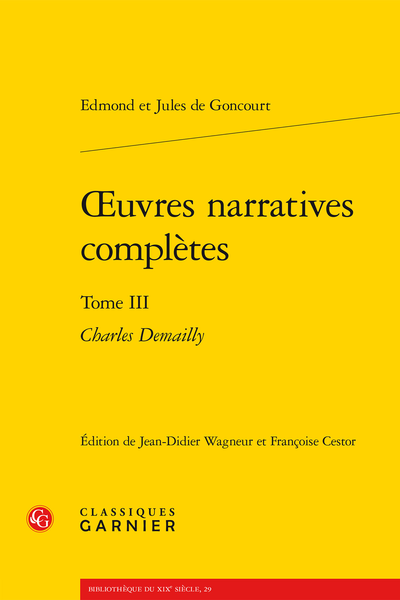
Préface de la première édition
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres narratives complètes. Tome III. Charles Demailly
- Pages : 107 à 107
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 29
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782812420689
- ISBN : 978-2-8124-2068-9
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2068-9.p.0107
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/10/2014
- Langue : Français
PRÉFACE
de la première édition
… Je dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu dire, et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire, et que je ne dis point1.
La Bruyère
1 Cette phrase-préface est extraite du discours de réception de La Bruyère à l’Académie française, prononcé le 15 juin 1693. L’auteur s’y explique quant aux listes de noms qui circulaient dans Paris, révélant des clés des Caractères : « Il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint de ceux qui par hasard verroient leurs noms écrits dans ces insolentes listes, que je désavoue et que je condamne autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette justice, que sans s’arrêter à un auteur moral qui n’a eu nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu dire ; et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire, et que je ne dis point [cnqs]. Je nomme nettement les personnes que je veux nommer, toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite ; j’écris leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les voie de loin, et que le lecteur ne coure pas risque de les manquer. Si j’avois voulu mettre des noms véritables aux peintures moins obligeantes, je me serois épargné le travail d’emprunter les noms de l’ancienne histoire, d’employer des lettres initiales, qui n’ont qu’une signification vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter des applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la composition des Caractères » (« Discours prononcé dans l’Académie françoise le lundi quinzième juin 1693 », Œuvres de La Bruyère, Paris, Hachette, 1865, t. 2, p. 450-451). Dans Les Caractères, La Bruyère s’en était pris au Mercure galant, et l’œuvre du moraliste fut en retour d’autant plus critiquée par cette publication que l’écrivain dans son Discours à l’Académie avait aussi avoué sa préférence pour Racine contre Corneille et de la sorte blessé Thomas Corneille, l’un des directeurs du Mercure. Cette phrase pointe la pusillanimité des directeurs de théâtre auxquels la pièce avait été proposée, mais elle veut aussi désamorcer les méprises que peut entraîner le genre du roman à clés : les deux frères ont toujours à l’esprit leur procès pour l’article « Voyage du 43 de la rue Saint-Georges au no 1 de la rue Laffitte » paru dans le Paris du 15 décembre 1852. La Bruyère fait partie des auteurs que les Goncourt invoquent souvent. Ainsi dans le Journal, cette notation contemporaine de la rédaction des Hommes de lettres : « Les livres à portée de ma main, le rayon dont je vis, là, près de mon lit, ce rayon fait par le hasard, je le regarde, ce clavier de ma pensée, quelque chose comme ma palette : Eschyle, Henri Heine, un mauvais petit dictionnaire français de poche, Angola, un Excerpta de Cicéron, une Histoire des singes, Aristophane, Horace, Pétrone, Le Bric à Brac de Grille, Rabelais, Courier, la Revue parisienne de Balzac, Tristram Shandy, La Bruyère, Bonaventure des Périers, Anacréon » (II, 13 novembre 1858, p. 185). Ils notent encore le 16 novembre 1862 : « Un homme qui ne regarde pas La Bruyère comme le premier écrivain de tous les temps n’écrira jamais » (Journal, III, 16 novembre 1862, p. 421) ; dans Charles Demailly il est question de « la langue de diamant de La Bruyère » (p. 284) et dans En 18…, Charles évoque une rare édition de « La Bruyère de Michallet, 1687 » (p. 96). Voir aussi Jacques Landrin, « Les Goncourt et La Bruyère », dans l’Hommage à Jean-Pierre Collinet, Dijon, Éditions universitaires dijonnaises, 1992, p. 193-202, Jeremy Wallace, « Les Goncourt, La Bruyère et l’art du portrait », Cahiers Edmond & Jules de Goncourt no 6, 1999, p. 74-94, et Françoise Gevrey, « La Bruyère moraliste : un modèle pour les Goncourt », id., no 15, 2008, p. 25-40.