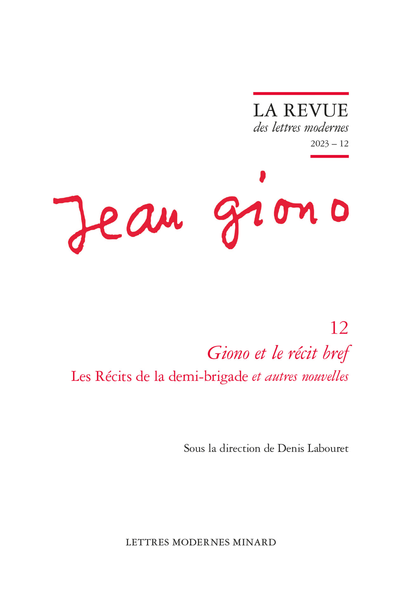
Foreword
- Publication type: Journal article
- Journal: Giono et le récit bref
2023 – 12. Les Récits de la demi-brigade et autres nouvelles - Author: Labouret (Denis)
- Abstract: Giono considered the short story not his type. He was hardly recognized as a great novelist by his readers, despite the early success of Solitude de la pitié and the narrative virtuosity shown in his two posthumous collections, in particular Les Récits de la demi-brigade. It is time to take seriously the Gionian art of the short story to try to identify its main characteristics.
- Pages: 13 to 17
- Journal: Journal of Modern Literature
- Series: Jean Giono, n° 12
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406159582
- ISBN: 978-2-406-15958-2
- ISSN: 0035-2136
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15958-2.p.0013
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-27-2023
- Periodicity: Monthly
- Language: French
- Keyword: short story, literary genre, poetics, reception, narration
AVANT-PROPOS
Giono prétendait ne pas être doué pour le récit bref. Il déclarait à son biographe Pierre Citron, en 1969 : « Je n’ai jamais été très à mon aise dans la nouvelle. […] Ça a toujours été très pénible pour moi d’écrire un petit texte ; c’est pour moi plus difficile à écrire qu’un texte long1. » S’il écrit malgré tout des nouvelles, il ne prend guère le temps de les assembler en volumes. L’Eau vive n’est pas à proprement parler un recueil de nouvelles mais un ensemble composite où de longs fragments d’un roman inachevé (« Promenade de la mort et départ de l’oiseau bagué le 4 septembre 1939 » et « Description de Marseille le 16 octobre 1939 ») côtoient des poèmes en prose (comme « Apporte, Babeau » ou « Les Larmes de Byblis »). L’on y trouve bien des textes qui ressemblent à des nouvelles, « Vie de Mlle Amandine » ou « La Ville des hirondelles » par exemple, mais leur format et leur statut sont loin d’être représentatifs du genre. Sans doute pensait-il rassembler pour une publication les récits qui formeront Faust au village, comme ceux qui aboutiront aux Récits de la demi-brigade, mais les deux recueils ne verront le jour qu’après sa mort, respectivement en 1977 et 1972.
Giono n’a donc guère cultivé une image de « nouvelliste ». Et il n’a pas davantage été reconnu comme tel, malgré la virtuosité narrative dont témoignent ces deux recueils posthumes, malgré la notoriété dont jouit aujourd’hui L’Homme qui plantait des arbres, malgré la poignante « poétique de la pitié » qui est à l’œuvre dans son premier recueil, Solitude de la pitié, et qui a pourtant touché aussi bien Robert Ricatte que Sylvie Germain, à quelque quarante ans d’intervalle, par son art même de la brièveté2. Le jugement de l’auteur sur lui-même a donc 14longtemps été confirmé par l’opinion des lecteurs, dans le grand public comme dans la critique savante, à de rares exceptions près. Giono est d’abord un romancier, c’est une chose entendue. Dans l’édition de la Pléiade, ses nouvelles sont dispersées au sein des « œuvres romanesques complètes », comme de petits romans perdus parmi les grands. Des ouvrages de référence ont été consacrés au Chant du monde, à Un roi sans divertissement, aux Âmes fortes, au Hussard sur le toit, ou aux Grands Chemins – et c’est légitime. Des livraisons précédentes de la Série Jean Giono de LaRevue des lettres modernes ont traité de Naissance de l’Odyssée, de Jean le Bleu, de Que ma joie demeure, de Noé – et c’était nécessaire. Mais il n’y a rien eu d’équivalent jusqu’ici pour les recueils Solitude de la pitié, Faust au village ou Les Récits de la demi-brigade, ni pour le genre de la nouvelle considéré comme tel, en dépit des perspectives ouvertes dès 1975 par l’étude fondatrice de Roland Bourneuf, « Pour une poétique de la nouvelle chez Jean Giono3 », la première à considérer comme majeur ce genre que l’on dit mineur.
La présente livraison entend contribuer à combler cette lacune. Elle est centrée sur le recueil Les Récits de la demi-brigade, et plus largement sur les nouvelles d’après-guerre. Les textes des années vingt et trente ne sont pas ignorés pour autant : dans l’étude qu’il propose ici, David Perrin ne s’intéresse pas seulement aux deux grands recueils posthumes mais aussi à L’Esclave, un « conte » écrit en 1925, et à « Prélude de Pan », texte de 1929 qui sera intégré au recueil Solitude de la pitié en 1932 ; le diable de Faust au village a des précédents, et la forme de la nouvelle favorise un fantastique4 qui n’a pas attendu le temps des Chroniques romanesques pour se manifester. Sylvie Vignes montre de son côté toute la richesse d’un récit aussi resserré que « La Ville des hirondelles », nouvelle autobiographique de 1936 publiée dans L’Eau vive. Mais l’usage que fait Giono du genre de la nouvelle est peut-être plus exemplaire après 1945, quand l’auteur cherche à reprendre pied dans le monde littéraire grâce à des récits brefs 15publiés en revue. La contribution d’Annabelle Marion explique ainsi comment le choix d’une forme donnée peut correspondre à une stratégie de l’auteur dans le champ littéraire : quand Giono cherche à passer pour un conteur et non plus pour un prophète, rien de tel que des nouvelles pour donner l’impression de simplement « raconter des histoires » en s’adressant presque directement à ses lecteurs via des publications faciles d’accès. Voilà pourquoi la prise en compte du lecteur – et surtout de la lectrice pour des textes qui furent souvent publiés dans des magazines féminins – est essentielle. C’est à cette figure du lecteur inscrite dans le texte qu’est consacré l’article d’Agnès Landes : le narrateur des Récits de la demi brigade ne raconte pas dans le vide ; il postule un destinataire, dont toutes sortes d’indices permettent d’identifier les contours. La brièveté narrative a donc ses vertus propres, que n’a pas le roman.
Est-il bien légitime toutefois de parler de « nouvelles » ? La catégorie du « récit bref », proposée comme titre de ce dossier, est volontairement moins précise, plus souple, peut-être plus fidèle à l’esprit d’un auteur qui n’employait guère lui-même le mot « nouvelle ». À propos de Faust au village ou des Récits de la demi-brigade, Giono parlait plutôt de « contes » : c’est cette étiquette générique qui a sa préférence. Et c’est l’appellation « récit » qu’il conservera pour les aventures de Martial sous la monarchie de Juillet. Gallimard a suivi l’exemple en publiant en recueil, en 1973, Le Déserteur et autres récits. Giono parle aussi d’« églogues », non sans ironie, pour définir les récits de Faust au village5. Et il fait peut-être du « caractère » un genre littéraire, à la suite de La Bruyère, quand il écrit dans les années soixante Ennemonde et autres caractères et Cœurs, passions, caractères.
Comment d’ailleurs établir une frontière, s’agissant d’Ennemonde, ou du Déserteur, ou du « Poète de la famille », entre longue nouvelle et court roman ?… La nouvelle est un genre poreux : elle emprunte elle-même au roman – au point que Les Récits de la demi-brigade confrontent un des principaux personnages des Chroniques romanesques (Martial, alias Langlois) aux Théus du Cycle du Hussard. Dans « Le Bal », Giono s’amuse ainsi à faire danser Langlois avec « la petite marquise », qui valse si bien (Brig., 42)… Dans sa contribution au présent volume, Jean-Yves Laurichesse s’interroge sur cette insertion dans une série de nouvelles d’un narrateur, Martial, qui apparaît donc d’abord comme un personnage de roman.
16En outre, on peut se demander si les romans n’intègrent pas eux-mêmes toutes sortes de récits brefs qui pourraient souvent être lus comme autant de nouvelles autonomes : que l’on songe à Jean le Bleu (d’où a pu être extraite l’histoire de « la femme du boulanger »), à Noé (l’histoire d’Empereur Jules, celle de Melchior et Rachel…) ou au prologue polyphonique des Âmes fortes où voix et histoires se succèdent comme dans un recueil de Maupassant… Mais la clôture propre à la nouvelle, son « unité d’impression » et sa « totalité d’effet » (comme le disait Baudelaire à la suite de Poe) nourrissent une spécificité qui la distingue du roman – par la concentration de l’intrigue, par un usage particulier des silences du récit6, par un travail formel qui s’apparente à l’« exercice de style » (Brig., 16)7.
On est donc en droit de parler des nouvelles de Giono, même s’il employait peu le mot lui-même. Mais c’est pour reconnaître qu’il en fait éclater les frontières. Loin de se limiter à des récits de fiction, il écrit des nouvelles autobiographiques (« Ivan Ivanovitch Kossiakoff », « Son dernier visage », « La Ville des hirondelles »…). Loin de se borner à des textes narratifs, il écrit des nouvelles presque entièrement descriptives (Présentation de Pan, « Rondeur des jours », « Automne en Trièves »…). Loin de se contenter de raconter des histoires, il expose des idées comme dans des essais ou des chroniques de presse (« Le Chant du monde » dans Solitude de la pitié, « Aux sources mêmes de l’espérance » dans L’Eau vive). Sur ce vaste éventail typologique, on se reportera à la très éclairante notice « Nouvelle » du Dictionnaire Giono8.
L’ordre suivi dans ce dossier procédera par élargissements successifs : d’abord, utilement introduite par un préambule théorique sur les caractéristiques du genre, l’étude d’une seule nouvelle, « La Ville des hirondelles », mais qui est un tel « condensé de “poéthique” gionienne » 17(Sylvie Vignes) qu’elle mérite bien plus qu’un détour. Ensuite deux articles qui prennent pour objet les seuls Récits de la demi-brigade, d’une part sous l’angle de la relation à l’« invisible » et omniprésent lecteur (Agnès Landes), d’autre part du point de vue du « personnage de roman » (Jean-Yves Laurichesse). Enfin une vision plus ample de l’ensemble que forment les deux recueils posthumes, sans « dieu ni diable » (David Perrin), et du contexte de publication des nouvelles d’après-guerre, en un temps de « reconquête » par Giono d’une position d’écrivain reconnu (Annabelle Marion).
Ces approches sont inévitablement partielles, et ne pourront répondre à toutes les questions que pose la nouvelle gionienne. Puissent-elles simplement ouvrir à la recherche des pistes nouvelles sur ce sujet, et, surtout, être en mesure de convaincre que Giono est assurément, aussi, un grand auteur de « petits textes ».
La communauté des amis, lectrices et lecteurs de Giono a eu à déplorer deux grandes pertes ces dernières années : celle d’Alan J. Clayton en 2020, celle de Jacques Mény en 2022. Ce dernier, dont on connaît le rôle immense, a fait l’objet de beaux hommages auxquels nous nous unissons au sein de l’Association des Amis de Jean Giono, qu’il a longtemps dirigée, et dans les pages de la Revue Giono qu’il avait contribué à créer. Il nous revenait de faire mémoire ici même de la personne d’Alan J. Clayton, le fondateur de cette Série Jean Giono de La Revue des lettres modernes, pour rappeler la part essentielle qu’il a prise à l’élan initial des études gioniennes.
La dernière section de ce volume, enfin, laisse toute sa place à un Carnet critique dont l’importance est à la mesure des nombreuses publications qu’a suscitées le cinquantième anniversaire de la mort de Jean Giono, en 2020. Cet ensemble de recensions témoigne de la vitalité d’une recherche dont Alan J. Clayton et Jacques Mény, à qui elle doit tant à des titres divers, pourraient certainement continuer d’être fiers.
Denis Labouret
1 Cité par Pierre Citron, « Notice » de Solitude de la pitié, I, 1039.
2 Robert Ricatte écrivait dès 1978 à propos de ces nouvelles : « [P]lus le récit est concis, plus la pitié s’y montre dans ce qu’elle a d’irréductible » (« Jean Giono : récit court et poétique de la pitié », Revue des sciences humaines, no 169, 1978, p. 53). Et Sylvie Germain, beaucoup plus près de nous, voit dans la nouvelle-titre qui ouvre le recueil, « si dense dans sa brièveté », un « art de l’ellipse » qui met en valeur « toute la pudeur de la bonté » (« L’amitié au fond du puits », in Emmanuelle Lambert (dir.), Giono, catalogue de l’exposition du Mucem, Paris & Marseille, Gallimard & Mucem, 2019, p. 62 et 66.
3 Roland Bourneuf, « Pour une poétique de la nouvelle chez Jean Giono », Saggi e ricerche di letteratura francese, vol. xiv, nuova serie, Pisa & Roma, 1975, p. 411-452.
4 Ou du moins l’expression condensée d’une tentation : la nouvelle Une aventure ou la Foudre et le Sommet (1954) peut aussi être lue, à cet égard, comme une réécriture de L’Esclave (ou La Daimone au side-car, d’après le premier titre auquel pensait Giono).
5 Voir la « Notice » de Faust au village par Robert Ricatte dans la Pléiade (V, 949), et la contribution de David Perrin infra.
6 Voir Denis Labouret, Giono au-delà du roman, chap. 21 : « Silences de la nouvelle », Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, « Lettres françaises », 2016. Les spécialistes de la nouvelle s’entendent sur cette caractéristique du genre, qui ne pouvait que séduire Giono : « Délimitée dans le temps de la lecture, la nouvelle conjure les contraintes de la brièveté par des ouvertures sur l’au-delà du récit. L’art de raconter se double d’une volonté de demeurer dans l’implicite, de faire comprendre plus qu’on ne dit. » (Daniel Grojnowski, Lire la nouvelle [1993], Paris, Nathan, « Lettres Sup. », 2000, p. 150).
7 Voir l’article que Jacques Chabot a consacré aux Récits de la demi-brigade : « Exercices de style et ouvrages de dames », Bull.52 (1999), 46-93. Le même Bulletin, par les études qu’il rassemble, constitue une référence sur ce recueil : on lira aussi avec grand profit les articles de Marie-Anne Arnaud Toulouse (« Des choses et des hommes », p. 22-45) et d’Agnès Landes (« Martial, le libre jeu de l’honneur », p. 94-111).
8 Sylvie Vignes, « Nouvelle » (DG, 658-659).